Biographies
Cyprien Tanguay, père de la généalogie québécoise
![]() Par
ouimet-raymond
Le 02/06/2023
Par
ouimet-raymond
Le 02/06/2023
La généalogie est aujourd’hui un passe-temps extrêmement populaire partout en occident. Au Canada français, elle est pratiquée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le Québec, à l’instar de l’Islande, est l’endroit le mieux équipé au monde en matière d’instruments de recherches généalogiques. Et cela, nous le devons en grande partie à Cyprien Tanguay.
Fils de Pierre Tanguay et de Reine Barthel, Cyprien Tanguay naît à Québec, à deux pas du Séminaire, le 15 septembre 1819 ; il est le troisième d’une famille de quatre enfants (trois garçons et une fille). Sa mère est issue d’une famille originaire d’Allemagne, plus précisément de Hesse-Cassel. Il a pour parrain un célèbre patriote, le curé Étienne Chartier, qui est curé de Saint-Benoît (Mirabel) au moment de la rébellion des Patriotes en 1837. Après des études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au Séminaire et au Grand Séminaire de Québec, il devient professeur de rhétorique en 1840 et 1841 dans son alma mater avant d’être ordonné prêtre le 14 mai 1843.
D’abord desservant à Sainte-Luce et à Trois-Pistoles, il est nommé vicaire à Rimouski à la fin de 1843 où exerce le célèbre abbé Charles Chiniquy, apôtre de la tempérance qui sera par la suite excommunié et deviendra pasteur presbytérien. En 1846, Tanguay devient curé de Saint-Raymond-de-Portneuf où il s’occupe en priorité de l’instruction primaire en suscitant la création d’une commission scolaire dont il devient le secrétaire. Il travaille à l’amélioration de la voirie, puis se fait nommer maître de poste, ce qui lui permet d’organiser un service postal régulier entre Saint-Raymond et d’autres localités, dont Québec. Il cumule aussi la fonction de curé de la nouvelle paroisse de Saint-Basile avant d’être déplacé et nommé curé de Rimouski. À cet endroit, il procède à la construction d’une nouvelle église. En 1859, Cyprien Tanguay est nommé curé de Saint-Michel-de-Bellechasse. Mais son administration y suscite de la grogne ce qui fait qu’il demande une nouvelle affectation. Ce sera Sainte-Hénédine-de-Dorchester, à 40 kilomètres au sud de Lévis.
Il entreprend de dépouiller des registres des baptêmes, mariages et sépultures (BMS) de paroisses dès 1846. En effet, le curé avait accès aux registres des BMS du Québec qui sont probablement les mieux conservés au monde. En mars 1865, le sous-ministre de l’Agriculture du Canada-Uni, Jean-Charles Taché, lui écrivait : …ayant été informé du fait que des études et des travaux entrepris par vous, depuis plusieurs années, vous ont acquis des connaissances toutes spéciales sur les statistiques des premiers temps de l’établissement du pays, et ayant l’intention de constituer la statistique canadienne à dater de cette époque…
L’œuvre de Tanguay
Taché n’était pas seulement sous-ministre de l’Agriculture, mais aussi des Statistiques. Parle-t-il de Tanguay à son ministre ? Sans doute, car Thomas d’Arcy McGee, député de Montréal et ministre en titre de l’Agriculture, de l’Immigration et de la Statistique lui offre un poste. En effet, Taché a besoin d’aide pour accomplir sa tâche. Quoi qu'il en soit, le curé demande d’être relevé de sa cure. Comme son statut d’ecclésiastique lui interdit d’occuper un poste de fonctionnaire, il est « attaché au Département des statistiques [!] » avec un traitement confortable de mille dollars par année. C’est ainsi que Tanguay vient s’installer à Ottawa et se met à fréquenter les routes du Québec pour dresser un énorme fichier sur les familles du Québec. Ce fichier comprend pas moins de 122 623 fiches familiales qui contiennent 1 226 230 actes de baptêmes, mariages et sépultures. Cette compilation impressionnante constituera la matière du grand œuvre de Cyprien Tanguay, le Dictionnaire généalogique des familles canadiennes dont le premier volume – il en aura sept pour un total d’environ quatre mille pages - est publié en 1871.
Pour bâtir cette généalogie des familles canadiennes, Tanguay a systématiquement dépouillé les registres paroissiaux du pays, voire même de toute l’Amérique française. De longs voyages sur le continent européen lui ont aussi permis d’explorer minutieusement les dépôts d’archives stratégiques, comme le Dépôt des archives de la Marine à Paris, des fonds en Belgique, en Prusse et dans d’autres États allemands, ainsi qu’en Italie.
Le célèbre généalogiste québécois René Jetté a dit : Son œuvre maintenant centenaire demeure aussi estimable que monumentale, tant par l’ampleur de l’information, patiemment recueillie dans des conditions d’accès, d’éclairage et de transport héroïques, que par l’élan indiscutable et toujours soutenu qu’elle a donné aux enquêtes généalogiques au Québec.
Enfin, je souligne que nommé prélat romain en 1887, Cyprien Tanguay a pris sa retraite en 1893 et est mort à Ottawa le 28 avril 1902. Bien qu’il habitait à Ottawa, au 90, de la rue Guigues – la maison est toujours en place –, il a été inhumé dans la chapelle du Séminaire de Québec.
Le Dictionnaire généalogique des familles canadiennes peut être consulté en ligne (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/dicoGenealogie/).
SOURCES
BAnQ, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos jours / | BAnQ numérique.
Dictionnaire biographique du Canada en ligne; érudit.org.
GAGNON, Jacques, Père de la généalogie québécoise et canadienne, Montréal, LIDEC, 2005 ; Wikipédia.
Eugène Décosse, l'homme orchestre
![]() Par
ouimet-raymond
Le 18/05/2023
Par
ouimet-raymond
Le 18/05/2023
Il y a à Gatineau, près du boulevard Mont-Bleu, une rue appelée Décosse. Cette rue rappelle le souvenir d’Eugène Décosse, un grand sportif de la région qui a même revêtu le chandail de la sainte Flanelle.
Eugène Décosse a été un grand sportif de la région. Né au 57, rue Wellington à Hull le 9 décembre 1900, du mariage d’Aristide Décosse avec Corinne Barrette, Eugène est un fanatique du sport, et plus particulièrement du hockey ; c’est un gardien de but de grand talent. Il joue pour les Canadiens de Hull, puis pour le Ottawa Royal Canadiens et l’Ottawa New Edinburghs. Au cours de la saison 1918-1919, il remporte six victoires en huit parties, dont cinq par blanchissage ! Il gagne, au cours des années suivantes, deux titres First All-Star et un titre Second All-Star.
En novembre 1924, le Canadien de Montréal invite Décosse à son « camp d’entraînement ». Il obtient un contrat comme agent libre et se rend à Toronto pour l’inauguration de la saison 1924-1925. Le Canadien remporte la victoire au compte de 7 à 1 contre le St. Pat’s. Le gardien en titre du Canadien, Georges Vézina, a été si bon que Décosse a réchauffé le banc toute la partie. Peu après cette partie, le Hullois a été renvoyé à Hull.
A-t-il été déçu de la façon dont il avait été traité par le grand club ? Sans doute. Quoi qu’il en soit, il revient dans la région en compagnie de deux autres joueurs de la sainte Flanelle : René Lafleur et René Joliat, ce dernier frère du fameux ailier gauche du Canadien, Aurèle Joliat, et du futur chef de police d’Ottawa, Émile Joliat.
Eugène Décosse reprend alors sa carrière de hockeyeur dans les rangs amateurs et joue pendant deux saisons pour le Ottawa New Edinburgh’s pour prendre sa retraite définitive à l’âge de 26 ans.
Du sport à la politique
De retour à Hull, Décosse a besoin de mettre  du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.
du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.
Membre de l’Association athlétique du Hull-Volant dès 1933, il met sur pied, en 1936, une fameuse équipe de hockey senior, soit celle du Hull-Volant dont il est l’instructeur. Il conduit cette équipe à la finale de l’est de la fameuse coupe Allan après avoir vaincu les équipes de Cornwall, Smith Falls, Moncton et les As de Québec. Malheureusement, l’équipe baissera pavillon devant les puissants Tigres de Sudbury qui alignent plusieurs futures vedettes de la Ligue nationale de hockey.
En 1938, il construit le stade Décosse, rue Laurier (près de l’ancien monastère des Servantes de Jésus-Marie), où s’affronteront des équipes de baseball, des lutteurs, des boxeurs, pendant plusieurs années. C’est alors le lieu le plus achalandé de Hull.
Le sport continue à jouer un grand rôle dans la vie de Décosse. Il préside les destinées de la Ligue de baseball interprovincial et la Ligue de la cité de Hull, il est aussi directeur de l’équipe nationale de baseball à Ottawa et… gérant de l’Auditorium d’Ottawa ! Véritable homme-orchestre. il se lance en politique municipale en 1941 et est élu à deux reprises conseiller du quartier Laurier. En 1945, il décide de se présenter à la mairie de Hull contre le populaire Raymond Brunet qui a mis fin au P’tit Chicago. Alertés par les bien-pensants qui craignaient cet homme non conformiste qui pourfendait le bon chef de police Adrien Robert, le clergé et la presse unissent leurs efforts pour lui barrer la route. Décosse est défait par un peu plus de mille voix. Mais comme il est un valeureux soldat de l’Union nationale qui a remporté le scrutin provincial de 1944, le voici nommé « chef de la police provinciale pour le district de Hull » ! Sa femme dira plus tard : « Eugène ne savait pas se servir de son revolver et je pense même qu’il avait un peu peur de cette arme. »
Eugène travaille 16 à 18 heures par jour. Et malgré ses positions politiques, il ne rechigne pas à venir en aide à des gens d’un camp autre que le sien. En 1953, son journal, L’Opinion publique cesse ses opérations. Peu de temps après cette fermeture, Eugène Décosse subit un infarctus et, le 2 janvier 1955, il meurt d’un arrêt cardiaque.
Sources
http://wwweyesontheprize.blogspot.com/2007_04_01_archive.html
Le Régional (Hull) 26 mars 1985.
La Revue,(Gatineau) 26 mars 1985.
TROTTIER, Jean-Claude, Le Petit Hull-Volant (1932-2007), Gatineau, 2009.
Théotime Bonhomme : un entrepreneur... entreprenant !
![]() Par
ouimet-raymond
Le 24/03/2023
Par
ouimet-raymond
Le 24/03/2023
La Petite-Nation regorge de personnages plus grands que nature depuis les tout débuts de sa colonisation. Pensons aux Denis-Benjamin Papineau, premier ministre conjoint du Canada-Uni en 1846-1848, à Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes et le meilleur tribun de l’histoire du Québec, à Henri Bourassa, politicien exceptionnel et fondateur du journal Le Devoir, à Julie Bruneau, fondatrice d’un comité de femmes patriotes, etc.
À ces personnages bien connus, il faut ajouter Théotime Bonhomme. Né à l’île Perrot le 27 avril 1858, celui-ci épouse Coralie Tessier le 17 février 1879, à l'église Saint-Jacques-le-Majeur, à Montréal. La mariée n’a que 17 ans alors que Théotime en a 21. Trois ans plus tard, la famille Bonhomme s’établit dans la Petite-Nation, plus précisément à Papineauville. Théotime commence par fabriquer des meubles. Ses qualités d’organisation et son dynamisme sont rapidement remarqués par ses concitoyens qui l’élisent chef de la compagnie des pompiers volontaires de Papineauville le 3 février 1888. À ce titre, il sera appelé à superviser la construction de la première station de feu de la municipalité.
Homme on ne peut plus énergique,  Bonhomme devient vite un remarquable homme d’affaires. Dix ans après son arrivée en Petite-Nation, il se lance dans le commerce du bois de sciage et, en 1896, il fait de sa petite entreprise la Compagnie industrielle de Papineauville avec comme associé Henri Bourassa et trois autres Papineauvillois. La compagnie remportera un vif succès et Bonhomme en assurera la présidence jusqu’à sa mort. Dès 1935, alors que la plupart des concessions forestières étaient accordées aux papetières de la région, l’entreprise commence à orienter ses activités sur la vente de bois d’œuvre scié et de matériaux de construction – un précurseur des activités de l’entreprise d’aujourd’hui connue sous le nom de Bonhomme Pro à Gatineau et celui de Bytown Pro en Ontario.
Bonhomme devient vite un remarquable homme d’affaires. Dix ans après son arrivée en Petite-Nation, il se lance dans le commerce du bois de sciage et, en 1896, il fait de sa petite entreprise la Compagnie industrielle de Papineauville avec comme associé Henri Bourassa et trois autres Papineauvillois. La compagnie remportera un vif succès et Bonhomme en assurera la présidence jusqu’à sa mort. Dès 1935, alors que la plupart des concessions forestières étaient accordées aux papetières de la région, l’entreprise commence à orienter ses activités sur la vente de bois d’œuvre scié et de matériaux de construction – un précurseur des activités de l’entreprise d’aujourd’hui connue sous le nom de Bonhomme Pro à Gatineau et celui de Bytown Pro en Ontario.
Un industriel qui a à cœur sa région
L’industriel de Papineauville ne fait pas que des affaires. En effet, la politique l’intéresse et il n'hésite pas à appuyer Henri Bourassa à qui il voue une amitié indéfectible. Toujours est-il que Bonhomme brigue les suffrages de ses concitoyens qui l’élisent à la mairie de la paroisse de Sainte-Angélique de Papineauville de 1893 à 1897[1]. Théotime est alors solidement ancré à Papineauville. Aussi achète-t-il un terrain de son ami Bourassa et s’y fait construire une maison que l’on peut admirer au 179, rue Henri-Bourassa. L’homme est heureux en affaires, mais a le malheur de perdre son épouse qui décède le 20 décembre 1902 sans doute usée par 21 grossesses.
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul », dit l’Éternel[2]. Et Théotime est bien d’accord avec la bible. Aussi, le 14 juillet 1903, il épouse Hermine Provencher. Puis il acquiert, en 1907, la minoterie (moulin à farine) de Papineauville qui était l’ancien moulin banal des Papineau et vend la farine sous le nom de Five Stars à Montréal et à Ottawa. Il fonde aussi une crèmerie qui deviendra la plus importante du Québec et d’autres entreprises comme la Villeray Lumber.
 Théotime Bonhomme s’intéresse vivement au développement de l’Outaouais et il est celui qui électrifiera la municipalité de Maniwaki et qui y installera un réseau téléphonique. En effet, en 1904, il fonde la Compagnie électrique de Maniwaki, qui exploitera un barrage sur la rivière au Corbeau, et dont il se départira en faveur de la Gatineau Power en 1927, année où il fonde la Blanche River Power Company. Il construit alors un barrage et une usine d’alimentation électrique près du lac McGregor. Cette entreprise passera elle aussi aux mains de la tentaculaire Gatineau Power.
Théotime Bonhomme s’intéresse vivement au développement de l’Outaouais et il est celui qui électrifiera la municipalité de Maniwaki et qui y installera un réseau téléphonique. En effet, en 1904, il fonde la Compagnie électrique de Maniwaki, qui exploitera un barrage sur la rivière au Corbeau, et dont il se départira en faveur de la Gatineau Power en 1927, année où il fonde la Blanche River Power Company. Il construit alors un barrage et une usine d’alimentation électrique près du lac McGregor. Cette entreprise passera elle aussi aux mains de la tentaculaire Gatineau Power.
Ami intime d’Henri Bourassa, l’industriel de Papineauville participe à la fondation du journal Le Devoir en 1910 et continue à s’intéresser à la politique : il est maire de Papineauville de 1925 à 1928. Il meurt à Papineauville le 3 avril 1939 et de nombreux journaux parlent de lui d’une façon élogieuse. Quant à sa seconde épouse, elle trouvera la mort le 11 février 1944 à l’âge de 88 ans.
Illustrations :
- Théotime Bonhomme.
- Le 179, Henri-Bourassa. Google Maps.
Sources :
BONHOMME, Claude, communications à l’auteur le 21 et 27 février 2023.
Calendrier 2015 : 125 ans de la brigade des pompiers, municipalité de Papineauville.
LEBLANC, Claire, Le moulin seigneurial de Papineau, Généalogie Petite-Nation, bulletin de septembre 2019.
Le Devoir (Montréal), 3 avril 1939.
Le Droit (Ottawa), 3 avril 1939.
Alexandre Taché : un bleu chez les rouges
![]() Par
ouimet-raymond
Le 17/02/2023
Par
ouimet-raymond
Le 17/02/2023
On a longtemps cru qu’il fallait être membre du Parti libéral pour devenir député du comté de Hull à l’Assemblée législative du Québec, puis à l’Assemblée nationale. On a même dit que le Parti libéral pouvait faire élire un poteau s’il était peint en rouge. Cela est exagéré, mais il est vrai que pendant 41 années consécutives (1981-2022) les Libéraux ont détenu la circonscription. Toutefois, 4 députés du comté ont été élus comme membre du Parti conservateur, de l’Union nationale, du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec. L’un de ses personnages a été Alexandre Taché député pendant 11 ans.
Alexandre Taché a vu le jour à Saint-Hyacinthe, le 17 août 1899. Il était le fils de Joseph de La Broquerie Taché et de Marie-Louise Langevin. Son père (1858-1932), notaire de profession, s’est signalé davantage dans le monde du journalisme comme directeur propriétaire du Courrier de Saint-Hyacinthe de 1902 à 1914 ; puis à Ottawa comme imprimeur du Roi, de 1914 à 1920, et conservateur de la Bibliothèque du Parlement, de 1920 à 1932. Il avait aussi, comme plusieurs membres de sa famille avant lui, milité dans les rangs du Parti conservateur dont il avait en vain porté les couleurs dans deux élections fédérales à Saint-Hyacinthe en 1904.
Alexandre Taché a fait ses études au séminaire de Saint-Hyacinthe, à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Montréal. Le 21 janvier 1924, il était admis au Barreau de la province de Québec, puis a été fait conseiller en loi du roi en 1938. Huit ans plus tard, il était fait docteur honoris causa de l'Université d'Ottawa. Il a exercé la profession d'avocat à Hull jusqu'en 1956. Entre-temps, il a aussi été nommé bâtonnier du Barreau de Hull en 1939 et en 1944.
Alexandre Taché a épousé, le 26 octobre 1925, Berthe Laflamme, fille mineure d’Édouard-Hector, agent d’assurances, et de Delvina Berthiaume, dont il aura trois enfants : à Hull, dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce.
Si le ciel est bleu, l'enfer est…
En 1936, il se lance en politique et se fait élire comme député de l'Union nationale dans le comté de Hull[1] après avoir remporté la victoire contre le libéral Alexis Caron. Avait-il bénéficié d’un effet de chaire du haut de laquelle plus d’un prêtre a enseigné à ses paroissiens : « N’oubliez pas que si le ciel est bleu, l’enfer est rouge » ? Quoi qu’il en soit, il sera défait trois ans plus tard par le même Caron dont le Parti libéral décevra les Hullois tant et si bien qu’ils rééliront Taché en 1944, 1948 et 1952.
Nommé orateur (président) de l'Assemblée législative du Québec, il occupe cette fonction du 7 février 1945 au 15 décembre 1955, date de sa démission à la fois comme orateur et député. Selon le regretté Cartier Migneault, ancien libraire et membre de l’Union nationale, Alexandre Taché aurait un jour donné tort à son chef, Maurice Duplessis, qui pour se débarrasser de son député de Hull l’a alors nommé juge. Poursuivant sa vengeance, le « cheuf » serait allé jusqu’à empêché le fils de Taché, Pierre, à devenir candidat de l’Union nationale aux élections de 1956, lui préférant Roland Saint-Onge qui sera défait par 157 voix par le libéral Oswald Parent dans un scrutin qui entaché d’irrégularités. C’est ainsi que l’Union nationale a perdu le comté de Hull à tout jamais
 Comme député, Alexandre Taché, s'est plus particulièrement intéressé à la reconstruction et au développement des institutions régionales : écoles, prison de Hull – on lui doit hôpital du Sacré-Cœur de la rue Gamelin –, orphelinat Sainte-Thérése ; et à l'essor touristique de la Gatineau, par l'amélioration du réseau routier ; à l'encouragement des troupes théâtrales et littéraires de Hull et des talents artistiques locaux. S’il a été un fervent adepte du bridge et des échecs, il s’est aussi intéressé à la philatélie et à l'histoire
Comme député, Alexandre Taché, s'est plus particulièrement intéressé à la reconstruction et au développement des institutions régionales : écoles, prison de Hull – on lui doit hôpital du Sacré-Cœur de la rue Gamelin –, orphelinat Sainte-Thérése ; et à l'essor touristique de la Gatineau, par l'amélioration du réseau routier ; à l'encouragement des troupes théâtrales et littéraires de Hull et des talents artistiques locaux. S’il a été un fervent adepte du bridge et des échecs, il s’est aussi intéressé à la philatélie et à l'histoire
Juge à la Cour de magistrat des districts de Hull, Terrebonne et Pontiac en 1956, il est ensuite promu juge à la Cour supérieure en 1958. Il est alors reconnu pour sa loyauté, sa ténacité, sa perspicacité, sa tolérance et son entregent,
Alexandre Taché est décédé subitement d'une thrombose coronarienne à Hull, le 9 mars 1961 et a été inhumé dans le cimetière Notre-Dame de Hull ; il avait 61 ans et 6 mois. Il aura laissé le souvenir d’un homme plein d’humour et de principes.
Sources :
BAnQ.
Le Droit (Ottawa) juin 1956.
MIGNEAULT, Cartier, conversations avec l’auteur, janvier 1997.
Musée canadien de l’Histoire, site Internet consulté le 9 février 2023.
TACHÉ, Alexandre, o.m.i., Biographie de l’honorable Alexandre Taché (1899 – 1961) Député de Hull Orateur de l’Assemblée législative (1945 – 1955), UQO, janvier 1997
[1] À cette époque, Pointe-Gatineau faisait partie du comté de Hull.
Les trois femmes d'Éraste d'Odet d'Orsonnens
![]() Par
ouimet-raymond
Le 22/01/2023
Par
ouimet-raymond
Le 22/01/2023
À Gatineau, dans le quartier Mont-Bleu, se trouve une rue d’Orsonnens, en l’honneur de l’ancien maire d’Odet d’Orsonnens. Les prénoms de ce personnage étaient Jean Éraste Protais. Évidemment, avec de tels prénoms, il ne pouvait pas être un homme ordinaire.
D’Odet d’Orsonnens naît à Saint-Roch-l’Achigan le 12 avril 1836 du mariage du mercenaire d’origine suisse, Protais d’Odet d’Orsonnens avec Louise Sophie Rocher. Le capitaine d’Odet d’Orsonnens était arrivé au Canada en 1811 avec le régiment des Meurons qui a servi au pays jusqu’en 1816. Quand le régiment a quitté le Canada, Protais d’Odet d’Orsonnens avait atteint le grade de lieutenant-colonel. Il s’établit alors à Saint-Roch-l’Achigan.
Contrairement à son père, Jean Éraste Protais n’a pas la moindre inclination pour la carrière militaire. Il fait des études au collège de l’Assomption et au collège des Jésuites, à Montréal où il opte pour le notariat ; il est reçu notaire à 22 ans.
À 17 ans, il a déjà acquis une belle réputation d’écrivain au Québec et, en 1856, il publie deux nouvelles : L’épluchette de blé d’Inde et Une résurrection. Avec le futur premier ministre de la province, Olivier Chauveau, d’Odet d’Orsonnens est l’un des écrivains qui a le plus de succès au Québec. En 1860, il publie Le parricide Luron et Felluna.
D’Odet d’Orsonnens s’établit à Hull en 1873 et il y exerce le notariat pendant 17 ans avant de se tourner vers le commerce. Dès 1875, il y fonde un cercle littéraire avec Alfred Rochon et l’avocat Charles Marcil. La même année, il est élu président de la Société Saint-Jean-Baptiste locale.
D’Odet d’Orsonnens est un touche-à-tout. En 1877, il se lance en politique et se fait élire échevin, poste qu’il conserve pendant 11 ans. En 1889, il devient même maire de Hull. Puis, à partir de 1879, il siège pendant 15 ans à la Commission scolaire dont il sera président pendant pas moins de 7 ans.
En 1892, fortune faite, il devient prêteur et l’un des plus grands propriétaires terriens de Hull. D’Odet d’Orsonnens a le temps d’avoir des loisirs… créatifs. Il fait des recherches sur le mouvement perpétuel et, en 1899, il publie, chez Bureau & frères à Ottawa, 2 opuscules : Le moteur centripète et Le moteur centrifuge. Il se penche aussi sur l’étude de la dynamite.
Mais qui était la femme derrière cet homme exceptionnel ? Il y en avait plus d’une : outre sa mère, elles étaient trois !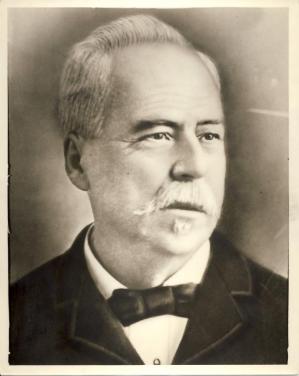
Revenons en arrière : Jean Éraste Protais d’Odet d’Orsonnens a 22 ans. Le célibat et sans l’inactivité sexuelle lui pèsent quand il fait la rencontre d’une gentille petite anglaise : Mary Ann Smith. Mais pour jouir des faveurs de la jeune personne d’âge mineure, il lui faut la marier, ce qui se fait en grand secret, le 1er novembre 1858, à Montréal, en présence de la seule mère de la jeune fille, parce que le nouveau notaire ne veut pas déplaire à sa mère qui lui fournit ses moyens de subsistance. Moins de trois mois après le mariage, la jeune fille et sa mère s’enfuient aux États-Unis pour des raisons qui restent inconnues.
Les flammes de l’enfer
Il ne semble pas que la fuite Mary Ann Smith ait importuné plus qu’il ne faut d’Odet d’Orsonnens qui fait la rencontre d’une autre jeune fille mineure, enfant d’un boulanger. Son nom : Tharsile Amyot. Les deux jeunes gens se plaisent tant et si bien qu’ils convolent en injustes noces le 20 septembre 1860 en l’église Notre-Dame à Montréal. Pendant ce temps-là, Mary Ann Smith vit toujours… à Boston aux Massachusetts. Voilà qu’un jour de 1867 ou de 1868, on ne sait pas trop, notre d’Odet d’Orsonnens avoue, en confession, son premier mariage et l’existence de Mary Ann Smith. Le prêtre lui ordonne alors de se séparer de sa femme sous peine des flammes de l’enfer !
Voilà donc d’Odet d’Orsonnens obligé d’avouer à sa douce (croyait-il) Tharsile, sa bigamie. La voilà en furie qui exige l’annulation de son mariage. C’est alors que Mary Ann Smith a la bonne idée de passer de vie à trépas le 25 mars 1869. Heureuse coïncidence se dit sans doute notre petit tabellion qui se remet à faire la cour à Tharsille. Mais la jeune dame a du caractère et repousse sèchement celui qui aurait dû être son mari. Elle exige toujours l’annulation officielle du mariage. D’ailleurs, les avocats sont tous d’accord là-dessus : le premier mariage étant valide, le deuxième ne peut l’être.
Un mariage secret
Pendant des années, Jean Éraste Protais d’Odet d’Orsonnens essaie de convaincre Tharsile de son amour, sans succès. Il la menace même de recourir à la loi pour lui faire entendre raison. Pas plus de succès. « Il n’est pas bon que l’homme reste seul », dit la Bible et d’Odet d’Orsonnens est bien d’accord avec cette sentence. Dès son arrivée à Hull, qui n’est sans doute pas étrangère à sa situation matrimoniale, d’Odet d’Orsonnens confie son problème au père Charpeney, oblat de Marie-Immaculée, qui réfère l’affaire à Mgr Guigues, évêque d’Ottawa. Celui-ci déclare : « Comme pour faire déclarer nul ce mariage il aurait des formalités sans nombre à remplir […] les parties devraient se donner l'une à l'autre un papier signé par lequel elles s'engageraient à ne pas s'inquiéter l'une l'autre, que Mr D'Orsonnens pourrait se marier avec une autre personne, mais qu'on ne mettrait pas l'acte de mariage dans les registres... » Il prend soin d’ajouter qu’il serait sans doute mieux de marier le couple en Ontario, là où le Québec n’a pas autorité !
Tharsile ne signe pas le papier et d’Orsonnens estime que personne ne peut le condamner au célibat, ce à quoi acquiesce le père Charpeney qui marie le notaire à Marie-Louise Fiset le 8 novembre 1874 sans en porter mention au registre.
L’affaire n’est pas finie. Par l’entremise de ses avocats, Tharsile Amyot demande comment on a pu marier d’Odet d’Orsonnens ? A-t-elle du chagrin ? Toujours est-il, qu’au point de vue de la loi, Jean Éraste Protais et Tharsile sont mari et femme. Les Oblats aimeraient que l’affaire ne fasse pas de bruit et n’hésitent pas à dire que s’il fallait annuler le deuxième mariage de d’Orsonnens, l’évêque pourrait y voir « sans faire du bruit pour rien ».
Quoi qu’il en soit, d’Odet d’Orsonnens a, une nouvelle fois, deux femmes en même temps. Et à Montréal, le cas finit par faire tant de bruit que les tribunaux s’en emparent. Enfin, le 20 septembre 1875, le juge Johnson déclare le mariage d’Orsonnens-Amyot nul au grand déplaisir du père de Tharsile.
En 1900, d’Odet d’Orsonnens perd une cinquantaine de maisons dans le Grand feu. Deux ans plus tard, il a la douleur de perdre son épouse qu’il suivra dans la tombe en 1906 après une vie plus que bien remplie.
Sources :
Archives de la Ville de Gatineau H12-01-0667, Archives des OMI, Montréal ; Boutet, Edgar, Éraste d’Odet d’Orsonnens, notaire, dans Asticou, cahier no 34, juillet 1986, pages 4-6 ; BANQM ; Latrémouille, Denise, D’or et d’azur, de sueur et de labeur, Hull, 2000.
Aimé Guertin : un député à la défense de la classe ouvrière
![]() Par
ouimet-raymond
Le 29/11/2022
Par
ouimet-raymond
Le 29/11/2022
Il y a dans notre histoire des députés qui sont passés presque inaperçus tant ils ont été silencieux, et d’autres qui, malgré la brièveté de leurs mandats, ont marqué l’histoire. C’est le cas d’Aimé Guertin. Sixième d’une famille qui comptera douze enfants, il naît à Aylmer le 7 juin 1898 du mariage de Timothée Guertin, commerçant, et de Lina Bélanger. Aimé quitte l’école en sixième année pour aller travailler comme chasseur à l’hôtel Victoria d’Aylmer. Puis il occupe divers emplois jusqu’au jour où il entre au Canadian Pacific Railway (CPR), en 1916, où il acquiert une formation en télégraphie.
Parfaitement bilingue, Aimé Guertin compense son manque de diplômes par une constante autodidaxie. Sa curiosité naturelle et sa discipline en feront plus tard un orateur de grand talent. Fier francophone, Guertin n’a pas froid aux yeux et participe à la lutte contre l’inique Règlement 17 qui restreint les droits de francophones en Ontario. Promu commis principal à Pembroke, Ontario, il y est accusé de sédition pour s’être porté à la défense de la langue française. C’est sans doute pour cette raison que le CPR le mute, ce qui l’amène à remplacer des agents de la compagnie dans diverses localités canadiennes de son réseau ferroviaire. Fatigué de ces voyages incessants, il démissionne en 1921 de son poste d’agent voyageur et devient simple commis à la gare de Hull-Ouest, rue Montcalm à Hull. Puis il épouse Aline Tremblay ; le couple aura douze enfants.
Une soif de justice
Selon l’historien Pierre-Louis Lapointe, Aimé Guertin a soif de justice pour les siens et intervient en faveur du français chaque fois que l’occasion se présente : « Il prend parti contre les orangistes et tous ceux qui méprisent les Canadiens français, tant à Aylmer qu’ailleurs au Québec. » En 1925, il lance son entreprise de courtage en en assurances et deux ans plus tard, il est élu député du comté de Hull pour le  Parti conservateur du Québec. Dès lors, il intervient avec force pour appuyer le combat des francophones du Pontiac pour le droit l’obtention du droit d’enseigner le français à leurs enfants. L’historien Lapointe a écrit : « Rarement aura-t-on vu un député de l’Outaouais occuper autant de place sur l’échiquier politique québécois. » Guertin est alors une étoile montante à Québec et le chef du parti, Arthur Sauvé le nomme whip des conservateurs dès 1928. Le député de Hull se fait le défenseur de l’ouvrier et l’instigateur de l’adoption de mesures sociales avant-gardistes tels le salaire minimum, la pension de vieillesse, les allocations familiales, la journée de travail de huit heures, etc. Et il n’hésite pas à pourfendre le capitalisme sauvage. Maurice Duplessis le traite de bolcheviste.
Parti conservateur du Québec. Dès lors, il intervient avec force pour appuyer le combat des francophones du Pontiac pour le droit l’obtention du droit d’enseigner le français à leurs enfants. L’historien Lapointe a écrit : « Rarement aura-t-on vu un député de l’Outaouais occuper autant de place sur l’échiquier politique québécois. » Guertin est alors une étoile montante à Québec et le chef du parti, Arthur Sauvé le nomme whip des conservateurs dès 1928. Le député de Hull se fait le défenseur de l’ouvrier et l’instigateur de l’adoption de mesures sociales avant-gardistes tels le salaire minimum, la pension de vieillesse, les allocations familiales, la journée de travail de huit heures, etc. Et il n’hésite pas à pourfendre le capitalisme sauvage. Maurice Duplessis le traite de bolcheviste.
Un discours de huit heures
Aimé Guertin est un homme combatif et les 1er et 2 avril 1931 il prononce un discours fleuve de huit heures dans le but d’obtenir des précisions sur les dépenses effectuées par le ministère de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries. Dans une lettre datant du 11 septembre 1933, Guertin manifeste clairement son refus d’appuyer le nouveau chef du Parti conservateur qui est nul autre que Maurice Duplessis. Cette décision ne l’empêche nullement de lutter pour la justice. Aussi, n’hésite-t-il pas à prononcer des allocutions bien senties en faveur des travailleurs de la forêt du Témiscamingue et de l’Abitibi contre la compagnie James MacLaren et contribue ainsi à l’adoption d’une réglementation qui rappelle à l’ordre les compagnies forestières, à l’augmentation des salaires et à l’amélioration des conditions de travail des forestiers. Guertin ne néglige pas son comté et il obtient l’Orphelinat Ville-Joie-Sainte-Thérèse ainsi que le Sanatorium Saint-Laurent, hôpital pour tuberculeux.
Guertin est devenu l’adversaire de son cheuf, Duplessis, et préfère alors quitter la politique provinciale en 1935. L’Outaouais vient de perdre un député exceptionnel. Il tente sa chance au fédéral sous la bannière du Parti de la restauration nationale. Sans succès. Il abandonne alors la politique partisane pour se consacrer à grosse famille et à ses affaires. On l’approche à deux reprises pour qu’il présente sa candidature à la mairie de Hull, mais il refuse obstinément. Il devient l’un des plus importants courtiers d’assurance du Québec et fonde l’Agence de voyages Guertin.
Bien qu’éloigné de la politique, il n’en demeure pas moins intéressé au développement de l’Outaouais. Il travaille à la création de la paroisse Sainte-Bernadette à Hull, fonde l’Union des Chambres de commerce de l’ouest du Québec dont il sera président jusqu’en 1949, lance l’idée de la création d’un diocèse en Outaouais, etc. En 1959, le premier ministre du Canada John Diefenbaker le nomme au comité exécutif de la Commission de la capitale nationale (CCN) où il s’y fait le gardien des intérêts de l’Outaouais. Puis il se prononce ouvertement en faveur de l’autonomie de l’Outaouais face à Ottawa et à la CCN, opinion qu’il réitérera en 1967 dans un mémoire qu’il rédige avec Égide Dandeneault sur l’intégrité du territoire du Québec.
Homme d’affaires averti, autodidacte, et franc, sa passion pour la justice sociale a fait d’Aimé Guertin l’un des meilleurs députés du comté de Hull au XXe siècle. Il est décédé dans l’ancienne ville de Hull le 8 juin 1970 et a été inhumé à Aylmer.
Sources :
Assemblée nationale du Québec, Aimé Guertin - Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca)
BAnQ-Gatineau, fonds Aimé Guertin, P8.
LAPOINTE, Pierre, Louis, Aimé Guertin : le lion de l’Outaouais dans Hier encore, no 8, 2016, pages 15-21.
Andrew Leamy : terreur de l'Outaouais ?
![]() Par
ouimet-raymond
Le 02/10/2022
Par
ouimet-raymond
Le 02/10/2022
Le patronyme Leamy, en dépit du lac et du casino, n’a pas toujours été connu sous ses orthographe et prononciation originelles à Gatineau. En effet, les Hullois et Pointe-Gatinois avaient depuis longtemps francisé le nom en Lemay. Ainsi, le lac Leamy, situé dans le secteur Hull de la ville de Gatineau, est-il souvent appelé lac à Lemay ou encore, le lac Lemay. C’est le casino de l’ancienne ville de Hull qui a popularisé de nouveau le toponyme Leamy. Mais au XIXe siècle, le lac Leamy avait pour nom Columbia Pond.
Le lac tient aujourd’hui son nom d’Andrew Leamy, né à Drom, dans le comté de Tipperary, en Irlande, le 17 avril 1810 comme l'indique un document de la North Tipperary Genealogy Center. Le personnage arrive à Bytown (Ottawa) vers 1826. Selon l'historienne Denise Latrémouille, il devient le bras droit de Peter Aylen (1799-1868), chef des Shiners, groupe de terroristes irlandais qui fait régner la terreur sur la Gatineau et à Bytown en incendiant les commerces et les maisons de ceux qui leur résistent, en brutalisant et tuant même ceux qui s’opposent à eux et essaient de chasser les Canadiens français des chantiers forestiers pour s’approprier les emplois (il n'y avait pas de police permanente à cette époque). Ces comportements font de Leamy un adversaire de Jos Montferrand.
En 1835, ce colosse d’Andrew Leamy épouse Erexina Wright, fille de Philemon Wright, fils, et de Sarah Olmstead. Exerina recevra en héritage  de son père une terre située à un jet de pierre du lac Columbia et où le couple semble s’être établi. De ce mariage naîtront 13 enfants ! Mais en 1843, Leamy déclare faillite, une faillite que d’aucuns ont prétendu frauduleuse.
de son père une terre située à un jet de pierre du lac Columbia et où le couple semble s’être établi. De ce mariage naîtront 13 enfants ! Mais en 1843, Leamy déclare faillite, une faillite que d’aucuns ont prétendu frauduleuse.
Un dur de dur…
Le 5 février 1839, Andrew Leamy et quatre de ses hommes de main agressent la famille du pasteur Holmes, son épouse, le pasteur John Sayers Orr et une amie, Margaret Fitz-Gibbon de Bytown, sur le territoire de Wrightstown aussi appelé Village des Chaudières par les francophones. Toujours est-il que Leamy est accusé de tentative de meurtre par le juge de paix Thomas Brigham (Assault & battery with intent to murder) ; le procès d’Andrew Leamy et de ses comparses, qui devait avoir lieu à Montréal, ne se fera… jamais ! Pourquoi ? Sans doute à cause de l'une des deux raisons suivantes : les émeutes qui ont conduit à l'incendie criminel de parlement du Bas-Canada à Montréal en 1840 ou de fortes pressions exercées sur l'appareil judiciaire.
Le 20 avril 1845, le même Leamy a une altercation, à l'embouchure de la rivière Gatineau, avec un certain Donald McCrae qui s'était apparemment senti floué par la banqueroute de Leamy en 1843, et qu’il tue d’un coup de rame. On tient une enquête à Ottawa, puis un jury l’accuse de meurtre. Le procès a lieu à Montréal en août 1846 et Leamy y est déclaré non coupable faute d’un témoin oculaire. Le procès a-t-il été arrangé ? Peut-être, car dans son rapport le constable Henri Hébert rapporte qu'un aubergiste nommé Pinard aurait affirmé qu'on avait offert à deux témoins la somme de 300 dollars pour qu'ils quittent la région et évitent ainsi de témoigner. Étrangement, le constable n'aura pas été appelé à témoigner au procès. Toutefois, devant la colère de McCrae, Leamy a peut-être agi en légitime défense. Chose certaine, cette affaire est pour le moins nébuleuse.
En 1847, des entrepreneurs forestiers de la Gatineau, dont John Egan, Joseph Dumond, Allan Gilmour, Ruggles Wright et la Cie MacKay & MacKinnon, réclament du gouvernement du Canada-Uni la mise en œuvre de travaux à l’embouchure de la Gatineau pour recevoir et trier les billes de bois. L’année suivante le gouvernement entreprend des travaux, dont le creusage d’un premier canal entre le lac Columbia et la rivière Gatineau.
En 1851, Leamy obtient de son richissime beau-père, Nicolas Sparks, second mari de Sarah Olmstead, la Gatineau Farm qui comprenait le lac Columbia. A-t-il loué ou acheté la ferme ? En tout cas, selon Albert LeBeau, sa succession aurait été incapable de prouver qu’il en était le légitime propriétaire[1]. Philemon Hull Wright (1828-1906) affirmera, le 16 juin 1874 dans l'Ottawa Daily Citizen, qu’il est l’héritier légal de la Gatineau Farm, mais ne réussira pas à le démontrer. En 1853, Leamy profite des travaux de canalisation pour ériger une scierie à vapeur sur la rive sud dudit lac. Le moulin Leamy, qui a été la seconde scierie à vapeur dans la région – une des deux seules n’ayant jamais fonctionné – sera plus tard détruite par l'explosion de l’une des deux chaudières à vapeur.
Retour du balancier ?
Bien que violent, Leamy aurait été un fervent catholique et a travaillé de concert avec le Père Reboul, qui ne le tenait vraisembablement pas pour un assassin, afin de réaliser l'émancipation du système scolaire dans le canton de Hull, ce qui aura pour résultat la création de la Commission scolaire indépendante en 1866, dont il sera élu le premier président. Mais Leamy sera rattrapé par son passé, car la violence finit toujours par engendrer la violence.
Le soir du 21 avril 1868, alors qu’il marche sur le chemin qui mène à son domicile (près du bd Saint-Joseph), Leamy aurait été attaqué par deux hommes qui auraient maquillé leur crime en accident. En dépit d’une enquête, le crime reste longtemps un mystère. Ce n’est que dix ans plus tard que l’on arrêtera les présumés meurtriers : un certain Henry Maxwell, ancien employé de Leamy, et son beau-frère qui réfutent l’accusation. On ne sait ce qui est advenu de Maxwell et de son complice. Curieusement, Peter Aylen serait décédé la même année que Leamy, soit en octobre 1868.
Leamy a été inhumé au cimetière Notre-Dame à Gatineau, secteur Hull, et sa tombe fait face au lac qui porte son nom.
SOURCES :
BAnQ-CAM, dossiers le la Cour du banc du Roi/de la Reine (TL19, S1, SS11) ; dossiers judiciaires 07H-P79-13.
Bytown Gazette and Ottawa Advertiser, Ottawa, 24 avril 1845, no 42, pages 12 et 13.
Dictionnaire biographique du Canada, volume IX (1861-1870).
Historical Society of Ottawa, La guerre des Shiners, site Internet La guerre des Shiners - Société historique d’Ottawa (historicalsocietyottawa.ca)
LATRÉMOUILLE, Denise, D'or et d'azur, de sueur et de labeur, Hull, 2000.
LEBEAU, Albert, Andrew Leamy (1810 – 1868) : quelques dossiers criminels, publication privée, 29 septembre 2022.
North Tipperary Genealogy Center, extrait de naissance, copyright 2015.
Ottawa Free Press (Ottawa), 15 février 1878.
The New York Times (New York), 19 août 1878.
[1] Voir cause de P. Wright : Chevrier c. La Reine, Cour suprême du Canada 3 mars 1879. L'appel sera rejeté.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 26/06/2022
Par
ouimet-raymond
Le 26/06/2022
12 juillet 1897. À l’église presbytérienne d'Ottawa, le pasteur Knowles bénit le mariage de Damien Richer et d'Éliza Côté. Ce mariage devient vite une source de scandale chez les francophones de l'époque non seulement parce que les mariés sont des leurs, mais surtout parce que… catholiques ! Des catholiques qui se mariaient devant un pasteur protestant… c’était de la trahison ! Et le scandale ne s'arrêtait pas là. Mais n’anticipons pas.
Né le 25 septembre 1865, Damien Richer était le sixième d'une famille de dix enfants qui avaient tous vu le jour à Saint-André-Avellin du mariage de Joseph Richer, cultivateur, tanneur et boulanger, et d’Olive Gagnon, mariage qui avait été célébré à Saint-Jérôme le 26 mai 1851 .
.
Jeune homme, Damien avait voulu être avocat, mais sa mère aurait dit qu’elle aimait mieux le voir tomber raide mort devant elle que de le voir devenir un menteur et un tricheur ! C’est ainsi que Damien est poussé vers la prêtrise par sa mère – à cette époque, toutes les familles s’enorgueillissaient d’avoir un prêtre parmi elles. Ordonné le 19 août 1888 à Saint-André-Avellin, Damien Richer fait un an de vicariat à la paroisse Sainte-Anne d'Ottawa, puis les autorités ecclésiastiques lui confient la cure de la jeune paroisse de Notre-Dame-de-la-Salette, dans la vallée de la Lièvre, de même que les missions voisines de Notre-Dame-de-la-Garde de Val-des-Bois et de Saint-Louis-de-France de Poltimore deux ans plus tard. Enfin, il terminera sa carrière de prêtre à Masson. Quoi qu’il en soit, Damien Richer tombe amoureux de l’une de ses paroissiennes de Poltimore, Éliza Côté, qui partage ses sentiments.
Coup de foudre
Éliza avait vu le jour le 25 mai 1879 à Hébertville, au Lac-Saint-Jean, et sa famille s’était installée dans la Lièvre attirée par le travail crée par une nouvelle mine de mica. De 14 ans la cadette de Damien, elle était institutrice dans une école de rang à Poltimore. Toujours est-il que pour éloigner Damien Richer des attraits d’Éliza Côté, les autorités diocésaines le nomment curé de Notre-Dame-des-Neiges de Masson en octobre 1896. Mais l’amour est plus fort qu’un archevêque aussi puissant ou saint soit-il. Ainsi, le jour même où il bénit un mariage, Damien se rend à Ottawa et épouse l’objet de son amour.
La réaction des autorités religieuses, des familles et de la communauté à leur union n’est évidemment pas unanime. Les nouveaux époux sont excommuniés et voués aux flammes de l’enfer. Il leur est même désormais interdit d’entrer dans une église catholique ! Les Richer excluent ce fils indigne de la famille. Seuls deux des frères et une des sœurs de Damien, Amélia, religieuse, gardent contact avec lui. Cet ostracisme fera que lorsque sa mère sera à l’agonie, il refusera de la voir. Toutefois, la belle-famille de Richer, c’est-à-dire les Côté, est plutôt complaisante et continuera à fréquenter assidûment Éliza.
La collectivité semble avoir été divisée devant la situation du nouveau couple qui, par surcroît, s’était s'installer à Val-Des-Bois, et ce, d’autant plus que les prêtres visiteurs incitaient les fidèles à ignorer la famille Richer. Certains concitoyens valboisiens traitaient même Damien de « faux prêtre ». N’empêche, les enfants Richer fréquenteront l’Église catholique parce que la foi de leurs parents était plus forte que le mépris des autorités religieuses. Grâce à son expérience et à son instruction, Damien est secrétaire municipal et plusieurs de ses concitoyens ont recours à ses bons conseils, notamment en matière juridique. En revanche, son moulin à scie est la proie des flammes à deux reprises. Accidents ou vengeances ? En effet, tout en travaillant pour une compagnie d’exploitation forestière, il exploite localement et en partenariat un moulin à scie sur un bras de la Lièvre.
 Damien et Éliza ont eu six enfants – trois filles et trois garçons –, tous nés à Val-des-Bois entre 1898 et 1911, et baptisés dans la religion… catholique ! Il semble bien que les autorités religieuses aient hésité avant d'accueillir les enfants au sein de l'Église catholique. De fait, il faudra l'intervention de l'évêque pour que les enfants soient admis aux fonts baptismaux. Mais les autorités ecclésiastiques sont dures, si dures qu’on refuse à Damien et à son épouse d’assister aux funérailles de leur fille, Marie Damienne, décédée en 1900.
Damien et Éliza ont eu six enfants – trois filles et trois garçons –, tous nés à Val-des-Bois entre 1898 et 1911, et baptisés dans la religion… catholique ! Il semble bien que les autorités religieuses aient hésité avant d'accueillir les enfants au sein de l'Église catholique. De fait, il faudra l'intervention de l'évêque pour que les enfants soient admis aux fonts baptismaux. Mais les autorités ecclésiastiques sont dures, si dures qu’on refuse à Damien et à son épouse d’assister aux funérailles de leur fille, Marie Damienne, décédée en 1900.
Une Église catholique intransigeante
En 1911, Éliza, qui est hospitalisée à Ottawa, raconte son histoire à un prêtre dominicain qui offre de les aider, elle et son époux, à régulariser leur situation avec l'Église catholique. À la suite de tractations avec les autorités religieuses, le Vatican accepte de lever l'excommunication des deux époux. Mais à trois conditions : 1) quitter la région parce qu’ils sont une source d'embarras pour les autorités diocésaines et de scandale pour la collectivité ; 2) accepter de vivre comme frère et sœur ; 3) faire bénir leur mariage par un prêtre catholique. Il semble bien que le couple ait accepté les deux premières conditions, mais pas la troisième ce qui, pour Damien, aurait été reconnaître le caractère illégitime de ses enfants.
En 1918, Damien et son épouse quittent Val-des-Bois pour Timmins, en Ontario, puis, deux ans plus tard, pour la Saskatchewan où leur fille Jeanne a déjà accepté un poste d'enseignante. La famille s'installe sur une ferme à Ditton Park, près de Prince Albert. Malgré le temps et la distance, le passé de la famille Richer les rattrape rapidement. Damien se plaint à l'évêque de Prince Albert du curé de sa paroisse qui lui fait des misères. Mgr Prud'homme décide d'intervenir auprès du prêtre un peu trop bavard. N’empêche, l’une des filles de Damien, appelée Damienne, et qui voulait devenir religieuse, se verra refuser chez les Grey Nuns de Regina parce que de naissance… n’était pas légitime ! Un des fils éprouve des problèmes avec son acte de naissance lorsqu'il veut se marier : on remet en cause sa légitimité.
Les humiliations subies par les enfants motivent trois d'entre eux à abandonner la religion catholique au grand regret de leurs parents restés malgré tout catholiques. Entre-temps, les parents cèdent leur terre de Ditton Park à un de leurs fils pour s'établir quelques kilomètres plus loin, à Hudson Bay Junction. Damien décède en 1941 et son épouse Éliza s'établit alors chez sa fille Jeanne, à Edmonton, où elle meurt en 1953. Ainsi, l’amour partagé de Damien et Éliza aura été plus fort que la vindicte de l’Église catholique qui, elle, aura perdu des fidèles à la foi plus fortes que celle de la hiérarchie religieuse.
SOURCES :
OLSEN (RICHER), Jeanne-Élise, As I remember them, 2002, Calgary University Press.
Communications de Claire Leblanc et de Pierre Valois.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 13/06/2022
Par
ouimet-raymond
Le 13/06/2022
Le 11 novembre 1918, les clairons des armées en guerre sonnent l’armistice, la fin de la Grande Guerre. Plusieurs mois plus tard, des millions de soldats blessés, meurtris dans leur chair et leur esprit, sont rapatriés dans leur foyer alors que d’autres (9 millions ?) dorment pour l’éternité dans les champs de bataille . Le plus souvent, ils sont abandonnés à leur sort comme nous avons pu le constater, chez nombre de nos soldats laissés à leur sort à la suite des interventions que nos troupes ont menées au Kosovo ou au Koweït. Et même les héros sont vitement oubliés.
Filip Konowal naît en Ukraine (pays alors occupé depuis le XVIIe siècle par les Russes) en 1887. Conscrit en 1908 par l’armée impériale de Russie, il est rendu à la vie civile en 1913. C’est alors qu’une entreprise canadienne le recrute comme bûcheron. Il laisse son épouse et une fille, puis s’embarque pour le Canada où il travaille dans les forêts de l’Outaouais.
La Grande Guerre, celle que l’on a appelé alors la Der des der, éclate le 3 août 1914. Le Canada se joint aux alliés le 4 août et dès le mois d’octobre suivant, il envoie des troupes en Europe. En juillet 1915, Konowal est à Ottawa et il s’engage dans le 77e bataillon du corps expéditionnaire canadien (réaffecté au 47e bataillon en Europe) . Au mois d’août 1916, notre homme est à pied d’œuvre sur les champs de bataille de France face aux armées allemandes qui ont envahi le territoire français deux ans plus tôt. Il est rapidement promu caporal. Il participe à la bataille de la Somme, puis à celle de la crête de Vimy.
Un troupeau de douleurs
Cette guerre, presque oubliée, a été affreuse pour les soldats tapis pendant des semaines dans des tranchées boueuses, de l’eau jusqu’aux genoux, sales et couverts de poux. Un soldat français écrit alors : « Nous sommes un troupeau de douleurs . »
. »
Ce sont les 21 et 22 août 1917 que le caporal Konowal accomplit des exploits d’une bravoure exceptionnelle. Ces jours-là, Konowal en a assez de vivre dans une tranchée avec de l’eau jusqu’à la taille sous le feu des mitrailleuses allemandes. Il décide de sortir de sa position (un officier qui croit qu’il déserte tente de l'abattre), il entre dans une cave où il met hors combat trois ennemis, puis attaque à la baïonnette un groupe de soldats caché dans un trou d’obus. Ensuite, il s’attaque à un nid de mitrailleuses dans lequel il tue tous les ennemis. Enfin, le lendemain, il nettoie un autre nid de mitrailleuses allemand. En deux jours, il a tué au moins 16 ennemis. Mais le soir du 22 août, il est gravement blessé au visage et envoyé dans un hôpital anglais.
Pour ses exploits, il reçoit, des mains du roi George V, la plus haute distinction de l’Empire britannique : la croix Victoria[1]. La guerre prend fin le 11 novembre 1918. Konowal est alors incorporé dans le corps armé canado-sibérien et combat les Soviétiques au côté des Russes blancs dans la région d’Omsk. De retour au pays en juin 1919, il est démobilisé le 4 juillet.
Des autorités ingrates
Notre homme souffre toujours des blessures subies en France et mal soignées (paralysie partielle de la figure, fracture du crâne, maux de tête) ; l’alcool est son analgésique. 1919 : nous sommes à l’époque de la prohibition. Mais Konowal apprend qu’il se vend de l’alcool rue Saint-Rédempteur à Hull. Le 20 juillet, il se rend dans une maison où vit un Autrichien (l’ennemi d’hier) nommé Wilhem Artich qu’il tue d’un coup de couteau pendant une courte altercation.
Konowal est arrêté puis remis en liberté sous caution. On ne sait pas quoi en faire : imaginez, un titulaire de la croix Victoria ! Enfin, à l’été de 1921, les autorités judiciaires décident de l’enfermer à Saint-Jean-de-Dieu où il sera soigné. Mais les autorités canadiennes, pour le moins ingrates, entrent en communication avec le consulat soviétique dans l’intention de déporter le héros en URSS. Enfin, son internement prend fin en 1930. Il apprend que sa femme est morte de faim et que sa fille est décédée dans un goulag stalinien. Il s’établit à Hull où il prend épouse.
Konowal est sans conteste un héros guerrier. Mais que fait-on avec les héros, lesquels doivent aussi gagner leur vie ? Un ancien officier lui trouve un emploi à la Chambre des communes. Un jour, le premier ministre William Lyon Mackenzie King l’aperçoit en train de laver le plancher du parlement. Il le fait réaffecter comme gardien spécial d’une salle. Quand Konowal est interrogé au sujet de son poste de gardien, il répond en toute simplicité : « Outremer, j’ai nettoyé avec un fusil, et ici je dois nettoyer avec une vadrouille ! » Si la vie vous intéresse…[2]
Sources :
Archives nationales du Canada.
Archives nationales du Québec.
Communications de M. Ron Sorobey.
LUCIUK, L. et SOROBEY, R. Filip Konowal, The Kastan Press, 1996.
Louis Bisson : une vie exceptionnel
![]() Par
ouimet-raymond
Le 27/05/2022
Par
ouimet-raymond
Le 27/05/2022
Né le 22 mars 1909 à Hull, Québec, du mariage d'Hector Bisson, ingénieur, et de Marie-Louise Lachance, il fait des études chez les Frères des écoles chrétiennes, puis travaille à la E.B. Eddy dès l'âge de 16 ans. Après avoir vu des avions voler à l'aéroport d'Ottawa, Louis Bisson se passionne pour l'aviation et se trouve un second emploi pour se payer des cours de pilotage. Il obtient son brevet de pilote en 1930.
En 1931, Louis Bisson s'achète un avion triplace biplan de marque OX5 Swallow, ce qui lui permet de participer à divers concours et d'embarquer des passagers... au poids, c'est-à-dire au tarif de 1¢ la livre. Ainsi, un passager qui pesait 150 livres devait verser 1,50$ ! En 1933, Bisson offre au père jésuite Joseph-Marie Couture, de piloter bénévolement pour lui, ce que le missionnaire accepte. Le père Couture, qui s'occupait des missions de la baie James et de la baie d'Hudson dira plus tard : « [...] j'avais là l'homme souhaité. Il me fallait quelqu'un prêt à rompre avec la civilisation et à embrasser une vie rude et solitaire. Bisson était taillé sur mesure pour ce genre d'existence. Bisson est un incomparable pilote. [...] ».
Pendant quatre ans, Louis Bisson, pilote de brousse, transporte bénévolement le jésuite un peu partout dans le Nord ontarien à bord d'un biplan Gipsy Moth tout en l'aidant dans son travail de pastoral. Les Autochtones l'appellent Bemissewinini, c'est-à-dire « l'homme qui vole ». Pour subvenir à ses besoins, il transporte des prospecteurs et des mineurs pour la Nipigon Airways dont il serait actionnaire et partage son salaire avec le père Couture. En 1937, Mgr Breynat, o.m.i., décide à son tour d'employer la voie des airs pour faire la visite des missions de son immense vicariat du Mackenzie. Louis Bisson lui propose ses services que le prélat accepte avec enthousiasme. La communauté des oblats lui confie alors un avion de marque Bellanca, baptisé Santa Maria, que le Hullois pilotera pendant quatre ans dans le ciel de l'Arctique. On estime qu'il aurait parcouru une distance d'environ 30 000 kilomètres sans accident.
brousse, transporte bénévolement le jésuite un peu partout dans le Nord ontarien à bord d'un biplan Gipsy Moth tout en l'aidant dans son travail de pastoral. Les Autochtones l'appellent Bemissewinini, c'est-à-dire « l'homme qui vole ». Pour subvenir à ses besoins, il transporte des prospecteurs et des mineurs pour la Nipigon Airways dont il serait actionnaire et partage son salaire avec le père Couture. En 1937, Mgr Breynat, o.m.i., décide à son tour d'employer la voie des airs pour faire la visite des missions de son immense vicariat du Mackenzie. Louis Bisson lui propose ses services que le prélat accepte avec enthousiasme. La communauté des oblats lui confie alors un avion de marque Bellanca, baptisé Santa Maria, que le Hullois pilotera pendant quatre ans dans le ciel de l'Arctique. On estime qu'il aurait parcouru une distance d'environ 30 000 kilomètres sans accident.
En 1937, il fait un périple de 9 000 kilomètres dans le Grand Nord comme pilote de brousse. Au cours de sa carrière, Louis Bisson aura franchi plus de 2 millions de milles aériens avec pour passagers des personnes comme Winston Churchill, Louis Mountbatten et Anthony Eden. Il vole au sein du Royal Air Force Ferry Command où il a le grade de capitaine et reçoit la King's Commendation for Valuable Service le 11 juin 1942, pour avoir relevé, malgré les dangers, des routes aériennes. Il a été appelé à baliser la route aérienne « Crimson » avec Don McVicar entre le Canada et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Bisson pilotait alors un Norseman. Il reçoit l'Ordre de l'Empire britannique le 1er janvier 1944. Il a traversé l'Atlantique 138 fois, principalement comme pilote de bombardiers parmi lesquels de nombreux bombardiers Liberator.
La guerre achevée, il cofonde et préside Artic Wings, entreprise établie à Churchill, au Manitoba. Puis il devient directeur et copropriétaire de Prairie Airways à Regina, Saskatchewan et enfin directeur et copropriétaire de la Air Observer School No 3 à Moose Jaw, Saskatchewan.
Un homme d'affaires
Louis Bisson a un sens inné des affaires. Le 14 avril 1945, il fonde Amusements de  Hull, entreprise propriétaire du nouveau cinéma Montcalm. En 1946, il crée la compagnie du Transport Urbain de Hull, puis achète, en 1958, la Gatineau Bus Company Ltd, propriété de Paul Desmarais, qu'il renomme en la francisant Transport Hull Métropolitain.
Hull, entreprise propriétaire du nouveau cinéma Montcalm. En 1946, il crée la compagnie du Transport Urbain de Hull, puis achète, en 1958, la Gatineau Bus Company Ltd, propriété de Paul Desmarais, qu'il renomme en la francisant Transport Hull Métropolitain.
Louis Bisson est un travailleur acharné et il n'est pas question pour lui de se reposer sur ses lauriers. En 1948, il avait fondé l'entreprise Logements de Hull et construit au début des années 1950 les maisons du secteur du lac des Fées à Hull. Les employés de Transport urbain peuvent acheter une de ces maisons sans mise de fonds initiale, car la compagnie la leur prête et le diminue même de 100 dollars si le chauffeur a passé une année complète sans accident. Avec ses frères Georges et Jacques Gaston (Jim), il développe le Parc de la montagne, à Hull, où il construit pas moins de 1 100 maisons. Bien que Louis Bisson ait peu de respect pour les politiciens qu'il achète lorsqu'ils contrecarrent ses projets, il voit le ministre de la Justice du Québec le nommer commissaire de la cour supérieure pour le district de Hull le 30 novembre 1963.
Bisson est un homme qui ne tient pas en place. Quand il ne s'occupe pas de ses affaires commerciales, il fait du bénévolat ou étudie. En 1953, avec son ami Louis Landreville, Fernand Nadon et Jean Belleau, il fonde la bibliothèque municipale de Hull. Puis, en 1965, il fonde Bibliothèque régionale du nord de l'Outaouais, préside le conseil d'administration de la bibliothèque municipale d'Aylmer et participe à de nombreuses institutions hulloises dont l'orphelinat Ville-Joie Sainte-Thérèse de Hull à titre de directeur et de l'hôpital Sacré-Cœur comme membre du comité consultatif. Cofondateur de la Commission des bibliothèques publiques du Québec, il en sera longtemps le vice-président. Il est aussi membre du club Richelieu, de la Société des grands frères d'Ottawa, des Chevaliers de Colomb, etc.
Grand bénévole, Louis Bisson siège à de nombreux conseils d'administration dont celui de la fiducie irrévocable de Association de amigos de Ninos au Mexique, pour venir en aide à 200 enfants abandonnés de Mexico. Ordonné prêtre au Mexique en 1986, il est consacré évêque trois ans plus tard (janvier 1989) par Mgr Dom Luis, de l'Église apostolique et catholique du Brésil (Igreja Católica Apostólica Brasileira), une Église dissidente depuis 1945 qui ne reconnaît pas l'infaillibilité du pape. Puis il fait construire une chapelle à La Foresta, Mexique. Il œuvrerait auprès de jeunes défavorisés au Mexique depuis 20 ans.
Un pont de l'autoroute 13, qui enjambe la rivière des Prairies, porte son nom. Le 21 octobre 2002, il est intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. Commandeur de l'Ordre de la confrérie des chevaliers du Taste vin à château Clos de Vougeot, Côte d'Or, France.
Louis Bisson meurt le 17 septembre 1997 à Ajijic, province de Jalisco, Mexique, à l'âge de 88 ans. Ses funérailles seront célébrées en l'église catholique romaine St. Marks, à Aylmer, le 18 octobre suivant.
Pour en savoir plus, voir OUIMET, Raymond, Louis Bisson – un parcours de vie exceptionnel dans la revue Hier encore (Gatineau), numéro 12, 2020, p. 18 à 25.
Les pérégrinations de Geneviève Clark
![]() Par
ouimet-raymond
Le 27/09/2021
Par
ouimet-raymond
Le 27/09/2021
La plupart des Québécois de souche trouvent leurs ancêtres au pays de la douce France. Il est cependant beaucoup moins courant pour des Français de trouver les leurs au Québec. Et pourtant, il y en a : trois ou quatre générations après l’arrivée des pionniers en Nouvelle-France, des Canadiens ont émigré sur le vieux continent. Citons par exemple les Lemoyne et les Rigaud de Vaudreuil, dont l’histoire est bien connue et qui ont quitté le pays après la chute de la Nouvelle-France. Mais que savons-nous d’autres familles, d’autres personnes issues de la masse anonyme du peuple parties vivre au pays de leurs ancêtres ? Peu de choses, en vérité. Et pourtant, il y a sans doute là plus d’une histoire étonnante à raconter. En voici une, celle de Geneviève Clark, une fille née au 7, rue des Jardins, à Québec, qui est allée vivre aux pays de ses aïeux, l’Angleterre,  puis la France.
puis la France.
Geneviève Clark est née en 1780, à Québec, du mariage de William Clark, un soldat anglais sans doute, et de Geneviève Lépine dit Lalime, une Canadienne de deuxième génération. Or, voilà qu’un officier des troupes d’occupation britanniques, le lieutenant Richard Skottowe, fils de l’ancien gouverneur de l’île Sainte-Hélène, remarque la jeune fille qui, contrairement à sa mère, est illettrée. Il en tombe follement amoureux au point où, en 1799, il lui fait une offre exceptionnelle, soit celle de lui verser mensuellement la somme de 48 livres sterling jusqu’à ce qu’il lui demande de venir le retrouver en Europe. Et pour garantir cette exceptionnelle pension, il va jusqu’à hypothéquer ses biens.
Cette pension est importante, car elle se monte à la somme annuelle de 576 livres. Par exemple, à la même époque, le gouverneur de la Province of Quebec recevait annuellement la somme de 2 000 livres, le secrétaire et greffier, 400 livres et le procureur général 300 livres… Ainsi, la pension annuelle de Geneviève était-elle plus élevée que les appointements de deux des trois plus importants fonctionnaires du gouvernement !
Il faut dire que Geneviève est belle – pouvait-il en être autrement ? – ; elle paraît quatre à cinq ans de moins que son âge. Cheveux et teint foncés, elle mesure 1,52 mètre. De plus, on dit qu’elle a un air distingué et elle passe pour être une excellente cavalière. Elle ne maîtrise pas bien l’anglais – son accent français devait la rendre encore plus charmante.
Départ pour la Grande-Bretagne
En 1800, Skottowe regagne la Grande-Bretagne avec son régiment. L’année suivante, sans doute, l’officier fait mander Geneviève à Londres où elle arrive probablement au printemps de 1802. Quoi qu’il en soit, le 2 juillet 1802, le couple convole en justes noces, puis revient au Canada où il fait baptiser son premier enfant à Québec au printemps de 1803. Puis le couple retourne en Europe et s’installe à l’île de Wight, située dans la Manche. C’est là que Geneviève donne naissance à trois autres enfants dont deux mourront en bas âge. Enfin, elle accouche d'une fille en Écosse.
En 1813, on trouve Richard Skottowe sur la Côte d’Or, aujourd’hui le Ghana, où il est à l’emploi de l’African Committe qui y pratique la traite négrière. Il meurt à Cape Coast Castle à l’hiver 1813 et laisse dans le deuil, outre sa femme, trois enfants : un garçon et deux filles.
Geneviève quitte la Grande-Bretagne vers 1820 pour s’établir au pays de ses ancêtres maternels, la France. Jean-Baptiste Rémy Belle, un jeune homme de 22 ans, de 19 ans le cadet de Geneviève et de surcroît avoué de profession (c.-à-d. avocat et notaire), en tombe amoureux. Geneviève va alors s’installer à Tours, dans l’une des plus belles maisons de la ville, place Foire-le-Roi.
Le nouveau couple ne convolera pas tout de suite. Il va d’abord avoir  trois enfants – trois filles – qui naissent en 1821 et en 1823, la première à Tours et les deux dernières à Orléans où Geneviève a déménagé ses pénates. Le couple a un comportement très XXIe siècle, car Rémy et Geneviève ne vivent pas ensemble si on en croit les recensements d’époque. Quoi qu’il en soit, Geneviève tombe malade en 1841. En mars 1842, elle épouse enfin son amoureux à Orléans où elle meurt huit mois plus tard à l’âge de 62 ans.
trois enfants – trois filles – qui naissent en 1821 et en 1823, la première à Tours et les deux dernières à Orléans où Geneviève a déménagé ses pénates. Le couple a un comportement très XXIe siècle, car Rémy et Geneviève ne vivent pas ensemble si on en croit les recensements d’époque. Quoi qu’il en soit, Geneviève tombe malade en 1841. En mars 1842, elle épouse enfin son amoureux à Orléans où elle meurt huit mois plus tard à l’âge de 62 ans.
La descendance de Geneviève
La descendance totale de Geneviève Clark, qui a eu six enfants viables, doit se monter à environ 90 personnes, peut-être plus, dont apparemment une seule porte aujourd’hui le patronyme de Skottowe et aucun celui de Belle. En effet, aucun des petits-enfants de la Québécoise n’a eu plus de trois enfants ; certains sont morts dans la prime enfance. De plus, 51,81 % de sa descendance connue est de sexe féminin, lequel ne pouvait pas transmettre son nom de famille sauf pour les enfants conçus hors mariage, et il y en a eus un certain nombre.
Si le fils de Geneviève, Thomas Henry (1807-1868). qui s'est arrogé le titre de chevalier, est devenu riche comme Crésus grâce à un héritage comprenant cinq mines de plomb, sa fille, Joséphine, épouse Antoine Dieudonné Belle qui sera successivement juge, maire de Tours, député de l’Indre-et-Loire, sénateur de ce même département et l’un des 363 fondateurs de la IIIe république ; un buste à l'effigie du personnage orne la Place-du-14-juillet à Tours. De plus, une de ses petites-filles, Léonide-Désirée, a épousé l’économiste franco-suisse de renom Léon Walras (1834-1910), une autre Jeanne Sabine (1851-1933), est devenue vicomtesse, et un petit-fils, Henri Adolphe Laherrère (1898-1952), a été décoré de la Légion d’honneur. Cela dit, certains ont sombré dans la quasi-misère : au moins une Skottowe a grandi à l’Assistance publique, un autre est mort au bagne en Guyane à la suite d'un crime commis dans la Légion étrangère, alors que la plupart des autres ont vécu la vie des personnes de la classe moyenne. Ils portent ou ont porté les patronymes d’Aurange, Bernasconi, Boudon, Charmantray, Laherrère, Mailly, Pruvot, Villard, etc. Et toute cette histoire a débuté au 7, de la rue des Jardins à Québec.
Sources :
Archives départementales du Loiret, France.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
British Library : IOR/D/158ff 297-98 1804 2 folios.
Diverses communications de Mme Marian Press, Toronto, Ontario.
Diverses communications de Mme Nicole Mauger, Paris, France.
État civil de La Ferté-Saint-Aubin, d’Orléans et de Tours.
The Morning Chronicle (Londres), 24 juin 1802.
The Times (Londres), 1871.
Cette recherche a été faite en collaboration avec madame Nicole Mauger.
Hommage à Éléonore Gaudette, une femme de coeur
![]() Par
ouimet-raymond
Le 10/09/2021
Par
ouimet-raymond
Le 10/09/2021
Connaissez-vous l'île aux Allumettes ? Cette île, la plus grande de la rivière des Outaouais, est située à environ 140 kilomètres à l'ouest de Gatineau, au bout de la route 148. C'est le « père de la Nouvelle-France », Samuel de Champlain, qui en fit le premier la description en 1613, bien que l'île ait été explorée en 1610 par un premier Européen, Étienne Brûlé. La population autochtone de l'île, les Kichesipirinis de la nation algonquine, fut éliminée par les Iroquois dès 1650.
C'est dans cette île, dont la population comptait alors un tiers de francophones, que naquit Éléonore Gaudette le 16 avril 1889 du mariage de Louis Gaudette et de Philomène Soucie. En 1911, celle que l'on surnommait « Lanore » épousa Isidore Mainville de qui elle aura treize enfants.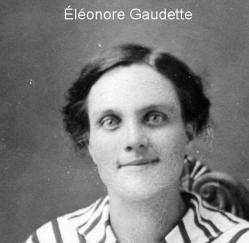
Le couple Gaudette-Mainville vivait dans la maison de Zoé Chaput, mère d'Isidore Mainville, située dans le rang du Piquefort (4e rang). Chaque année, Éléonore voyait son mari partir dès l'automne pour les chantiers forestiers de l'Outaouais ou encore ceux du nord de l'Ontario. En février 1932, Éléonore avait dix enfants vivants, dont un âgé d'à peine cinq mois. Isidore travaillait, à ce moment-là, dans les chantiers de Gogama (Ontario) comme charretier.
Le 8 février 1932, la famille Mainville apprit, par télégramme, la mort subite de l'un des siens dans les chantiers de Gogama : Édouard, 35 ans. Veuf, celui-ci avait quatre enfants placés dans deux familles différentes. Chagrinés, les enfants furent réunis chez une tante où le corps d'Édouard devait être exposé avant les funérailles qui seraient célébrées dans l'église paroissiale au village de Chapeau. Une des enfants, Rita, partie de Hull, a raconté qu'elle et ses parents nourriciers avaient pris train pour se rendre à Pembroke, Ontario, où un taxi les avait attendus pour les conduire à l'île aux Allumettes en traversant la rivière des Outaouais sur un pont de glace. Le jour avait déjà fait place à la nuit qui arrive tôt à cette époque de l'année. Comme il y avait un redoux, la glace de la rivière des Outaouais était recouverte d'eau par endroit. Néanmoins, le taxi s'aventura sur la rivière, ses portières ouvertes au cas où la glace céderait alors qu'aucun des passagers ne savait nager ! Or, le chauffeur était ivre et se perdit sur la rivière plongée dans le noir. Enfin, après plusieurs errements, le taxi parvint à laisser ses passagers au lieu prévu.
Un drame imprévu
Toute la famille Mainville – et elle était grande – était réunie dans la maison dont le salon avait été préparé pour recevoir la dépouille d'Édouard que l'un des frères Mainville, Athanase, était parti « quérir » à la gare ferroviaire de Pembroke. Dans la maison surchauffée, on avait commencé à discuter de l'avenir des enfants du disparu. Après avoir longuement palabré, certains proposèrent de tout simplement placer les enfants dans un orphelinat, soit à Hull soit à Pembroke. Une femme, tante par alliance, s'y opposa : Éléonore Gaudette. « Il n'en est pas question », lança-t-elle avec autorité. « Je vais les prendre chez moi s'il le faut, mais on ne placera pas ces enfants dans un orphelinat ! » Voilà un bon cœur, pour ne pas dire une belle âme comme on le formulait à l'époque !
 La discussion n'était pas achevée qu'arriva à la porte Athanase Mainville qui hésita à franchir le seuil. Il avait le visage couvert de sueur. Embarrassé sinon confus, il bégaya : « Il y a eu erreur : Édouard est vivant ! » Les enfants de celui-ci émirent des cris de joie. La voix tremblante, Athanase reprit son propos : « On a confondu les prénoms en écrivant le télégramme : c’est Isidore qui est mort. » La famille fut consternée. Des enfants se mirent à pleurer.
La discussion n'était pas achevée qu'arriva à la porte Athanase Mainville qui hésita à franchir le seuil. Il avait le visage couvert de sueur. Embarrassé sinon confus, il bégaya : « Il y a eu erreur : Édouard est vivant ! » Les enfants de celui-ci émirent des cris de joie. La voix tremblante, Athanase reprit son propos : « On a confondu les prénoms en écrivant le télégramme : c’est Isidore qui est mort. » La famille fut consternée. Des enfants se mirent à pleurer.
Tout l'attirail funéraire fut déplacé de l'autre côté du chemin du Piquefort où Isidore, décédé à l'âge de 46 ans, fut veillé dans son lieu de résidence habituelle, maison de sa mère veuve depuis vingt ans. Quant à Éléonore Gaudette, elle éleva sa famille en compagnie de sa belle-mère sans jamais se remarier. L'abbé Harrington, qui deviendra curé de la paroisse de Chapeau, s'arrangea pour faire instruire l'aînée de la famille, Imelda, pour qu'elle devienne enseignante et puisse ainsi aider la famille à subsister. Quant aux enfants d'Édouard, ils retournèrent dans leur foyer nourricier respectif, au lieu de l'orphelinat, en attendant que leur père se remarie. La leçon d'Éléonore avait été retenue.
Éléonore Gaudette vécut longtemps. Elle quitta ce monde à Peterborough, Ontario, le 2 juillet 1984 à l'âge de 95 ans, mais sera inhumée dans son milieu d'origine au côté de son mari. Deux de ses enfants vécurent plus longtemps qu'elle : sa fille aînée, Imelda, décédée à l'âge de 98 ans et Ange-Maie, qui a présentement 96 ans.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 17/08/2021
Par
ouimet-raymond
Le 17/08/2021
Virginie Taillefer naît le 26 septembre 1866 à Trenton, Ontario, mais elle croyait avoir vu le jour au Grand Brûlé (Saint-Benoît, Qc). Elle ne possédait que son certificat de première communion, rédigé à Ripon, en Petite-Nation, en juin 1879, qui authentifiait sa date de naissance, mais il n'en précisait pas le lieu. Il faut dire que son père, Calixte, était tantôt jobbeur tantôt voyageur et qu'à ce titre il a vécu dans de nombreux endroits, dont Ripon, Saint-Jovite, Blind River, Mattawa, Powassan, Trenton, etc.
Aînée d'une famille qui comptera six enfants, Virginie épouse, en novembre 1883, un certain Léon Ouimet, peintre en bâtiment, de qui elle n'aura pas d'enfants. Mais Virginie est une Taillefer, patronyme apparemment tiré du nom de l'épée de Guillaume, comte d'Angoulême (†962). Une légende dit que le comte aurait coupé en deux, d'un coup de son épée, un Normand revêtu de son armure. En dépit de la stérilité de son couple, Virginie aimerait bien avoir des enfants et le sort lui en donnera dans des circonstances dramatiques. En effet, en 1896, sa sœur, Louisa, meurt à Mattawa une semaine après avoir donné naissance à un fils, David. Le père, David Turgon, qui ne peut élever seul l'enfant, le confie à son beau-frère, Léon Ouimet, époux de Virginie, par contrat fait sous seing privé le 12 janvier 1897 à Klock Mills, Ontario :
Je soussigner (sic) suis témoin du marché qui se passe entre moi David Turgeon et Léon Ouimette qu'il garde mon enfant comme nourricier et il es (sic) compris que le jour ou je voudrais reprendre l'enfant, il est compris devant témoin que je paye la somme demandé (sic).
Hector Lévis David Turgon
Henri Tremblay
Léon Ouimette
Une famille plus grande que prévu
Bien que le père de David se remarie trois ans plus tard, il ne reprendra pas son fils qu'il ne verra qu'une vingtaine d'années plus tard, peut-être parce qu'il n'avait pas la « somme demandé[e] » qu'auraient pu exiger Léon et Virginie. Toutefois, il faut dire que sa seconde épouse lui a rapidement donné une multitude d'enfants soit... 23 ! Il avait amplement de quoi s'occuper.
« somme demandé[e] » qu'auraient pu exiger Léon et Virginie. Toutefois, il faut dire que sa seconde épouse lui a rapidement donné une multitude d'enfants soit... 23 ! Il avait amplement de quoi s'occuper.
En 1906, voilà qu'une autre sœur de Virginie, Sophie, épouse Tremblay, meurt à son tour. Son beau-frère lui confie alors ses quatre enfants qu'elle va élever même si son mari, Léon, meurt deux ans plus tard. De plus, elle loge pendant quelque temps son frère, Calixte, cocher de Mgr J.-Onésime Routhier, curé de la paroisse Notre-Dame d'Ottawa et s'occupe de son beau-père qui meurt chez elle en 1907. Pour vivre, Virginie devient couturière et, plus tard, travaille la nuit à l'entretien ménager de la bibliothèque Carnegie, rue Laurier à Ottawa. Mère courage, elle n'hésite pas à faire faire instruire les enfants qu'elle a sous sa garde, aidée en cela par son beau-frère Henri Tremblay ; David, auquel elle a transmis le patronyme de Ouimet, ira à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque dans le milieu ouvrier. En 1911, elle loge son père qui mourra à l'Hôpital général d'Ottawa en 1915.
 Virginie est une ardente défenderesse de la langue française. Aussi, en 1912, quand le gouvernement ontarien adopte l'inique Règlement 17 qui interdit l'usage du français « comme langue d'enseignement et de communication » dans les écoles bilingues des réseaux publics et séparés, elle sera du nombre des mères de famille qui, armées d'aiguilles à chapeau, assureront la garde de l'école Guigues à Ottawa contre les sbires du gouvernement francophobe.
Virginie est une ardente défenderesse de la langue française. Aussi, en 1912, quand le gouvernement ontarien adopte l'inique Règlement 17 qui interdit l'usage du français « comme langue d'enseignement et de communication » dans les écoles bilingues des réseaux publics et séparés, elle sera du nombre des mères de famille qui, armées d'aiguilles à chapeau, assureront la garde de l'école Guigues à Ottawa contre les sbires du gouvernement francophobe.
Virginie, qui héritera du surnom de Mémère Ouimet, est morte chez David Turgon dit Ouimet le 11 février 1960 à l'âge de 93 ans. Virginie n'a pas de descendance propre, mais elle a une descendance fièrement francophone qui vit majoritairement à Gatineau.
Sources :
Acte des BMS de la paroisse Notre-Dame d'Ottawa.
Décarie, Jacques E., communication de la date et du lieu de naissance de Virginie Taillefer à l'auteur le 19 août 2021.
Documentation familiale.
Recensements du Canada 1871 à 1921.
Amicie Piou Lebaudy, femme de cœur
![]() Par
ouimet-raymond
Le 10/04/2021
Par
ouimet-raymond
Le 10/04/2021
Une rue de Gatineau (Québec) porte son nom, mais bien peu de gens connaissent l'histoire de cette femme de cœur, bienfaitrice du collège Saint-Alexandre.
Née le 27 juillet 1847 à Lyon (France), du mariage de Constance Piou et de Palmyre Le Dall de Kéréon, Marguerite Amicie Piou est issue d’une famille de la grande bourgeoisie provinciale française. Le 13 décembre 1865, à Toulouse, elle épouse le riche financier Jules Lebaudy et monte à Paris où elle tient salon fréquenté par les grandes familles catholiques.
À la suite de l'effondrement de la banque catholique Union générale en 1882, causé en partie par les manipulations boursières de son mari, Amicie prend conscience, devant son salon déserté, que son mari est un coquin. Elle considère que l’argent de sa fortune est sale. Il lui est pourtant légué à la mort de son mari survenue en 1892. Elle vend alors son logement et s'installe dans un petit deux-pièces dans le quartier Saint-Lazare. Peu de temps après, elle décide de s'investir dans les œuvres sociales. Le 4 mai 1897, à Paris, l’incendie du Bazar de la charité fait pas moins de 136 morts, dont 126 femmes et 10 hommes. Parmi ces femmes, il y a la duchesse d’Alençon (1847-1897), sœur de Sissi, impératrice de l’Autriche. En 1898, le journal Le Figaro lance une campagne de souscription pour venir en aide aux familles des malheureuses victimes qui ne faisaient pas toutes partie de l'aristocratie parisienne. Or, un jour, le journal reçoit en un seul versement une souscription de 937 438 francs ! Mais qui est ce souscripteur anonyme capable de donner presque un million de francs se demandent les Parisiens ? Le journal La Libre Parole révélera son nom : Amicie Piou, veuve Lebaudy.
Dans la plus grande discrétion, elle finance la fondation du Groupe des Maisons ouvrières (GMO) en 1899, future Fondation de Madame Jules Lebaudy, dont elle reste inconnue de celui-ci jusqu’au lendemain de sa mort (seul le président du Groupe recevait d’elle, directement de main à main et sans reçu, les sommes nécessaires à l’achat des terrains et à la construction de ces groupes d’immeubles). Le GMO s'occupe de construire des immeubles salubres pour les ouvriers et à bon marché en vue de leur location à des personnes n'ayant pas de maison, notamment à des ouvriers ou employés vivant de leur salaire à Paris ou en banlieue parisienne et la construction de l'hôpital de l'Institut Pasteur. Elle aura été l'une des pionnières du logement social. Sa fondation loge aujourd'hui plus de 6 500 personnes.
Amicie Piou deviendra l’insigne bienfaitrice du Collège Saint-Alexandre de Gatineau. Cette femme, dont on n’a pas réussi à percer le mystère, aura été d’une générosité exemplaire en donnant à Mgr Alexandre Le Roy la somme de 200 000 $ pour l’achat d’une propriété et l’établissement d’une école d’agriculture au Québec. Et c’est en sa présence que l’Institut colonial Saint-Alexandre sera inauguré le 11 juin 1905. Sept ans plus tard, la Congrégation des Pères du Saint-Esprit fondera le Collège apostolique Saint-Alexandre, incorporé en 1914 en vertu des statuts de la province de Québec. Affilié à l’Université Laval et considéré comme l’un des meilleurs collèges classiques au Québec jusqu’en 1967, le Collège est alors devenu un établissement d’enseignement secondaire privé.
Amicie Piou veuve Lebaudy est décédée à Paris le 3 mai 1917.
Sources :
Armée du salut France, Association humanitaire – Armée du Salut, [en ligne], 2002-2008. [www.armeedusalut.fr] (Consulté le 15 février 2008).
Collège Saint-Alexandre, [en ligne], 2005-2008. [www.college-stalexandre.qc.ca] (Consulté le 15 février 2008).
La Congrégation du Saint-Esprit, [en ligne], s. d. [www.spiritains.qc.ca/fr/Accueil.aspx] (Consulté le 15 février 2008).
FULIGNI, Bruno, L'incendie du Bazar de la charité, Paris, éditions Archipoche, 2019.
GENEANET, Généalogie de Marguerite Amicie Piou par Jacky Lesage.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 02/01/2021
Par
ouimet-raymond
Le 02/01/2021
Qui n’a pas entendu parler des exploits de Jos. Montferrand, figure mythique de l’Outaouais du XIXe siècle ? Né le 25 octobre 1802 à Montréal, Jos. Montferrand, fils de François-Joseph Favre dit Montferrand (1773-1908), voyageur, et de Marie-Louise Couvret (1782-?), grandit dans le faubourg Saint-Laurent, à deux pas du Fort-Tuyau et du Coin-Flambant, deux tavernes situées à l'angle des rues Lagauchetière et Cadieux. Il est devenu une véritable légende grâce aux combats qu'il a remportés au cours de sa vie. En 1818, il devient une célébrité quand il flanque une raclée à trois brutes qui terrorisent les gens du faubourg Saint-Laurent à Montréal. En 1828, il remporte un combat contre le champion de la marine anglaise au quai de la Reine, à Québec, devant une foule considérable.
Il commence par gagner sa vie en 1820 comme charretier à Kingston (Ontario)pour ensuite entrer, peu après la mort de sa mère, au service de la Compagnie du Nord-Ouest qui vient enfin de se joindre à la Hudson Bay Company, qui fait le commerce des fourrures. En 1827, Montferrand quitte la Compagnie du Nord-Ouest pour entrer au service de Joseph Moore qui exploite des coupes de bois sur la rivière du Nord ; il est conducteur en chef pendant deux ans. En 1829, il passe au service de Bowman et McGill, riches marchands de bois dont les scieries sont situées sur la rive droite de la rivière du Lièvre. C’est là son premier voyage en l'Outaouais où il régnera en maître pendant trente ans, et où il sera « conducteur d'hommes, défenseur des siens et redresseur de torts. ». Pendant plus de trente ans, Montferrand est tour à tour contremaître, chef de « cages » et l’homme de confiance de ses employeurs, pour lesquels il se fait médiateur de conflits. Ces derniers se l’arrachent et font appel à lui pour régler ce genre de problèmes.
Un gentilhomme fort
Haut de 1,93 mètre, Jos. Montferrand avait, rapporte l'historien Benjamin Sulte, de grands yeux bleus, les cheveux blond foncé, le teint clair et les joues roses. « Danseur incomparable, précise Sulte, un peu poseur comme tous les beaux garçons [...] À table, gai et poli, à la mode des anciens seigneurs. » Sulte a conclu : « La postérité se tromperait grandement si elle en faisait un hercule mal dégrossi, avide de luttes et rude envers les autres comme il l'était parfois pour lui-même... Il y avait un fonds de chevalerie dans son coeur et dans son imagination. Au Moyen âge, il eut porté la lance et  la hache d'armes avec éclat, pour Dieu, sa dame et son roi. »
la hache d'armes avec éclat, pour Dieu, sa dame et son roi. »
Dans les années 1830, Wrightstown (les Chaudières, Hull) et Bytown (Ottawa) subissent la violence des Shiners, des raftsmen irlandais déterminés à monopoliser le travail dans les chantiers aux dépens des Canadiens Français. Les deux rives de la rivière des Outaouais servent alors de théâtre à de titanesques combats au cours desquels Jos. Montferrand ferait preuve d'une force et d'un sens de la justice exceptionnelle. C'est pour rendre hommage à son courage que l'on a donné son nom à l’actuel Palais de Justice de Hull.
Une bataille mémorable
À plus d'une reprise, Montferrand défend ses compatriotes contre les Shiners qui prétendent faire la loi dans Bytown et n’hésitent pas à mettre le feu aux maisons, à battre les passants et même à tuer. Dans l’atmosphère surchauffée qui règne sur la région, Montferrand prend vite la stature du chevalier sans peur et sans reproche en triomphant des Irlandais. Son haut fait le plus célèbre et légendaire remonterait à 1829. Plus de 150 Shiners, armés de gourdins, s'étaient embusqués du côté de Wrightstown à l’extrémité du pont Union (site de l’actuel pont des Chaudières) qui traversait la rivière des Outaouais. Avant de s’y engager, Montferrand, soupçonneux, interroge la tenancière d'un débit de boisson situé tout près du pont du côté de Bytown. Sur l'assurance que le pont est désert, il s'y aventure. À peine est-il arrivé au milieu que l'ennemi fonce sur lui. Tentant de revenir sur ses pas, il se rend compte que la femme a perfidement fermé les portes du pont. Après avoir fait le signe de la croix, il passe à l'attaque : il saisit un des assaillants par les jambes et s'en sert comme d'une masse pour abattre les autres. En pleine bataille, l'un des adversaires l'implore du regard et se signe. Montferrand lui dit de se placer derrière lui. La lutte acharnée n'en continue pas moins et Montferrand abat homme par-dessus homme. Alors que la troupe ennemie est mise en déroute, le traître qu'avait protégé Montferrand l'assaille par-derrière et lui assène un coup de gourdin. Vivement, le héros se retourne, assomme son agresseur et le jette dans le gouffre. La scène est horrible, le sang coule du tablier du pont diront plus tard des témoins qui ont sans doute exagéré le déroulement de l'action. De la rive hulloise, un groupe de gens regarde les Shiners fuir à toutes jambes par le chemin d'Aylmer et Montferrand traverser, victorieux, le pont Union.
En 1852, à Champlain, Montferrand épouse Marie-Anne Trépanier qui meurt 11 ans plus tard sans descendance, puis en 1864 à Montréal, il marie Esther Bertrand qui lui donnera un enfant posthume : Napoléon-Louis (1865-1896).
Montferrand est mort à Montréal, à son domicile de la rue Sanguinet, le 4 octobre 1864 et il a été inhumé au cimetière Côte-des-Neiges où se dresse, sur sa tombe, un monument de granit gris.
Sources :
Dictionnaire biographique du Canada.
Histoire forestière de l'Outaouais, capsule B8, site internet http://www.histoireforestiereoutaouais.ca/b8/
Nos origines.qc.ca
PRÉVOST, Michel, Jos Montferrand, de la légende à la réalité, Fédération des Québécois de souche, https://quebecoisdesouche.info/jos-montferrand/
SULTE, Benjamin, Histoire de Jos. Montferrand, l’athlète canadien, Montréal, 1899.
Albert Demers : un artiste international de l'Outaouais
![]() Par
ouimet-raymond
Le 08/12/2020
Par
ouimet-raymond
Le 08/12/2020
L'Outaouais regorge d’artistes de toutes sortes. Souvent méconnus ici, ils font souvent un tabac ailleurs au pays ou dans le monde. C’est le cas d’Albert Demers, un personnage à la vie étonnante, originaire de l’Île aux Allumettes dans le Pontiac.
Albert Demers naît le 12 avril 1910 à Pembroke, Ontario, mais grandit à Demers Centre, un petit hameau situé au cœur de l’île aux Allumettes, soit à environ 150 kilomètres de Gatineau. La famille Demers est l’une des premières familles francophones à s’établir à l’île aux Allumettes dès le début des années 1830. Plus tard, un certain Moïse Demers est devenu maître de poste et c’est comme ça que le lieu a pris de nom de Demers Centre.
Issu d’une famille qui subsiste grâce aux ressources offertes par la forêt, Albert commence tôt à dessiner dans un calepin ours, chevreuils, orignaux, bref tous les animaux sauvages qu’il voit. Vers l’âge de 9 ans, il s’amuse à sculpter des figurines d’animaux et même de personnages. Ses outils se limitent à un rasoir droit. Mais l’enfant a du talent. Ainsi, quand il accompagne son père au marché de Pembroke (Ontario), il réussit à y vendre plusieurs de ses œuvres. Il lui arrive même de rapporter à la maison de 15 à 20 dollars, sommes considérables à cette époque. À l’adolescence, des gens aisés de Pembroke l’embauchent pour peindre des scènes sur les murs de leur maison. De plus en plus de touristes, qui fréquentent les forêts giboyeuses de l’Outaouais, lui achètent des œuvres comme souvenirs.
Un client célèbre : Al Capone
Sa réputation s’étendra soudainement un matin de 1930 quand une grosse Oldsmobile noire arrive chez lui, à Desjardinsville, un hameau de l’Île-aux-Allumettes où un traversier interprovincial relie les insulaires à la ville de Pembroke. Deux gorilles sortent de la grosse voiture noire, armes cachées sous le manteau, et l’apostrophent en lui disant que leur patron veut le rencontrer. Le peintre, qui n’a pas le choix d’accepter une invitation aussi insistante, monte dans la luxueuse automobile où on lui bande les yeux. L'Oldsmobile s’arrête longtemps plus tard, dans un lieu situé à une centaine de kilomètres de l’île aux Allumettes, près des Rapides-des-Joachims. Enfin, on lui débande les yeux.  Devant lui, un homme puissant, que toutes les polices d’Amérique du Nord aimeraient bien mettre à l’ombre pour le reste de ses jours : Alphonso Caponi dit Al Capone !
Devant lui, un homme puissant, que toutes les polices d’Amérique du Nord aimeraient bien mettre à l’ombre pour le reste de ses jours : Alphonso Caponi dit Al Capone !
Capone possédait un pavillon de chasse et pêche non loin des Rapides-des-Joachims, au lac de la Théière (anciennement Tea Pot Lake) et avait entendu parler des talents d’Albert Demers. Il demande, sinon commande au Pontissois de peindre des scènes sur les murs de sa résidence de Chicago. Le jeune peintre, qui tremble dans ses culottes, demande un semblant de rétribution : 100 dollars. Capone réplique en lui offrant… 10 000 dollars ! À Chicago, Albert décorera deux salles sous la garde d’hommes armés.
Albert Demers ne s'établira pas aux États-Unis et continuera à vivre à l’Île-aux-Allumettes. En 1940, il épouse une jeune femme de Hull, une certaine Jeanne Dupuis, après avoir passé l’hiver à la maison des célèbres acteurs américains Clark Gable et Carole Lombard où il a peint des scènes murales. Puis il s’installe dans la région de Montréal (Saint-Timothée de Beauharnois et Saint-Zotique) où il peint et fait de la sculpture sur bois. Il vend ses œuvres aux magasins Dupuis Frères et Simpson de Montréal. En 1945, l’archevêque d’Ottawa, Mgr Alexandre Vachon, lui commande des statues de la Vierge et un groupe d’anges pour le congrès marial. Puis, le peintre s’installe à Chomedey (Laval) où il terminera ses jours.
Albert Demers n'oubliera jamais l'Outaouais : il passe tous ses étés, avec sa femme et ses trois enfants, à son chalet du lac Jim, situé au nord de Waltham, sur la rivière Noire. Il meurt le 29 mars 1989 à Laval, et laissé derrière lui une œuvre exceptionnelle et abondante, disséminée un peu partout dans le monde.
Sources
Centre d’Histoire La Presqu’île, Archives régionales de Vaudreuil-Soulanges.
Généalogie outaouaise de Jean-Guy Ouimet, Généalogie outaouaise-Ascendance Albert Demers (sympatico.ca)
LEROUX, Manon, L’Autre Outaouais – Guide de découverte du patrimoine, Gatineau, Pièce sur pièce, 2012.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 19/11/2020
Par
ouimet-raymond
Le 19/11/2020
Les Canadiennes ont longtemps lutté pour avoir le droit de disposer de leur corps comme bon leur semble. Retour sur un étonnant procès qui s’est déroulé à Ottawa en 1936-1937 et qui a fait les manchettes de tous les journaux du pays : l’affaire Dorothea Palmer.
Le droit à la contraception existe chez les autorités civiles depuis longtemps, mais pas chez les toutes les autorités religieuses. Par contre, les autorités civiles ont longtemps interdit d'en faire la promotion. L’Église catholique acceptait la contraception par des moyens naturels et elle accusait les Églises protestantes et le judaïsme d’accepter la contraception avec des moyens artificiels et mécaniques.
Né en Angleterre en 1908, Dorothea Palmer exploite une bibliothèque à Ottawa et est, à temps partiel, une infirmière visiteuse de la Parent Information Bureau qui avait été fondé en 1935 à Kitchener par un riche philanthrope de l’endroit, A. R. Kaufman. L’objectif de l’organisation était d’informer les parents de familles pauvres sur des moyens anticonceptionnels et de leur vendre des instruments peu coûteux. Depuis sa fondation, la Parent Information Bureau avait répondu à 43 000 demandes à la suite d’enquête dans des foyers de pauvres.
À partir de renseignements qui lui provenaient surtout des médecins, Dorothea Palmer organisait des réunions de famille dans les quartiers pauvres de la ville et informait les mères des moyens de contraception qui étaient à leur disposition. Elle leur remettait un guide intitulé Le contrôle de la natalité et quelques-unes de ses méthodes les plus simples.
Arrêtée le 14 septembre 1936, elle est accusée d’avoir fait la promotion illégale du contrôle de la natalité, diffusé des instruments « antifécondants » dans la ville d’Eastview (aujourd’hui le quartier Vanier à Ottawa), eu en sa possession des moyens de contraception et suggéré la stérilisation des femmes faibles d’esprit. Cette accusation a été portée en vertu d’un article du Code criminel sur… l’obscénité ! Commence alors un procès qui durera pas moins de six mois.
Le procès commence le 21 octobre 1936 à Eastview. Des femmes viennent témoigner. Plusieurs, dont une mère de 3 enfants, disent que leur revenu familial n’est que de 40 dollars par mois. Or, à cette époque, une famille de 5 personnes a besoin d’un revenu annuel d’au moins 1 000 dollars. D’autres disent que Dorothea Palmer leur a même remis gratuitement des moyens de contraception.
Habile, l’avocat de Palmer, un certain F. W. Wanegast, réussit à transformer le procès en celui du contrôle de la natalité au Canada en faisant témoigner une foule de gens : des ministres du culte, des médecins, des universitaires. Or, les ministres du culte se contredisent et interprètent des passages de la bible différemment au grand plaisir de l’avocat qui démontre que même chez les doctes religieux la morale n’est pas une chose aisée à définir.
Un certain révérend Wiclox, du Social Service Council of Canada est en faveur de la contraception parce que par une fécondité extraordinaire, les catholiques canadiens-français tentent de délibérément de dépasser les Anglais par le nombre des naissances ! Maurice Zeidman, pasteur presbytérien, déclare que ceux qui condamnent aujourd’hui la régulation des naissances érigeront peut-être un jour un monument à Dorothea Palmer et accusent les sectes religieuses qui s’opposent à la femme d’être un siècle en retard et ils les traitent de morons !
Les non-catholiques ne sont pas tous en faveur du contrôle de la natalité. L’épiscopat anglican le condamne et la High-Chuch of England s’y oppose formellement. Les médecins catholiques, comme le docteur Ernest Couture, estiment que la régulation des naissances peut engendrer une « condition pathologique » et préconise la continence. Son témoignage est conforté par celui du Dr Gérin-Lajoie, professeur de gynécologie à l’Université de Montréal. Il estime que l’usage « d’antifécondants » sont de nature à affecter le système nerveux et qu’ils pouvaient constituer un danger même pour l’homme ! Il est contredit par le professeur Scott de l’université de Toronto. Gérin-Lajoie dit que si quelqu’un s’avisait d’enseigner la contraception à l’Université de Montréal, il en serait expulsé. D’autres médecins ne s’opposent pas à la contraception, mais s’opposent à ce que les moyens soient diffusés autrement que sous leur contrôle… direct ! Certains ont peur que ces moyens tombent en de mauvaises mains et qu’ils aient pour conséquence une augmentation des relations sexuelles hors mariage.
Tous les journaux parlent de l’affaire Palmer, y compris le journal Le Droit, propriété des oblats de Marie-Immaculée. Évidemment, Le Droit s’oppose à la contraception. Choses certaines, des hommes réagissent violemment au débat. Ainsi, un d’entre eux, ayant vu Dorothea Palmer, l’entraîne dans une ruelle et tente de la violer en disant : « J’vais te montrer ce que c’est de ne pas contrôler la natalité. » Elle réussit à s’en défaire au moyen d’un coup de genou au bon endroit !
Le procès s’est terminé le 17 mars 1937. Le juge a conclu que Dorothea Palmer avait diffusé du matériel de contraception pour simplement venir en aide à ses concitoyens. Enfin, soulignons que l’article en vertu duquel Mme Palmer a été accusée n’a été abrogé qu’en 1969.
SOURCES
Le Droit (Ottawa), 1936-1937.
Site Internet http://modern-canadian-history.suite101.com/article.cfm/parents_information_bureau
Ludger Genest (1847-1910) chef des pompiers de Hull
Né à Saint-Henri-de-Lauzon, au Québec, le 3 décembre 1847 du mariage de Charles Genest dit Labarre et de Marguerite Beaulé, Ludger Genest[1] est le 12e d’une famille de 22 enfants. Après avoir travaillé dans les chantiers de la Gatineau et de l’Outaouais, il s’enrôle dans le 17e bataillon d’infanterie de la milice de Lévis pour ensuite s’engager dans la police provinciale créée depuis peu. C’est d’ailleurs à titre de policier qu’il est affecté au détachement de Hull en 1874. Cinq ans plus tard, il entre dans la police municipale hulloise à la tête de laquelle il sera nommé l’année suivante.
En 1883, Ludger Genest, avait essayé d'organiser une compagnie de pompiers volontaires, mais sans succès puisque, en janvier 1885, il n'y en avait toujours pas. En fait, le service d'incendie n'était plus composé que du chef de police et de son assistant qui, à eux deux, n'avaient pas assez de bras pour actionner la pompe Victoria. Quoi qu'il en soit, en juillet 1885, Genest revient à la charge et parvient à former un corps composé d'une compagnie de pompiers et d'une compagnie d'échelles et de crochets composé d'une trentaine de volontaires. Le corps prend le nom de brigade Jacques-Cartier[2] et la ville lui consent une subvention annuelle de 200 dollars jusqu'en 1892. Services de police et d'incendie dépendent désormais d'un seul chef : Ludger Genest.
Genest est un véritable homme à tout faire. Non seulement est-il longtemps le chef de police et des pompiers de Hull, mais c'est aussi lui qui organise le premier recensement municipal en 1885, et qui numérote, en 1886, les maisons de la ville pour la première fois. De plus, il est un « patenteux » qui essaie constamment d'améliorer le fonctionnement de l'équipement des services publics – eau, feu, police – dont il a la charge. Il invente le dévidoir automatique qui « ...au lieu d'enroûler [sic] ou de dérouler les boyaux sur un cylindre, c'est le cheval qui, tout en continuant sa course fera cet ouvrage. Tout se mut [sic] au moyen de poulies[3]. » Et conscient que la brigade des pompiers doit être sur les lieux d'un incendie dans les délais les plus brefs pour avoir une chance de maîtriser les flammes – après cinq minutes, le feu augmente de volume huit fois à la minute –, et que les minutes passées à atteler les chevaux aux dévidoirs laissent aux flammes le temps de devenir incontrôlables, il conçoit, avec ses hommes, un système ingénieux :
Les attelages des chevaux étaient suspendus au-dessus de travails des dévidoirs, à la hauteur des chevaux; ces derniers viennent d'eux-mêmes [sic] se placer sous leur harnais respectif et par un mécanisme ingénieux de la propre invention du chef Genest, le cheval est attelé en une demie-minute [sic][4].
Un homme mal aimé, mais indispensable
En 1894, Genest perd la charge de chef des pompiers dans le cadre d’une vendetta politique, mais conserve celle de chef de police. Il reprend son poste de chef des pompiers en 1896 qu’on lui enlèvera à nouveau en 1899. Quasi indispensable, il redevient chef des pompiers en 1901, charge qu’il conservera jusqu’à son décès en 1910.
Le 18 septembre 1906, la chute principale des Chaudières de la rivière des Outaouais, entre Hull et Ottawa, est à sec. Genest invite alors un groupe d’amis à dîner sur le site rocheux des chutes où il a fait ériger une tente. Après avoir brisé une bouteille de champagne, on allume un feu pour préparer un repas qui est dégusté par une vingtaine de personnes dès la fin du discours de circonstance prononcé par maître Lorenzo Leduc[5].
Époux de Marie-Louise Laflamme qu'il a mariée en 1876, il meurt à Hull le 1er avril 1910[6]. « […] Différentes vues des funérailles du chef Genest[7] » sont alors présentées au cinéma/théâtre Eldorado, rue Principale. C'est sans doute le premier reportage cinématographique tournée dans l'ancienne ville de Hull[8].
Sources :
Voir Ouimet, Raymond, Une ville en flammes, Hull, éditions Vents d'Ouest, 1994.
[1] Notons qu’à son baptême, Ludger Genest a reçu le prénom d’Esdras.
[2] À ses débuts, la brigade était composée des personnes suivantes : Ludger Genest, chef; J. Blais, capitaine; V. O. Falardeau, lieutenant; Joseph Séguin, secrétaire; Ferdinand Côté, sergent; J. Carrière, sergent; et les pompiers J. B. Cyr, T. Latour, A. Guilbault, J. Vaillancourt, J. Gagné, D. Grondin, T. Legault, C. Gravelle, J.-B. Saint-Jules, A. Coursol, Noé Carrière, A. Dion, C. Girouard, P. Durocher, T. U. Proulx, Z. Ouellette, Félix Desrochers, Victor Bilodeau, A. Pariseau, L. Lemieux, J. Legault, F. Ouellette, P. Gravelle, J. B. Ménard et E. Tessier.
[3] Le Spectateur (Hull), 14 septembre 1889.
[4] Ibid., 7 février 1890.
[5] Boutet, E. Le bon vieux temps à Hull, Hull, éd. Gauvin, 1971, p.52 et 53.
[6] Il a eu douze enfants dont sept lui ont survécu : sœur Marie de Lourdes (sœur grise), Edgard, Urgel, Oscar, Omer, Alice et Conrad.
[7] Le Temps (Ottawa) 4 avril 1910.
[8] Hull fait partie de la ville de Gatineau depuis 2001.
Louis Étienne Delille Reboul : un prêtre hors du commun II
La fondation de la Ville de Hull
En 1866, Louis Reboul se met à la tête des citoyens du village de Hull pour réclamer l’ouverture de rues, la construction de chemins et de ponts. En 1868, il prône la séparation du village et du canton de Hull aux fins municipales. En organisant la paroisse Notre-Dame, il met en place une structure qui facilitera la fondation de la « cité de Hull » en 1875. Puis, il entreprend des démarches pour doter Hull d’une charte municipale.
La Ville de Hull fondée, Reboul continue à s’intéresser aux affaires municipales et n’hésite pas à s’engager quand il estime son intervention nécessaire. On fait d’ailleurs souvent appel à lui pour régler des questions épineuses. Un certain nombre de citoyens hullois dont Ezra Butler Eddy, le docteur Graham et, croit-on, Alonzo Wright, avaient réussi à modifier, en catimini, la charte municipale au mépris des intérêts de la population hulloise. Ayant pris connaissance de cette machination, le père Reboul n’hésite pas à en informer le premier ministre du Québec, Charles-Eugène de Boucherville, et à demander justice. Il réussit à faire partager ses convictions par le nouveau conseil municipal qui, après avoir corrigé la charte, délègue les conseillers Charles Delude et Narcisse Trudel, de même que le père Reboul, auprès du gouvernement québécois pour faire adopter les amendements.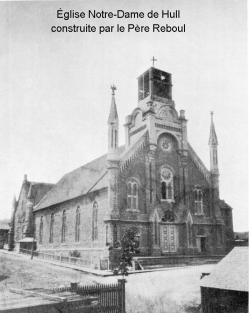
Bien que les affaires municipales, scolaires et sociales prennent la majeure partie de son temps, Louis Reboul ne désintéressera jamais des hommes de chantiers qu’il continue à visiter tous les hivers, pendant deux à trois mois. À partir de l’automne 1876, il souffre de plus en plus souvent de violents maux de tête. Cela ne l’empêche toutefois pas d’entreprendre, le 8 janvier suivant, sa 24e campagne de mission des chantiers. Après la visite d’un 43e chantier, il tombe si gravement malade qu’on doit le ramener en toute hâte à Mattawa (Ontario) où il expire quelques jours plus tard, soit le 2 mars 1877.
La mort de Reboul
Dès que sa mort est connue, toute la population du village de Mattawa vient lui rendre un dernier hommage. Une foule immense accueille à Ottawa la dépouille de Reboul puis, accompagne les restes du prêtre précédés par la fanfare de Hull qui joue des airs funèbres. Le char s’arrête devant l’église Saint-Jean-Baptiste où le curé de la paroisse chante un libera solennel. Puis, le cortège funèbre reprend sa marche escorté par une compagnie de voltigeurs. Enfin, le cortège défile dans les rues de Hull où on entend les cloches de l’église Notre-Dame pleurer la mort du fondateur de la paroisse. À mesure que la procession avance, la foule recueillie, pressée sur le bord des rues et même montée sur le toit des maisons, ne cesse de croître.
À l’église de Hull, Mgr Eugène Duhamel, évêque d’Ottawa, qui prononce l’oraison funèbre de Reboul s’écrie : « Citoyens de Hull, vous n’oublierez jamais qu’il a été, je le dirai, le premier et le plus actif parmi ceux qui ont travaillé à la fondation et au progrès de votre jeune cité. » Enfin, on inhume le corps de Reboul dans l’église qu’il a lui-même construite. Son corps sera par la suite tranféré au cimetière Notre-Dame, boulevard Fournier, à la suite de la conflagration qui détruit l'église en 1888.
Sources
BRAULT, Lucien, Hull 1800-1950, Ottawa, Les éditions de l'Université d'Ottawa, 1950.
CARRIÈRE, Gaston, Louis Reboul, o.m.i., 1827-1877, organisateur de la vie religieuse à Hull, Ottawa, Les éditions de l'Université d'Ottawa, 1959.
Louis Étienne Delille Reboul : un prêtre hors du commun I
S’il est un pionnier de l’Outaouais qui mérite notre reconnaissance, c’est bien le père oblat Louis Étienne Delille Reboul. Le journaliste Ernest Cinq-Mars, qui a rédigé la première histoire de l’ancienne ville de Hull, écrivait, en 1908 : « Le R.P. Reboul, se trouvant à Hull en face de tout à commencer, commença tout. »
Né en France à Saint-Pons (Ardèche) le 4 décembre 1827, Louis Reboul est le septième d’une famille de neuf enfants. Il entre au séminaire en 1840 et quand un père oblat de Montréal se rend en France, sa parole convaincante décide la vocation oblate de Reboul. En 1852, Mgr Joseph Eugène de Mazenod, fondateur des missionnaires oblats de Marie Immaculée, l’élève à la prêtrise.
En 1853, les Oblats dépêchent Louis Reboul au Canada. Il se rend à Bytown (Ottawa) où sa communauté est établie depuis 1848. Dans un premier temps, il sert d’auxiliaire à Mgr Guigues dans les différentes missions du diocèse puis, de vicaire à La Visitation de South-Gloucester. Dès 1854, Reboul se consacre aux missions. Il passe les étés de 1854 et 1855 à la Baie James et lance l’œuvre des chantiers. En 1856, il est à Maniwaki, lieu à partir duquel il visite les missions de la Gatineau et de la Baie James.
Au printemps 1858, Reboul est nommé chef de la mission des chantiers. À partir de cette époque, il visite, chaque hiver, une soixantaine de chantiers de l’Outaouais où il dit la messe et confesse les bûcherons de toutes nations. L’hiver terminé, le bois coupé dans les chantiers est assemblé en cages et acheminé à Québec par la rivière des Outaouais. Aux Chaudières (Hull), les nombreux cageux, soudain oisifs, doivent attendre cinq ou six jours pour sauter la chute des Chaudières. Pour les prémunir contre les dangers de Bytown, le père Durocher avait fait construire à Hull, en 1846, une chapelle qu’il avait dédiée à Notre-Dame-du-Bonsecours, mais qui a surtout été connue sous le vocable de « chapelle des chantiers ». On dit que souvent Reboul prêchait aux bûcherons et cageux, à partir du balcon de la chapelle.
En 1860, l’évêque d’Ottawa charge Reboul de la desserte des catholiq ues de la future ville de Hull. Dès cette époque, le prêtre ardéchois devient la véritable cheville ouvrière des Chaudières. En 1864, il agrandit la chapelle puis voit à l’organisation de deux écoles, l’une pour garçons et l’autre pour filles. En 1872, il est nommé président de la commission scolaire de Hull qu’il dirigera pendant 5 ans. Il s’attelle à la construction d’une école en pierre pour les garçons et obtient que les Frères des écoles chrétiennes viennent y enseigner.
ues de la future ville de Hull. Dès cette époque, le prêtre ardéchois devient la véritable cheville ouvrière des Chaudières. En 1864, il agrandit la chapelle puis voit à l’organisation de deux écoles, l’une pour garçons et l’autre pour filles. En 1872, il est nommé président de la commission scolaire de Hull qu’il dirigera pendant 5 ans. Il s’attelle à la construction d’une école en pierre pour les garçons et obtient que les Frères des écoles chrétiennes viennent y enseigner.
La chapelle des chantiers étant devenue trop petite, il commence, en 1868, la construction d’une grande église en pierre qui deviendra le siège de la paroisse Notre-Dame en 1871. Le père Henri Tabaret, supérieur du Collège d’Ottawa, écrit en 1871 : « La construction de l’église avance. Le P. Reboul qui en a la direction s’en donne à cœur joie, car vous savez qu’il n’est jamais plus heureux que lorsqu’il est au milieu des ouvriers. » Au grand déplaisir des Hullois, un autre que Reboul est alors nommé curé de la nouvelle paroisse : le père Charpeney.
L'âme de Hull
Reboul est alors l’âme de Hull, celui à qui on s’adresse quand il y a des problèmes à régler. Quand le tocsin se fait entendre, il arrive le premier sur les lieux, organise les moyens de protection, applique les échelles et monte sur les toits ou se précipite dans les maisons enflammées pour y arracher des flammes quelque personne ou objet. Son ascendance sur ses concitoyens est considérable. Un jour, deux hommes décident d’aller vider leur querelle sur une petite île sise au beau milieu de la rivière des Outaouais, entre Hull et Ottawa, pensant qu’ils seraient là en sûreté. Deux cents hommes les suivent pour assister à la bataille qui promet d’être spectaculaire, sanglante même. Quand Reboul apprend le projet des deux hommes, il saute dans un canot et arrive bientôt sur la petite île bondée d’hommes excités. Sans hésiter un instant, il sépare les belligérants et met fin au combat, séance tenante. Puis, il réprimande les spectateurs qui bêtement avaient encouragé la violence.
Hull est alors en très grande partie le fief de la famille Wright, ce qui fait obstacle au progrès de la future ville : 50 ans après l’arrivée de Philemon Wright, Hull n’est qu’un petit hameau d’une demi-douzaine de maisons. Et pourtant, Wright avait reçu des instructions du gouverneur Dalhousie pour l’établissement d’un village qui n’a pas encore vu le jour. Wright et ses descendants acceptent bien de louer leurs terrains aux nouveaux venus, mais refusent de les vendre à ceux qui désirent y construire leur maison. Ce régime de propriété, appelé « constitut », est un sérieux handicap à la fondation et à l’expansion d’un véritable établissement urbain. Pas étonnant que les nouveaux arrivants dans la région choisissent de s’établir à Bytown qui compte alors plus de 7 000 habitants.
Heureusement, il y a Reboul, véritable homme à tout faire qui a aussi à cœur le bien-être matériel des Hullois avec lesquels il n’hésite pas à travailler à l’aménagement de services collectifs. C’est lui qui obtient du gouvernement les fonds nécessaires à la construction d’un pont sur le ruisseau de la Brasserie dont il surveillera lui-même les travaux. Il ne se contente pas de diriger les ouvriers, mais travaille autant qu’eux, s’exposent au soleil, à la neige, à la pluie et au froid, passant des journées entières avec des vêtements humides ou mouillés, ne pouvant comprendre qu’on put le plaindre. Pas étonnant que les Hullois aient tant aimé cet homme. À suivre...
Le secret de Raoul Denonville, l'homme qui n'a jamais été
Raoul Denonville : on ne sait rien ou presque de ce personnage sinon qu'il serait né au Québec au début des années 1890, un 27 avril. Mais aucun document, aucun recensement n’en fait état. Mais nous savons, par contre, qu'il avait une sœur qui vivait à Hull (aujourd'hui Gatineau). Du moins l'a-t-il prétendu. On a dit que son accent était celui des gens des Cantons de l'Est et même celui d'un Français. Mais tous ces dires ne sont que spéculation : personne ne sait ni ne connaît l'origine de Raoul Denonville. Chose certaine, il était unilingue français – certains ont même qualifié son français de « joual ». Il savait lire, puisqu'il possédait de très nombreux numéros de l'édition française du Reader's Digest.
La Grande Guerre (1914-1918) battait son plein quand Raoul Denonville est arrivé à River Valley, comté de Nipissing, dans le Moyen Nord ontarien, accompagné de Wilfred Jean. Les gens de River Valley ont alors cru que les deux hommes étaient des soldats déserteurs venus du Québec. Quoi qu'il en soit, ils se sont installés dans une cabane en bois rond, en haut du lac Grassie, où ils ont habité pendant toute la guerre et même pendant quelque temps après la paix signée. Puis Wilfred Jean s'en est allé.
Denonville a passé presque toute sa vie à faire du trappage et il vendait ses maigres prises à LaFrance Furs à Sudbury. Mais il a aussi travaillé à la scierie de Cockburn au lac Emerald où il a été draveur. Ses collègues ont dit qu'il travaillait fort et même souvent plus fort que les autres employés.
il vendait ses maigres prises à LaFrance Furs à Sudbury. Mais il a aussi travaillé à la scierie de Cockburn au lac Emerald où il a été draveur. Ses collègues ont dit qu'il travaillait fort et même souvent plus fort que les autres employés.
L'homme croyait dans la capacité de la nature pour guérir des maladies ; il se soignait avec des racines et des herbes, car il détestait les médecins, les hôpitaux, les aiguilles et les pilules. Il prétendait que les aiguilles donnaient le cancer, que les pilules n'avaient aucun pouvoir de guérison et que certains médecins empoisonnaient leurs patients. Quand ses yeux ont été affligés de la cataracte, il est allé se faire opérer à Sudbury, suffisamment loin de son bled, River Valley, pour conserver un secret, un secret qu'il n'a jamais dévoilé.
Denonville ne consommait pas d'alcool, mais a fumé jusque dans la soixantaine avancée. Quand l'heure de la retraite est arrivée, il a refusé de demander la pension de sécurité de vieillesse, car il estimait que les contribuables étaient déjà suffisamment taxés sans qu'ils aient à le soutenir financièrement. Une bonne âme qui a réussi à le ramener à la raison l'a aidé à remplir les papiers nécessaires à l'obtention de la pension à laquelle tous les Canadiens ont droit.
À la fin de sa vie, Raoul vivait dans une cabane en bois rond près de la rivière Temagami. De nombreux concitoyens croyaient qu'il cachait de l'argent dans sa masure ou encore dans la doublure de ses vêtements.
Une partie du secret éventée
Le 4 mars 1970, on trouve Raoul Denonville sur le plancher de son petit logement où il est étendu depuis quelques jours, inconscient. Une ambulance le transporte à l'hôpital Saint-Jean-de-Brébeuf, à Sturgeons Falls, pour lui sauver la vie. On lui enlève ses vêtements bien qu'il lutte pour empêcher qu'on lui retire son pantalon. Stupéfaction : on découvre que Raoul est... une femme ! Pas question de divulguer cette découverte même quand le patient meurt le 14 mai 1970. Le code de déontologie des autorités hospitalières, des médecins, des prêtres et autres professionnels s'y oppose. Mais la nouvelle fera très rapidement son chemin bien que les médecins et, plus tard, la maison funéraire Théorêt inscrivent, sur les papiers officiels, que Denonville est un mâle.
La police, qui ne sait pas encore de quoi il en retourne, procède à la fouille de la cabane du disparu. On y trouve un coffre marqué aux initiales A. H., une valise et des vêtements. Dans un garde-robe, il y a des souliers et des couvre-chaussures de femme, des vêtements ainsi qu'un manteau. On trouve aussi un petit anneau pour femme et rien d'autre. Pas de petits pécules ni même le nom d'un parent.
Qui était Raoul Denonville ? Bien qu'elle soit décédée depuis 48 ans et que madame Florence Serré en ait fait un sujet de recherche, les origines de l'homme/femme de River Valley restent toujours un mystère. Aujourd'hui, Raoul Denonville repose dans le cimetière de River Valley dans une concession anonyme.
Sources :
LABELLE, Wayne, West Nipissing Ouest, "River Valley resident died with his secret", s.l. n.d., pages 122 et 123.
SERRÉ, Florence, communication à l'auteur en mars 2018.
The North Bay Nuggett (North Bay), 1er avril 1971, article de Wayne LaBelle du Nugget Sturgeon Bureau.
Catherine de Baillon, mystérieuse fille du roi
Les filles du roi, jeunes femmes envoyées en Nouvelle-France pour se marier, intéressent beaucoup de généalogistes et d'historiens depuis plusieurs années. Si on sait presque tout sur la vie en Nouvelle-France de ces filles à marier, on ne sait toutefois presque rien sur leur vie en France. Pourquoi ont-elles quitté la France ? L'ont-elles quitté volontairement ? Étaient-elles orphelines ? Filles rebelles ? On tout cas, l'une des plus belles énigmes est celle de Catherine de Baillon.
Né aux Layes (département des Yvelines) en 1645 du mariage d'Alphonse de Baillon (1590-1648), écuyer, sieur des Enclaves et de la Massicotterie, et de Catherine de Marle (1612-1680), Catherine perd son père en novembre 1648, mais sa mère se remarie, avec Marq d'Amanzé (1616-1669), écuyer, sieur de la Fond. Par après, on n'entend plus parler de Catherine, en France, c omme si elle avait grandi à part de sa famille. Elle arrive à Québec en 1669 avec un contingent de 150 jeunes femmes tirées de l'hôpital de La Salpêtrière à Paris. L'ursuline, Marie de l'Incarnation, écrivait alors à son fil en octobre 1669 : « [...] il y en a de toutes conditions, il s'en est trouvé de très-grossières, et de très-difficiles à conduire [...] » Elle ajoutera : « Il y en a d'autres de naissance et qui lui ont donnée [à Anne Gasnier, recruteuse] plus de satisfaction. » Catherine de Baillon était, de par ses parents, de noble naissance.
omme si elle avait grandi à part de sa famille. Elle arrive à Québec en 1669 avec un contingent de 150 jeunes femmes tirées de l'hôpital de La Salpêtrière à Paris. L'ursuline, Marie de l'Incarnation, écrivait alors à son fil en octobre 1669 : « [...] il y en a de toutes conditions, il s'en est trouvé de très-grossières, et de très-difficiles à conduire [...] » Elle ajoutera : « Il y en a d'autres de naissance et qui lui ont donnée [à Anne Gasnier, recruteuse] plus de satisfaction. » Catherine de Baillon était, de par ses parents, de noble naissance.
Catherine avait deux demi-sœurs, nées du mariage de son père avec Claude Dupuy en 1639 : Élisabeth, née en 1633 et mariée à Paul Hanot, notaire et procureur du roi à Neauphle-le-Château ; Claude Marie, née en 1635 et mariée à Gilles Thiboust, commis aux aides et greffier de la prévôté de Neauphle-le-Château. Cadette de la famille, elle a un frère, Antoine, né en 1643, marié à Marthe Deruel de Beauregard ; une soeur : Louise, née en 1644, mariée à 1) Jacques Pocquet, écuyer, sieur de Champagne, brigadier des gardes du duc de Montausier, 2) Jacques Stoup, écuyer, sieur de Courmont, officier de la vénerie du duc d'Orléans.
La famille de Catherine avait de puissants alliés. Parmi eux, Jehan de Fleury, écuyer, lieutenant de la galère La Patronne, lieutenant de la louveterie du roi, gentilhomme de la grande bannière du roi, chevalier du Saint-Empire et seigneur des Violettes. Il avait épousé la sœur de Loyse de Marle, Catherine, en 1645. Fleury, était le fils d'un célèbre architecte, René Fleury, contrôleur général des bâtiments du roi, et le neveu de Jehan Desmaretz (1595-1676), seigneur de Saint-Sorlin. Ce dernier était un personnage considérable. Ami intime du cardinal de Richelieu, il a été l'un des fondateurs de l'Académie de la langue française, secrétaire général de la marine du Levant, poète et dramaturge.
Ce qui rend encore plus incompréhensible la venue de Catherine de Baillon en Nouvelle-France est la carrière de son frère, Antoine. D'abord page d'Henry Gaston de Bourbon, bâtard du roi Henri IV, évêque de Metz, il devient écuyer, puis premier écuyer du même homme devenu duc de Verneuil. À la mort du duc survenu en 1682, Antoine devient lieutenant de la louveterie du Gand Dauphin de France. Et à son mariage avec Marthe Deruel de Bauregard en 1686, il devient gouverneur du château du Pont-de-l'Arche en Normandie. Ce qui est encore plus surprenant est la liste des personnes qui ont assisté à la signature de son contrat de mariage. Parmi les plus considérables :
Louis XIV
Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France
Louis de France, dauphin
Marie-Anne Christine de Bavière, épouse du dauphin
Charlotte Séguier, duchesse de Verneuil
Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier
Antoinette Servien, duchesse de Sully
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès
Marie-Julie de Sainte-Maure, duchesse d'Uzès
Julie de Crussol
Gabrielle Angélique de La Motte-Houdancourt, duchesse de La Ferté
Françoise-Julie de Grignan, belle-fille de la célèbre épistolaire, madame de Sévigné
Etc.
 Malheureusement, Antoine n'a pas bénéficié longtemps de ses puissantes relations, car il meurt en août 1685 en laissant une épouse enceinte qui meurt en couche en avril 1686.
Malheureusement, Antoine n'a pas bénéficié longtemps de ses puissantes relations, car il meurt en août 1685 en laissant une épouse enceinte qui meurt en couche en avril 1686.
Avec de telles relations, on ne peut faire autrement que se demander pourquoi Catherine de Baillon a quitté la France pour s'établir dans la vallée du Saint-Laurent ? Elle y a épousé Jacques Miville en novembre 1669, donné naissance à sept enfants en onze ans et, rendu l'âme en 1688 à La Pocatière à l'âge de 42 ans. Elle aurait dû normalement vivre la vie que ses sœurs ont eue, et ce, dans le relatif confort du XVIIe siècle. Mais tel n'a pas été son cas. Et en dépit d'une dot de mille livres, Catherine n'aura pas eu la vie facile d'autant plus que son mari a fait faillite en 1675 pour devenir, par la suite, simple fermier de Charles Aubert de La Chesnaye.
Aujourd'hui, Catherine de Baillon compte plusieurs centaines de milliers de descendants en Amérique du Nord. Vous en êtes peut-être un. Qui sait ?
Pour en savoir plus :
OUIMET, Raymond et MAUGER, Nicole, Catherine de Baillon : enquête sur une fille du roi, Sillery, éditions du Septentrion, 2001, troisième tirage, 268 pages.
OUIMET, Raymond, La fortune d'Antoine de Baillon, frère de Catherine, in « Les mémoires de la Société généalogique canadienne-française », vol. 66, no 1, cahier 283, printemps 2014, p. 25 à 31.
Une femme de tête et de coeur : Laurette Larocque dite Jean Despréz
Si les femmes d’aujourd’hui obtiennent leur lot de reconnaissances, elles peuvent remercier leurs devancières qui ont lutté sans relâche pour occuper dans la société une place équivalente aux hommes. Parmi ces devancières : Laurette Larocque dite Jean Despréz.
C’est dans l’ancienne ville de Hull que Laurette Larocque naît le 1er septembre 1906 du mariage d’Adrien Larocque et de Rose-Alma Berthiaume. Adrien Larocque est propriétaire d’une librairie-papeterie à une époque où le livre est rare au Canada français. Cet environnement a très tôt influencé Laurette Larcoque. Non seulement son père fait-il partie du Cercle dramatique de Hull, mais son grand-oncle, Alfred Berthiaume y a joué Michel Strogoff en… 1895 !
Dès l’âge de neuf ans, la petite Laurette organise des séances de théâtre pour ses camarades qui doivent remettre trois pinces à linge pour y assister. Pour s’assurer d’un nombre suffisant de spectateurs, elle confectionne des affiches que ses frères diffusent auprès des marchands.
Laurette fait ses études secondaires au couvent Notre-Dame-de-la-Merci à Aylmer où elle organise nombre de séances de théâtre, dont Les Femmes savantes de Molière. Devenue jeune femme, elle sait provoquer au moyen de ses vêtements. Pis, elle se maquille. René Provost, père de Guy, dit de Laurette : « l’un des plus beaux brins de fille de Hull avec en plus un petit extra qui lui est bien personnel. »
En 1922, Laurette travaille à la librairie de son père où elle dévore à longueur de journée livres et revues de toutes sortes. Puis un jour, elle tombe amoureuse d’un certain Oscar Auger qui a vu le jour à proximité de l’actuel théâtre de l’Île en 1901. Oscar, qui change son nom pour Jacques, est un jeune acteur à la voix grave dont Laurette boit littéralement les paroles, ce qui fait que la jeune femme opte résolument pour faire carrière, elle aussi, au théâtre.
Avec Jacques Auger, Laurette fait des tournées en Outaouais et même à Montréal jusqu’au jour où son amoureux obtient une bourse pour étudier à Paris en 1929. Un an plus tard, et sans crier gare, Laurette va rejoindre son amoureux à Paris. Auger se sent pris au piège. Elle fait tant et si bien, que deux mois après son arrivée en France, elle réussit à se faire épouser par le beau Jacques Auger (25 novembre 1930) qui souvent lui reprochera : « Tu m’as envahi à Paris. » Dans la Ville lumière, Laurette étudie à la Sorbonne et chez des professeurs d’art dramatique. Cependant, le couple connaît rapidement le désenchantement surtout que Jacques boit plus que de raison.
Une femme aux multiples talents
Le couple peine à survivre. Heureusement, Adrien Larocque leur envoie des mandats-poste  régulièrement. Le couple revient au pays en 1933 et Laurette obtient un poste à l’Université d’Ottawa où elle enseigne la diction, la phonétique et la mise en scène. En même temps, elle fonde l’école de spectacle de Montréal. De plus, elle écrit pièces de théâtre et des contes. En 1938, elle obtient son premier rôle de comédienne professionnelle dans le radioroman Vie de famille auprès de Nicole Germain, Mimi d’Estée et Guy Maufette. L’année suivante, elle devient critique de théâtre dans le magazine Radiomonde. Les années 1930 annoncent déjà une femme exceptionnelle.
régulièrement. Le couple revient au pays en 1933 et Laurette obtient un poste à l’Université d’Ottawa où elle enseigne la diction, la phonétique et la mise en scène. En même temps, elle fonde l’école de spectacle de Montréal. De plus, elle écrit pièces de théâtre et des contes. En 1938, elle obtient son premier rôle de comédienne professionnelle dans le radioroman Vie de famille auprès de Nicole Germain, Mimi d’Estée et Guy Maufette. L’année suivante, elle devient critique de théâtre dans le magazine Radiomonde. Les années 1930 annoncent déjà une femme exceptionnelle.
Laurette Larocque est une femme sensuelle. Nombreux sont ceux, et surtout celles, qui lui reprochent ses blouses sans manches, ses décolletés, ses jupes au-dessus des genoux et ses robes moulantes sans compter la cigarette. Elle s’en fout royalement : c’est une femme émancipée et n’entend pas courber l’échine devant l’Église. Deux jolis contes offrant quelques situations osées pour l’époque, entraîne une rupture avec l’Université d’Ottawa dirigée par les Oblats de Marie Immaculée. N’empêche, Laurette écrira une pièce, Le miracle du frère André, qui obtiendra un joli succès au pays.
En 1938, Laurette Larocque s’établit définitivement à Montréal. De mai 1939 à décembre 1943, elle ne publie pas moins de 24 nouvelles dans La Revue moderne tout en jouant au théâtre. De 1940 à 1943, elle écrit le radioroman à succès C’est la vie. Et à partir de 1938, Laurette Larocque commence à écrire sous divers pseudonymes, dont ceux de Carole Richard et Suzanne Clairval. Mais c’est un nom d’homme qu’elle finira par adopter une fois pour toutes – Jean Despréz – parce qu’elle s’est aperçue que trop souvent on lui retournait ses textes sous prétexte qu’une femme n’a pas à se sortir la tête de ses chaudrons !
L’ère de Jean Desprez commence. Elle loue, à trois dollars par mois, une machine à écrire qui crépite sept jours sur sept et produit toute une flopée de radioromans : M’amie d’amour, Jeunesse dorée, Chez Rose, La Marmaille, Docteur Claudine, Yvan l’intrépide. Tous les matins de la semaine, elle collabore à une série d’entrevues à Radio-Canada, avec Jean-Maurice Bailly, qui s’intitule Sur nos ondes.
Deux ans après la naissance de leur fille, le couple Auger-Larocque se sépare. À cette époque, Jean Despréz jouit déjà d’une immense popularité : à la fin des années 1940, elle bénéficie de revenus annuels de l’ordre de 50 000 dollars. En 1944, elle avait collaboré à la réalisation du film Le Père Chopin en écrivant les dialogues. Femme généreuse, Hubert Loiselle dira d’elle : « Quand un comédien était sans le sou, elle lui créait un personnage dans ses feuilletons. »
Une femme malheureuse
 Cette femme-orchestre ne prend guère soin de sa santé ; elle se surmène. Elle souffre de névralgie et de troubles gastriques, s’endort avec des somnifères. (Elle devient quasiment sourde au début des années 1960 et doit porter un appareil auditif dans chaque oreille.) Sa silhouette s’est alourdie et sa vue baisse. Pour mieux cacher son embonpoint, elle donne dans l’élégance tapageuse. Pourtant, cette femme n’a que 45 ans !
Cette femme-orchestre ne prend guère soin de sa santé ; elle se surmène. Elle souffre de névralgie et de troubles gastriques, s’endort avec des somnifères. (Elle devient quasiment sourde au début des années 1960 et doit porter un appareil auditif dans chaque oreille.) Sa silhouette s’est alourdie et sa vue baisse. Pour mieux cacher son embonpoint, elle donne dans l’élégance tapageuse. Pourtant, cette femme n’a que 45 ans !
Elle fait son entrée à la télévision en 1955 quand elle écrit une série de dramatisations historiques Je me souviens et vend, plus tard, l’idée d’un jeu culturel à la télévision d’État : Faites vos jeu. Mais son plus grand succès télévisuel a été le téléroman Joie de vivre qui a tenu l’affiche de 1959 à 1963, soit pendant 4 saisons.
Jean Despréz femme-orchestre ? En voici la preuve. Elle dirige des courriers du cœur tant à la radio (CKLM) que dans les journaux (Photo-Journal et Télé-Radiomonde) et à la télévision (Radio-Canada). Pour accomplir cette tâche, elle s’entoure de spécialistes au besoin. Ainsi, pour nombre de femmes en plein désarroi, Jean Despréz devient synonyme d’espoir
Et pourtant, Jean Despréz n’est pas heureuse. Elle a dit : « J’ai toujours été très mal aimée et très peu longtemps. J’ai raté mes amours complètement. Raté complètement. » Elle accepte mal de vieillir : elle subit 4 lissages en 10 jours. Elle meurt à Montréal dans la nuit du 26 au 27 janvier 1965. Elle a été inhumée au cimetière Notre-Dame, à Gatineau, dans la concession 329B. Le matin de sa mort, Mario Verdon dit, à la radio de CKLM : Elle est morte comme elle a vécu : dans un grand élan de générosité. »
Sources :
Archives du cimetière Notre-Dame de Hull.
BMS 2000.
La Rose, André et Simard, François-Xavier, Jean Despréz (1906-1965), Ottawa, éd. du Vermillon, 2001.
Marcel Chaput : le courage de ses opinions
Peu de gens consacrent toute leur vie à une cause, et ce, même au prix de leur confort personnel. Retour sur la vie d’un ancien Hullois, cofondateur du Rassemblement pour l’indépendance nationale, Marcel Chaput.
Marcel Chaput naît dans l’ancienne ville de Hull le 14 octobre 1918 du mariage de Narcisse Chaput avec Lucia Nantel. Il grandit au 49, rue Maisonneuve et fréquente le collège Notre-Dame des Frères des écoles chrétiennes. Grâce au frère Ernest, le jeune Chaput s’initie aux sciences et plus particulièrement à la chimie. Très engagé dans son milieu, il fonde les Emmaüs de Hull (aujourd'hui Gatineau).
Si son père, Narcisse, était un nationaliste, c’est la servilité de certains des professeurs de Marcel, tant à l’École technique de Hull ainsi qu’à l’Université d’Ottawa, qui poussent le jeune Hullois à s’interroger sur l’avenir des francophones. En effet, plusieurs professeurs des années 1930, et ce, même à Hull, s’ingénient à enseigner exclusivement en anglais parce que c’est la langue de la majorité et celle de la fonction publique fédérale ! Ces lèche-bottes scandalisent Marcel Chaput qui exige le respect de ses droits à étudier et à passer ses examens en français.
Pour au contre le séparatisme ?
Membre du réputé cercle Reboul de Hull, on demande un jour à Marcel de participer à un débat intitulé Pour ou contre le séparatisme. Il demande à l’organisateur : « Quel rôle me réservez-vous ? » – Marcel, je vous vois très bien dans le rôle du « méchant ». Vous êtes pour le séparatisme. C’est alors que Marcel Chaput se documente sur le séparatisme québécois pour enfin devenir séparatiste.
Pendant la guerre, il est technicien en chimie au Conseil national de la recherche du Canada à Ottawa au Chemical Warfare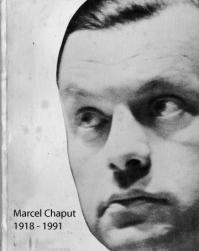 Laboratory. Le conflit terminé, il épouse Madeleine Dompierre, fille d’un boulanger de Hull, pour ensuite aller étudier à l’Université McGill à Montréal où il obtient un doctorat en chimie en 1952. Il revient en Outaouais et réintègre le Conseil national de la recherche du Canada, puis est transféré au ministère de la Défense nationale
Laboratory. Le conflit terminé, il épouse Madeleine Dompierre, fille d’un boulanger de Hull, pour ensuite aller étudier à l’Université McGill à Montréal où il obtient un doctorat en chimie en 1952. Il revient en Outaouais et réintègre le Conseil national de la recherche du Canada, puis est transféré au ministère de la Défense nationale
En 1959, Marcel Chaput fait venir à Hull Raymond Barbeau, chef de l’Alliance laurentienne, avec lequel il se lie d’amitié. Il écrit de nombreuses lettres aux journaux où il prend la défense des « méchants séparatisses » sans s’inquiéter de sa carrière. Il devient une tête d’affiche du mouvement séparatiste québécois dès 1960. Les fédéralistes le voient comme un dangereux agitateur, un illuminé dont la croisade est odieuse et malsaine. Le 10 septembre 1960, il participe à la fondation du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) dont il devient le vice-président.
Le courage de ses convictions
Un jour, à la Chambre des communes, le député néo-démocrate, Douglas Fisher, pose une question au ministre de la Défense : « Ce Marcel Chapoot serait-il par hasard attaché à votre ministère ? » Ce qui fait que quelques semaines plus tard son gestionnaire lui dit : « Je vous préviens que si vous voulez garder votre poste, vous êtes mieux de vous taire. »
Chaput ne se tait pas, au contraire, il continue à donner des conférences. À son lieu de travail, ses collègues le fuient ; on ne lui donne plus de dossiers à traiter. Pendant ses trois semaines de vacances, il rédige un livre : Pourquoi je suis séparatiste. Invité à parler au Congrès des affaires canadiennes à Québec, son employeur lui interdit de prendre congé. Chaput passe outre. À son retour au bureau, il est suspendu pour deux semaines sans salaire. Le 4 décembre 1961, il donne sa démission et quitte la Fonction publique fédérale.
Ses patrons sont fort heureux de sa démission. Et à Hull, nombreux sont les gens qui pensent qu’il est fou ou, à tout le moins, illuminé. Imaginez : quitter un emploi fort rémunérateur pour faire l’indépendance du Québec ! La même année, Chaput devient le président du RIN. Mais il n’a pas une carrière politique très heureuse. À la suite de dissensions au RIN, il fonde le Parti républicain du Québec en novembre 1962, puis se joint au Front républicain indépendant. En 1965, il réintègre le RIN
En 1968, le RIN se saborde pour donne toute la place au Parti Québécois. Bien qu’il n’ait jamais réussi à se faire élire député, Chaput n’abandonnera jamais la cause de l’indépendance du Québec. Et pourtant, cette cause lui coûte cher. Il a de la difficulté à se trouver des emplois. Fâcheuse ironie de l’histoire : l’Université McGill n’a pas hésité pas à lui offrir un poste alors que les universités francophones l’ont abandonné ! Enfin, il se lancera dans les affaires et deviendra commerçant.
 Marcel Chaput n’est pas qu’un homme d’action, mais un homme de réflexion. Il est parmi les premiers au Québec à faire la promotion de la santé naturelle avec le naturopathe Raymond Barbeau. Toujours chimiste, il s’intéresse à la pollution et en 1971, il publie un dossier étoffé intitulé Dossier pollution qui sera vendu à 35 000 exemplaires. Pêcheur assidu dans les îles de Boucherville, il avait pu vérifier la détérioration des conditions de vie de la faune au Québec.
Marcel Chaput n’est pas qu’un homme d’action, mais un homme de réflexion. Il est parmi les premiers au Québec à faire la promotion de la santé naturelle avec le naturopathe Raymond Barbeau. Toujours chimiste, il s’intéresse à la pollution et en 1971, il publie un dossier étoffé intitulé Dossier pollution qui sera vendu à 35 000 exemplaires. Pêcheur assidu dans les îles de Boucherville, il avait pu vérifier la détérioration des conditions de vie de la faune au Québec.
En 1979, il est atteint de la maladie de Parkinson ; il meurt à Montréal le 19 décembre 1991 et est inhumé au cimetière Notre-Dame de Gatineau (Hull). Ironie de l’histoire (encore une fois), c’est une ville à forte minorité anglophone, Aylmer, qui a honoré la mémoire de Marcel Chaput en donnant son nom à une rue, et ce, au grand dam de l’ancien ministre libéral Oswald Parent qui ne pardonnait pas à son concitoyen nationaliste d’avoir eu le courage de ses convictions et sa fierté de Québécois.
Sources:
BRUNET, Jean-Marc, La Patriote, Marcel Chaput et son époque, s.l., l’Ordre naturiste social de Saint-Marc l’Évangéliste, 2006.
Le Droit (Ottawa) 1961, 1991.
Radio-Canada, 14 janvier 1979.
Wikipédia.




