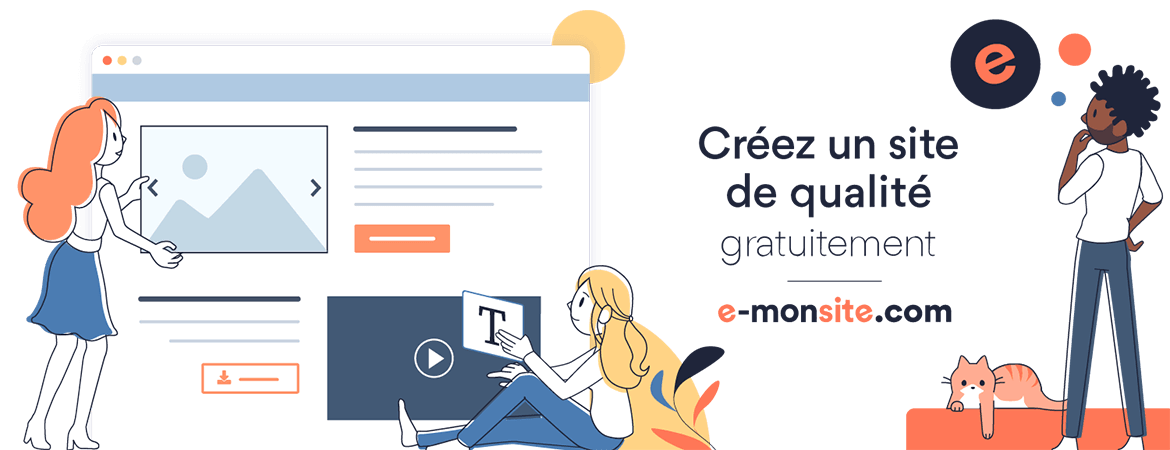Histoire locale
Catégorie qui traite de l'histoire de l'Outaouais.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 17/06/2023
Par
ouimet-raymond
Le 17/06/2023
Il fut une époque où le nationalisme était fort en vogue dans l’ancienne ville de Hull. Au début du XXe siècle, notre Fête nationale était célébrée avec faste, et ce, pendant plusieurs jours même. Il y avait alors une section de la Société Saint-Jean-Baptiste à Hull – il y en aura même une à Masson dont le monument a été détruit il y a quelques années dans l’indifférence générale – qui invitait tout l’Outaouais à « […] affirmer d’une manière bien éclatante l’existence du peuple Canadien français […] » tout en donnant l’assurance de sa loyauté à la couronne britannique. Cela dit, déjà, les Canadiens-Français, dont ceux de Hull et de sa banlieue, savaient qu’ils faisaient partie d’une nation francophone !
En 1911, un comité d’organisation, présidé par un certain Joseph Normand, orchestra une superbe « Fête nationale des Canadiens-Français » qui eut lieu à Hull les 24, 25 et 26 juin. Toute la population de la région, y compris celle d’Ottawa et de sa banlieue, avait été conviée aux célébrations qui promettaient d’être grandioses. De fait, plus de 40 000 personnes y assisteront ! Pendant des jours, des semaines, plus de deux cents bénévoles préparèrent la fête en fabriquant des costumes, en construisant des chars allégoriques et des arcs de triomphe le long d’un parcours où furent appelés à défiler quelques centaines de participants.

La fête commença le samedi 24 juin quand les cadets du Collège Notre-Dame circulèrent dans la ville à bord d’un tramway de la Hull Electric « en faisant entendre sur tout le parcours des chants patriotiques », et ce, pour inviter la population à participer à de grands feux de la Saint-Jean dans deux ou trois endroits de la ville. Des centaines d’édifices et des maisons étaient décorés et pavoisés à profusion et donnaient à l’île de Hull « un coup d’œil féérique».
Les festivités les plus imposantes eurent lieu le dimanche 25 juin – le dimanche était le seul jour férié de la semaine – avec une grand-messe en plein air, accompagnée d’un chœur de 300 voix et d’une fanfare, dans la cour du Collège Notre-Dame, qui était situé dans l’actuelle rue Hôtel-de-Ville. La messe fut célébrée par un certain Père Lambert assisté de deux autres prêtres ; le Père Arthur Guertin, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce et fervent nationaliste, prononça le sermon dans lequel il fit l’éloge du français et de la religion catholique.
Un défilé grandiose
Il était onze heures quand le défilé tant attendu se mit en branle pour parader dans quatorze rues de la ville, soit de la rue Albion (Dollard-des-Ormeaux), jusqu’au parc Dupuis, rue Adélaîde (Sacré-Cœur). Le défilé comprenait six fanfares, dont quatre d’Ottawa, une de Montréal et une de Hull, dix-huit chars allégoriques, tirés par deux, quatre, voire six chevaux, soulignaient les grands personnages et les accomplissements de nos ancêtres. Le premier, rendait hommage à Jacques-Cartier et à Donnacona, un autre à Champlain, puis un autre à Madeleine de Verchère, ensuite à Frontenac, etc. Plus d’une centaine de piétons et de cavaliers représentaient les gouverneurs de la Nouvelle-France, d’autres le Cercle Reboul, celui de Brébeuf, Duhamel, Mazenod, etc., qui se firent une gloire de précéder le char qui rendait hommage à Dollard des Ormeaux
À l’Arc de triomphe de la paroisse du Très-Saint-Rédempteur, des enfants entonnaient des chants joyeux. Sur celui de la rue Saint-Étienne, où il était inscrit « Faisons revivre le passer pour y puiser des leçons de patience et de force », 86 fillettes, portant les couleurs nationales, chantaient à intervalles des chants français. À l’Arc de triomphe de la rue Saint-Henri, on avait installé un petit saint Jean-Baptiste personnifié par… une fillette, Antonia Lacoste ! Et il semble bien que personne ne critiquât ce choix.
Le défilé compta aussi de nombreuses autres organisations de la ville comme l’Alliance nationale, la Société des Artisans Canadiens-Français, l’Ordre des Forestiers catholique, la Société de tempérance, la Ligue antialcoolique, l’Union Saint-Joseph section Très-Saint-Rédempteur, etc. Des milliers de personnes, de chaque côté des rues assistèrent excités au défilé et firent connaître leur appréciation par des cris et de nombreux applaudissements. L’avant-dernier char rendait hommage aux femmes d’ici et avait pour nom « Vive la Canadienne ». Enfin, le dernier était celui de l’enfant saint Jean-Baptiste, personnifié par le fils d’un certain Arthur Courville.
Le défilé s’acheva au parc Dupuis et fut suivi d’un banquet sous la tente avec de nombreux chants et sept discours patriotiques. Celui du docteur Antonio Pelletier, fut très remarqué : il demanda à la Ville de franciser le nom des rues, ce qui ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd, puisque le maire Joseph Urgel Archambault y donnera suite. Puis, ce fut le moment des jeux comme partie de baseball entre un club de Hull et un autre d’Ottawa, de nombreuses courses à pied, de la souque à la corde, etc. Sur la place de l’hôtel de ville, on représenta « L’Attaque et prise du fort de Dollard par les Iroquois » suivit de la « Bataille de Châteauguay ».
banquet sous la tente avec de nombreux chants et sept discours patriotiques. Celui du docteur Antonio Pelletier, fut très remarqué : il demanda à la Ville de franciser le nom des rues, ce qui ne tomba pas dans l’oreille d’un sourd, puisque le maire Joseph Urgel Archambault y donnera suite. Puis, ce fut le moment des jeux comme partie de baseball entre un club de Hull et un autre d’Ottawa, de nombreuses courses à pied, de la souque à la corde, etc. Sur la place de l’hôtel de ville, on représenta « L’Attaque et prise du fort de Dollard par les Iroquois » suivit de la « Bataille de Châteauguay ».
Enfin, on invita la population à assister à une pièce de théâtre, donnée par le Cercle Saint-Jean, à la Salle Notre-Dame, à l’ascension d’un ballon et à un magnifique feu d’artifice. La Fête nationale se termina le lendemain avec le concert de diverses fanfares et la pièce de théâtre La famille sans nom. Jamais, de mémoire d’homme, les Hullois n’avaient assisté à une aussi grandiose Fête nationale.
Puisse cette fierté qui animait nos élites d’affaires et politiques d’antan retombe sur celles d’aujourd’hui pour que l’on mette fin à l’anglicisation de notre ville.
Photographie :
George Courville personnifiait saint Jean-Baptiste.
Sources :
Album-Souvenir de la Fête Nationale des Canadiens-Français célébrée à Hull, les 24 – 25 – 26 juin 1911, Comité de la Saint-Jean-Baptiste de Hull, 1911.
Le Temps (Ottawa), 25, 26, et 27 juin 1911.
Eugène Décosse, l'homme orchestre
![]() Par
ouimet-raymond
Le 18/05/2023
Par
ouimet-raymond
Le 18/05/2023
Il y a à Gatineau, près du boulevard Mont-Bleu, une rue appelée Décosse. Cette rue rappelle le souvenir d’Eugène Décosse, un grand sportif de la région qui a même revêtu le chandail de la sainte Flanelle.
Eugène Décosse a été un grand sportif de la région. Né au 57, rue Wellington à Hull le 9 décembre 1900, du mariage d’Aristide Décosse avec Corinne Barrette, Eugène est un fanatique du sport, et plus particulièrement du hockey ; c’est un gardien de but de grand talent. Il joue pour les Canadiens de Hull, puis pour le Ottawa Royal Canadiens et l’Ottawa New Edinburghs. Au cours de la saison 1918-1919, il remporte six victoires en huit parties, dont cinq par blanchissage ! Il gagne, au cours des années suivantes, deux titres First All-Star et un titre Second All-Star.
En novembre 1924, le Canadien de Montréal invite Décosse à son « camp d’entraînement ». Il obtient un contrat comme agent libre et se rend à Toronto pour l’inauguration de la saison 1924-1925. Le Canadien remporte la victoire au compte de 7 à 1 contre le St. Pat’s. Le gardien en titre du Canadien, Georges Vézina, a été si bon que Décosse a réchauffé le banc toute la partie. Peu après cette partie, le Hullois a été renvoyé à Hull.
A-t-il été déçu de la façon dont il avait été traité par le grand club ? Sans doute. Quoi qu’il en soit, il revient dans la région en compagnie de deux autres joueurs de la sainte Flanelle : René Lafleur et René Joliat, ce dernier frère du fameux ailier gauche du Canadien, Aurèle Joliat, et du futur chef de police d’Ottawa, Émile Joliat.
Eugène Décosse reprend alors sa carrière de hockeyeur dans les rangs amateurs et joue pendant deux saisons pour le Ottawa New Edinburgh’s pour prendre sa retraite définitive à l’âge de 26 ans.
Du sport à la politique
De retour à Hull, Décosse a besoin de mettre  du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.
du beurre sur son pain d’autant plus que son père est mort pendant l’épidémie de grippe espagnole et qu’il s’était marié en 1921. Or, Décosse a une imprimerie à laquelle il se consacre sans pour autant abandonner le sport puisqu’il joue au baseball avec des amis. En 1932, il fonde l’hebdomadaire L’Opinion publique, dont la devise est « Bien faire et laisser braire », pour appuyer la candidature d’Alexis Caron dans la campagne électorale provinciale. Insatisfait des Libéraux, il passe dans le camp de l’Union nationale en 1935.
Membre de l’Association athlétique du Hull-Volant dès 1933, il met sur pied, en 1936, une fameuse équipe de hockey senior, soit celle du Hull-Volant dont il est l’instructeur. Il conduit cette équipe à la finale de l’est de la fameuse coupe Allan après avoir vaincu les équipes de Cornwall, Smith Falls, Moncton et les As de Québec. Malheureusement, l’équipe baissera pavillon devant les puissants Tigres de Sudbury qui alignent plusieurs futures vedettes de la Ligue nationale de hockey.
En 1938, il construit le stade Décosse, rue Laurier (près de l’ancien monastère des Servantes de Jésus-Marie), où s’affronteront des équipes de baseball, des lutteurs, des boxeurs, pendant plusieurs années. C’est alors le lieu le plus achalandé de Hull.
Le sport continue à jouer un grand rôle dans la vie de Décosse. Il préside les destinées de la Ligue de baseball interprovincial et la Ligue de la cité de Hull, il est aussi directeur de l’équipe nationale de baseball à Ottawa et… gérant de l’Auditorium d’Ottawa ! Véritable homme-orchestre. il se lance en politique municipale en 1941 et est élu à deux reprises conseiller du quartier Laurier. En 1945, il décide de se présenter à la mairie de Hull contre le populaire Raymond Brunet qui a mis fin au P’tit Chicago. Alertés par les bien-pensants qui craignaient cet homme non conformiste qui pourfendait le bon chef de police Adrien Robert, le clergé et la presse unissent leurs efforts pour lui barrer la route. Décosse est défait par un peu plus de mille voix. Mais comme il est un valeureux soldat de l’Union nationale qui a remporté le scrutin provincial de 1944, le voici nommé « chef de la police provinciale pour le district de Hull » ! Sa femme dira plus tard : « Eugène ne savait pas se servir de son revolver et je pense même qu’il avait un peu peur de cette arme. »
Eugène travaille 16 à 18 heures par jour. Et malgré ses positions politiques, il ne rechigne pas à venir en aide à des gens d’un camp autre que le sien. En 1953, son journal, L’Opinion publique cesse ses opérations. Peu de temps après cette fermeture, Eugène Décosse subit un infarctus et, le 2 janvier 1955, il meurt d’un arrêt cardiaque.
Sources
http://wwweyesontheprize.blogspot.com/2007_04_01_archive.html
Le Régional (Hull) 26 mars 1985.
La Revue,(Gatineau) 26 mars 1985.
TROTTIER, Jean-Claude, Le Petit Hull-Volant (1932-2007), Gatineau, 2009.
À l'origine de Gatineau l'ancienne : la C.I.P.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 22/04/2023
Par
ouimet-raymond
Le 22/04/2023
Avant l’arrivée de la Canadian InternationaI Paper (C.I.P.), l’ancienne ville de Gatineau n’existait pas et son futur territoire faisait partie de la municipalité de Templeton-Ouest (Sainte-Rose-de-Lima). En 1925, le conseil municipal entreprenait des démarches auprès de la C.I.P. pour intéresser cette dernière à acheter des terrains à Templeton-Ouest pour y construire une usine de fabrication de papier. À cette époque, l’industrie du bois était encore florissante en Outaouais où on trouvait non seulement la E.B. Eddy et la MacLaren, mais aussi la Gilmour & Hughson et de nombreuses autres scieries.
La C.I.P. était issue de la St. Maurice Lumber Company acquise par l’entreprise étasunienne International Paper Company. En 1925, la C.I.P. achetait les actifs de la Riordon Pulp and Paper qui avait des territoires forestiers et des droits de coupe au Québec. Mais pour exploiter ses actifs, la C.I.P. devait, selon la loi, transformer au Québec le bois récolté dans cette province. En 1926, la C.I.P. fit l’acquisition des belles terres agricoles des Berlinguette, des Dugal-Dupras, des Davidson, des Goyette, des Madore, etc., qui vendirent leur propriété parfois à leur corps défendant.
Le chantier de construction, confié à la firme Fraser Brace Company qui embauche les ouvriers au nombre de 3 000, s’érige dès le mois de mai 1926. Les travaux de construction se font si rapidement que l’usine démarre ses opérations le 6 avril 1927. On y fabrique alors deux types de pâtes : la pâte mécanique (défibreur) et la pâte chimique (bisulfite).
L’usine est équipée de quatre machines à papier fabriquées par la Dominion Engineering Works de Montréal qui produisent quotidiennement 545 tonnes de papier. L’usine emploie alors de 1 000 à 1 500 travailleurs selon les saisons.
Fondation du village de Gatineau
La municipalité de Templeton-Ouest ne profitera pas longtemps des taxes foncières payées par la C.I.P. parce qu’en 1933, l’agglomération de Gatineau, qui compte déjà 2 000 habitants à 90% francophones, se détache de la municipalité pour s’incorporer en village. Treize ans plus tard, soit en 1946, le petit village deviendra Ville de Gatineau (souvent appelé Gatineau Mills à cause des panneaux d’affichage de la C.I.P. : Gatineau Mills’ Plant.)

La C.I.P dans les années 1930.
En 1935, la C.I.P. faisait l’acquisition d’une cinquième machine à papier journal qui ne sera pas employée à cause de la crise économique. Toutefois, au début des années 1940, la machine sera convertie pour fabriquer de la pâte de rayonne qui servait alors au tissage des parachutes, très en demande à cause de la guerre. On ajoutera une sixième machine qui épaulera celle-ci pour répondre aux besoins suscités par le conflit mondial.
La fabrication du Ten/Test
En 1927, MM. Wiser et Timmins avaient créé une entreprise de transformation des résidus de bois de l’usine de papier journal de la C.I.P de Gatineau pour y produire du carton goudronné, et des tuiles acoustiques. La C.I.P. l’acheta l’année suivante et la nomma International Fibre Board Ltd pour ensuite commercialiser le carton-planche dur sous le nom bien connu de Ten/Test. En 1939, la C.I.P et Masonite Corporation forma une société commune qui construisit une usine de carton-planche vulcanisé, toujours à partir des résidus de l’usine de papier journal, le Masonite. En 1945, la C.I.P. érigea une usine de contreplaqués pour utiliser les bois feuillus de ses territoires de coupe. En 1947, la Commercial Alcohols Ltd s’installa à Gatineau, à proximité de la papeterie. Elle utilisera la liqueur issue de la cuisson des copeaux pour fabriquer de l’alcool de type commercial.
Toutes ces entreprises satellites de la C.I.P cessèrent leurs activités entre 1970 et 1990. Je souligne que l’ancienne Gatineau Power Company, incorporée en 1926 et propriétaire de plusieurs barrages et usines de production d’électricité en Outaouais de même qu’au Nouveau-Brunswick et en Ontario (nationalisée par le Québec en 1963), était aussi la propriété de l’International Paper.
En 1989, la C.I.P. devint Produits forestiers Canadien Pacifique ltée qui changea son nom pour Avenor inc. en 1994. Quatre ans plus tard, l’usine passa aux mains de la société étasunienne Bowater qui fusionnera avec Abitibi Consolidated en 2007 pour devenir Produits forestiers Résolu en 2011.
SOURCES
BAnQ-Outaouais.
HARDY, Mireille, De courage et de fierté – Courage and Pride 1927 – 2002.
MASSIE, J. Marcel, Histoire de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney, tomes 1 et 2, s.l. s.d.
HAR
Hull : du centre-ville au centre-vide
![]() Par
ouimet-raymond
Le 02/03/2023
Par
ouimet-raymond
Le 02/03/2023
Le centre-ville de l’ancienne ville de Hull a commencé à se développer dans le dernier quart du XIXe siècle. Mais la construction du pont Royal Alexandra (Interprovincial) va beaucoup ralentir son développement. Le commerçant de la rue Victoria, Basile Carrière, l’avait prévu en disant que si on construisait ce pont, les Hullois iraient acheter à Ottawa, rue Rideau, où les établissements commerciaux étaient plus nombreux et plus gros. C’est ce qui est arrivé.
Dans les années 1940 et 1950, la rue Rideau, à Ottawa, était fort achalandée et moult clients des nombreux magasins diversifiés provenaient de l’Outaouais. Ces gens avaient une nette préférence pour les grands magasins comme Caplan’s, Freiman et Larocque qui, plus est, étaient situés tout à côté du marché By et des grands hôtels de la capitale fédérale. Seuls se développaient à Hull à une vitesse accélérée les débits de boisson, car les heures d’ouverture de ces commerces étaient plus longues au Québec qu’en Ontario. Aussi, les Ottaviens venaient s’amuser en grand nombre sur la rive gauche de l’Outaouais dans des boîtes de nuit telles Chez Henri et Standish Hall ou encore dans les hôtels comme l’Interprovincial et le Windsor.
Néanmoins, le centre-ville de Hull se développait vaille que vaille rues Principale (Promenade du Portage) et Eddy, ainsi qu’à proximité de ces artères commerciales, où le consommateur trouvait pas mal tout ce dont il avait besoin. Il y avait des commerces importants comme les magasins à rayons multiples Pharand[1] (rue Champlain), Beamish, Metropolitan et Woolworth, des quincailleries, des restaurants, et même trois marchés d’alimentation : Dominion, A. L. Raymond et Steinberg. Le vieux Hull était aussi doté de lieux de divertissements, autres que des débits de boisson, comme le théâtre Laurier (1 250 sièges), le cinéma Cartier, de salles de quilles, de quatre salles de billard, de centres de loisirs paroissiaux et d’un rolostade au Pavillon Alouette, rue Eddy, un aréna, etc. On peut même dire que les rues Eddy et Principale étaient tapissées de vitrines où, les soirs et journées de congé, les Hullois allaient admirer les étalages.
Pharand[1] (rue Champlain), Beamish, Metropolitan et Woolworth, des quincailleries, des restaurants, et même trois marchés d’alimentation : Dominion, A. L. Raymond et Steinberg. Le vieux Hull était aussi doté de lieux de divertissements, autres que des débits de boisson, comme le théâtre Laurier (1 250 sièges), le cinéma Cartier, de salles de quilles, de quatre salles de billard, de centres de loisirs paroissiaux et d’un rolostade au Pavillon Alouette, rue Eddy, un aréna, etc. On peut même dire que les rues Eddy et Principale étaient tapissées de vitrines où, les soirs et journées de congé, les Hullois allaient admirer les étalages.
Mais voilà, édiles politiques et gens d’affaires, envieux du développement de la cité transpontine nantie de plusieurs dizaines d’immeubles à bureaux, réclament à cors et à cris la construction d’édifices fédéraux à Hull afin de pouvoir y faire croître les activités commerciales. En même temps, les autorités politiques fédérales cherchent à donner un visage bilingue à la Région de la capitale fédérale en établissant plusieurs de ses ministères à Hull.
Un miroir d’Ottawa
À la fin des années 1960, la Ville de Hull concocte un plan de « rénovation urbaine » de l’île de Hull qui entraîne la démolition de plus de 1 500 logements occupés par environ 6 000 personnes, soit 27% de la population du quartier. Bien que l’on construise de nombreux édifices fédéraux où travaillent désormais plusieurs milliers de fonctionnaires et que celui appelé Place (sic) du Centre soit doté de deux étages à usage commercial, les  magasins du centre-ville se mettent à péricliter. En effet, la population du vieux Hull privilégie désormais les centres commerciaux Place Cartier et Galeries de Hull construits au début des années 1960 d’autant plus qu’elle répugne à magasiner dans les tours à bureaux où la marchandise en vente est plus chère qu’ailleurs à cause du prix excessif des loyers. Pas plus fous que le reste de la population, les fonctionnaires magasinent dans les grands centres commerciaux plutôt qu’à la porte de leur bureau. Aussi, la vocation commerciale de Place du Centre est un échec.
magasins du centre-ville se mettent à péricliter. En effet, la population du vieux Hull privilégie désormais les centres commerciaux Place Cartier et Galeries de Hull construits au début des années 1960 d’autant plus qu’elle répugne à magasiner dans les tours à bureaux où la marchandise en vente est plus chère qu’ailleurs à cause du prix excessif des loyers. Pas plus fous que le reste de la population, les fonctionnaires magasinent dans les grands centres commerciaux plutôt qu’à la porte de leur bureau. Aussi, la vocation commerciale de Place du Centre est un échec.
La diminution de la population de l’île de Hull, qui est passée de 22 000 à 10 000 habitants en 25 ans, à la suite des expropriations, d’incendies criminels, de la réduction de la taille des familles, de la spéculation foncière et de la construction de centres commerciaux, aura entraîné la transformation du centre-ville en centre-vide bitumineux qui, avec ses nouvelles tours à logements dispendieux et aux noms à consonance anglo-saxonne tels le Vibe, le Viù, le We font que le vieux Hull perd son identité et devient un peu plus chaque jour le miroir d’Ottawa. La preuve en est qu’un jour, un couple de touristes m’a abordé, rue Laurier, pour me demander la direction à suivre pour Gatineau ; il se croyait encore à Ottawa !
En 1985, l’ancien ministre et député du comté, Oswald Parent, dira « n’avoir qu’un seul regret : celui de ne pas avoir réussi à faire disparaître le vieux Hull ![2] » L’île de Hull est désormais conçue non pour répondre aux besoins de ses habitants, mais pour séduire des promoteurs, des investisseurs (spéculateurs), des touristes.
Illustrations
1. Une partie de l’île de Hull dans les années 1940. (E.B. Eddy, PHO-579)
2. La rue Maisonneuve après la démolition des maisons du côté ouest. (CRAO P64-01-9)
Sources :
BOUCHARD, Daniel, Quand les béliers mécaniques frappaient aux portes du vieux-Hull, dans « Hier encore », no 3, 2011.
Le Droit (Ottawa), 17 mai 1985.
GUITARD, Michelle, entretien avec l’auteur 23 février 2023.
NADEAU, Jean-François, Pour que cesse la destruction des habitations, dans Le Devoir (Montréal), 27 février 2023.
POIRIER, Roger, Qui a volé la rue Principale, Montréal, Les éditions Départ, 1986.
THÉORÊT, Hugues, Dehors tout le monde, dans « Hier encore », no 3, 2011.
[1] Le magasin à rayons multiples de Josaphat Pharand, sera vendu à Thomas Moncion, puis à Georges Champagne, père d’Andrée qui a personnifié Donalda dans Les belles histoires des pays d’en-haut.
[2] Le Droit (Ottawa), 17 mai 1985. Triste farce : Parent sera honoré du titre de « bâtisseur de Hull » en 1995.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 04/02/2023
Par
ouimet-raymond
Le 04/02/2023
Quel puissant sentiment que celui de l’amour ! Il peut tout autant rendre heureux que malheureux ; il peut faire perdre la tête ou susciter la haine. Mais qui voudrait s’en passer ? Retour sur des amours d’autrefois.
Il est difficile de résister à l’amour surtout pour un homme de la famille Papineau mis en présence d’une douce et jolie jeune femme intelligente. De fait, peu d’hommes peuvent se passer de la plus belle créature du monde ! Amédée Papineau, fils de l’illustre Louis-Joseph disait : Quant aux récréations dignes de l’homme, je n’en connais que quatre : les livres d’abord, puis les femmes, et la chasse et la pêche. Donnez-les-moi et mon paradis terrestre est complet. Disons que je n’aurais pas classé ces quatre « récréations » dans le même ordre !…
Louis-Joseph Papineau était tombé amoureux, à l’âge de 78 ans. Il avait alors éprouvé pour une jeune couventine de 15 ans, Marie-Louise Globensky, une « amitié amoureuse » qui se manifestait dans sa correspondance. Ainsi, lui a-t-il écrit : Vienne le mois de juillet que vous soyez caressée […] que vous dormiez bien pendant la nuit sans que cela vous empêche de vous étendre sur mes genoux quand vous voudrez et aussi quand je vous en prierai […]
Mais revenons à Amédée. Veuf depuis 1890, il avait à son emploi une jeune fille, Jane  Curren, qu’il a adoptée vers 1894 et lui a donné le prénom de Iona. L’année suivante, il en tombait amoureux ; elle avait 23 ans et lui en avait… 76 !. Est-ce elle qui lui a ouvert sa couche un soir du mois de mai 1896 ou si c’est Amédée qui a trouvé le moyen de s’y glisser ? L’Histoire nous enseigne que ce sont généralement les maîtres qui s’imposent dans le lit des domestiques. D’ailleurs, on se demande bien comment le barbon pouvait séduire une femme de 53 ans sa cadette – il aurait pu être son grand-père ! Quoi qu’il en soit, il a épousé sa fille adoptive à New York le même mois. De ce mariage, naîtront deux enfants : Lafayette en 1897 et Angélita en 1901, soit 82 ans après la naissance de son père qui meurt à l’automne 1903.
Curren, qu’il a adoptée vers 1894 et lui a donné le prénom de Iona. L’année suivante, il en tombait amoureux ; elle avait 23 ans et lui en avait… 76 !. Est-ce elle qui lui a ouvert sa couche un soir du mois de mai 1896 ou si c’est Amédée qui a trouvé le moyen de s’y glisser ? L’Histoire nous enseigne que ce sont généralement les maîtres qui s’imposent dans le lit des domestiques. D’ailleurs, on se demande bien comment le barbon pouvait séduire une femme de 53 ans sa cadette – il aurait pu être son grand-père ! Quoi qu’il en soit, il a épousé sa fille adoptive à New York le même mois. De ce mariage, naîtront deux enfants : Lafayette en 1897 et Angélita en 1901, soit 82 ans après la naissance de son père qui meurt à l’automne 1903.
Le coup de foudre
ll n’y a pas d’âge pour le coup de foudre, surtout quand on est en manque de tendresse ! Ainsi, un mardi soir du mois d’août de 1906, le docteur Gustave Paquet, 47 ans et veuf depuis 4 ans, et Annonciade Routhier, une veuve de 49 ans, sont présentés l’un à l’autre par des amies communes qui cherchent à former un couple avec ces deux âmes esseulées. Contre toute attente, à part le fol espoir des deux entremetteuses, les deux veufs se plaisent tant qu’on ne peut expliquer la suite des événements que par un coup de foudre réciproque. En effet, les deux amoureux décident, dans les heures suivant leur rencontre de s’épouser le plus rapidement possible, et pourquoi pas, le lendemain même ? Ainsi, le mercredi, les nouveaux amoureux réussissent à signer un contrat de mariage (c’est beau de perdre la tête, mais quand même…) à obtenir une dispense de trois bans de mariage et à se marier en soirée à l’église Notre-Dame-de-Grâce à Hull. Même à Las Vegas on ne fait pas mieux !
Tous ne sont pas prêts à s’engager aussi rapidement, mais il y en a plus qu’on ne le croit généralement. Sam Renaud était un cultivateur du canton de Masham âgé de 60 ans et veuf depuis un certain temps. Un beau jour de 1908, il fait la connaissance d’une veuve de 41 ans nommée Sarah Meunier. Les deux âmes esseulées ne se sont vues que deux fois en trois semaines, quand ce coquin de Cupidon pousse soudainement Sam à demander Sarah en mariage. Enchantée, la quadragénaire accepte la demande de Sam. En femme d’expérience, elle mandate son notaire pour qu’il rédige un contrat de mariage dans lequel son soupirant doit lui faire un don de 200 dollars. Le contrat signé, Sam prépare le mariage. Ainsi, le dimanche 13 septembre 1908, les deux amoureux se rendent à l’église Sainte-Cécile. Sarah s’assoit dans le premier banc, et Sam tout à l’arrière. Quand le prêtre dit Ite missa est – la messe est finie – Sam s’imagine que Cupidon est en train de lui jouer un mauvais tour. Il se lève, hésite un instant, puis quitte l’église précipitamment en abandonnant à sa peine Sarah.
Six semaines plus tard, Sarah apprend que Sam… a convolé avec une autre veuve, Agnès Desjardins, à qui il a fait, auparavant, une donation de… 500 dollars ! C’en était trop. Sarah ne pouvait laisser l’affront impuni et son cœur meurtri sans soins ou sans consolation. C’est alors qu’elle décide de poursuivre Sam en justice. À son avis, seul un dédommagement de 999 dollars pouvait rétablir la cadence des battements de son cœur. Mais c’était trop demandé pour un organe qui battait quand même depuis 41 ans ! – le juge lui aura adjugé la somme de… 375 dollars !
La lettre d’amour
Qui dit amour dit aussi lettre d’amour. J’en ai trouvé une qu’a écrite Louise Ouimet en 1943, sans doute à la suite d’une fausse couche. Épouse de Fernand Cousineau, elle avait alors 22 ans et perdu son seul et unique enfant en mai 1942 :
Fernand Cousineau, elle avait alors 22 ans et perdu son seul et unique enfant en mai 1942 :
Hull, le 2 décembre 1943. C’est à l’occasion de ton anniversaire de naissance que je viens te faire mes vœux de bon souhait. Je te souhaite de tout mon cœur et toutes mes forces Bonne Fête, santé, bonheur, longue vie, et beaucoup de succès dans tes entreprises. La raison pour laquelle je ne puis te les souhaiter de vive voix est que j’ai le cœur bien gros et je ne pourrais pas les souhaiter à mon aise comme je le voudrais et c’est pour cela que je les fais sur ce bout de papier. Mais crois-moi, c’est des vœux sincères que je t’ai faits. Je te fais ce petit cadeau, ce n’est pas grand-chose, mais je crois que tu l’apprécieras. J’aurais voulu faire plus pour toi, car tu es mon unique amour et j’apprécie tout ce que tu fais pour moi. Tu es le meilleur mari qu’une personne peut avoir pour sure (sic). De ta femme qui ne t’oublie pas et qui t’aime et t’aimera toujours sois sans crainte. Louise qui t’embrasse bien fort.
Louise est décédée le 7 octobre 1995 à Gatineau, sans postérité, huit ans après son mari, Fernand.
SOURCES
Documentation familiale personnelle.
OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1994.
PAPINEAU, Amédée, Journal d’un fils de la liberté 1838-1855, texte établi avec introduction et notes par Georges Aubin, Sillery, 1998.
Gatineau : les parcs d'attractions d'autrefois (suite)
![]() Par
ouimet-raymond
Le 11/01/2023
Par
ouimet-raymond
Le 11/01/2023
C’est en 1924 que l’on parle d’aménager un nouveau parc d’attractions en Outaouais. En avril 1925, la Belmont Amusement Company lance sa construction dans l’ancienne ville de Hull, quartier Val-Tétreau, sur le site de l’actuel parc Moussette[1]. Le lieu, qui a été nommé Luna Park dans le but évident d’y attirer la population ottavienne, est inauguré le 16 mai suivant devant une grande foule ébahie. : 20 987 personnes en visiteront les installations en seulement 1½ journée. Le parc compte de nombreuses attractions dont un manège de chevaux de bois, un chemin de fer miniature, un manège de véritables poneys, une Fun House, une plage, une piste de danse, une piste de patins à roulettes et des montagnes russes, appelées Sky Chaser, longues de 1,6 kilomètre, le tout illuminé par des milliers d’ampoules électriques.
Un an après son inauguration, le parc se voit doter de nouveaux équipements, dont une autochenille, un carrousel d’aéroplanes et de scooters, des autos tamponneuses et des balançoires ; on y présente aussi des films et des vaudevilles. En 1927, on propose la construction d’une piscine de 60 mètres sur 15 qui ne semble pas avoir vu le jour ; les pistes de danse et de patins à roulettes ainsi que les montagnes russes sont alors les attractions les plus populaires du parc.
de nouveaux équipements, dont une autochenille, un carrousel d’aéroplanes et de scooters, des autos tamponneuses et des balançoires ; on y présente aussi des films et des vaudevilles. En 1927, on propose la construction d’une piscine de 60 mètres sur 15 qui ne semble pas avoir vu le jour ; les pistes de danse et de patins à roulettes ainsi que les montagnes russes sont alors les attractions les plus populaires du parc.
Le 5 septembre 1928, la Belmont Park Amusement organise un marathon de danse de 72 heures sous la supervision médicale du docteur Laverdure. Quatorze couples participent au concours. Mais le lendemain midi, alors que 7 couples sont encore en compétition, le maire de Hull, Théo Lambert, ordonne la fin du marathon. Les dirigeants du parc mettent alors fin au marathon après 25 heures de danse alors que 5 couples se trémoussaient encore sur la piste de danse ; ils recevront 10 dollars chacun pour leur performance.
Des alligators en cavale
En février 1929, la Belmont Amusement vend le parc Luna à des investisseurs locaux et c’est un parc rénové qui ouvre ses portes le 18 mai avec les marathons de danse qui reviennent à l’ordre du jour. On a ajouté un petit jardin zoologique et un manège appelé The Whip. Le zoo compte des alligators, des cerfs, des ours et des singes. Le 12 juillet, 2 des 26 alligators, importés de Floride, s’échappent du parc alors qu’on était en train de les mettre dans un aquarium. On en attrape un, non sans mal, le lendemain après-midi. Les dirigeants du parc promettent alors une récompense de 25$ à qui capturera vivant l’animal en cavale et 10 $ ainsi que la peau du reptile à qui l’attrapera mort. On ne sait pas si le second alligator a été capturé.
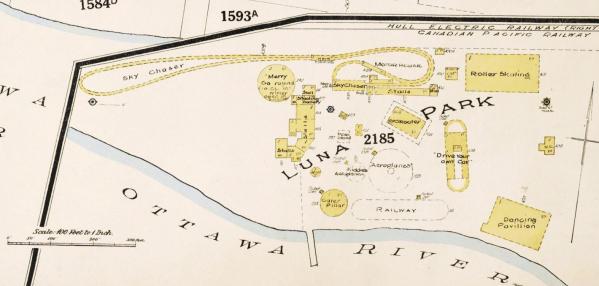 En 1931, le parc Luna est pourvu d’une piste d’athlétisme, d’un parc de baseball et d’un terrain de pique-nique. Spectacles et concours complètent les attractions du parc Luna comme des marathons de chaises berceuses et de danse, ainsi que des spectacles d’acrobates. Mais ces attractions ne font pas toutes l’unanimité. En effet, le jeudi 5 octobre 1933, environ 200 étudiants et des citoyens indignés, venus principalement d’Ottawa, envahissent le parc d’attractions et manifestent contre la tenu de marathons de danse commencés le 15 juillet précédent et qui devaient continuer pendant encore une semaine. Le Local Council of Women’s d’Ottawa estime alors que ces marathons sont tout simplement dégoûtants ainsi que mauvais pour la santé et demandent à la Ville d’Ottawa de faire en sorte qu’il n’y ait pas de tels événements dans la capitale.
En 1931, le parc Luna est pourvu d’une piste d’athlétisme, d’un parc de baseball et d’un terrain de pique-nique. Spectacles et concours complètent les attractions du parc Luna comme des marathons de chaises berceuses et de danse, ainsi que des spectacles d’acrobates. Mais ces attractions ne font pas toutes l’unanimité. En effet, le jeudi 5 octobre 1933, environ 200 étudiants et des citoyens indignés, venus principalement d’Ottawa, envahissent le parc d’attractions et manifestent contre la tenu de marathons de danse commencés le 15 juillet précédent et qui devaient continuer pendant encore une semaine. Le Local Council of Women’s d’Ottawa estime alors que ces marathons sont tout simplement dégoûtants ainsi que mauvais pour la santé et demandent à la Ville d’Ottawa de faire en sorte qu’il n’y ait pas de tels événements dans la capitale.
Les heures du parc Luna sont comptées, car la crise économique qui a commencé lors du krach boursier de 1929 appauvrit de plus en plus tant la population de l’Outaouais que celle d’Ottawa et les propriétaires du parc d’attractions sont désormais incapables d’acquitter leurs taxes foncières. Aussi, la Ville de Hull saisit le parc pour arrérages de taxes municipales en décembre 1936. En septembre de l’année suivante, la Ville procède à la démolition des montagnes russes et en février 1939 renomme le parc Moussette du nom du sulfureux maire de Hull.
La fin des attractions principales
En juin 1942, le parc d'attractions ouvre à nouveau ses portes. Il compte encore plusieurs manèges qui sont gérés par le Daniel’s Greater Shows and Carnivals. Mais à la suite de pressions venant de plusieurs curés, la Ville décide de fermer le parc au public à 22h30 afin de calmer les opposants. Mais cette décision ne satisfait pas la population du quartier qui, le 30 juin, adresse une pétition au conseil municipal :
Nous, de la jeunesse de la paroisse N.-D.-de-Lorette de Val-Tétreau, désirons nous préserver de l’ambiance désastreuse au point de vue (sic) moralité, et, en particulier dans notre paroisse ; nous, appuyés des soussignés, demandons au Conseil Municipal (sic) de Hull de prendre les moyens à sa disposition pour faire disparaître de chez-nous, la principale cause d’immoralité, le parc Moussette, lequel attirant ici ce qu’il y a de moins désirable, est par le fait la cause première du scandal (sic) et de l’immoralité qui gâte notre jeunesse.
 En effet, il se pratique des jeux illégaux dans ce parc qui se veut familial, ce qui a eu pour effet de soulever l’ire des familles du quartier. Aussi, les autorités municipales séviront contre les contrevenants et dix ans plus tard, il ne restera plus qu’une plage, une aire de pique-nique, un restaurant et la piste de patins à roulettes gérée par le promoteur hullois Léo Gratton.
En effet, il se pratique des jeux illégaux dans ce parc qui se veut familial, ce qui a eu pour effet de soulever l’ire des familles du quartier. Aussi, les autorités municipales séviront contre les contrevenants et dix ans plus tard, il ne restera plus qu’une plage, une aire de pique-nique, un restaurant et la piste de patins à roulettes gérée par le promoteur hullois Léo Gratton.
Illustrations :
- Manège du parc Luna dans les années 1930. BAnQ 07H,P28,D292.
- Plan d’incendie du parc Luna, Hull, 1928. BAnQ-Gatineau.
- Entrée du parc Moussette, ca 1946. Archives Ville de Gatineau, VG,P064-02,0021,p0004,2.
Sources :
BAnQ-Gatineau, dossier Parc Luna.
Le Droit (Ottawa), 1924-1952.
The Ottawa Journal (Ottawa), 1929-1942.
[1] L’auteur remercie Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Gatineau pour sa collaboration dans cette recherche sur le parc Luna/Moussette.
Gatineau : les parcs d'attractions d'autrefois
![]() Par
ouimet-raymond
Le 03/01/2023
Par
ouimet-raymond
Le 03/01/2023
Il y a eu au moins trois parcs d’attractions sur le territoire actuel de Gatineau : le parc Queen’s Park (1896-1921), le parc Belle Isle (1912) et le parc Luna/Moussette (1925-1936 et 1942-1952).
C’est en 1896 que la Hull Electric Company,  une entreprise de transport en commun, crée le parc Queen. nommé ainsi en l’honneur de la reine Victoria, pour inciter la population à utiliser ses tramways dont un circuit relie Hull à Aylmer. Le parc, situé à environ 3 kilomètres au nord-ouest de l’actuelle marina d’Aylmer, dans le quartier des Cèdres, s’étend alors sur une surface de 27 hectares, dont une partie est boisée. On y a construit un grand pavillon et un carrousel de chevaux. Il y a une très belle plage qui convient aux enfants puisqu’ils peuvent marcher dans l’eau sur une distance de près de 100 mètres sans être submergés. Dix ans plus tard, le parc comptera de nombreuses attractions supplémentaires dont un terrain de balle, une glissade d’eau située au-dessus d’un auditorium, un studio de photo, un kiosque à musique, un quai avec le pavillon du club de voile et un labyrinthe qui compte 124 portes et surnommé The Mystic Moorish Maze. Viendront s’ajouter par la suite un scope (cinéma), une galerie des miroirs, une patinoire pour patins à roulettes et une cage à ours.
une entreprise de transport en commun, crée le parc Queen. nommé ainsi en l’honneur de la reine Victoria, pour inciter la population à utiliser ses tramways dont un circuit relie Hull à Aylmer. Le parc, situé à environ 3 kilomètres au nord-ouest de l’actuelle marina d’Aylmer, dans le quartier des Cèdres, s’étend alors sur une surface de 27 hectares, dont une partie est boisée. On y a construit un grand pavillon et un carrousel de chevaux. Il y a une très belle plage qui convient aux enfants puisqu’ils peuvent marcher dans l’eau sur une distance de près de 100 mètres sans être submergés. Dix ans plus tard, le parc comptera de nombreuses attractions supplémentaires dont un terrain de balle, une glissade d’eau située au-dessus d’un auditorium, un studio de photo, un kiosque à musique, un quai avec le pavillon du club de voile et un labyrinthe qui compte 124 portes et surnommé The Mystic Moorish Maze. Viendront s’ajouter par la suite un scope (cinéma), une galerie des miroirs, une patinoire pour patins à roulettes et une cage à ours.
Le parc Queen devient vite populaire et, dès l’été 1899, les tramways de la Hull Electric y transportent 500 000 passagers, dont 12 000 en une seule journée. Un arrêt est situé juste devant le splendide hôtel Victoria alors considéré comme étant l’un des meilleurs centres de villégiature du Canada et le plus grand hôtel à l’ouest de Montréal.
Des excursions sur l’Outaouais
Un bateau, le Bella Ritchie, offrait, depuis 1895, des excursions jusqu’aux chutes des Chats. Selon Richard Bégin, de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, cette randonnée était tellement populaire que, l'année suivante, la Hull Electric Railway Company nolise le G.B. Greene de la Upper Ottawa Improvement Company pour effectuer des randonnées similaires. Ce vapeur à roues à aubes est plus spacieux et élégant que le Bella Ritchie : il peut recevoir 250 personnes et filer à une vitesse de croisière de 21 kilomètres à l'heure. On y compte pas moins de neuf membres d'équipage. Le Bella Ritchie ne peut résister à pareille concurrence et son capitaine abandonne la partie. Le 6 juillet 1911, alors que le G.B. Greene s'apprête à partir et que ses passagers accourent, une partie du quai du Queen's Park s’effondre. Heureusement, personne ne se noie, mais une trentaine de personnes se retrouvent à l'eau.
Dans la nuit du 27 juillet 1916, un incendie éclate à bord du G. B. Greene, amarré à Quyon, et fait quatre victimes. Le bateau est reconstruit en plus petit et plusieurs milliers de personnes continueront de profiter des excursions estivales aux chutes des Chats. Vers 1918, les propriétaires du bateau en cessent l’exploitation. La Chat Falls Navigation prend lors la relève pour abandonner le service dès 1921.
Les incendies finiront par mettre fin à l’exploitation du parc Queen. Le réputé hôtel Victoria brûle le 15 décembre 1915 peu avant l’incendie du bateau à vapeur G.B. Greene en 1916. Puis le pavillon du Victoria Yacht Club, situé à l’extrémité du quai du parc et qui a connu ses années de gloire au lendemain de la Première Guerre mondiale, est détruit par un incendie en 1921, la même année que le grand feu du 10 août au centre de la ville d’Aylmer.
Le parc Belle Isle
Vers 1910, un groupe d’homme d’affaires fonde la Belle Isle Park Co. Ltd qui inaugure son parc d’attractions sur l’île Kettle le 16 juin 1912. On y trouve un manège doté entre autres d’un immense carrousel muni d’un orgue électrique reproduisant les sons d’une fanfare de 65 instruments et de même que des montagnes russes. Le parc comprend aussi des balançoires, un scope (La Gaieté), un champ de baseball, un restaurant, un lieu aménagé pour les pique-niques familiaux, etc. C’est donc là que des milliers de personnes de la région se rendent, toutes les fins de semaine, pour assister à des matchs de boxe, de lutte, de baseball ou pour y voir des films et assister à du vaudeville tout en prenant un p’tit coup… c’est agréable ! Un bateau, le Quinte Queen (700 passagers), fait alors la navette entre Ottawa et l’île Kettle. La compagnie du parc Belle Isle met aussi en vente pas moins de 300 terrains de villégiature et rebaptise l’île Kettle, aussi appelée Laverdure, l’île Fraîche. Les terrains sont vendus entre 100 et 450 dollars chacun.
Ce lieu ne fait pas le bonheur de tous. Le curé de la Pointe-Gatineau trouve que le parc d’attractions lui fait sans doute trop de concurrence. Ainsi, tous les dimanches que le Bon Dieu amène, il tonne contre cet endroit où, selon lui, les jeunes gens y perdent âme et virginité. À la fin de l’année 1912, The Belle Isle Park Co. Ltd fait faillite. On avait probablement vu trop grand trop vite.
À suivre…
SOURCES :
Archives de la Ville de Gatineau.
BÉGIN, Richard, Le chemin et le « port » d’Aylmer : la voie de l’Outaouais supérieur dans Histoire Québec, vol 11, no 1, juin 2005.
Centre régional d’archives de l’Outaouais.
DESCHÊNES Jean, Les derniers vestiges du parc d'attractions Queen's Park, dans Hier encore, no 6, 2014.
Le Temps (Ottawa), 1912.
Ezra Butler Eddy : le roi des allumettes
![]() Par
ouimet-raymond
Le 18/11/2022
Par
ouimet-raymond
Le 18/11/2022
S’il est un homme qui a mis l’ancienne ville de Hull sur la carte, c’est bien Ezra Butler Eddy, principal industriel de cette ville qui a été dominée par ses usines pendant plus de cent ans. Et pourtant, cet homme n’était pas des plus aimés…
Originaire du Vermont, près de Bristol, Ezra Butler Eddy est né en 1827. Il aurait apparemment fait ses études à l’école publique de Bristol et commencé sa carrière dans la ville de New York comme commis dans un magasin. Et ce sont diverses tentatives plus ou moins fructueuses dans des entreprises de produits laitiers et de fabrication d’allumettes au Vermont, entre 1847 et 1854, qui expliqueraient son départ pour Hull. On dit qu’à l’époque, des liens commerciaux unissaient alors la vallée de l’Outaouais et Burlington, où Eddy aurait travaillé avant son départ du Vermont. Quoi qu’il en soit, notre homme arrive à Hull avec sa femme en 1854.
À cette époque, l'ancienne ville de Hull n’existe pas et fait partie de la municipalité du canton de Hull. Dès son arrivée dans le canton, Eddy entreprend la fabrication artisanale d’allumettes au soufre dans une bicoque louée de Ruggles Wright, fils de Philemon déjà décédé depuis une quinzaine d’années. L’entreprise revêt à ce moment un caractère familial et madame Eddy (Zaïda Diana Arnold) initie elle-même les femmes et les enfants de la région à l’emballage des allumettes à domicile. Celles-ci sont vendues dans un magasin situé près de la fabrique et distribuées dans la région par Eddy lui-même, vendeur né selon des témoignages de l’époque.
Fondateur d'une ville
Eddy remporte rapidement du succès. Il profite d’ailleurs des difficultés qu’éprouvent les descendants de Philemon Wright à s'adapter à l’évolution du monde des affaires, et achète des propriétés foncières de cette famille, dont l’ensemble de l’île Philemon particulièrement bien située près des chutes des Chaudières. Sa première percée dans le commerce du bois scié date de cette époque, et survient après avoir loué une scierie de la famille Wright. Les investissements qu’il fait dans le domaine semblent rentables, puisqu’au début des années 1870, Eddy a accumulé suffisamment de capital pour acquérir des concessions forestières et construire sa propre scierie près de la fabrique d’allumettes. Sa progression est alors vertigineuse. Entre 1870 et 1880, sa production de bois scié oscille entre 15 et 23 millions de mètres linéaires de planches annuellement et le nombre de ses scieries passe à quatre, ce qui en fait l’un des producteurs les plus importants de la vallée de l’Outaouais. En 1873, Eddy détient des permis de coupe de bois sur une superficie de 3 625 kilomètres carrés en Outaouais.
De 1871 à 1875, il est député conservateur à l’Assemblée législative. Il est défait en 1875 par Louis Duhamel parce la circonscription est devenue majoritairement francophone (Eddy ne parle pas français et ne le parlera jamais)  et aussi parce qu’il est souvent absent à cause de ses affaires. Il siège surtout en tant que maire du canton de Hull voué aux intérêts autonomistes des habitants du bas du canton qui désirent la scission par l’érection en municipalité. Et c’est en collaboration avec le père oblat Louis-Étienne Delille Reboul qu’il fonde la Ville de Hull en 1875. Élu plusieurs fois échevin de la Ville qu’il a contribué à créer, il représente le quartier n° 3, de 1878 à 1888 et en 1891-1892, et il est maire de Hull de 1881 à 1884, en 1887 et en 1891.
et aussi parce qu’il est souvent absent à cause de ses affaires. Il siège surtout en tant que maire du canton de Hull voué aux intérêts autonomistes des habitants du bas du canton qui désirent la scission par l’érection en municipalité. Et c’est en collaboration avec le père oblat Louis-Étienne Delille Reboul qu’il fonde la Ville de Hull en 1875. Élu plusieurs fois échevin de la Ville qu’il a contribué à créer, il représente le quartier n° 3, de 1878 à 1888 et en 1891-1892, et il est maire de Hull de 1881 à 1884, en 1887 et en 1891.
À la fin des années 1870, il est administrateur de la Compagnie du chemin de fer du Canada central. En 1888, il entreprend la construction d’une usine de pâte à papier. Dotée de quatre lessiveurs, elle entre en exploitation en décembre 1889. La plus grande partie de sa production de pâte est alors expédiée aux États-Unis. Eddy installe en 1890 sa première machine à papier. Il en ajoutera deux autres en 1891. Entre 1889 et 1894, Eddy et ses associés mettent en place une usine de papier équipée de cinq machines pour la production de papier mousseline, de papier impression, de papier brun, et, à partir de 1896, de papier journal. Pendant toute cette période, l’expansion de la fabrique d’allumettes se poursuit et l’on estime que « le roi des allumettes » – il en produit 30 millions par jour – domine le marché canadien dès 1879.
Un homme peu aimé
L'homme est un résilient. Par exemple, la crise qui touche le commerce du bois entre 1873 et 1880 le force à céder temporairement le contrôle de son entreprise à la Banque des marchands du Canada. Les choses semblent rétablies en 1882, année où un incendie majeur détruit presque entièrement ses installations. Pratiquement acculé à la faillite, il reconstruit, avec l’aide de capitaux empruntés à la Banque de Montréal, un complexe industriel comprenant deux scieries, une fabrique de portes et châssis, un atelier de rabotage, la fabrique d’allumettes, des forges, bureaux et entrepôts. Eddy, avec J. R. Booth sera l’un des seuls entrepreneurs des Chaudières à se remettre de l’incendie majeur du 26 avril 1900 qui a détruit une partie importante des sections industrielles des villes de Hull et d’Ottawa. Ses pertes sont évaluées à 3 000 000 $ dont 150 000 $ seulement auraient été remboursables par l’assurance. Reconstruites en moins d’une année, les usines Eddy fonctionnent de nouveau en décembre suivant. Il faudra attendre 1902 pour que la compagnie reprenne l’ensemble de ses activités, fournissant de l’emploi à plus de 2 000 personnes dans des scieries et ateliers de fabrication de papier, fibre durcie, allumettes, sacs de papier, seaux et cuves.
Ardent défenseur de l’Empire britannique, Eddy meurt à Hull, le 10 février 1906, à l’âge de 78 ans ; il est inhumé à Bristol, au Vermont. Il laisse à son décès une fortune évaluée par ses contemporains à plus de 2 500 000 $.
Eddy était peu aimé des Hullois, car il était un employeur intransigeant, dur – de 1858 à 1888, il y a eu 562 accidents mortels dans ses usines – qui ne s’est jamais intégré un tant soit peu à la population francophone de la ville. Et s’il a participé activement à plusieurs œuvres philanthropiques de la collectivité régionale, on ne peut s’empêcher de remarquer que c’est surtout (et pour une très large part) la communauté protestante de la rive ontarienne qui a bénéficié de ses contributions. Ajoutons qu’il avait aussi tendance à confondre ses intérêts avec ceux de la Ville. Eddy était aussi un membre influent de la franc-maçonnerie, une organisation peu prisée chez les catholiques francophones.
Sources :
Dictionnaire biographique du Canada.
OUIMET, Raymond, Hull : mémoire vive, Hull, Éd. Vents d’Ouest, 2000.
Petite histoire du parc Fontaine
![]() Par
ouimet-raymond
Le 04/11/2022
Par
ouimet-raymond
Le 04/11/2022
Au cœur de l'île de Hull, à quelques minutes d'un centre-ville bétonné à l'excès, se trouve un havre de verdure : le parc Fontaine. Il y a à peine plus de cent ans, ce parc était un étang appelé Flora vraisemblablement en l'honneur de Flora Morrisson, épouse de Philemon Wright fils. C’était alors un lieu d’amusement. L’hiver, on y patinait sur ses eaux gelées et on y organisait même des courses de chevaux. L’été, on s’y promenait en canot ou en chaloupe. L’auteur Jean Provencher raconte, dans les Quatre Saisons, que le 5 mai 1889 :
Un lac de feu : tel est l’aspect que présentait le lac Flora dimanche soir. Par le fort vent qu’il faisait alors, cette petite nappe d’eau était devenue terriblement agitée, et les houles profondément creusées balayaient le fond marécageux, duquel s’élevaient un nombre incalculable de feux-follets.
On ne se préoccupait guère de la qualité de l’environnement au XIXe siècle. Au cours des années 1880, on a construit un certain nombre de rues autour du petit lac, lesquelles étaient inondées tous les printemps et automnes par la crue des eaux. En 1885, la Vallée d’Ottawa estimait que ce serait une bonne chose que de vider totalement l’étang, parce que sa mise à sec créerait de nouveaux terrains de bonne valeur.  La même année, la Ville a décidé d’abaisser le niveau de l’eau du lac, pour mettre fin aux inondations, en le vidant en partie au moyen d’un canal relié à la rivière des Outaouais. Malheureusement, cette opération de drainage a eu pour effet de laisser dans le lac une eau stagnante sur un fond de cinq mètres de vase. Vers 1895, les eaux du nouvel égout sanitaire de la rue Kent ont été dirigées vers le lac, ce qui a entraîné progressivement sa mort d’autant plus qu’à l’angle des rues Frontenac et Hélène-Duval, le purin d’une porcherie était régulièrement vidé dans un ruisseau qui l’alimentait.
La même année, la Ville a décidé d’abaisser le niveau de l’eau du lac, pour mettre fin aux inondations, en le vidant en partie au moyen d’un canal relié à la rivière des Outaouais. Malheureusement, cette opération de drainage a eu pour effet de laisser dans le lac une eau stagnante sur un fond de cinq mètres de vase. Vers 1895, les eaux du nouvel égout sanitaire de la rue Kent ont été dirigées vers le lac, ce qui a entraîné progressivement sa mort d’autant plus qu’à l’angle des rues Frontenac et Hélène-Duval, le purin d’une porcherie était régulièrement vidé dans un ruisseau qui l’alimentait.
Le lac à Foucault
À cette époque, on appelait le lac Flora le « lac à Foucault », du nom de l’entrepreneur chargé de la cueillette des ordures et des fosses d’aisances à Hull. Or, cet entrepreneur cherchait à gagner son argent le plus facilement possible et déchargeait les détritus de ses centaines de clients dans le lac. Avec le temps, le lac Flora est devenu un trou infect, un cloaque. En 1905, on a accusé ses eaux pestilentielles d’être à l’origine de l’épidémie de choléra qui sévissait parmi les enfants de la ville. En 1909, le journal Le Spectateur lançait, en vain, une campagne pour assainir le lac.
Les autorités municipales ont continué à abaisser le niveau du lac et, en 1917, il était complètement asséché. Le creux a été comblé avec divers matériaux dont des déchets de toutes sortes. Pour empêcher les mauvaises odeurs d’empester le voisinage et contrôler la vermine qui y proliférait, on a embauché un homme chargé d’y répandre quotidiennement de la chaux. La Ville a alors offert le terrain vacant à la Canadian Pacific Railway pour y construire une gare ferroviaire, sans succès. Enfin, en 1927, la Commission du district fédéral aménageait l’ancien lac en parc. En 1936, les autorités ont nommé le nouveau terrain Fontaine, en l’honneur de l’ancien maire et député libéral Joseph-Éloi Fontaine. L’année suivante, on y fera l’inauguration d’un modeste terrain de jeu.
Un terrain de jeu
Dès le début des années 1930, le parc Fontaine est devenu le rendez-vous des sportifs. En 1933, Léo Gratton y construira un stade de hockey en plein air, rue Charlevoix. C'est là que la fameuse patineuse hulloise Pierrette Paquin, s'est produite en spectacle à l'hiver de 1948. Les nombreuses activités qui s’y déroulaient ont font les belles heures de la population hulloise d’avant-guerre : boxe avec les Darky Fortier et les Battling Corneau ; balle-molle avec les Cabochons et les Chats noirs ; cirques, kermesses, pique-niques, etc. En 1947, la nouvelle Ligue commerciale de balle-molle de Hull, fondé par Marcel Lévis et Yvon Saint-Louis, voyait le jour et les équipes telles le Hull-Volant, le Lambert, le Transport Marcoux, etc. disputeront leurs parties au parc Fontaine jusqu’en 1962.
En 1941, les Oblats avaient fondé le Terrain de jeu du parc Fontaine qu’ils avaient affilié à l’Œuvre des terrains de jeu de Hull (O.T.J.) et le parc a fait l'objet d'un second aménagement avec chalet, marquise, balançoires, glissoire et... niche à la Vierge, don du commerçant Josaphat Pharand. Le premier moniteur du terrain de jeu a été un certain Sylvio Huneault, assisté du futur prêtre oblat hullois, Roger Poirier. Les premiers maire et mairesse du terrain de jeu ont été, en 1949, Roger Marengère et Marie-Paule Bélanger.
 En août 1949 et en juin 1961, le parc est redevenu momentanément un étang à la suite de pluies diluviennes qui ont entraîné l’affaissement du sol et la disparition de quelques arbres dans les profondeurs de ses entrailles.
En août 1949 et en juin 1961, le parc est redevenu momentanément un étang à la suite de pluies diluviennes qui ont entraîné l’affaissement du sol et la disparition de quelques arbres dans les profondeurs de ses entrailles.
Pendant une vingtaine d’années, le parc Fontaine, ainsi aménagé, a fait la joie de la population de l'Île de Hull. Mais à partir des années 1960, on l'a laissé à lui-même au point qu’il est redevenu un terrain vague. En 1978, à la suite d'une lutte épique (cinq ans) entre la population du quartier, les autorités municipales, provinciales et fédérales, la Ville y entreprenait des travaux d’aménagements qui feront du parc Fontaine un lieu agréable pour enfants et adultes d’un quartier où les familles sont désormais la proie de la spéculation immobilière.
Sources :
Archives de la Ville de Gatineau.
HENDERSON, Rick, communication du 22 janvier 2021.
La Vallée d’Ottawa (Hull), 1884-1885.
Le Droit (Ottawa), 1913-1990.
Le Spectateur (Hull), 1889-1910.
PROVENCHER, Jean, Les Quatre Saisons, Un lac complet de feux follets | Les Quatre Saisons (jeanprovencher.com)
La première exécution capitale en Outaouais
![]() Par
ouimet-raymond
Le 12/10/2022
Par
ouimet-raymond
Le 12/10/2022
Pendant une bonne partie du XIXe siècle, l’Outaouais est le Far West du Québec. La violence fait alors partie des mœurs des hommes qui vivent une bonne partie de l’année dans les chantiers à couper du bois ou à faire la drave sur la rivière des Outaouais et ses affluents. Et la loi, celle qui s’applique véritablement, est celle du plus brutal, du plus fort, car il n’y a pas là d’autorités judiciaires avant la fin des années 1840.
La mort du pêcheur
En 1863, l’Outaouais est devenu plus paisible sans doute à cause de la mise en place d’une autorité judiciaire qui a pignon sur rue dans le petit village d’Aylmer. Les Shiners se sont calmés et les francophones gagnent en masse la région où de nombreux « moulins à scie » transforment en planches les immenses forêts de pins de la région. Le rôle de la prison du district judiciaire ne mentionne d’ailleurs que 36 arrestations pour cette année-là, la plupart pour de menus larcins.
L’année est à son solstice estival. Plusieurs hommes pêchent dans le ruisseau Brigham – cours d’eau mal nommé, puisque c’est une petite rivière aujourd’hui connue sous le nom de ruisseau (sic) de la Brasserie – qui coule en la ville de Gatineau dans le quartier appelé Île de Hull. Sa source est la rivière des Outaouais, à 50 mètres en amont des chutes des Chaudières. Après avoir parcouru un demi-cercle de 2,5 kilomètres, il se jette dans cette même rivière, à 200 mètres en aval des chutes Rideau.
À cette époque, il n’y a pas de ville de Gatineau et le ruisseau s’épanche dans un milieu bucolique qu’égaient les piaillements et les ritournelles de plus de 150 espèces d’oiseaux. De grands arbres feuillus se tendent les branches au-dessus des eaux limpides qui sont poissonneuses à souhait, puisque l’on y pratique la pêche commerciale au filet. Toujours est-il que le 20 juin, plusieurs personnes y tâtent qui le brochet qui la truite dans l’espoir d’en faire un bon repas ou d’en tirer de l’argent sonnant. Parmi eux, François-Xavier Séguin dit Ladéroute qui habite généralement au village de la Pointe-Gatineau situé à 3,5 kilomètres du ruisseau.
Âgé de 46 ans en 1863, Ladéroute s’est vu 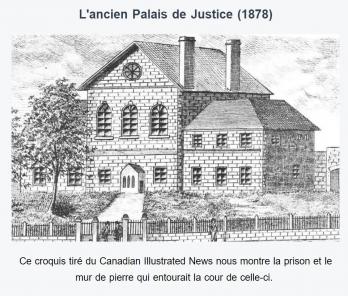 amputer d’une jambe 9 ans plus tôt par suite d’un accident. Depuis, son épouse l’a quitté emmenant avec elle les enfants. Il vit du produit de sa pêche et dort le plus souvent à la belle étoile. Ce pauvre bougre a changé et sa raison chancelle. Le 20 juin 1863, William Larocque , un robuste gaillard, navigue dans une chaloupe sur le ruisseau Brigham à environ 300 mètres de la rivière des Outaouais[1]. Plus loin, François-Xavier Larédoute pagaie dans son canot. Les deux hommes s’échangent quelques paroles : « Tu as encore pillé mes filets, mais je te jure que c’est la dernière fois. » Le lendemain, Ladéroute se vante auprès de sa belle-sœur d’avoir réglé le cas de Larocque le matin même. Deux pêcheurs trouvent le corps inerte de Larocque qui semble avoir été tué de cinq coups de rame. L’Outaouais est en émoi, car Larocque laisse dans le deuil une veuve et 9 enfants. Ainsi donc, dix-huit ans après l’affaire Leamy, l’aviron sert encore d’arme de combat.
amputer d’une jambe 9 ans plus tôt par suite d’un accident. Depuis, son épouse l’a quitté emmenant avec elle les enfants. Il vit du produit de sa pêche et dort le plus souvent à la belle étoile. Ce pauvre bougre a changé et sa raison chancelle. Le 20 juin 1863, William Larocque , un robuste gaillard, navigue dans une chaloupe sur le ruisseau Brigham à environ 300 mètres de la rivière des Outaouais[1]. Plus loin, François-Xavier Larédoute pagaie dans son canot. Les deux hommes s’échangent quelques paroles : « Tu as encore pillé mes filets, mais je te jure que c’est la dernière fois. » Le lendemain, Ladéroute se vante auprès de sa belle-sœur d’avoir réglé le cas de Larocque le matin même. Deux pêcheurs trouvent le corps inerte de Larocque qui semble avoir été tué de cinq coups de rame. L’Outaouais est en émoi, car Larocque laisse dans le deuil une veuve et 9 enfants. Ainsi donc, dix-huit ans après l’affaire Leamy, l’aviron sert encore d’arme de combat.
Ladéroute est prestement arrêté et accusé de meurtre. Son procès commence le 12 juillet au palais de justice d’Aylmer. C’est le juge Aimé Lafontaine, un homme qui ne faisait pas l’unanimité en Outaouais, qui préside le procès. Ironie de l’histoire, l’un des deux défenseurs de Ladéroute est le fils d’un des plus féroces Shiners : Peter Aylen ! La populace indignée crie vengeance et plusieurs des jurés ont déjà décidé du sort du prévenue : la pendaison. Et un des jurés dort pendant le procès.
Comme prévu, le jury trouve Ladéroute coupable de meurtre et le pauvre hère est condamné à être pendu haut et court le 18 septembre. Mais Ladéroute est-il coupable. Ce n’est pas sûr ; personne n’a tété témoin de l’homicide. Aussi, certains esprits éclairés, dont ses avocats, se demandent : « Comment un estropié dans un petit canot versant a-t-il pu attaquer et tuer un homme fort dans une chaloupe à fond plat ? »
Au mois de septembre, deux médecins, les Drs Douglas et Litchfield d’Ottawa procèdent d’abord à l’évaluation mentale du condamné et concluent qu’il est sain d’esprit, mais ignorant pour ne pas dire idiot. L’exécution est reportée au 2 octobre en dépit de nombreuses pétitions qui réclamaient que la peine capitale soit commuée en prison à vie. Déçu, le curé Ginguet de Pointe-Gatineau déclare alors : « L’exécution de ce pauvre malheureux sera celle d’un imbécile incapable de réaliser la conséquence de ses actions. »
Il est 10 h quand Ladéroute est lentement traîné à la potence, installée du coté ouest du palais de justice, par deux hommes. Comme le pays n’a pas de bourreau, les autorités ont sorti de la prison de Kingston un prisonnier qui a bien voulu exercer momentanément le rôle d’exécuteur des hautes œuvres. Une pluie fine commence à tomber. Ladéroute tremble de tous ses membres et au moment où le bourreau lui passe la corde au cou, il fond en larmes et s’écrie : « Oh ! Monsieur le Curé, je vous en prie, dites-leur donc de me laisser aller ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! » Le curé Michel de la paroisse d’Aymer ne peut que lui montrer le ciel en lui disant de prier. Puis à 10h10, le bourreau enfile un bonnet noir sur la tête de Ladéroute et expédie le condamné dans l'au-delà devant une foule nombreuse sous le regard d’un détachement de soldats chargé d’assurer l’ordre.
Satisfaites, la foule et les autorités judiciaires abandonneront à leur pauvreté l’épouse et les enfants de William Larocque…
SOURCES :
BAC, RG4, C1, Provincial Secretary’s Office Canada East (P.S.O. C.-E.) 1863 « Goal Calendar », vol. 540, 541 et 543, nos 2144, 2147, 2413, 2482.
ROSSIGNOL, L., Histoire documentaire de Hull 1792-1900, Thèse de doctorat en philosophie, juin 1941, Université d’Ottawa.
[1] Vis-à-vis de l’église de la paroisse Notre-Dame-de-l’Île, boulevard Sacré-Cœur.
Les frères Aubry ou chronique de scandales locaux
![]() Par
ouimet-raymond
Le 09/09/2022
Par
ouimet-raymond
Le 09/09/2022
La société est faite d'êtres humains dont la vanité et les ambitions, qui forment une jolie paire, ne sont guère différentes de celles que l'on observe partout où argent et pouvoir sont les seules choses qui comptent. Ainsi, n’y a-t-il rien de neuf sous le soleil. Pour preuve, l'histoire suivante : Les frères Aubry ou chronique de scandales locaux.
Stanislas Aubry a vu le jour à Saint-Scholastique, aujourd’hui Mirabel, dans les Basses-Laurentides le 29 juillet 1860. D'un bouillant caractère, un rien le faisait sortir de ses gonds. Son comportement fantasque révélait, sans doute, une vieille blessure enfouie dans son inconscient, vraisemblablement celle causée par les circonstances de sa naissance. En effet, né en dehors des liens du mariage alors que sa mère était veuve depuis près de huit ans – un véritable déshonneur au siècle dernier –, il avait été baptisé à l'âge de neuf jours, soit la journée même des noces de ses parents. Pour quelqu'un qui voulait faire sa marque dans la vie, les circonstances de son arrivée en ce bas monde constituaient une tache... originelle.
Médecin, Stanislas Aubry était un personnage fort imbu de lui-même ; il croyait vraisemblablement que son entourage était né pour le servir sinon pour faire ses quatre volontés. Une maison imposante, qu'il a fait construire en 1908 à l'angle de la promenade du Portage et de la rue Aubry, décrit bien la personnalité du médecin : elle a la particularité d'avoir deux façades apparemment identiques, mais qui se différencient par l'inversion de ses éléments architecturaux…
Scandale à l'église
Ses défauts lui vaudront un étonnant scandale… familial qui fera le tour de la région. Stanislas Aubry et son frère cadet Georges avaient apparemment appris, peu de temps avant le mariage de leur jeune soeur Marie-Louise avec le photographe François-Xavier Filteau, que leur frangine était enceinte. Stanislas avait-il eu l'esprit obnubilé par la grossesse de sa soeur qui lui rappelait sa propre naissance ? La suite des événements 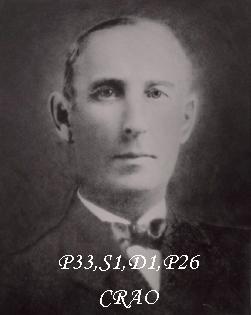 le laisse croire. Furieux, il avait résolu d'empêcher, avec l'aide de son frère, la célébration de ce mariage sans égard pour les sentiments des futurs mariés. Le jour de la cérémonie nuptiale, c'est-à-dire le 31 mai 1885, les frères Aubry mettaient à exécution leur plan, un beau scandale qui alimenta les conversations de la population hulloise pendant tout l'été. Le mariage avait lieu au presbytère de l'église Notre-Dame-de-Grâce, comme c'était généralement le cas quand on voulait éviter toute publicité. Au cours de la cérémonie, Stanislas s'était dirigé vers sa soeur qu'il avait d'abord frappée et à qui il avait ensuite arraché son chapeau devant une assistance ahurie. Puis, les deux frères s'étaient permis de bousculer vivement plusieurs personnes dans l'assistance. (Ci-contre, Stanislas Aubry)
le laisse croire. Furieux, il avait résolu d'empêcher, avec l'aide de son frère, la célébration de ce mariage sans égard pour les sentiments des futurs mariés. Le jour de la cérémonie nuptiale, c'est-à-dire le 31 mai 1885, les frères Aubry mettaient à exécution leur plan, un beau scandale qui alimenta les conversations de la population hulloise pendant tout l'été. Le mariage avait lieu au presbytère de l'église Notre-Dame-de-Grâce, comme c'était généralement le cas quand on voulait éviter toute publicité. Au cours de la cérémonie, Stanislas s'était dirigé vers sa soeur qu'il avait d'abord frappée et à qui il avait ensuite arraché son chapeau devant une assistance ahurie. Puis, les deux frères s'étaient permis de bousculer vivement plusieurs personnes dans l'assistance. (Ci-contre, Stanislas Aubry)
Le soir des noces, les frères Aubry étaient mis en état d'arrestation et le mercredi suivant, ils comparaissaient devant la cour de police. Les accusations étaient précises : avoir voulu empêcher la célébration d'un mariage et avoir frappé les personnes présentes à la célébration. L'avocat des deux frangins avait demandé que l'accusation soit limitée à une simple accusation de voie de fait, ce dont la cour n'avait pas tenu compte. Après avoir entendu plusieurs personnes qui avaient été témoins de la rixe, la cour de police condamnait les frères Aubry à subir un procès aux assises criminelles à Aylmer, là où le Palais de justice du district judiciaire était situé à cette époque.
On ne sait pas si les frères Aubry ont été condamnés, car la plupart des documents d'époque sur cette affaire manquent. Mais, il a fort à parier que l’affaire s’est réglée hors cours.
Un politicailleux
Trois ans après ce scandale, Stanislas Aubry, habile blablateur d'estrades, s'est lancé en politique municipale ; il sera élu conseiller municipal de Hull de 1888 à 1893 et maire de la ville en 1894. Il est le premier maire élu par le vote populaire – auparavant, le maire était élu par les échevins. Mais en 1895, il est déchu de ses droits civiques pour la vie et condamné à une imposante amende de 2 000 dollars pour avoir exigé des pots-de-vin d’entrepreneurs pour régler des factures. Il récupéra ses droits civiques quatre ans plus tard grâce à une étonnante loi passée au parlement à Québec.
Aubry n’aura pas perdu le de sa prépondérance sociale : en 1905, il pose de nouveau sa candidature à la mairie de Hull. Et comme le peuple a la mémoire courte, Stanislas Aubry sera… réélu et restera au conseil jusqu’en 1907. Deux ans plus tard, il proposera le change de nom de la ville de Hull pour celui d’Ottawa-Nord ! Stanislas est décédé en 1936 à l’âge de 76 ans.
Soulignons que magnifiquement restaurée, la maison Aubry a mérité à son propriétaire le prix d’excellence de la rénovation de la Ville de Hull en 1998.
SOURCES
Centre régional d'archives de l'Outaouais.
Encyclopedic Canada, vol. 5, The Bradley-Garretson Company Ltd, Toronto;1896.
Guitard, Michelle, Historique des bâtiments au coeur de Hull, Ville de Hull, 1990.
Le Spectateur, Hull, 12 janvier 1899.
La Vallée de l'Ottawa, 3 juin 1885, Hull.
Procès-verbal du 23 décembre 1885 du Conseil municipal de Hull.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 17/08/2022
Par
ouimet-raymond
Le 17/08/2022
Qu’est-ce qu’un homme ne ferait pas pour épouser la femme de ses rêves ? Jean-Guy Lacroix, âgé de 19 ans, est amoureux fou d’une certaine Jacqueline N., âgée de 17 ans, qui lui rend bien son amour. Chaque jour, les deux tourtereaux trouvent le moyen de se rencontrer dans un endroit discret pour parler avec tendresse de leur bel amour et rêver doucement à leurs projets. Ils nourrissent l’ambition de se marier afin de vivre continuellement l’un près de l’autre.
Il y a un obstacle à l'amour des tourtereaux : les parents de Jacqueline. Mais Jean-Guy est un homme déterminé et ne se décourage pas pour autant. Doué d’une imagination féconde, il ébauche dans son esprit un plan d’attaque qui l’obligera à exécuter des prouesses.
Jean-Guy est un talentueux jeune homme débrouillard et plein d’idéaux. Il a obtenu des rôles dans de petites pièces de théâtre et fait alors ses débuts à la radio, ce qui lui fait espérer de jouer un jour à la télévision. Peu de temps avant cette affaire, il s’est même rendu à Paris pour tenter fortune dans le monde artistique. Mais après un mois de vaines tentatives, il a dû rentrer chez lui.
Au mois d’août 1954, il conçoit l’idée de tourner un court métrage pour la télé. Sa partenaire sera, il va sans dire, son amie Jacqueline qui possède une certaine expérience de la scène pour avoir joué avec Jean-Guy auparavant. Avec l’aide de deux camarades, Jean-Guy commence les prises de vue. L’intrigue tourne autour d’une jeune fille qui épouse un jeune homme sans le consentement de ses parents. À la fin de janvier 1955, tout est prêt pour la grande scène.
Jean-Guy, qui habite à Hull, va rencontrer le curé de la paroisse Saint-François-de-Sales à Pointe-Gatineau, Antoine Lalonde, à qui il demande la permission de tourner la scène du mariage dans son église. Le curé n’y voit aucune objection et consent même à officier à la cérémonie. Flanqués du bedeau, qui sert de père au jeune homme, et de l’un des cameramen, André Croteau, qui sert de père à la jeune fille, les jeunes gens voient leur idylle scellée au pied de l’autel.
Une cérémonie bidon
Ce n'était évidemment pas un vrai mariage. Le curé avait d'ailleurs pris soin de le souligner aux « époux ». Mais Jean-Guy voit dans ce petit bout de film une occasion merveilleuse de forcer la main des parents de Jacqueline. Aussi, muni d’un faux certificat de mariage, obtenu aux fins de l’histoire filmée, il se rend chez les parents de son amie et déclare à la mère que lui et sa fille sont bel et bien mariés, et que sa fille est même… enceinte !
La mère n’a pas dû être trop contente. Mais, elle constate qu’elle ne peut plus résister à ce mariage et consent à ce que Jacqueline range tous ses effets personnels dans une valise et accompagne son « mari » à sa nouvelle demeure.
Quand le père de Jacqueline apprend, de la bouche de sa femme, que sa fille est désormais mariée et, qui plus est, sans son consentement, il se dirige immédiatement chez les Lacroix et en ramène sa fille manu militari. Mais Jean-Guy a d’autres tours dans son sac. Et toujours aux fins du fameux film, il tourne une scène dans laquelle un avocat persuade la vedette féminine qu’elle est réellement mariée au jeune homme.
Mais en allant reconduire la jeune fille chez lui, un certain Marcel Lévesque – il avait joué le rôle de l’avocat –, déclare tout bonnement à Jacqueline qu’il n’est pas du tout avocat et que les conseils qu'il lui a donnés venaient du scénario qu'on lui avait remis. Quelques jours plus tard, un « policier » aborde Jacqueline sur la rue et lui ordonne de le suivre chez son « mari ». Le hasard veut que le père de la jeune fille soit témoin de la scène et invite promptement le « policier » à lâcher sa fille.
Quelques jours plus tard, un « huissier » se présente chez Jacqueline et lui remet un ordre de la cour, signé par un « juge » avec sceau du palais de justice, l’enjoignant à retourner auprès de son « mari » sous peine de poursuite judiciaire. Le père de Jacqueline entre de nouveau en scène : il remet le document à la police de Hull. Une enquête s’ensuit et des accusations sont portées contre Jean-Guy Lacroix dont l’enquête préliminaire se tient le 29 juin 1955 derrière des portes closes. Que s’y dit-il ? Je ne le sais pas. Mais le juge, Jacques Boucher, a rejeté la plainte et Jean-Guy a été libéré. Qu'est-il advenu du couple ? Je ne le sais pas. Mais peut-être qu'une lectrice ou un lecteur le saurait ?...
SOURCES
Allô Police (Montréal) 10 juillet 1955.
Annuaire de la ville de Hull, 1956.
Archives judiciaires, BAnQ-CAO.
L'incorrigible séducteur Louis Giroux
![]() Par
ouimet-raymond
Le 02/08/2022
Par
ouimet-raymond
Le 02/08/2022
Il était une fois un beau grand garçon brun à moustache noire, Louis Giroux, aventurier qui pratiquait l'art de la persuasion avec une surprenante habileté pour subvenir à ses besoins. Il avait l'incurable manie des grandeurs qui l'a fait vivre pendant une trentaine d'années aux crochets de gens trop crédules. Originaire de Montebello, Giroux avait épousé Scholastique Cayer à l'Orignal le 30 juin 1872, à son retour des États-Unis où il avait participé, comme soldat, à la guerre de Sécession (1861-1865). Intelligent comme un singe et roublard comme un diplomate, Giroux était aussi beau parleur et petit faiseur. Doué d'un sens de la réplique hors du commun, il n'était jamais à court d'arguments : un véritable orfèvre du mensonge quoi !
À cette époque, Louis Giroux se faisait appeler Antoine Cyr, et il demeurait chez un certain Legault, à Clapham dans le comté de Pontiac. Il n'avait encore jamais payé sa pension et devait à son logeur la somme de 49 dollars. Or, un certain dimanche, il a voulu fuir sans payer son dû, mais Legault a eu le temps de lui réclamer le paiement de la pension. Indigné, Giroux a répliqué :
Comment, vous osez me demander de l'argent le dimanche ! Me prenez-vous pour un fou ? Je vous connais vous monsieur. Vous voudriez bien vous faire payer aujourd'hui sous prétexte que les affaires conclues le dimanche ne valent rien.
Et avec un air de mépris, Louis a tourné le dos à son interlocuteur médusé et s'en est allé. Bien entendu, jamais Legault n’a revu la binette de son chambreur.
Un survenant
Grand voyageur, Giroux connaissait les petites histoires de beaucoup de monde tant en Outaouais que dans l'Est ontarien. Aussi, il avait appris un jour qu'un nommé Lacouture, de Plantagenet, avait quitté sa femme dix-huit ans auparavant pour ne plus revenir. Où était-il passé? Nul ne le savait. Mais Louis Giroux a vu là une occasion en or de remplir sa bourse, mal en point, auprès d'une femme esseulée qui avait réussi, malgré tout, à épargner la rondelette somme de 500 dollars depuis le départ de son mari. Giroux a alors emprunté le patronyme de Lacouture pour ensuite se présenter chez l'épouse esseulée en se jetant dans ses bras et en lui demandant pardon pour tout le mal qui lui avait fait en l'abandonnant. Évidemment, Virginie avait trouvé son mari bien changé en dix-huit ans et elle aurait eu, du moins au premier abord, comme un léger doute sur l'identité du survenant. Mais pour lui prouver qu'il était vraiment son mari, Louis, qui savait que Virginie avait déploré la mort de son petit garçon longtemps auparavant, est allé jusqu'à simuler son regret en se rendant tous les jours pleurer sur la tombe de son prétendu fils. Convaincue – ne demandait-elle d'ailleurs pas mieux ? – par la magistrale performance de Giroux en père repenti et surtout heureuse du retour du mari infidèle, Virginie s'est finalement offerte avec un pudique abandon à l'imposteur.
Au bout de quelques mois de bonheur parfait dont Giroux gardera un souvenir impérissable, Virginie s'est retrouvée seule à nouveau ; Giroux avait déserté son lit en emportant toutes ses épargnes. L'imposteur n'a cependant pas réussi à se sauver bien loin et la Justice, qui a parfois le bras long, est arrivée à lui mettre la main au collet, même si l'affabulateur de Montebello avait à nouveau changé son nom, cette fois pour celui Joseph Prévost. Enfin, au mois de mai 1894, les autorités le confinaient dans une cellule du pénitencier de Kingston.
Une bonne râclée
Le séducteur de ces dames n'est pas resté longtemps en prison puisqu’en 1896, il prenait le nom de Jos. Latreille pour sévir à Ottawa, dans le quartier Mechanicsville, chez l'épicier Hyacinthe Latreille, et ce, pour lui annoncer qu'il venait le rencontrer au nom de plusieurs membres de la famille. Il avait à régler, lui aurait-il dit, la succession du grand-père Latreille, soldat de la guerre de 1812, à qui le gouvernement avait concédé plusieurs terres. Giroux a bien sûr été accueilli à bras ouverts par l'épicier chez qui, pendant une semaine, il a été traité comme un enfant de la maison.
au nom de plusieurs membres de la famille. Il avait à régler, lui aurait-il dit, la succession du grand-père Latreille, soldat de la guerre de 1812, à qui le gouvernement avait concédé plusieurs terres. Giroux a bien sûr été accueilli à bras ouverts par l'épicier chez qui, pendant une semaine, il a été traité comme un enfant de la maison.
Hyacinthe Latreille avait plusieurs filles dont l'une, Flavie, était veuve depuis peu. Giroux s'en était amouraché et il avait fini par lui promettre le mariage. Après lui avoir acheté un jonc et lui avoir fait visiter plusieurs maisons de briques à Ottawa, il avait rencontré la parenté ottavienne en sa compagnie. Mais un jour, il a aperçu la jeune veuve, chez elle, en compagnie d'un jeune homme. Fâché, il a élevé la voix pour interdire au jeune homme de parler à Flavie qui devait, du moins dans son esprit, devenir la sienne. Le frère de Flavie, Mérile Latreille, qui avait assisté à la scène de jalousie, a estimé que le cousin était allé trop loin. Armé d'un beau gros morceau de bois franc, il a servi une véritable raclée à Louis Giroux alias Jos. Latreille qui a alors quitté Ottawa sans demander son reste
En dépit de ses échecs, Louis Giroux a conservé une assurance hors du commun et pendant six autres années, il a accompli des dizaines d'entourloupettes, tant dans la Petite-Nation, à Hull que dans la Haute-Gatineau. Mais en novembre 1902, à Perkins' Mills, il a été mis en état d'arrestation à la suite d'une accusation pour vol portée par le notaire Labelle de Hull. Incarcéré dans la prison de Hull sous le nom de Joseph Prévost, il a fallu prouver l'identité du voleur qui avait nié s'appeler Giroux. Et chaque fois qu'on lui emmenait une personne qui prétendait l'avoir connu, il restait de marbre. On a même fait venir Mélina Latreille, sœur de la jeune veuve que Giroux avait fréquentée, qui l'a reconnu comme étant Jos. Latreille grâce à la cicatrice qui lui était restée à la joue par suite de la raclée que son frère lui avait infligée autrefois. Mais peine perdue, Giroux est resté coi. Enfin, on a fait venir un certain David Ranger qui l'avait bien connu au temps de sa jeunesse. Il a reconnu sans la moindre hésitation Louis Giroux et lui a parlé comme à une ancienne connaissance des souvenirs de chantier en l'appelant par son surnom : Ti-Noir. Mais l'escroc est resté imperturbable. Il lui alors a rappelé des souvenirs de jeunesse. Rien. Silence total. Mais quand Ranger a prononcé les noms de Virginie Lacouture, alors là Giroux a porté son mouchoir à la bouche pour cacher ce sourire qu’il a esquissé comme celui d'un joueur de tours qui se souvient d'une bonne blague.
Le 17 novembre 1902, Louis Giroux alias Antoine Cyr alias Jos. Latreille alias Joseph Prévost était condamné par le juge Talbot à deux ans de prison à passer au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul pour crime de vol. Il est ensuite passé à la trappe de l'histoire.
Sources :
OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1994.
Le Temps, Ottawa, du 3, 4, 5, 6, 8 et 17 novembre 1902.
Photographie des Archives de la Ville de Gatineau, H005--01-0084.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 07/07/2022
Par
ouimet-raymond
Le 07/07/2022
On trouve, à Gatineau, dans le secteur Aylmer, un vieux bâtiment bien conservé dont l’histoire est généralement méconnue et fréquenté par nombre de Gatinois depuis plus de 180 ans. Il s’agit de l’hôtel British situé au 71, rue Principale, la plus vieille auberge située à l’ouest de Montréal et qui est toujours utilisée à des fins d’hôtellerie.
On dit que l’hôtel a été construit vers 1834. Chose certaine, il était en activité en 1841 comme l’indique une annonce publiée dans la Bytown Gazette du 17 août 1841. Soulignons que l'odonyme Bytown est l’ancien nom de la ville d’Ottawa.
L’hôtel a été érigé par Robert Conroy, originaire de l’Irlande du Nord, qui avait épousé, en 1837, Mary McConnell, fille de William, l’un des trois frères McConnell à venir s’installer dans la région de Deschênes au début du XIXe siècle. En épousant une McConnell, Robert Conroy a été, dès le début de son établissement à Aylmer, en contact étroit avec l’élite locale naissante. En 1839, il s’était associé à John Egan, Charles Symmes et Harvey Parker pour bâtir un moulin à farine fonctionnant à la vapeur, l’Aylmer Bakery. Dans les années 1850, Conroy devient l’un des hôteliers (dans ces années-là, il s’était aussi porté acquéreur de l’auberge de Symmes) et négociants en bois les plus prospères de la vallée de l’Outaouais.
Un hôtel incomparable
Conroy a fait bâtir cet hôtel en pierres avec des murs de 122 centimètres d’épaisseur pour s’assurer que le froid rigoureux canadien n’y pénètre pas l’hiver. On rapporte qu’aucun autre hôtel ne pouvait s’y comparer au Canada à l’époque ; Bytown n’avait alors qu’une simple cabane en bois rond comme hôtel, près du pont des Sapeurs. Robert Conroy a érigé la première partie de cet édifice en pierres pour lui servir de résidence personnelle, mais elle a été rapidement transformée en hôtel. En plus des chambres et des repas qu’offrait l’hôtel British, un service de diligences « confortables » a relié, dès les années 1840, l’auberge au débarcadère (quai) de Hull. On trouvait aussi dans l’écurie de l’hôtel des chevaux et des voitures que les voyageurs pouvaient louer sans réserver à l’avance.
Dès sa construction, l’hôtel British a été au centre des activités importantes d’Aylmer. Ainsi, en 1842, on raconte qu’on y a organisé des festivités pour célébrer la naissance du prince de Galles, futur roi Édouard VII de l'empire britannique. En 1860, le prince de Galles, venu poser la première pierre du futur édifice parlementaire à Ottawa, s’est adressé à la population aylmeroise du haut de la véranda du British où il assistera à un bal donné en son honneur.
Une veillée mortuaire
En 1866, le conseil municipal, qui voulait exprimer son appréciation de façon tangible, a offert un déjeuner gratuit au British Hotel à un régiment de miliciens volontaires qui devaient aller protéger les édifices gouvernementaux nouvellement construits à Ottawa contre d’éventuels raids féniens. C’est alors que qu'un député canadien, Thomas D’Arcy McGee, a été assassiné à Ottawa. Or, si l’on en croit les dires de l'historien Pierre-Louis Lapointe, l’hôtel British aurait été, encore une fois, au centre des événements :
Thomas D’Arcy McGee a été assassiné à Bytown (Ottawa) le 7 avril 1868. Ce même soir, il y avait une veillée Conroy à l’hôtel British American, à Aylmer. On rapporte que, soudainement, quatre hommes ont surgi dans la pièce où avait lieu la veillée [mortuaire], après avoir laissé leurs chevaux épuisés, écumant de la gueule, à l’entrée. C’étaient tous des étrangers, très nerveux, tantôt surveillant la porte, tantôt regardant fréquemment leurs montres, et personne ne pouvait comprendre pourquoi ils étaient à la veillée des Conroy. On raconta plus tard qu’il s’agissait des assassins de Thomas D’Arcy McGee venus établir leur alibi à Aylmer.
Cette anecdote est d’autant plus intéressante qu’il existe effectivement des doutes sérieux quant à la culpabilité de James Patrick Whelan, pendu le 10 février 1869 pour le meurtre du député.
Soulignons que le 3 octobre 1895, Mackenzie Bowell (premier ministre du Canada 1894-1896), sir Charles Tupper (son successeur, 1896), sir Adolphe Caron, postier général du Canada, le comte de Westmeath (de l’ambassade britannique à Washington) et le vice-consul général des États-Unis au Canada, Julius G. Lay, étaient de passage à l’hôtel British. De quoi ont-ils parlé ? L’histoire ne le dit pas. Autre anecdote intéressante : le passage remarqué du célèbre homme fort canadien-français, Louis Cyr, à l’hôtel British en 1898.
Robert Conroy est mort en 1868. Son épouse Mary est restée propriétaire de l‘hôtel. Puis, Mary Conroy s’est éteinte à son tour en 1887, mais l’édifice restera encore quelques années la propriété de la succession Conroy (Robert H. et William J.). Par la suite, l’hôtel British va connaître une série de propriétaires plus ou moins éphémères. Le 10 août 1921, un incendie a ravagé le centre-ville d’Aylmer et détruit la plupart des bâtiments du côté nord de la rue Principale, de la rivière jusqu’au parc municipal. Par chance, la conflagration n'a pas détruit British qui a ouvert ses portes à la collectivité, se transformant en école la semaine, en palais de justice le samedi et en église le dimanche.
L’hôtel British est un témoignage du passé remarquable qu’a connu l’ancienne ville d’Aylmer. Seul hôtel à l’ouest de Montréal à n’avoir pas dérogé, pendant près de 180 ans, à sa vocation première, il a visiblement été au centre de l’histoire outaouaise.
Sources :
Asticou, nos 48-49, décembre 1996.
BÉGIN, Richard M., De l’auberge Conroy à l’hôtel British, Aylmer, 1993.
Wikipédia.
John Romanuk alias Jos Patates
![]() Par
ouimet-raymond
Le 23/04/2022
Par
ouimet-raymond
Le 23/04/2022
Avant l’arrivée des grandes surfaces et des dépanneurs à tous les coins de rue, la population a longtemps compté sur les vendeurs itinérants qui passaient de porte en porte pour vendre leurs produits. On a tout vendu de cette façon : lait, pain, fruits et légumes, glace, guenille et même des frites.
Ces vendeurs itinérants ont beaucoup attiré l’attention dans les années 1950, car ils ont souvent été les derniers à se transporter au moyen de véhicules hippomobiles. Tous les enfants étaient fascinés pas les chevaux qu’ils caressaient. Mais leurs parents en avaient vu d’autres, au temps où presque tous les véhicules étaient tirés par des chevaux. Car qui dit chevaux, dit aussi écurie, avoine, épouvante, crottin et odeurs. L’avoine mêlée au crottin nourrissait tout de même les moineaux dont la population est nettement en baisse depuis la disparition des chevaux de la ville.
De son vrai nom ROMANIUK, il demeurait au 10½ rue Saint-Florent. Célibataire. On disait qu’il était un « Poloc », mais son nom laisse croire qu’il était plutôt Ukrainien. Ils sont venus nombreux les Ukrainiens au pays, fuyant un pays partagé en deux par l’occupation polonaise et soviétique en 1921. Il parlait un peu l’anglais et baragouinait le français. Quant aux Romanuk, il semble être arrivé au pays peu avant la guerre, peut-être à la suite des menaces que l'Allemagne nazie faisait peser sur l'ensemble de la Pologne à la fin des années 1930. Chose certaine, John Romaniuk, né en 1902, vendait déjà des frites en 1938 comme le montre une photo de la rue Montcalm prise cette année-là (BAnQ).
Jos Patates entretenait peu de relations avec le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.
le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.
Cet homme ne faisait apparemment rien d’autre que de travailler. Il se couchait tôt ; rarement les lumières de sa maison étaient allumées. Il possédait plusieurs propriétés ; on le disait même riche.
Les meilleures frites en ville
Comme son nom l’indique, Jos Patates vendait des pommes de terre frites qu’il faisait frire dans sa voiture tirée par un cheval. Il a été le dernier marchand hullois, sinon le dernier Hullois à entretenir un cheval dans la ville, dans une écurie située derrière sa maison, au 10½, rue Saint-Florent.
Il vendait les meilleurs frites en ville. Il avait appris ce métier de Roger Millette, aussi un « friteur » de patates qui s’était attaché aux Romanuk au point de travailler avec Mike Romanuk, propriétaire d’un commerce de location de salles de fêtes (mariage, etc.). Roger Millette était un Hullois pure laine qui avait commencé à vendre des frites en 1931, à la faveur de la crise économique de 1929. Ses fils, Réjean et Robert, suivront plus tard ses traces et feront les meilleures frites de Hull et Gatineau.
Jos Patates pelait ses patates tous les matins, en compagnie de deux enfants de la rue Saint-Florent qu’il payait de 0,05 à 0,10 dollar (pour 1 heure de travail, avant la classe, dans les années 1950) et qu’il entreposait dans de gros barils pleins d’eau.
Avec son cheval, il faisait un circuit de rues bien déterminé dans le Vieux Hull. Dans les années 1950, il vendait ses frites 5¢ dans un petit cornet et 10¢ dans un sac, en papier brun, plus gros. Le midi, les mères lui envoyaient leurs enfants avec un bol qu’il comblait généreusement de frites contre la somme de 1 dollar. Le soir, il s’installait, avec sa voiture et son vieux cheval, aux abords de lieux où se déroulaient des événements sportifs. Trois fois par semaine, durant la belle saison, il se garait au coin des rues Papineau et Kent, aux abords du parc Fontaine, où se déroulaient les matchs de balle rapide de la fameuse Ligue commerciale. Il y avait là parfois jusqu’à trois mille spectateurs. Ces jours-là, Jos Patates vendait toutes ses frites et son maïs soufflé.
Puis un jour, le cheval de Jos Patates est mort. Dès que la nouvelle s’est répandue, les enfants du quartier ont vite fait d’entourer l’écurie pour regarder à travers les interstices des planches ce à quoi pouvait ressembler un cheval mort.
Comment faisait-il pour donner une couleur dorée à ses patates et un goût incomparablement bon ? Il faisait simplement frire les pommes de terre dans de la graisse de bœuf (suif), la moins chère sur le marché, après les avoir lui-même épluchées, lavées et essuyées. Certains ont dit qu’il ajoutait un peu de Coca-Cola au suif, d’autres de la... mélasse ! Mais avez-vous essayé d’ajouter de la mélasse à du saindoux liquéfié ? Quoi qu’il en soit, ces frites étaient bonnes, meilleures que celles de la plupart des autres vendeurs itinérants. Et si c’était à cause de l’odeur du crottin de son cheval ?
Carnage à l'île aux Allumettes
![]() Par
ouimet-raymond
Le 15/04/2022
Par
ouimet-raymond
Le 15/04/2022
Située au bout de la route 148, à environ 140 kilomètres à l’ouest de Gatineau, dans le comté de Pontiac, l’île aux Allumettes apparaît pour la première fois dans l’histoire du Québec sous la plume de Samuel de Champlain qui l’a visitée en 1613. D’abord occupée par les Kichesipirini, Amérindiens algonquiens, elle est colonisée par la population blanche à partir de 1836 ou environ.
À l’île aux Allumettes se trouvent un village, Chapeau, et trois lieux-dits : Desjardinsville, Demers Centre et Saint-Joseph. La population comptait, en 1933, une population composée de 2/3 d'anglophones et de 1/3 de francophones.
Parmi les francophones de Demers Centre se trouvaient aussi quelques familles anglophones. Au nombre de ces derniers, il y avait la famille Bradley, c’est-à-dire Joseph et son épouse Margareth Berrigan. En 1929, celle-ci acheta une ferme de 53 hectares, dans le rang de la Ouabache, au lieu-dit Demers Centre, au prix de 8 000 dollars. L’un des fils Bradley, Michael, y investit alors tout son avoir : 1 000 dollars.
Les Bradley formaient une sorte de clan. Vivaient ensemble les parents, Joseph et Margareth, trois de leurs enfants, Thomas, Michael et Johanna, et le frère de Joseph, John.
Une famille dysfonctionnelle
Joseph Bradley était un homme dur, violent, qui élevait ses enfants avec une effroyable sévérité. Michael était celui qui travaillait le plus fort à la ferme de son père. Bien qu’il fut quadragénaire, son père n’hésitait pas à le frapper quand il estimait – le plus souvent à tort – que celui-ci méritait une correction. Mais Michael continuait à respecter le paternel. Un jour que son père eut une rude altercation avec Thomas, l’aîné des fils qui était, a-t-on dit, à demi fou, Michael lui sauva la vie en s’interposant entre les deux adversaires au moment où Thomas s’apprêtait à frapper son père avec un piquet de clôture.
En dépit du bon travail de Michael et de sa santé plutôt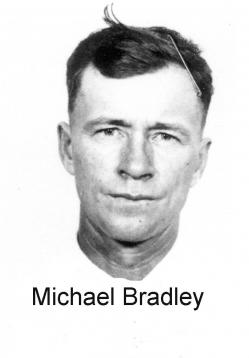 fragile, Joseph n’arrêtait pas de le traiter durement pour ensuite l'expulser de sa maison. Michael avait bien tenté d’obtenir sa part de la valeur de la ferme, soit environ 3 000 dollars, mais son père avait catégoriquement refusé. Michael lui demanda alors la permission de se payer à même le bois debout qu’il couperait lui-même, sans plus de succès.
fragile, Joseph n’arrêtait pas de le traiter durement pour ensuite l'expulser de sa maison. Michael avait bien tenté d’obtenir sa part de la valeur de la ferme, soit environ 3 000 dollars, mais son père avait catégoriquement refusé. Michael lui demanda alors la permission de se payer à même le bois debout qu’il couperait lui-même, sans plus de succès.
Michael réussit à s’installer sur une autre ferme, à moins de 2 kilomètres de celle de son père où il continua tout de même à travailler. Ses parents le traitaient toujours aussi mal. On refusait de l’accueillir dans la maison et il prenait ses repas dehors, sur le balcon ou encore dans l’écurie avec les chevaux. Un jour, Michael finit par en avoir assez ; il commença à parler de suicide.
C'était le 21 juillet 1933 à six heures et demie. Narcisse Vaillancourt était en train de prendre son petit déjeuner quand il entendit un coup de feu, puis un deuxième. Pan ! Pan ! Il se leva et alla voir à la fenêtre de sa maison qui donnait sur la terre des Bradley. Il aperçut un homme qui poursuivait une femme et qui entra par derrière elle dans la maison. Puis, Narcisse entendit deux autres coups de feu rapprochés et, quelques minutes plus tard, une autre décharge.
Puis il vit l’homme, la tête couverte d’un sac kaki, quitter la ferme des Bradley à travers champs. Moins d’une demi-heure plus tard, les habitants du rang se massaient autour de la maison des Bradley. On envoya quérir un prêtre du village, l'abbé Denis Harrington, qui arriva sur les lieux vers les 10 heures. Il pénétra dans la maison des Bradley avec deux concitoyens. Dans la cuisine, le groupe trouva étendue sur le plancher Johanna Bradley (37 ans). À ses côtés, assise et appuyée contre un mur, une brosse à dents dans une main, Mme Bradley (67 ans) baignait dans son sang. Le groupe de citoyens monta à l’étage et y trouva dans une chambre, Thomas Bradley (45 ans), mort lui aussi. Ensuite, le curé se rendit à la grange où on finit par y trouver deux cadavres : celui de Joseph Bradley (65 ans), le père, et de John Bradley (62 ans), son frère.
L'enquête
Pendant ce temps-là, le p’tit Narcisse se rendit chez Michael Bradley pour l’informer du drame qui venait de se dérouler à la maison paternelle. Michael eut peu de réactions si ce n’est de dire que c’était probablement son frère ou son oncle qui aurait fait le coup. La femme de Michael dit à son mari, en aparté, que s’il y avait problème, il serait mieux d’aller voir l'abbé Harrington.
Le docteur Jean Roussel, de l'Institut médico-légal de Montréal, pratiqua une autopsie sur les corps des victimes et il y trouva des balles de calibre 32. L’enquête criminelle fut alors confiée au sergent-détective Dalpé de la Sûreté provinciale qui, en quelques heures, se fit une bonne idée de l’identité du meurtrier. Il arpenta la terre des Bradley, trouva le sac kaki du meurtrier, puis décida d’interroger Michael Bradley.
Toujours est-il, après quelques interrogatoires du suspect, le policier décida de faire une perquisition chez Michael Bradley, en compagnie de collègues. Dans les poches d’une salopette de Michael, les enquêteurs trouvèrent la douille vide d’une cartouche de calibre 32. Or, en fouillant l’étable, un homme remarqua qu’une pièce de bois du plancher bougeait anormalement. Un policier la souleva : il y trouva une carabine Winchester de calibre 32 et une boîte de cartouches partiellement vide. L’examen de l’arme démontra peu après qu’elle avait bel et bien servi au massacre des Bradley.
Michael Bradley était démasqué : il avait assassiné cinq personnes. Grand, maigre, stature osseuse, figure ovale illuminée par deux petits yeux bleu clair, Michael assista aux funérailles des siens à partir du balcon d'un hôtel Gray au village de Chapeau.
Le procès eut lieu à Campbell’s Bay en juillet 1934. Le procureur de la Couronne était le fameux François Caron de Hull, celui-là même qui présidera à l’enquête sur la corruption à Montréal plusieurs années plus tard. Le jury ne réussit pas à s’entendre : la majorité voulait rendre un verdict d’homicide involontaire en dépit des directives du juge. On dut donc reprendre le procès.
Le second procès eut lieu à Hull en janvier 1935. Il y avait tellement de monde au palais de justice que l’on eut peur que le plancher de la salle d’audience fléchisse sous le poids des spectateurs. De fait, le plafond du dessous perdit plusieurs morceaux de plâtre. Après 45 minutes de délibération, le jury trouva Bradley coupable de meurtres prémédités. Quand il entendit le juge le condamner à mort, le prévenu s’évanouit. On ne lui reconnut aucune circonstance atténuante. Choqués par la condamnation, des Pontissois firent circuler une pétition pour empêcher l’exécution du condamné, ce à quoi les autorités fédérales se refusèrent. Ainsi, Bradley fut pendu à la prison de Campbell’s Bay le 5 avril 1935 à 6 heures en présence de l'abbé Harrington.
Sources :
BAC, RG 13, vol. 1595, dossier CC 429; 1933-1937.
BAnQ-CAO, TP9-S9, Archives judiciaires, divers, exécutions 1863-1937.
Des enfants exilés en Outaouais
![]() Par
ouimet-raymond
Le 04/04/2022
Par
ouimet-raymond
Le 04/04/2022
À la fin du XIXe siècle, la Grande-Bretagne dirigeait l’empire le plus grand et le plus riche du monde. Cela était dû au fait qu’en 1700, les élites dirigeantes de la Grande-Bretagne avaient décidé de dominer l’économie mondiale au moyen d’une flotte de navires commerciaux et militaires sans précédent. Ainsi, Londres est devenue la plus grande cité commerçante du monde et « ses richesses les plus importantes de tout l’univers. » Paradoxalement, la capitale britannique aura aussi été une ville où vivait une des plus grandes concentrations de nécessiteux de la planète. Au moindre écart, les démunis et les opprimés étaient sanctionnés. Par exemple, un homme y a été pendu à l’âge de 22 ans pour avoir volé un jambon en 1734.
Entre 1770 et 1830, 35 000 condamnations à mort ont été prononcées en Angleterre et au pays de Galles[1] ! En 1798, à la suite d’un soulèvement en Irlande, 30 000 paysans ont été massacrés dans le cadre de pendaisons officielles et de massacres improvisés. Non, il ne faisait pas bon pour un pauvre de vivre au Royaume-Uni.
Un poids social
Dans les années 1850, on fonde en Grande-Bretagne des maisons de correction et des écoles industrielles pour les enfants des familles pauvres. En 1882, 17 000 enfants nécessiteux fréquentaient ces écoles devenues ingérables. Pour se débarrasser de ce poids social, les autorités ont alors décidé de mettre en œuvre un système d’immigration juvénile dans le but de « sauver les enfants de mauvaises influences » en les expédiant outre-mer dans un milieu rural loin des tentations urbaines et de ses misères ! À cette époque, la pauvreté était vue comme une maladie infectieuse. Ainsi, de 1869 à 1930, les autorités britanniques enverront au Canada entre 80 000 et 100 000 enfants orphelins, abandonnés ou touchés par la pauvreté, dont 70 000 en Ontario et 8 000 au Québec. Cette immigration était définie par Londres et imposée au Canada.
Des enfants semblent avoir été  recrutés ou séduits par des circulaires aux promesses alléchantes, mais plusieurs ont simplement été déportés sans le consentement de leur famille alors que d’autres ont été envoyés au Canada par leurs parents qui espéraient que leur progéniture serait plus heureuse dans ce vaste pays. Le plus souvent, l’enfant ignorait où il allait et où il habiterait si ce n’est sur une ferme ; il ne savait même pas qu’il quittait sa famille à jamais, quand il en avait une. Or, la plupart ne savaient pas ce qu’était de travailler sur une ferme et ne connaissait pas la rigueur du climat canadien. Pire, frères et sœurs étaient souvent séparés.
recrutés ou séduits par des circulaires aux promesses alléchantes, mais plusieurs ont simplement été déportés sans le consentement de leur famille alors que d’autres ont été envoyés au Canada par leurs parents qui espéraient que leur progéniture serait plus heureuse dans ce vaste pays. Le plus souvent, l’enfant ignorait où il allait et où il habiterait si ce n’est sur une ferme ; il ne savait même pas qu’il quittait sa famille à jamais, quand il en avait une. Or, la plupart ne savaient pas ce qu’était de travailler sur une ferme et ne connaissait pas la rigueur du climat canadien. Pire, frères et sœurs étaient souvent séparés.
Au Canada, les enfants ont été accueillis dans des orphelinats ou des Home. Ils étaient souvent dans le désarroi le plus total. Le jour précédent leur arrivée, on informait la population que les enfants attendraient d’êtres accueillis ou même adoptés. Au Québec, les enfants ont été placés au nombre de quatre à douze par paroisse.
Si des enfants ont été accueillis comme des garçons ou des filles de la maison, de nombreux autres ont été reçus comme de la main-d’œuvre bon marché. Certains ont même été abandonnés quand leur tuteur jugeait qu’ils ne faisaient pas l’affaire ou qu’ils étaient malades, alors que d’autres ont été battus. Des enfants ont été logés dans des granges alors que des filles ont parfois été violées. Et nombreux ont été ceux qui ont subi plusieurs placements dans diverses familles d’accueil à cause de l’insatisfaction, le décès ou le déménagement du tuteur et à la suite d’une plainte de l’enfant pour mauvais traitements.
Les enfants ont généralement été bien accueillis au Québec. En 1902, un rapport de Bans & Chilton a souligné : « Il est clair dans la majorité des cas que l’enfant reçoit un meilleur traitement avec le Français [francophone] qu’avec l’Anglais. » Mais placer l’enfant dans un milieu francophone accentuait sa solitude à cause de la barrière de la langue et des mœurs différentes.
En Outaouais
Environ 3 000 enfants britanniques ont été placés en Outaouais dont 515 ont été identifiés par Mme Reine G. Morin-Lavoie. La vie de ces enfants n’a pas été différente en Outaouais qu’ailleurs au pays. Ainsi, celle du jeune Arnold Welsh, né en 1891 à Sheffield en Angleterre. Sa mère morte en 1901, son père s'est remarié, mais a confié son fils au Nugent Home. Arnold est arrivé au Québec en 1905, puis il a été placé à Masson chez un agriculteur prospère, James Kelly. Forcé à dormir dans la grange avec le bétail, l’adolescent mourra à la suite d’importants sévices moins de 7 mois après son arrivée au pays. Kelly sera condamné à 7 ans de prison.
D’autres ont été plus chanceux que le jeune Welsh. Par exemple, Violet Low, née en Écosse en 1897, est arrivée au Canada en 1910. En 1911, elle vivait à Ironside (Hull Ouest) où elle travaillait chez William Olmsted qui a fini par l’adopter. En 1916, elle a épousé un jeune d’origine allemande qui lui fera trois enfants. Violet est décédée en 1972 à Ottawa.
Comme l’a écrit Reine G. Morin-Lavoie : « [C’est-là] une page de notre histoire peu glorieuse qui mériterait d’être rappelée à ceux qui, trop souvent, utilisent les plus vulnérables pour forger leur profil philanthropique. »
Sources :
La Presse (Montréal), 1er mars 2017.
LINEBAUGH, Peter, Les pendus de Londres, crime et société civile au XVIIIe siècle, Montréal, éd. Lux, 2018.
MORIN-LAVOIE, Reine G., Enfants immigrants dans l’Outaouais québécois 1870-1930 – Portraits et destins, s.l., 2020.
[1] Ils ont été 7 000 à être exécutés.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 09/03/2022
Par
ouimet-raymond
Le 09/03/2022
Hull, Québec, printemps 1871. Olivine Bleau est une femme heureuse. Âgée de vingt et un ans, elle a trouvé un mari à la fin de l’été précédent[1]. L’énergique père Louis-Étienne Delisle Reboul a consenti à bénir son mariage, lequel a été célébré à Hull en septembre 1870 dans l’église Notre-Dame en construction.
Olivine a vu le jour le 3 juillet 1849, à la Pointe-Claire, du mariage d’Édouard Bleau, forgeron, et de Louise Rableau. Mais que sait-elle de son mari, Onésime Lesage ? À part son âge – environ 37 ans – , elle le connaît que bien peu sinon pas du tout. Mais à son bras, un brin d’orgueil bien légitime rougit ses joues de contentement. Il est vrai que l’allure herculéenne du bel Onésime lui donne un air de Jos-Montferrand et que les amoureux ont des prénoms dont la rime semble être un présage de bonheur. Mais le bonheur est parfois éphémère.
Une femme en colère
Olivine n’avait pas vu qu’Onésime avait la mine  d’un renard maraudant près d’un poulailler. Alors que son mari bosse dans les chantiers de l’Outaouais, elle reçoit une lettre qui lui apprend qu’elle n’est pas le seul amour du bel hercule. En effet, Onésime a déjà convolé auparavant et on dit que sa première épouse a toujours bon pied bon œil. Pire encore, Onésime aurait aussi des enfants ! En colère, Olivine porte plainte auprès des autorités qui mettent en état d’arrestation Onésime le soir du 15 juillet 1871 alors qu’il fait une halte à Hull : il travaille comme cageux pour un certain Aenan.
d’un renard maraudant près d’un poulailler. Alors que son mari bosse dans les chantiers de l’Outaouais, elle reçoit une lettre qui lui apprend qu’elle n’est pas le seul amour du bel hercule. En effet, Onésime a déjà convolé auparavant et on dit que sa première épouse a toujours bon pied bon œil. Pire encore, Onésime aurait aussi des enfants ! En colère, Olivine porte plainte auprès des autorités qui mettent en état d’arrestation Onésime le soir du 15 juillet 1871 alors qu’il fait une halte à Hull : il travaille comme cageux pour un certain Aenan.
Onésime, fils de François Lesage et de Marie-Anne Arseneau, prétend que sa première épouse est décédée ; il avait épousé Sophie Roy le 23 septembre 1862 à Sainte-Ursule. De ce mariage sont nés quatre enfants : Délia, Hedwige, Hormisdas et Louis-Adélard[2]. Le 27 juillet 1871, Hilaire Roy, le frère de la prétendue morte, vient témoigner. Il dit que sa sœur, Sophie, a quitté Lesage quatre ans après leur mariage et qu’elle est ensuite partie pour les États-Unis. Il ne sait toutefois pas où elle habite – dans l’état de New York peut-être – et si elle vit encore. Mais on lui aurait affirmé qu’elle habitait dans la région de Moortown.
L’affaire n’est pas claire et le juge libère Lesage contre une caution et reporte la cause à plus tard en souhaitant qu’Hilaire Roy puisse vérifier ses renseignements. Le 31 juillet, la cause est entendue une nouvelle fois. Hilaire Roy déclare qu’il s’est rendu à Moore’s Junction où on aurait signalé la présence de sa sœur avec un homme, mais il ne l’a pas trouvée.
Un faux témoignage
Le père Reboul – un oblat de Marie Immaculée – identifie Onésime Lesage et Olivine Bleau puis assure la Cour qu’il les a bel et bien mariés en 1870. Olivine Bleau témoigne en après-midi. L’amour lui a donné une audace qui a plus à faire avec l’effronterie que le courage : elle nie avoir épousé Lesage ! On se demande bien alors de quoi la jeune femme a à se plaindre. Quoi qu’il en soit, le juge reporte la cause une nouvelle fois. Et comme Lesage n’a pas payé la caution imposée, il est arrêté et emprisonné.
 Le 12 août, l’avocat de la Couronne Lees réclame l’ajournement de la cause pour lui permettre de prouver l’existence de la première épouse. Le défenseur de Lesage, un certain Mosgrove, s’oppose à l’ajournement et estime que la cause est sans objet. Et comme la Couronne n’a toujours pas de preuves à présenter, Lesage est enfin relaxé.
Le 12 août, l’avocat de la Couronne Lees réclame l’ajournement de la cause pour lui permettre de prouver l’existence de la première épouse. Le défenseur de Lesage, un certain Mosgrove, s’oppose à l’ajournement et estime que la cause est sans objet. Et comme la Couronne n’a toujours pas de preuves à présenter, Lesage est enfin relaxé.
Onésime Lesage était-il bigame comme on l’a prétendu dans une lettre ? Peut-être bien, car la mort de Sophie Roy n’a jamais été démontrée, pas plus que son existence. Quoi qu’il en soit, le couple Lesage-Bleau n’a pas moisi dans la région puisqu’il n’apparaît pas au recensement de 1881.
Sources :
BMS de la paroisse Saint-Joachim de la Pointe-Claire, 1849.
BMS de la paroisse Sainte-Ursule, 1862 à 1866.
The Ottawa Times (Ottawa) 17 juillet au 18 août 1871.
Les amants diaboliques de Montpellier
![]() Par
ouimet-raymond
Le 13/02/2022
Par
ouimet-raymond
Le 13/02/2022
Marie Beaulne n’a que 17 ans quand elle épouse Zéphyr Viau qui, lui, en a 36 (1904). Était-ce un mariage d’amour ? Pas sûr. Toujours est-il qu’après 21 ans de mariage et 10 enfants, Marie s’est entichée d’un pauvre diable de 32 ans, Philibert Lefebvre qui a fait la Grande Guerre, celle de 14. Vers 1925-1926, il s’établit à Montpellier où il flâne apparemment plus qu’il n’y travaille.
À cette époque-là, Zéphyr Viau travaillait dans les chantiers. Les prêches et les sermons du curé, qui enseigne que l’adultère est un péché mortel, n’ont pas le moindre effet sur l’épouse Viau. Elle est follement amoureuse de Philibert et de son regard bleu clair. Dès que Zéphyr s’absente de la maison, elle suspend une pièce d’étoffe rouge à sa corde à linge pour avertir Philibert que la corrida peut commencer.
Un jour de l’automne 1928, Marie demande à l’ancien soldat s’il est prêt à l’épouser dans l'éventualité où son mari mourrait. Ce à quoi l’amant répond par l’affirmative. Voilà Marie doublement amoureuse. Tout habitée par cette dévorante passion, elle ne se soucie ni de la réalité ni des convenances et n’obéit plus qu’à son inconscient sinon à ses sens. Petit à petit s’impose comme seul remède à son obsession l’assassinat de l’encombrant mari pour être tout entière à celui qu’elle aime.
En ce matin-là, donc, juste avant le départ de Zéphyr pour les chantiers, Marie lui remet un médicament qu’il n’avalera qu’une fois rendu sur les lieux de son travail. C’est alors qu’il est soudainement pris de douleurs aux entrailles et de brûlements à l’estomac. Heureusement, le cuisinier du camp lui fournit une potion qui lui fait vomir ce qui était un poison !
Le temps passe et Zéphyr revient à la maison pour la période des fêtes de Noël et du jour de l’an. Amère constatation : le Philibert dort encore chez lui – pour ne pas dire qu’il y fornique – régulièrement. Le bûcheron sort de ses gonds et menace de tuer l’amant si ce dernier revient dans les parages. Marie s’énerve. Zéphyr songe à la faire arrêter et s’en confie à leur fille aînée. Mais Marie est incapable de se passer de l’ancien soldat, de ses caresses et des massages sensuels qu’il lui prodigue.
Le temps des Fêtes terminé, Zéphyr reprend le chemin des chantiers et Philibert celui de la couche de la chaude Marie ; les ressorts peuvent de nouveau grincer à répétition. Entre deux séries d’étreintes, le couple discute évidemment des menaces de mort que Zéphyr a proférées. C’est dans ces circonstances que Lefebvre aurait déclaré : « Puisqu’il en est ainsi, il vaut mieux que ce soit Viau qui meurt que moi. » Marie demande à Philibert du poison ; il lui remet une petite bouteille contenant de la strychnine, produit qu’il emploie souvent pour tuer les petites bêtes
Une soupe à la grimace
Le 19 janvier, Zéphyr rentre des chantiers. Le lendemain, Marie sert à son mari pour dîner une soupe qu’il trouvera très amère ; il la mange quand même. Immédiatement saisi de vomissements, il doit s’aliter. Marie demande à un voisin d’aller « quérir » le curé en précisant qu’un médecin n’est pas nécessaire. Quand le curé arrive chez les Viau, vers 15 heures 30, il trouve Zéphyr agonisant.
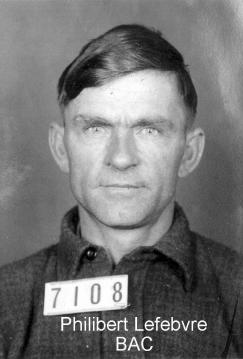 Le curé juge qu’il y a anguille sous roche, d’autant plus que la Marie ne semble ni inquiète ni même affligée en voyant son mari si mal en point. Quoi qu’il en soit, Zéphyr meurt deux jours plus tard. Le curé de Montpellier confie ses doutes, sur la cause de la mort de Zéphyr Viau au Procureur général de la province qui ordonne l’exhumation du corps. Le médecin légiste trouve dans le corps de Viau assez de strychnine pour tuer douze personnes.
Le curé juge qu’il y a anguille sous roche, d’autant plus que la Marie ne semble ni inquiète ni même affligée en voyant son mari si mal en point. Quoi qu’il en soit, Zéphyr meurt deux jours plus tard. Le curé de Montpellier confie ses doutes, sur la cause de la mort de Zéphyr Viau au Procureur général de la province qui ordonne l’exhumation du corps. Le médecin légiste trouve dans le corps de Viau assez de strychnine pour tuer douze personnes.
Tous les soupçons se portent sur Marie Beaulne et Philibert Lefebvre qui après une interrogation en règle finissent par avouer leur crime, Lefebvre jetant la responsabilité sur son amante.
Ce n'est pas pas moi, c'est l'autre...
Marie Beaulne déclare ceci : « …Lefebvre a fait de moi un martir […] il ses servi de l’huile de charme l’huile de radionne [?] puis l’huile danis il a mis cela sur moi vous savez qune créature est pas forte comme un homme quand sa veux mal fer… »
Voilà, cela semble assez clair : elle était incapable d’opposer la moindre résistance aux caresses et aux désirs de son amant. Marie aurait-elle osé tuer son mari si elle n’avait pas eu de poison ? C’est si facile de compléter l’assaisonnement d’un plat à l’aide d’un petit quelque chose à effet définitif !
Le procès des amants a lieu à Hull en juin 1929 et ils sont rapidement condamnés à mourir pendus haut et court. Le souffle coupé, la condamnée s’écrase sur son siège en cachant son visage en pleurs dans son mouchoir de deuil. Philibert Lefebvre s’écrie : Votre Honneur, vous devez m’accorder votre pardon. Dieu et les Évangiles exigent que vous soyez clément. »
Partout, on s’active pour sauver la vie des condamnés. Sans succès. Marie Beaulne panique. De sa belle écriture cursive, mais bourrée de fautes, elle adresse au shérif Saint-Pierre une lettre dans laquelle elle charge son amant :
[…] comme vous voyez que c’est pas moi quil est la plus coupable aracher une mère de 8 enfants pour l’amour d’un malfaisant trouvé vous que cest juste que si savait pas été lui que jamais sa serais ariver sa fésait 25 ans que jetait avec mon marie quon setait toujours bien aranger puis que ce Moribon vien nous separer en meme temps maraché de mes enfants ses pauvre petit […]
Le matin du 23 août 1929 – un vendredi, pour rappeler que deux larrons ont été crucifiés avec le Christ –, une foule évaluée à plus de 2 000 personnes est assemblée devant le palais de justice de Hull, où une partie d’entre elles a passé la nuit, et occupe les toits des bâtiments environnants qui donnent sur la cour de la prison attenante au palais.
L’exécution achevée, le père de Philibert Lefebvre réclamera le corps de son fils, mais personne ne demandera celui de Marie Beaulne qui sera enterré dans la fosse commune du cimetière Notre-Dame à Hull même si le policier Joseph Frédéric Dalpé, qui avait le cœur à la bonne place, avait offert de payer de sa poche le transport de la dépouille mortelle à Montpellier.
Source :
OUIMET, Raymond, Crimes, mystères et passions oubliés, Gatineau, éd. Vents d'Ouest, 2010.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 03/02/2022
Par
ouimet-raymond
Le 03/02/2022
Il y avait jadis en Outaouais, comme partout ailleurs au Québec, une coutume que l'on appelait « les fréquentations ». Celles-ci devaient normalement aboutir au mariage à la suite d'une cérémonie de fiançailles au cours de laquelle le prétendant s'engageait à prendre pour épouse la jeune fille pour laquelle son cœur battait. Ces fréquentations strictement restreintes aux « bons soirs » consistaient en des visites, des sorties, des échanges d'opinions et parfois aussi de plaisirs défendus. C'était un temps d'inquiétudes et pour le curé et pour les parents qui dénonçaient les fréquentations jugées inutiles quand elles n'avaient pas pour but principal le mariage. Pour les jeunes gens, c'était le bon temps, celui dont plus tard on se souvient avec nostalgie.
Les fréquentations se déroulaient généralement dans le cadre d'une surveillance rigide. Les couples d'amoureux étaient le plus souvent accompagnés d'un chaperon au cours de leurs sorties et parfois même pendant la soirée au salon.
Et quand le fiancé veillait un peu trop tard chez son amie de cœur, le futur beau-père n'hésitait pas à remonter, d'un air faussement innocent, l'horloge devant les tourtereaux qui comprenaient le message. Dès que les fréquentations marquaient une certaine assiduité, les parents intervenaient pour découvrir les intentions des jeunes gens. Et si l'ami ou l'amie de cœur de leur progéniture ne leur convenait pas, ils mettaient fin à l'idylle. Mais il arrivait parfois aux amoureux d'offrir une résistance particulièrement opiniâtre aux volontés parentales, surtout quand ils avaient fêté Pâques avant les Rameaux !
Alphonse Richard et son épouse avaient de très jolies filles qui étaient évidemment fort recherchées par cette partie de la gent masculine en quête d'une compagne. L'une d'elles, Alexandrine, âgée de dix-neuf ans, fréquentait un jeune homme de vingt-deux ans, Joseph Laviolette de la rue Duke (Leduc) à Hull. Les jeunes gens s'aimaient d'un amour si passionné qu'ils avaient résolu de s'épouser. Mais voilà, les parents d'Alexandrine ne voulaient pas entendre parler de ce mariage et s'y opposaient formellement. Malgré cela, les tourtereaux avaient décidé de passer outre aux objections des parents et ils conçurent le projet de convoler devant un pasteur anglican qui aurait été moins curieux que ceux de l'Église catholique. Après avoir fignolé dans le plus grand secret les préparatifs du mariage, Alexandrine s'était enfuie de chez elle pour rejoindre son cavalier le soir du 7 novembre 1895. Sans perdre de temps, le couple d'amoureux se rendit à l'église épiscopale Christ Church à Ottawa où le révérend Loucks bénit leur union conjugale le même soir.
Un secret vite éventé
Comme la partie urbaine de l'Outaouais était encore peu peuplée à l'époque, les secrets de cœur ne faisaient pas long feu et les nouvelles locales circulaient plus vite qu'aujourd'hui. Le soir du mariage du jeune couple hullois, Alphonse Richard était mis au courant de l'escapade de sa fille. Fort mécontent, il était allé se plaindre au poste de police où il avait réussi à obtenir un mandat d'arrestation à l'encontre de sa fille pour désertion du toit paternel .
.
Le lendemain, la jeune Alexandrine comparaissait en cour, mais le juge décida de remettre l'audition de la cause à la semaine suivante. Le père de la jeune mariée demanda alors que sa fille soit placée sous sa garde jusqu'au moment où le tribunal rendrait sa décision. Mais l'avocat Rochon, défendeur d'Alexandrine, s'y était opposé et il avait sollicité la mise en liberté provisoire de sa cliente sur simple cautionnement personnel, ce qui lui fut accordé.
Le lundi 11 novembre 1897, le recorder Champagne rendait sa décision en l'absence d'Alphonse Richard qui avait peut-être pressenti sa défaite judiciaire. En effet, le juge rejeta la plainte de Richard et le condamna à payer tous les frais, soit 20 dollars, dans les deux jours sous peine d'un mois de prison! Le 17 janvier 1896, à l'église Notre-Dame-de-Grâce de Hull, le jeune couple faisait valider son mariage par le père Dozois. Comme quoi l'amour est plus fort que la police !
La plus belle femme de Hull
Nul doute qu'après ce procès Alphonse Richard resserra la surveillance sur son autre fille, Victorine, qui pour le plus grand malheur du paternel était dotée de charmes et de formes si agréables que sa beauté faisait la quasi-unanimité dans la ville. Victorine était incontestablement très belle, jolie comme un cœur. D'ailleurs, à l'été de 1907, un marchand de cartes postales de la ville, un certain Paré, avait organisé un concours pour désigner la plus belle femme de Hull. Victorine Richard avait remporté haut la main le titre convoité avec 900 votes, ce qui lui valut un prix de 5 dollars en monnaie d'or.
À l'instar de sa sœur Alexandrine, treize ans auparavant, la pétillante Victorine était aussi follement éprise d'un jeune homme, Télesphore Potvin, qui le lui rendait bien. Les jeunes gens se courtisaient depuis cinq ans et les parents du soupirant voyaient d'un bon œil les attentions que leur fils prodiguait à la belle Victorine et ils comprenaient que leur fils, en s'approchant de la jeune femme, ait attrapé un rhume de cœur. Malheureusement, le père de cette dernière n'était pas animé de sentiments aussi aimables envers Télesphore. En novembre 1908, Alphonse Richard avait expliqué à sa fille qu'il voulait à tout prix qu'elle mit fin à ses engagements avec son cavalier et, de ce jour, il avait décrété que sa porte serait désormais fermée au jeune soupirant.
Angoissée, la belle et jeune Victorine avait fait part du décret paternel à celui qu'elle aimait. Mais il n'était pas question pour elle de mettre fin à cette relation, d'autant plus qu'elle avait déjà dépassé les bornes du tout sauf ça. Pendant de nombreux mois, le jeune couple sembla se plier aux désirs d'Alphonse Richard. Mais dans le secret, le mariage était organisé avec la complicité des parents de Télesphore et des Oblats de la paroisse. Le mardi 31 mars 1908, après avoir obtenu une dispense de trois bans de mariage et une dispense de temps prohibé – à cause du carême –, Victorine et Télesphore se marièrent en l'église Notre-Dame-de-Grâce. Il était temps et même grand temps. Le soir même, Victorine annonça à son père qu'elle avait épousé son cavalier. Surpris par le comportement de sa fille, Alphonse Richard renonça, devant le fait accompli, à recourir à la loi pour retenir sa fille à la maison. L'expérience de 1895 avait porté ses fruits.
Le 30 juillet suivant, le couple Potvin se rendit à l'église de Notre-Dame-de-Grâce pour faire baptiser son premier rejeton. Les parents de Télesphore étaient les parrain et marraine du nouveau-né : ils avaient compris qu'il était parfois difficile de résister à la tentation de la chair surtout quand, dans les bras d'un fringant jeune homme, se blottissait la plus belle fille de la ville.
Source :
OUIMET, Raymond, Histoires de coeur insolites, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1994.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 22/01/2022
Par
ouimet-raymond
Le 22/01/2022
La vie des pompiers au début du XXe siècle n'était pas drôle. Ils étaient confinés de longues heures à leur caserne à réparer l'équipement, à entraîner et nourrir les chevaux, à nettoyer les écuries, à entretenir la caserne, à jouer aux dames... en bois. En 1918, ils vivaient à la caserne 24 heures par jour et n'avaient qu'une demie journée de congé tous les quatre jours. Ils ne voyaient donc pas souvent femme et enfants. En avril 1919, un pompier déclara à l'éditorialiste du journal Le Droit, Thomas Poulin :
Je suis pompier depuis quelques années, j'ai des petits [jeunes] enfants qui commencent à grandir et ces enfants ne me connaissent pas parce qu'ils ne me voient jamais[1].
Rien d'étonnant que les pompiers de l'ancienne ville de Hull aient déclenché une grève en mai 1919 pour obtenir de meilleures conditions de travail. Le journal local appuya leurs revendications en ces termes :
Les besoins de la famille chrétienne exigent donc que l'employeur, qu'il soit individu ou corporation, fournisse au père les moyens d'élever chrétiennement sa famille, ce qu'il ne peut faire s'il ne va jamais à la maison[2].
 Après une grève qui n'aura duré que 30 heures, le conseil municipal décida de créer une seconde équipe de pompiers, ce qui limita la journée à 12 heures consécutives à la caserne. Quarante ans plus tard, les pompiers passaient 72 heures par semaine à la caserne, mais ne bénéficiaient que d'une fin de semaine par mois de congé[3].
Après une grève qui n'aura duré que 30 heures, le conseil municipal décida de créer une seconde équipe de pompiers, ce qui limita la journée à 12 heures consécutives à la caserne. Quarante ans plus tard, les pompiers passaient 72 heures par semaine à la caserne, mais ne bénéficiaient que d'une fin de semaine par mois de congé[3].
Au temps des chevaux, la vie de pompier ressemblait à celle des pilotes de course d'aujourd'hui. Leurs fringants quadrupèdes prenaient parfois le mors aux dents ou tournaient les coins de rue trop rapidement, jetant équipement et équipage en bas du fourgon à échelles, équipement et équipage ou renversant la voiture qu'ils tiraient. Même s'ils leur donnaient du fil à retordre, les pompiers aimaient leurs chevaux si bien qu'ils n'hésitaient pas à braver le danger pour leur sauver la vie.
Un jour d'avril 1914, les pompiers furent appelés pour intervenir dans une maison, située dans le coin de la rue Lois, ayant la réputation d'être possédée par des forces maléfiques, le feu s'y déclarant, disait-on, de manière mystérieuse. Une fois, il s'était déclaré sous un lit. Aussitôt éteint, il éclata dans l'armoire, puis dans une valise. Les propriétaires faisaient surveiller la maison par des gardiens chargés d'éteindre le feu aussitôt qu'il éclatait! Mais comme le feu continuait à s'allumer sans raison apparente, ils se résolurent à demander au pasteur de bénir la maison pour en chasser les mauvais esprits. Le pasteur MacFarlane, qui n'avait sans doute pas confiance dans ses prières, se rendit sur les lieux pour conseiller aux propriétaires de s'adresser à un prêtre catholique dont les incantations étaient à son avis plus efficaces !
Mais avant qu'un prêtre eut le temps d'aller exorciser la fameuse maison, un incendie y éclata encore une fois. Les pompiers tentèrent de s'y rendre le plus rapidement possible, mais le sort – ou le diable peut-être? – se mit de la partie. Pour traverser le ruisseau de la Brasserie, deux des chevaux de la pompe à incendie furent détachés, car le ponceau n'était pas assez solide pour soutenir à la fois quatre chevaux et la pompe. Effrayés par la foule accourue à l'incendie, les chevaux partirent à l'épouvante et s'engagèrent au grand galop sur le pont. Soudain, Ned, le cheval de droite, fit un écart et plongea dans le ruisseau en entraînant avec lui l'autre cheval, Dick. Les pompiers se jetèrent alors dans l'eau glacée pour sauver leurs bêtes. Malgré la force du courant et le poids des animaux de trait, ils réussirent, après des efforts quasi surhumains, à traîner les chevaux sur le rivage où ils moururent aussitôt. Lorsqu'ils parvinrent enfin à la maison, plus un mur ne tenait debout. Cendres et fumée étaient tout ce qui restaient du bâtiment hanté par d'hypothétiques diablotins. Comme on n'a plus jamais entendu parler de ces esprits malicieux, il faut croire que, pour une fois, le retard des pompiers a eu du bon!
Un rude métier
Rude tâche que le métier de pompier. Qui ne les a pas vus sortir du brasier la figure noircie par la fumée, les vêtements salis et déchirés et, parfois, le cœur chaviré par la mort d'un enfant qu'ils n'avaient pu sauver ? Les pompiers combattent l'incendie à toute heure, chaque fois que cela est nécessaire. Rien ne les empêche de faire leur devoir. Sortir par des froids sibériens avec tout le barda pour arroser pendant des heures n'est pas une sinécure. À -30°C, les pompiers finissent par ressembler à des fantômes à la moustache et aux sourcils de givre. L'hiver a longtemps été leur saison damnée, car ils n'ont pas toujours été aussi bien vêtus qu'aujourd'hui[4]. En décembre 1933, les pompiers hullois ont combattu 38 incendies à des températures inférieures à -17°C dont un, le 30 décembre, pendant 11 heures et par un froid de -34°C. Un an plus tard, le 24 décembre 1934, une tempête de neige aggravée de vents violents et de froid intense provoqua de si nombreux feux de cheminée et de tuyaux de poêle que les pompiers répondirent à 42 alertes en 3 heures! Dans ces conditions, on comprend que les engelures aient été fréquentes.
 Combattre le feu dans le froid de l'hiver relevait de l'exploit. Le matin du 23 janvier 1948, alors qu'il faisait -27°C, un incendie se déclara rue de l'Hôtel-de-Ville, au coin de Maisonneuve, dans les immeubles Farley et Laverdure, vers 5 h 20. Six minutes plus tard, les pompiers étaient sur les lieux de l'incendie qui semblait vouloir se propager aux immeubles voisins. Les flammes montaient dans le ciel et on pouvait voir de partout dans la ville le rouge écarlate ajouter des teintes inhabituelles au lever du jour.
Combattre le feu dans le froid de l'hiver relevait de l'exploit. Le matin du 23 janvier 1948, alors qu'il faisait -27°C, un incendie se déclara rue de l'Hôtel-de-Ville, au coin de Maisonneuve, dans les immeubles Farley et Laverdure, vers 5 h 20. Six minutes plus tard, les pompiers étaient sur les lieux de l'incendie qui semblait vouloir se propager aux immeubles voisins. Les flammes montaient dans le ciel et on pouvait voir de partout dans la ville le rouge écarlate ajouter des teintes inhabituelles au lever du jour.
Le froid était cinglant. Les pompiers grelottaient sous la couche de glace qui les recouvrait. L'un d'entre eux dut arrêter de combattre parce qu'il avait le poignet et le pied littéralement gelés. L'eau gelait à mesure qu'elle tombait sur les bâtiments en flammes. Tout à coup, un mur s'écroula, blessant deux pompiers. Pour éviter de perdre hommes et équipement, on voulut déplacer un camion à échelles, mais l'eau accumulée dans la rue avait emprisonné le camion jusqu'à la hauteur des essieux dans une couche de glace de 60 centimètres d'épaisseur. Fascinés par le combat que livraient les pompiers, les élèves du collège voisin « oublièrent » de rentrer en classe et les professeurs durent venir les chercher. Enfin, vers 13 heures, l'incendie fut éteint. Des édifices incendiés, il ne restait plus que des façades qui ressemblaient plus à des vieux châteaux de glace des contes de fée qu'à des immeubles de rapport.
Sources :
OUIMET, Raymond, Une ville en flammes, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1996.
[1] 7 avril 1919.
[2] Ibid.
[3] Communication de M. Jean-Marcel Gingras à l'auteur, 25 octobre 1991.
[4] Aujourd'hui les pompiers sont vêtus d'un habit fait de « Nomex », un matériau léger et efficace contre le froid, l'eau et le feu.
Monsieur Cinéma : Donat Paquin
![]() Par
ouimet-raymond
Le 15/01/2022
Par
ouimet-raymond
Le 15/01/2022
La vie du Hullois Donat Paquin mérite d’être résumée parce qu’elle se confond avec l’histoire du cinéma local. Né dans l’ancienne ville de Hull (aujourd'hui Gatineau) le 26 janvier 1890 du mariage d’Isidore Paquin avec Salomé Charron, son père était propriétaire d’une manufacture de meubles. Donat étudie au Collège Notre-Dame qu’il quitte à l’âge de 12 ans pour s’initier au métier de la peinture de meubles qu’il pratique pendant 7 ans au salaire de 25 cents par jour. En dépit de la modestie de son salaire, il réussit à économiser pas moins de 325 dollars.
En 1905, le cinéma est en plein essor et le jeune Donat Paquin est fasciné par les projecteurs qu’il a vus dans un scope hullois. Il y voit une occasion d’affaires prometteuse, même si les « vues animées » le laissent relativement indifférent, dit-on. Au cours d’un voyage à Montréal, il voit un projecteur à vendre au coût de 225 dollars. Une idée germe dans son esprit : celle de parcourir les campagnes pour y montrer des « vues animées ». Il revient à Hull et demande conseil à son père qui le laisse libre d’agir à sa guise. Sans plus tarder, Donat achète le projecteur et quelques autres accessoires. Comme son père, le jeune homme a la bosse des affaires et sait agir au bon endroit au bon moment .
.
Après s’être initié au fonctionnement de la machine et avoir acquis un certain nombre de pellicules cinématographiques, Donat Paquin se rend dans les villages de l’Outaouais et de l’Est ontarien où il loue les salles municipales pour y montrer des films ; il n’a que 16 ans. Les spectateurs se pressent et n’hésitent pas à payer les 15 et même les 25 cents demandés alors qu’à Hull on peut assister aux représentations pour 5 ou 10 cents.
Les projecteurs de l’époque sont assez dangereux et souvent la pellicule, faite de nitrate, s’enflamme. Un simple incendie pouvait lui faire perdre tous ses investissements, ce qui faillit arriver en tournée, dans la salle de l’hôtel de ville du village d’Alfred, dans l’est de l’Ontario. Pendant la projection, le jeune homme avait remarqué que le curé du lieu jetait négligemment la cendre de son cigare sur le parquet. Cette cendre tombait aussi sur la pellicule, hautement inflammable, qui s’était amoncelée sur le plancher. Trop timide pour dire au curé de cesser de fumer, le projectionniste regardait le plancher chaque fois que la cendre du cigare tombait en poussière sur la pellicule qui, heureusement, ne s’est pas enflammée.
Après une seule tournée rurale de trois mois, Donat Paquin a fait un profit de 600 dollars et s’est remboursé le coût de l’équipement qu’il a acheté. C’est donc à la suite de profits accumulés au cours de tournées dans les campagnes de l’Outaouais et de l’Est ontarien que Paquin achètera, avec son père, le cinéma Ollie en 1910. Il n’a que 20 ans.
Il s’occupe de son premier cinéma à temps plein. « J’étais chauffeur, balayeur, opérateur, placier et comptable », disait-il. Son entrée dans le domaine de la projection de films étant un succès, il ne s’arrête pas en si bon chemin. En 1915, il fonde la compagnie Théâtre des nouveautés de Hull limitée et fait construire le nouveau cinéma/théâtre Éden.
Le cinéma parlant
Le 1er août 1923, il acquiert l’Odéon devenu le Laurier au prix de 38 000 dollars. En 1927, il ferme son établissement pour l’été et y fait des rénovations et un agrandissement au coût de 43 000 dollars. Le cinéma/théâtre peut désormais accueillir 1 250 spectateurs. Donat Paquin est maintenant propriétaire de trois cinémas à Hull et d’un autre à Ottawa, le Français, aussi qualifié de Frog par les anglophones, qu’il a acheté en 1926. Construit en 1913 au coût de 100 000 dollars, le cinéma/théâtre Français est une des plus belles salles de la région et compte pas moins de 1 600 places !
L’arrivée du cinéma parlant met fin aux beaux jours du cinéma muet. Pour continuer d’attirer des spectateurs et concurrencer les autres établissements, particulièrement ceux d’Ottawa, Paquin doit moderniser ses salles pour faire place au tout nouveau cinéma parlant et pour satisfaire aux nouvelles normes de sécurité imposées à la suite de l’incendie du Laurier Palace à Montréal. Il décide de concentrer ses efforts sur le cinéma/théâtre Laurier ainsi que le cinéma/théâtre Français et ferme ses deux autres salles, l’Éden et le National Biograph devenu le Capitol. C’est ainsi que le Laurier devient le premier cinéma à présenter des films sonores et parlant à Gatineau.
Une grande entreprise
En 1931, Paquin reprend l’expansion : il acquiert le cinéma Régent à Pointe-Gatineau au coût de 25 000 dollars. Six ans plus tard, il fait l’acquisition du cinéma Capitol à Aylmer, pour 30 000 dollars, dont il change le nom pour celui de Pix. En 1939, il achète au prix de 75 000 dollars le cinéma Victoria, au 1257, rue Wellington à Ottawa, une salle de 580 places construite en 1934. Il le revendra en 1948. Paquin est aussi directeur de l’Association des propriétaires de théâtres de la province de Québec dès 1928.
À sa mort survenue le 20 mars 1958, Donat Paquin laisse un héritage considérable par un testament qu’il a rédigé un mois avant son décès. Propriétaire de 28 terrains dont 26 au centre-ville de Hull, il lègue aussi de l’argent sonnant. Bien qu’il ait précisé ses dernières volontés en spécifiant que, si un des légataires conteste son testament, il sera ipso facto considéré indigne et ne recevra rien, plusieurs clauses ne seront pas respectées. Très respectueux de son personnel, il avait demandé que son gérant, Paul-Hector Lafontaine, continue à gérer ses propriétés et prescrit : « Je veux et j’entends que mes employés aient l’usage de ma propriété à Miami pour trois mois i.e. (sic) décembre, janvier et février, sans payer de loyer, quant à la balance du temps, ce sera pour les membres de la famille. » Soulignons que Donat Paquin était le père de Pierrette, célèbre patineuse hulloise en son temps.
Sources
BAnQ, N-190.
GUITARD, Michelle, Bâtiments patrimoniaux à Hull, pour le Service d’urbanisme de la Ville de Hull, 1997.
Personnalités de Chez Nous, Hull, Le Progrès de Hull, 1946.
La légende de Georgiana Despaties
![]() Par
ouimet-raymond
Le 05/01/2022
Par
ouimet-raymond
Le 05/01/2022
Ottawa, 31 mars 1945, sept heures et demie. Ottaviens et Hullois affluent au marché By comme tous les samedis matin. Une partie de la foule qui fréquente le marché porte l’uniforme kaki de l’armée du Canada. En effet, le pays est en guerre contre les forces de l’Axe depuis plus de cinq ans.
Rue Murray, déambule Georgiana Despaties, une dame âgée de 64 ans – que tous appellent la « Vieille Despaties » ou encore Georgine et aussi Georgie. Elle rôde dans les rues des villes de Hull et d’Ottawa depuis au moins une quinzaine d’années en poussant devant elle un carrosse chargé de bois, de résidus de papier, de fruits et de légumes.
Un camion recule. Son conducteur, Joseph Girard, n’aperçoit pas Georgiana qu’il renverse brutalement. Un homme qui passe par là, Arthur Williams, avertit le conducteur d’arrêter. Mais quand celui-ci aperçoit les signaux de Williams, il est trop tard : les roues du camion ont écrasé la sexagénaire morte sur le champ. La nouvelle de la mort de Georgiana se répand comme une traînée poudre dans chez les francophones de Hull et d’Ottawa.
Femme originale s’il en est une, Georgiana Despaties a vu le jour le 10 février 1880 à Saint-Pierre-de-Wakefield, municipalité que les urbains raillaient en l’affublant du nom de Saint-Pierre-la-Misère, tellement la pauvreté y était courante. Elle est la cinquième d’une famille de onze enfants.
La vie de Georgiana
De l’enfance de Georgiana nous ne savons rien ou presque si ce n’est qu’elle semble avoir eu une bonne instruction, car non seulement savait-elle lire et écrire, mais elle était aussi une musicienne accomplie. Elle avait si bien appris à jouer du violon que tous les mélomanes de la région auraient, dit-on, applaudi son talent.
Pendant de nombreuses années, Georgiana  a habité dans un logement situé à l’intersection des rues Champlain et Verchères à Hull. Dans une des fenêtres du logement, on pouvait apercevoir une statue de la vierge. Par ailleurs, à l’âge de 17 ans, elle était à l’emploi de l’université d’Ottawa. Plus tard, elle a été à l’emploi de l’hôtel Impérial, à Hull, puis de l’imprimeur ottavien Mortimer, puis enfin chez le barbier Wilfrid Rhéaume, rue Cumberland à Ottawa où elle logeait.
a habité dans un logement situé à l’intersection des rues Champlain et Verchères à Hull. Dans une des fenêtres du logement, on pouvait apercevoir une statue de la vierge. Par ailleurs, à l’âge de 17 ans, elle était à l’emploi de l’université d’Ottawa. Plus tard, elle a été à l’emploi de l’hôtel Impérial, à Hull, puis de l’imprimeur ottavien Mortimer, puis enfin chez le barbier Wilfrid Rhéaume, rue Cumberland à Ottawa où elle logeait.
Quel est l’événement qui a changé le cours de la vie de Georgiana ? Cette femme, qui sera toujours célibataire, était pourtant jolie comme en témoigne une photo prise vers 1895-1900. Elle ressemblait à sa mère avec un brin de jovialité en plus. A-t-elle souffert d’une peine d’amour ? D’une dépression nerveuse consécutive à la ménopause ? On n’en sait rien.
À partir de cette époque, Georgiana entreprend une vie de bohème et devient « guenillou » ; elle déambule dans les rues des villes de Hull et d’Ottawa, coiffée d’un chapeau colonial en hiver et d’un feutre en été, en poussant un carrosse chargé de bois, de papier ou de résidus de fruits et légumes, et accompagnée d’un petit chien blanc. Originale, Georgiana l’est depuis longtemps, et plusieurs personnes la classent parmi les détraquées.
À partir de 1942, elle habite dans une bicoque située boulevard Sacré-Cœur, à côté du commerçant de bois Jos. Pilon, c’est-à-dire là où se trouve aujourd’hui l’immeuble de l’ancienne Imprimerie nationale. Le terrain appartenait alors à la Banque Provinciale qui lui a ordonné de partir au plus tard le 1er mai.
Sa bicoque ressemble, a-t-on dit, à un véritable capharnaüm. Elle est décorée de plusieurs arbres de Noël à longueur d’année ; des statues de saints et de saintes sont placées dans tous les coins de l’humble logement et elle orne ses fenêtres de billets de banque. De plus, elle garde une dizaine de chats.
Saine d’esprit
Le 8 mai 1942, la vieille fille est arrêtée par un agent de police pour avoir troublé la paix et les mœurs publiques. La cause est entendue le 1er juin suivant par le Recorder qui l’acquitte parce qu’il : « […] n’y avait eu aucune raison de l’arrêter et qu’il n’y avait eu aucune violation des règlements de la Ville. »
Figure légendaire de la région, Georgiana Despaties est maintes fois photographiée et plus particulièrement par l’artiste-photographe Bertin Mackenzie-Dubé en novembre 1944. Elle tient alors son petit chien blanc dans ses bras. Une autre photographie la montre en train de glaner sur le marché la marchandise qui devait remplir son carrosse.
Après l’exposition de son corps à la maison funéraire Gauthier, à Ottawa, les funérailles de Georgiana Despaties seront célébrées à l’église du Très-Saint-Rédempteur, à Hull, par le chanoine J.-A. Carrière, curé de la paroisse, le 2 avril 1945. Le lendemain des funérailles, le journal Le Droit écrit :
Des gens peuvent devenir populaires en jetant l’argent par une fenêtre d’hôtel. Mlle Despathies (sic) ne fut jamais en quête de popularité ; elle l’obtint quand même, mais bien humblement.
Georgiana aurait été inhumée par une âme charitable dans la fosse commune du cimetière Notre-Dame d’Ottawa.
Ainsi se termine le court résumé de la vie de Georgiana Despaties qui, faute d’avoir eu une descendance, a laissé dans le cœur des Hullois et des Ottaviens de son époque le souvenir d’une femme originale, bien sûr, mais aussi d’un commerce agréable.
Sources :
Archives municipales de Gatineau, correspondance générale, H-005. de la Ville de Gatineau.
Archives municipales de la Ville de Gatineau, Registre quotidien d'incendies du Service d'incendie de Hull, H-006.
PAQUETTE, Jean-Maurice, en collaboration avec Raymond Ouimet, La légende de la « vieille Despaties », Hier encore (Gatineau), no 7, 2015, pages 22-25.
DESPATIES, Gilles, communication du 20 février 2014.
LA LUTTE POUR UN HÔPITAL À GATINEAU
![]() Par
ouimet-raymond
Le 15/12/2021
Par
ouimet-raymond
Le 15/12/2021
Quelqu’un a dit que celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la répéter. Il y a 48 ans, la population outaouaise montait aux barricades dans le cadre de la campagne l’Outaouais à l’urgence. Et pourtant, il reste encore de sérieux problèmes à résoudre dans le domaine de la santé en Outaouais.
L’Outaouais à l’urgence est un mouvement qui a vu le jour au début des années 1970, dans l'ancienne ville de Hull, dans le but d’obtenir des services de santé adéquats dans la région. L’affaire a débuté par une menace de démission du personnel médical et infirmier de l’hôpital du Sacré-Cœur (Hull). En décembre 1972, le courageux docteur Guy Morrissette déclare :
La clinique d’urgence est bondée […] les ambulanciers, faute de lits disponibles, doivent « décharger » des patients dans des chaises (sic) roulantes, alors qu’ils devraient être étendus […] 621 noms figurent sur la liste d’attente actuelle de l’hôpital pour être hospitalisés […] des 350 lits actuels de l’hôpital plusieurs sont occupés par des malades chroniques, des vieillards ou des cas sociaux qui devraient se trouver dans des maisons spécialisées.
De fait, la région de l’Outaouais est dépendante des services de santé de la province voisine et le gouvernement québécois d’alors, comme ceux des années 2000, préfère verser des millions en frais d’hospitalisation au gouvernement ontarien 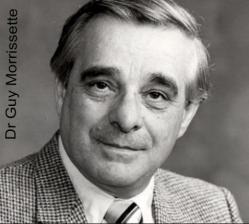 plutôt que de les investir dans la région. Or, en 1966-1967, le taux de mortalité infantile en Outaouais est de 28,5 pour 1 000 naissances alors qu’il est de 25 pour l’ensemble du Québec. Au point de vue de santé, l’Outaouais compte parmi les régions défavorisées, ce qui est encore le cas en 2021.
plutôt que de les investir dans la région. Or, en 1966-1967, le taux de mortalité infantile en Outaouais est de 28,5 pour 1 000 naissances alors qu’il est de 25 pour l’ensemble du Québec. Au point de vue de santé, l’Outaouais compte parmi les régions défavorisées, ce qui est encore le cas en 2021.
Trois hôpitaux
À cette époque, il n’y a que trois hôpitaux sur le territoire de l'actuelle ville de Gatineau : Sacré-Cœur, Pierre-Janet (Hull) et Saint-Michel (Buckingham). Aussi, dès 1972, le conseil d’administration de l’hôpital Sacré-Cœur demande la construction d’un autre hôpital. Le député-ministre libéral du comté de Hull, Oswald Parent, tente de désamorcer la crise en minimisant les problèmes. Devant la cécité délibérée du député-ministre et l’immobilisme de Québec, la région s’organise et en janvier 1973, des représentants de 18 syndicats, mouvements et associations communautaires se réunissent au Centre diocésain autour d’une table ronde intitulée « Outaouais à l’urgence »
Le mouvement vient de prendre son envol. Les députés régionaux, pour le moins apathiques dans ce dossier, sont dénoncés. Une grande offensive est lancée : l’opération 25 000, qui consiste à recueillir sur une pétition la signature des personnes « désireuses de voir les politiciens se réveiller ». Pour le député-ministre Oswald Parent, insensible aux problèmes de santé de ses commettants : « La crise à Sacré-Cœur c’est la faute aux religieuses et aux agitateurs ! »
43 000 signatures
Le ministre de la Santé, Claude Castonguay vient faire une visite en Outaouais pour désamorcer la crise. Il est escorté dans un autobus placardé ; « Aujourd'hui, on est tous médecins » ; « On est tannée (sic) ». L’Outaouais à l’urgence remet au ministre la pétition qui ne compte pas moins de… 43 000 signatures ! Le ministre propose un plan d’action de 19 millions de dollars : création de neuf CLSC dans la région, ajout de 159 lits à l’hôpital du Sacré-Cœur, ajout de 16 lits à l’hôpital Pierre-Janet, la disponibilité de 110 lits pour malades chroniques et de 400 autres pour les personnes âgées. Bien que le ministre refuse la construction d’un autre hôpital, dans l’ensemble, le mouvement Outaouais à l’urgence est satisfait. Le docteur Guy Morrissette pouvait être fier des résultats qu’il avait obtenus en si peu de temps, en collaboration avec de nombreux organismes de la région.
Lâché par ses pairs
La lutte pour les services de santé dans la région est terminée, du moins affectait-on de le croire. Mais le docteur Morrissette, président du conseil des médecins et dentistes de l’hôpital Sacré-Cœur, n’est pas dupe et sait qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres, c’est-à-dire que des promesses restaient des promesses tant qu’elles n’avaient pas été réalisées. Celui-ci veut continuer la lutte, mais il est abandonné par le frileux corps médical. Afin de garder les coudées franches, Guy Morrissette démissionne de la présidence de son conseil et continue à militer dans le cadre de l’Outaouais à l’urgence.
 À l’automne 1974, la liste d’attentes de l’hôpital du Sacré-Cœur compte près de 2 000 cas. Les employés sont surchargés de travail et il y a pénurie de personnel médical. Les infirmières de la salle des urgences menacent de démissionner si les patients (40) des urgences ne reçoivent pas de meilleurs traitements.
À l’automne 1974, la liste d’attentes de l’hôpital du Sacré-Cœur compte près de 2 000 cas. Les employés sont surchargés de travail et il y a pénurie de personnel médical. Les infirmières de la salle des urgences menacent de démissionner si les patients (40) des urgences ne reçoivent pas de meilleurs traitements.
La situation continue à se dégrader. En janvier 1975, 310 employés de l’hôpital du Sacré-Cœur démissionnent de leur poste. Au cours d’une réunion publique, l’Outaouais à l’urgence appuie les démissionnaires. Quelques jours plus tard, le gouvernement québécois met en tutelle l’hôpital.
La crise commence à se résoudre à partir du moment où la population outaouaise se prend en main et fait connaître son mécontentement à l’élection générale provinciale de 1976 : le député-ministre libéral et parrain de la région, Oswald Parent, est défait après 20 ans de règne. Un nouveau député, du comté de Chapleau, le péquiste Jean Alfred, se met rapidement à la tâche et le ministre de la Santé peut annoncer, le 24 mai 1978, la construction d’un nouvel hôpital de 300 lits à Gatineau, hôpital dont la construction s’amorce en 1980.
Toutes les difficultés n’auront pas été aplanies parce que la population va se satisfaire de peu et sombrer dans l'apathie. En effet, des problèmes importants subsistent encore en 2021 bien qu’ils semblent en voie de résolution avec la création d’une faculté de médecine affiliée à l’université McGill et l’annonce de la construction d’un nouvel hôpital de 600 lits.
Sources :
LAPOINTE, Pierre-Louis, Du Sacré-Cœur au C.H.R.O. 1911-1986, Centre hospitalier régional de l'Outaouais, s.l., s.d.
Le Droit (Ottawa), 16 février 1973.
POIRIER, Roger, Qui a volé la rue principale ? Montréal, Les éditions Départ, 1991.
Histoire de l’Outaouais, IQRC, 1994.
310 démissions ! Pourquoi elles ont démissionné de l’hôpital de Hull ? CSN, Montréal, 1975.
Petite histoire des hôpitaux de Gatineau
![]() Par
ouimet-raymond
Le 04/12/2021
Par
ouimet-raymond
Le 04/12/2021
C'est après la visite et une suggestion du couple vice-royal Lord et Lady Minto, en 1902, et grâce à l'appui financier de l'abbé François Michel, ancien curé de Buckingham, que l'hôpital Saint-Michel voit le jour à Buckingham dès 1906. Premier hôpital à voir le jour sur le territoire actuel de Gatineau et administré par les Sœurs grises de la Croix, il a alors une capacité de 25 lits. Agrandi en 1932, un nouvel hôpital de 134 lits est érigé de 1976 à 1979 sur le même site.
Ce n'est que cinq ans après Buckingham qu'un hôpital voit le jour dans le secteur Hull. Au début des années 1910, la ville de Hull était la seule ville de cette importance, au Québec, à n’avoir ni hôpital, ni hospice, ni orphelinat (1928).
Si la Ville de Hull a tant tardé à se doter d’un hôpital, c’est à cause de la dépendance de la petite ville industrielle et de son establishment à l’égard de la ville d’Ottawa. En effet, il apparaît plus facile aux dirigeants de l’époque de consommer des services chez sa voisine ottavienne qu’en développer dans leur propre ville, comportement qui affectera la Ville pendant la plus grande partie de son existence. Par exemple, l’ancien député-ministre Oswald Parent qualifiait d’utopique la création d’une université en Outaouais et estimait que les Hullois n’avaient qu’à se tourner vers les universités ottaviennes pour assurer leur instruction post-collégiale[1]. Enfin, le territoire de Hull faisait partie de l’archevêché d’Ottawa et les autorités religieuses privilégiaient alors les institutions ottaviennes.
L'initiative de la construction d'un hôpital à Hull revient au Dr Edmond-Stanislas Aubry qui, le 29 décembre 1909, avait invité les Sœurs de la Charité de la Providence à établir un hôpital à Hull. Mais la communauté a décliné l’offre faute de personnel religieux suffisant pour assumer une nouvelle fondation. Le 22 novembre 1910, le Dr Joseph-Éloi Fontaine, alors maire de la ville de Hull, décidait d’aller de l’avant avec un projet à caractère social en faisant l’acquisition , au coût de 16 500 dollars, de la vaste résidence du juge Louis-Napoléon Champagne. La résidence de Louis-Napoléon Champagne était située rue Laurier, entre l’actuel pont Cartier-Macdonald et le monastère des Servantes Jésus-Marie.
Malheureusement, le conseil hésite sur l’utilisation future de la résidence Champagne puisque la ville a besoin tant d’un hôpital, d’un hospice que d’un orphelinat. Embarrassé par la décision du maire à laquelle il avait pourtant donné son aval, le conseil décide alors de former une commission composée d’éminents citoyens : le curé Arthur Guertin et les Drs E.-S. Aubry et J.-Urgel Archambault. Le curé se dit incapable de participer à la réunion du comité, le Dr Aubry refuse d’en faire partie en disant : « Que les échevins qui ont favorisé cette transaction malheureuse supportent les responsabilités de leurs actions, leur déférence pour le public est un peu tardive pour être bien accueillie. » Enfin, le Dr Archambault déclare à son tour : « Je décline, car cette propriété n’aurait jamais dû, selon moi, être acquise par la cité. » Le projet ne faisait donc pas l’unanimité et pour cause : les trois médecins étaient aussi des politiciens : Aubry avait été maire en 1906, Fontaine de 1909 à 1911, et Archambault le sera en 1911-1912.
Enfin un hôpital
Mais la politique a des raisons... Aussitôt élu, Urgel Archambault écrit à son tour aux Sœurs de la Charité de la Providence. Le 13 février 1911, l’archevêque d’Ottawa, Charles-Hugues Gauthier, autorise les religieuses à prendre en charge l’hôpital de Hull : elles doivent donc convertir, à leur frais, la résidence en un hôpital et de le faire fonctionner. C’est là la fondation de l’hôpital qui sera longtemps connu comme sous le nom d’hôpital du Sacré-Coeur.
Trois religieuses arrivent à Hull au mois d’août 1911. Elles aménagent deux chambres à un lit, deux chambres à deux lits et deux salles pour les pauvres envers qui elles s’engagent à donner 825 jours d’hospitalisation gratuite, soit un total de 14 lits.
 La première patiente, une certaine dame Alexandre Simard, est admise à l’hôpital le 18 septembre 1911. Elle y mourra quelques semaines plus tard d’une affection cardiaque. Dès 1913, l’hôpital est incapable de répondre aux besoins des populations hulloise, aylmeroise et pointe-gatinoise. Aussi, les religieuses ajoutent-elles à l’ancienne résidence Champagne une aile comprenant 45 lits.
La première patiente, une certaine dame Alexandre Simard, est admise à l’hôpital le 18 septembre 1911. Elle y mourra quelques semaines plus tard d’une affection cardiaque. Dès 1913, l’hôpital est incapable de répondre aux besoins des populations hulloise, aylmeroise et pointe-gatinoise. Aussi, les religieuses ajoutent-elles à l’ancienne résidence Champagne une aile comprenant 45 lits.
Le 25 décembre 1928, l’hôpital est rasé par les flammes dans un incendie qui cause la mort d’une jeune religieuse, sœur Cécile (Marie Crevier) qui, n’écoutant que son courage, sauve de l’incendie des bébés de la pouponnière, et meurt en combattant les flammes. Après avoir remis à neuf les deux bâtiments lourdement endommagés, on ajoute une autre aile à l’hôpital. En 1948, l’hôpital compte pas moins de 175 lits, dont 31 berceaux.
De nouveaux hôpitaux
1938 voit l'ouverture du sanatorium Saint-Laurent, pour tuberculeux, qui deviendra l'hôpital psychiatrique Pierre-Janet en 1966. En 1952, la Commission du district fédéral exproprie l’hôpital Sacré-Cœur de la rue Laurier. Un nouvel hôpital doit donc être construit. Il est érigé au coût de 3 600 000 dollars d’après les plans de l’architecte Lucien Sarra-Bournet ; les travaux débutent en 1955. L’hôpital de 345 lits (il devait en compter 500) reçoit ses premiers patients le 18 février 1958. Au mois d’août suivant, les démolisseurs rasaient l’ancien hôpital de la rue Laurier en même temps que la très belle « résidence » Champagne. Le 30 janvier 1974, les Sœurs de la Charité de la Providence cédaient l’hôpital du Sacré-Cœur au gouvernement du Québec contre une compensation financière de 184 172,46 dollars, pour 63 ans de loyaux services rendus à la population outaouaise.
Mais dès les années 1970, l'hôpital Sacré-Cœur ne répond plus aux besoins sans cesse grandissants de la population outaouaise. Et c'est grâce à l'acharnement du député péquiste Jean Alfred qu'un nouvel hôpital de 300 lits est construit à Gatineau en 1980. Enfin, le gouvernement actuel prévoit la construction d'un nouvel hôpital de 600 lits dont la région a bien besoin.
SOURCES
BRAULT, Lucien, Hull 1800-1950, Ottawa, Les éditions de l’Université d’Ottawa, 1950.
LAPOINTE, Pierre-Louis, Du Sacré-Cœur au C.H.R.O, Hull, Centre hospitalier régional de l’Outaouais, 1986.
LAPOINTE, Pierre-Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre, la ville de Buckingham de ses origines à nos jours 18241990, Buckingham, 1990.
[1] Le Droit (Gatineau-Ottawa), 12 mars 2011, éditorial de Jean Gagnon.
Les Benoît : une famille de pompiers
![]() Par
ouimet-raymond
Le 20/11/2021
Par
ouimet-raymond
Le 20/11/2021
Maxime Benoît naît le 7 octobre 1834 à Saint-Constant. Comment cet homme en est-il venu à s’intéresser au monde des pompiers ? Sans doute son demi-frère, Zéphirin, y a-t-il été pour quelque chose puisque de simple pompier il est devenu chef du Service des incendies de Montréal. Quoi qu’il en soit, Maxime exerce les fonctions « d’inspecteur du feu » à Hull du 6 décembre 1875 au 22 février 1877. Le conseil municipal lui avait donné le mandat de réorganiser la compagnie des pompiers. Mais, comme les finances de la Ville étaient maigres, le conseil a décrété que Benoît «...devra se contenter du salaire que le Conseil voudra bien lui voter dans quelque temps [...] » On peut dire que Maxime Benoît a été le premier chef permanent des pompiers de Hull.
Maxime Benoît est congédié en février 1877 sans qu'aucune raison ne soit inscrite au procès-verbal de la réunion du conseil municipal. Il faut dire que la Ville, qui compte alors 7 000 habitants, est dans un état déplorable et que ses finances sont maigres ; une grave crise économique sévit au pays depuis quatre ans. Quoi qu’il en soit, Maxime quitte l’Outaouais et s’établit à Montréal ou il meurt en 1899.
Un héros chez les Hullois
Les exploits sinon l’uniforme de Maxime et de Zéphirin ont sans aucun doute influencé des enfants de la famille puisqu’un autre Benoît a marché dans les pas du chef des pompiers de Montréal, leur neveu Georges Francis qui joint les rangs  du Montreal Fire Department en 1889. Né le 23 septembre 1869 à Châteauguay, dans l’État de New York, il est promu au poste de capitaine du corps de sauvetage en 1895, puis l’année suivante, capitaine de la caserne no 2, rue Saint-Gabriel. C’est alors qu’il démissionne pour aller à Chicago où il travaille comme pompier pendant un certain temps avant d'être remercié de ses services par suite d’une réorganisation du personnel. Il revient alors à Montréal où il reprend son ancien poste.
du Montreal Fire Department en 1889. Né le 23 septembre 1869 à Châteauguay, dans l’État de New York, il est promu au poste de capitaine du corps de sauvetage en 1895, puis l’année suivante, capitaine de la caserne no 2, rue Saint-Gabriel. C’est alors qu’il démissionne pour aller à Chicago où il travaille comme pompier pendant un certain temps avant d'être remercié de ses services par suite d’une réorganisation du personnel. Il revient alors à Montréal où il reprend son ancien poste.
En 1899, la Ville de Hull décide de moderniser ses services de sécurité publique dirigés par l’homme-orchestre Ludger Genest qui est quelque peu débordé par un trop grand nombre de responsabilités. On lui laisse la direction de la police, mais on se met en quête d’un chef des pompiers. Mais qui choisir ? Bien que l’adjoint de Genest, Georges Tessier, soit capable de prendre la relève, le Conseil municipal décide de regarder ailleurs – là où l’herbe paraît plus verte –, et ce, par simple mimétisme sans doute. En effet, depuis toujours, les autorités hulloises n’ont de cesse de singer la capitale fédérale. Or, en 1897, la Ville d’Ottawa était allée chercher son chef des pompiers, Pierre Provost, à Montréal. Il fallait donc que Hull fasse pareil ! C’est ainsi que le conseil municipal dépêche deux de ses membres à Montréal pour demander au chef Zéphirin Benoît de l’éclairer de ses conseils. Benoît recommande alors aux édiles municipaux trois candidats – Benoît, Presseau et Richard – qui se montrent intéressé à diriger les pompiers de Hull à la condition expresse que le salaire autrefois versé à Genest soit majoré de 30% ! Le Conseil municipal de Hull accepte de consentir l’effort financier qui lui permet d’embaucher un homme de Montréal et choisit le neveu de Zéphirin Benoît, Georges Francis.
Benoît arrive à Hull auréolé du prestige des héros, car sa bravoure est légendaire. On dit qu'en 1893, il a sauvé la vie de trois enfants en les prenant dans ses bras pour les descendre, au moyen d'une échelle, du quatrième étage d'un édifice en flammes. Trois ans plus tard, il aurait sauvé la vie d'une femme en l'évacuant d'un troisième étage en feu. Très habile, il a un jour réussi à descendre les cinq étages d'un édifice en flammes le long d'un tuyau qui lui avait servi d'échelle !
Sitôt en poste, le héros montréalais réussit à obtenir des fonds pour embaucher quatre nouveaux pompiers « forts et bien constitués et [...] supposés ne pas avoir plus de 30 ans » qu'il choisit parmi 80 candidats. L'arrivée de ces hommes porte à 9 l'effectif de la brigade des pompiers de Hull. Ensuite, le comité du feu recommande au conseil l'achat de 300 mètres de boyaux, d'une échelle télescopique de 15 mètres, d'un cheval de relais, de haches et de crochets au coût de 1 000 dollars. Tout en reconnaissant la nécessité de ces équipements, l'échevin Richard Alexis Helmer réussit à convaincre ses collègues du conseil que les revenus de la Ville sont insuffisants pour faire de telles dépenses. Il n'est évidemment pas question d'augmenter les taxes, les gros contribuables ne le permettraient pas. Mais à quoi bon avoir plus de pompiers s'ils n'ont pas l'équipement nécessaire ? Apparemment, c'est là une question que le conseil de l’époque ne se pose même pas !
Le Grand feu
Le 26 avril 1900, vers 11 h du matin, commence un incendie rue Chaudière – le Grand Feu de 1900 – qui détruit, en une douzaine d’heures, environ 3 000 bâtiments à Hull et à Ottawa. Benoît a beau se démener comme le diable dans l’eau bénite, il n’a pas le matériel nécessaire pour freiner la course du pire incendie que la ville de Hull n’a jamais subi. Le Montréalais justifiera, encore une fois, sa réputation de brave homme : il sauve des flammes une fillette, mais doit être transporté dans un hôpital d'Ottawa tant il a respiré de fumée.
 Comme la ville de Hull est détruite à 40 p. 100 et ses citoyens considérablement appauvris, les autorités municipales décident de congédier le chef des pompiers le 4 février 1902 pour revenir à la situation d’antan avec Ludger Genest à la tête des services de sécurité. Benoît doit se trouver rapidement un nouvel emploi, car depuis le 8 janvier 1901, il est marié à... une Hulloise : Paméla Trudel. Benoît poursuit les autorités hulloises pour rupture de contrat et réussit à obtenir un dédommagement de 916 dollars. Entre-temps, il devient agent de la compagnie Knapp, fabricant de pompes à vapeur, puis quitte Hull pour Sault-Sainte-Marie, Ontario, où les autorités lui confient le commandement des pompiers de leur ville en septembre 1902. Benoît s’ennuie-t-il du Québec ? Peut-être bien, car il n’hésite pas un instant à postuler au poste de chef de la police et des pompiers de la ville de Maisonneuve (aujourd'hui un quartier de Montréal), poste qu’il obtient le 21 janvier 1903 à un salaire annuel réduit de 300 $ par rapport à celui qui lui était versé à Hull !
Comme la ville de Hull est détruite à 40 p. 100 et ses citoyens considérablement appauvris, les autorités municipales décident de congédier le chef des pompiers le 4 février 1902 pour revenir à la situation d’antan avec Ludger Genest à la tête des services de sécurité. Benoît doit se trouver rapidement un nouvel emploi, car depuis le 8 janvier 1901, il est marié à... une Hulloise : Paméla Trudel. Benoît poursuit les autorités hulloises pour rupture de contrat et réussit à obtenir un dédommagement de 916 dollars. Entre-temps, il devient agent de la compagnie Knapp, fabricant de pompes à vapeur, puis quitte Hull pour Sault-Sainte-Marie, Ontario, où les autorités lui confient le commandement des pompiers de leur ville en septembre 1902. Benoît s’ennuie-t-il du Québec ? Peut-être bien, car il n’hésite pas un instant à postuler au poste de chef de la police et des pompiers de la ville de Maisonneuve (aujourd'hui un quartier de Montréal), poste qu’il obtient le 21 janvier 1903 à un salaire annuel réduit de 300 $ par rapport à celui qui lui était versé à Hull !
Tous les espoirs sont permis à Georges Benoît qui doit sans doute rêver de succéder un jour à son oncle Zéphirin à la tête du corps des pompiers de Montréal, lequel d’ailleurs vient tout juste de prendre sa retraite. Mais voilà, le Destin en a décidé autrement et, au cours d’une enquête qu’il mène dans une affaire de vol en novembre 1908, il contracte la fièvre typhoïde qui l’emporte le 24 du même mois alors qu’il repose à l’hôpital Général de Montréal. À ses imposantes funérailles qui ont lieu à Maisonneuve trois jours plus tard, on remarque deux Hullois : son beau-frère, Ferdinand Trudel, et Napoléon Pagé du journal Le Spectateur.
Sources :
LEWIS, Françoise et CHARRAON, Huguette, Les débuts d’un chef : Zéphirin Benoît (s.l., s.d.).
Procès-verbaux du Conseil municipal de Hull, 1875-1902.
Le Temps (Ottawa), 1896-1902.
Le Spectateur (Hull), 1889-1903.
CKCH, LA VOIX DE L’OUTAOUAIS 1933-1994
![]() Par
ouimet-raymond
Le 11/11/2021
Par
ouimet-raymond
Le 11/11/2021
La première transmission radio, c’est-à-dire sans fil, est l’œuvre de l’Italien Guglielmo Marconi en 1895. Mais la première émission radio destinée au public a été diffusée le 15 juin 1920 à Chemlsford en Angleterre, suivie le 2 novembre de la même année à partir d’une station de Pittsburgh, aux États-Unis, puis le 24 décembre 1921 à Paris, France. Vingt ans plus tard, le 1er janvier 1943, les statistiques dénombrent plus de 3 110 émetteurs de par le monde, dont les programmes sont suivis par plus de 425 millions d'auditeurs, possesseurs de 130 millions de récepteurs. Évidemment, ces chiffres sont maintenant dépassés, et de loin. Le 4 mai 1922, CKAC, propriété du journal La Presse, est devenue la première station de radio francophone de l’Amérique.
En 1932, la région d’Ottawa compte deux stations de radio : CKCO et CNRO. Bien que la seconde diffuse quelques émissions en langue française, la population francophone est privée d’une station de langue française. En 1932, le pianiste Aurèle Groulx (originaire d’Ottawa), de retour de Détroit où il s’était produit trois fois par semaine dans une station de radio locale, décide de fonder une station de radio française en Outaouais. Ce passionné de musique et de radio, qui unit ses forces à Gaston Brodeur, met sur pied une équipe et demande une licence de radio. Imaginez la situation : la demande de licence de station radiophonique de Groulx est étudiée en 1933 par la Commission canadienne de la radiodiffusion., c’est-à-dire au pire de la crise économique commencée en 1929. Il fallait être drôlement convaincu, pour ne pas dire passionné pour se lancer dans une telle entreprise à un tel moment. Quoi qu’il en soit, la station CKCH ouvre officiellement le 30 juin 1933. Son modeste studio est situé au 63, rue Hôtel-de-Ville à Hull (aujourd'hui Gatineau), résidence de l’architecte Charles Brodeur, dont la maison a échappé, jusqu'à ce jour, aux démolisseurs. Mais à l'occasion de l'ouverture, CKCH a diffusé son émission à partir du Café Laurier situé au 178, rue du Pont (Eddy).
Une radio dynamique
Les premières années de CKCH sont des années difficiles. Il y a la crise économique, mais aussi la faible puissance de l’émetteur, 100 watts  sur la bande MA. L’entreprise a de lourdes dettes envers la Compagnie Marconi du Canada (fournisseur des équipements) qui, au printemps 1934, menace CKCH de saisie. C’est apparemment à cette époque que le commerçant Josaphat Pharand, propriétaire d’un gros magasin à rayons, rue Champlain, se porte acquéreur majoritaire de CKCH. En septembre précédent, la station avait déménagé son studio à l'hôtel Standish Hall, angle Principale (Promenade du Portage) et Montcalm, hôtel qui a depuis été démoli. En octobre, CKCH déménage pour la troisième fois, cette fois dans des locaux plus vastes situés au-dessus du magasin de Pharand. En 1937, CKCH reçoit la permission d’augmenter sa puissance de diffusion à 500 watts, ce qui n’est pas très puissant.
sur la bande MA. L’entreprise a de lourdes dettes envers la Compagnie Marconi du Canada (fournisseur des équipements) qui, au printemps 1934, menace CKCH de saisie. C’est apparemment à cette époque que le commerçant Josaphat Pharand, propriétaire d’un gros magasin à rayons, rue Champlain, se porte acquéreur majoritaire de CKCH. En septembre précédent, la station avait déménagé son studio à l'hôtel Standish Hall, angle Principale (Promenade du Portage) et Montcalm, hôtel qui a depuis été démoli. En octobre, CKCH déménage pour la troisième fois, cette fois dans des locaux plus vastes situés au-dessus du magasin de Pharand. En 1937, CKCH reçoit la permission d’augmenter sa puissance de diffusion à 500 watts, ce qui n’est pas très puissant.
La station prépare son âge d’or tôt quand, en 1934, elle s’affilie au réseau d’État, ce qui lui permet d’élargir sa plage horaire. CKCH devient alors La voix française de la vallée de l’Outaouais. À la fin des années 1930, la station atteint sa vitesse de croisière. En 1940, Pharand vend CKCH et pas à n’importe qui, mais aux Oblats de Marie-Immaculée, déjà propriétaires du journal Le Droit et de l’Université d’Ottawa, au prix de 35 000 $. C’est ainsi que CKCH devient un outil de promotion de la religion catholique et de la nation canadienne-française, mais aussi un outil d’éducation.
En 1947, les Oblats déménagent les pénates de CKCH dans le Centre Notre-Dame, située dans l'actuelle rue Notre-Dame-de-l’Île (Gatineau), et ce, dans un immeuble rénové et dans des studios modernes aujourd'hui disparus. L’année suivante, la puissance de l’émetteur de CKCH passe à 1 000 watts, puis à 5 000 watts en 1954. En mai 1960, la station déménage dans de vastes locaux modernes au 72, rue Laval, locaux aussi disparus.
CKCH est, au cours des années 1940 et 1950, une station de radio très dynamique qui présente non seulement des radio-romans, mais aussi de la musique francophone, des conférences, des débats, des concours, etc. Une de ses forces est alors l’information. CKCH informe la population outaouaise des événements qui se passent en Outaouais. C’est une radio locale qui répond à des besoins locaux. C’est une pépinière de journalistes, de réalisateurs, de comédiens.
Les animateurs de CKCH
Si le grand Henri Bergeron a fait ses premières armes à CKSB à Saint-Boniface, au Manitoba, il deviendra directeur des émissions à CKCH ; le comédien Yvon Dufour y a été annonceur à Hull avant de devenir comédien. D'autres animateurs s'y sont fait une renommée canadienne et québécoise dont Colette Devlin, Lisette Gervais, Laurette Larocque dite Jean Despréz, Denis Binet, Gilbert Chénier et Rhéal Guévremont (Chez Bébert), Olivier Caron, Pierre Dufault, Lionel Duval, Guy Provost, etc.
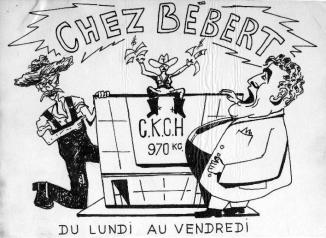 Nous mourrons tous, les entreprises comme les êtres humains. En 1964, Radio-Canada ouvre une antenne à Ottawa, CBOF, qui vient chercher une partie de l’auditoire de CKCH, jusque-là captif. La station hulloise perd alors son affiliation à Radio-Canada. Pour la première fois de son histoire, la radio outaouaise se voit confronter à la concurrence. En 1968, une autre radio francophone s’installe à Ottawa, puis à Gatineau : CJRC. Incapables de s’adapter, les Oblats vendent en 1968 la station, devenue déficitaire, au réseau Télémédia qui se fera concurrence en inaugurant, en 1970, la station CKCH-FM. La fusion Radiomutuel-Télémédia, dans les années 1990, lui porte le coup de grâce. CKCH cesse de diffuser 30 septembre 1994 à 11 heures.
Nous mourrons tous, les entreprises comme les êtres humains. En 1964, Radio-Canada ouvre une antenne à Ottawa, CBOF, qui vient chercher une partie de l’auditoire de CKCH, jusque-là captif. La station hulloise perd alors son affiliation à Radio-Canada. Pour la première fois de son histoire, la radio outaouaise se voit confronter à la concurrence. En 1968, une autre radio francophone s’installe à Ottawa, puis à Gatineau : CJRC. Incapables de s’adapter, les Oblats vendent en 1968 la station, devenue déficitaire, au réseau Télémédia qui se fera concurrence en inaugurant, en 1970, la station CKCH-FM. La fusion Radiomutuel-Télémédia, dans les années 1990, lui porte le coup de grâce. CKCH cesse de diffuser 30 septembre 1994 à 11 heures.
De l'histoire de la station radiophonique CKCH il nous reste quelques pièces d'archives ainsi que la maison du 63, rue Hôtel-de-Ville. La Ville de Gatineau est-elle prête à la conserver ?
Sources :
BAnQ-Outaouais.
Communication de Jean Joly à l'auteur sur Henri Bergeron le 11 novembre 2021.
CRAO, fonds Rhéal Guévremont.
FILION, Michel, CKCH la voix de l’Outaouais, éd. Vents d'Ouest, Hull, 2008.
Qui a volé la rue Principale ?
![]() Par
ouimet-raymond
Le 07/06/2021
Par
ouimet-raymond
Le 07/06/2021
Depuis plusieurs décennies, la gent politique gatinoise tente de faire de la Promenade du Portage un centre-ville de Gatineau. Des dizaines de millions y ont été investis sans trop de résultats depuis une quarantaine d’années si ce n’est la construction de nombreux édifices du gouvernement fédéral qui donnent à la rue une ambiance ottavienne. Et pourtant, la Promenade du Portage a déjà été LE centre-ville.
C’est en 1875 que l’ancienne Ville de Hull a obtenu son statut de Ville. Elle comptait alors environ 10 000 habitants. Son centre-ville se situait dans une rue alors appelée Main, odonyme qui sera littéralement traduit par « Principale ». À cette époque, la rue y était grouillante d’activités. Outre, six hôtels et tavernes, on y trouvait deux tailleurs, sept magasins divers et épiceries, trois cordonneries, trois forgerons, un horloger, deux journaux, cinq études d’avocat, le bureau de poste, etc. Dix ans plus tard, la rue comptait trois fois plus de magasins, dont des bijoutiers, plusieurs imprimeurs, une banque, de même que le palais de justice et une prison arrachés d’Aylmer. Et en 1896, une ligne de tramways desservait la rue commerciale. Malheureusement, le 26 avril 1900, la ville a été balayée par un vaste incendie qui y a détruit 1 300 bâtiments dont la vaste majorité des immeubles de la rue Principale.
La reconstruction de la ville et de son centre d’affaires se fera lentement : D’une part, les gens d’affaires peinaient à combler leurs pertes financières et d’autre part, la construction du pont Interprovincial, dit Alexandra, mettait en concurrence les centres-villes de Hull et d’Ottawa. Or, plusieurs années plus tôt, le marchand Basile Carrière s’était opposé à la construction de ce pont, car, disait-il, il drainerait la clientèle hulloise vers les gros commerces du centre-ville d’Ottawa. Il n’avait pas entièrement tort.
 À la fin de la première décennie du XXe siècle, la rue Principale reprenait ses activités d’antan qui déborderont dans les rues environnantes comme du Pont (Eddy) et Hôtel-de-Ville. Le quartier était même devenu un lieu de divertissement fort prisé. On y trouvait plusieurs cinémas/théâtres, dont l’Éden, l’Eldorado, l’Odéon et le Talbotoscope où le public y était régulièrement convié à des séances de cinéma, de théâtre et de vaudeville.
À la fin de la première décennie du XXe siècle, la rue Principale reprenait ses activités d’antan qui déborderont dans les rues environnantes comme du Pont (Eddy) et Hôtel-de-Ville. Le quartier était même devenu un lieu de divertissement fort prisé. On y trouvait plusieurs cinémas/théâtres, dont l’Éden, l’Eldorado, l’Odéon et le Talbotoscope où le public y était régulièrement convié à des séances de cinéma, de théâtre et de vaudeville.
La rue Principale, bordée au sud par les grandes usines de la E.B. Eddy, et au nord par une population sans cesse grandissante, était au cœur de la vie hulloise. Ses magasins côtoyaient tant les banques, les bureaux d’avocats, de comptables, de notaires et de médecins que le palais de justice dans la cour duquel on exécutait des condamnés à la peine de mort. La vie nocturne y était trépidante. Fernandel et Tino Rossi sont venus chanter au théâtre Laurier alors que, dans les années 1940 et 1950, le Standish Hall, qui possédait la plus grande salle de bal au pays, y accueillait les grandes vedettes américaines du jazz :Duke Ellington, Louis Amstrong, etc.
Les soirs de fin de semaine, la population de l’Île de Hull aimait marcher rue Principale pour y faire du lèche-vitrine, fréquenter cinémas et restos ou le sexe opposé. Mais cela ne suffisait pas et le centre-ville peinait à se développer : on n’y trouvait pas de magasins à départements comme à Ottawa, lesquels captaient une partie importante de la population de la rive québécoise de l’Outaouais, sauf deux 5¢ 10¢ 15¢ communément appelés « Quinze cents ». D’ailleurs, trois des quatre circuits d’autobus du Transport Urbain ltée avaient leur terminus à… Ottawa ! Ainsi, dans les années cinquante et soixante, les marchands rêvaient-ils de concurrencer les Caplan’s, Freiman, et Larocque de la rue Rideau qui jouissaient d’une clientèle nombreuse. Ils appelaient de tous leurs vœux la construction d’édifices fédéraux au centre-ville, convaincus que cela leur rapporterait une clientèle pléthorique et un succès digne de leurs concurrents ottaviens. Or, à la même époque, l’arrivée des centres commerciaux Place Cartier et Galeries de Hull, est venue mettre fin au développement commercial de la rue Principale.
La déconfiture d’un centre-ville
La fin des années 1960 et le début des années 1970 ont vu la population de l’Île de Hull diminuer de moitié par suite des expropriations et de la spéculation foncière. L’arrivée des immenses édifices fédéraux, qui ont dépersonnalisé et anglicisé le centre-ville, a entraîné une désaffection de la population locale à égard de la rue Principale dont le nom a été changé en « Promenade du Portage ». Les milliers de fonctionnaires, tant attendus, n’ont pas répondu pas aux attentes des marchands. Le centre-ville avait vécu ! En 1986, Roger Poirier, o.m.i., écrivait, fort à propos : « Qui a volé la rue Principale ? »
Au début des années 1980, le conseil municipal de Hull décidait de concentrer les boîtes de nuit dans la rue Promenade du Portage, et ce pour mieux les contrôler. Le centre-ville était alors devenu un lieu d’administration fédérale et de divertissements. À la fin des années 1980, on trouve sur celle que l’on surnomme désormais La Strip, et ses environs, près d’une trentaine de boîtes de nuit et tavernes, envahies presque tous les soirs par des milliers d’Otttaviens en goguette. On y faisait la fête, certes, mais on s’y enivrait aussi plus que de raison de sorte que les fins de nuit s’achevaient souvent par des querelles qui se transformaient parfois en drames ; prostitution et commerce de la drogue y fleurissaient, et le crime organisé y avait pignon sur rue. C’est ainsi que la réputation de la Ville de Hull s’est vue entachée par des agissements délictueux des fêtards de la Promenade du Portage, agissements parfois rapportés jusque dans des médias internationaux. Pour contrôler les fêtards et le développement de la criminalité, la Ville a dû engager plus de policiers.
Enfin, dans les années 1990, la Ville lançait l‘opération « Tolérance zéro ». Elle y a mis tout en œuvre pour retirer les permis de bars où il y avait du grabuge. Par ailleurs, l’Ontario avait décidé d’étendre ses heures de fermeture à 2 heures du matin, et le Québec a aligné les heures de fermeture des bars de l’Île de Hull sur ceux d’Ottawa. La Strip avait vécu. Le pseudo centre-ville est devenu un pôle à forte prédominance administrative avec des restaurants qui visent prioritairement la clientèle des fonctionnaires, et il se confond désormais avec Ottawa. Si vous cherchez un centre-ville, vous le trouverez probablement entre le boulevard Gréber et la montée Paiement.
L'arrivée du cinéma à Gatineau
![]() Par
ouimet-raymond
Le 28/04/2021
Par
ouimet-raymond
Le 28/04/2021
Le cinéma[1] a été qualifié, peu après son invention, de « Septième art ». Cela n'est pas étonnant puisqu’il fait rêver depuis maintenant plus de cent ans. Dès sa naissance, il a attiré des foules nombreuses et demeure toujours aussi populaire en ce XXIe siècle d’autant plus qu’il a conquis la télévision dès les années 1950, puis maintenant Internet.
Mais qui a donc inventé le cinéma ? Au moins une quinzaine d'autres personnes, dont les pionniers français Jules Marey et Louis Augustin Aimé Le Prince. Ce dernier, marié à une Anglaise, a conçu une caméra de projection cinématographique et tourné une scène de 2,11 secondes, Scène au jardin de Roundhay, en Grande-Bretagne en 1888 (Voir : Roundhay Garden Scene (1888) - YouTube). En octobre de la même année, il filmait des calèches, des tramways et des piétons sur le pont de Leeds à 16-20 images/seconde.
On ne sait pas où et quand exactement le premier film a été présenté à Gatineau : aucun historien de la région, à ce jour, n’en a dit mot si ce n’est Lucien Brault, dans son histoire d’Aylmer, qui raconte que le cinéma a fait son entrée dans cette ancienne ville en 1909, et Joseph Jolicoeur, dans son Histoire anecdotique de Hull, qui écrit erronément que le premier cinéma de Hull, le Talbotoscope, a ouvert ses portes en 1909.
Une première projection a eu lieu sur la rive droite de la rivière des Outaouais, à Ottawa, devant deux mille spectateurs, le 21 juillet 1896, au West End Park, et ce, au moyen du procédé Vitascope de l’inventeur Thomas Edison. Le spectacle comprenait alors 4 films Edison de 50 pieds (15 mètres) pour un total d’au plus 4 minutes de projection.
L'un des films produit par les frères ottaviens Andrew et George Holland, s’intitulait The Kiss dans lequel un couple s'embrassait pendant 30 secondes. Et selon l'historienne Georgette Lamoureux, il a scandalisé les spectateurs[2]. Et c’est le 30 mars 1897 que le cinématographe des frères Lumière est présenté à Ottawa dans une salle de la haute ville.
Les vues animées à Gatineau
Il est possible que les premiers films montrés à Gatineau l’aient été soit dans un parc d’attractions soit dans une fête foraine comme c’était le cas ailleurs, ou encore dans une salle comme celle de l’Œuvre de la jeunesse à Hull – elle pouvait contenir plus de 500 personnes – d’autant plus qu’on y présentait des pièces de théâtre depuis 1884. De 1897 à 1906, une certaine comtesse Anne d'Hauterives et son fils Henry parcouraient le Québec, jusque dans les régions les plus éloignées, avec leur Historiographe – c'est ainsi qu'ils avaient nommé leur entreprise et leur projecteur Lumière – au moyen duquel ils montraient aux citadins et aux ruraux « des "vues" historiques et religieuses que le vicomte commentait avec une éloquence reconnue ». Il serait étonnant qu'ils ne soient pas venus en Outaouais d'autant plus qu'ils avaient fait plusieurs projections à Ottawa au mois de mars 1898.
Nous savons toutefois avec certitude qu'une projection cinématographique a eu lieu dans l’ancienne ville Hull le 30 octobre 1898 dans cette fameuse salle de l'Œuvre de la jeunesse. En effet, ce jour-là, le Père Murphy,  oblat de Marie-Immaculée et professeur à l'université d'Ottawa, a présenté des : « Magnifiques Vues (sic) à projections illustrées [...] Plus de 100 tableaux comiques, coloriés et animés. » Ce qui fait croire que nous sommes possiblement en présence de vues animées, c'est le mot « animés ». Une autre projection cinématographique se fera à Hull en 1899. En effet, le 14 janvier de cette année, le journal Le Temps a rapporté que Louis d'Odet d'Orsonnens s'apprêtait à montrer à la salle Tellier, le lendemain soir : « [...] une exhibition de tableaux vivants au biomograme [...] » L'article précise que le biomograme est le plus « récent perfectionnement du kinétoscope », ce qui démontre que nous sommes bien là en présence de vues animées. D'Odet d'Orsonnens promettait de montrer « [...] le mouvement des vagues de l'Atlantique, de l'oiseau en vol, de l'homme, etc.
oblat de Marie-Immaculée et professeur à l'université d'Ottawa, a présenté des : « Magnifiques Vues (sic) à projections illustrées [...] Plus de 100 tableaux comiques, coloriés et animés. » Ce qui fait croire que nous sommes possiblement en présence de vues animées, c'est le mot « animés ». Une autre projection cinématographique se fera à Hull en 1899. En effet, le 14 janvier de cette année, le journal Le Temps a rapporté que Louis d'Odet d'Orsonnens s'apprêtait à montrer à la salle Tellier, le lendemain soir : « [...] une exhibition de tableaux vivants au biomograme [...] » L'article précise que le biomograme est le plus « récent perfectionnement du kinétoscope », ce qui démontre que nous sommes bien là en présence de vues animées. D'Odet d'Orsonnens promettait de montrer « [...] le mouvement des vagues de l'Atlantique, de l'oiseau en vol, de l'homme, etc.
C’est en 1905 que le cinéma s’est implanté à Gatineau pour y rester : c’était alors le début de la sédentarisation des projections. En effet, cette année-là, Joseph Maxime Lavigne inaugurait la salle de « récréation » Frontenac, rue du Pont (Eddy), à l’angle de la rue Queen (boulevard des Allumettières), dans le secteur Hull.
Il n'y a pas qu'à Hull que des salles de vues animées se sont développées. Le 9 mai 1908, Joseph Théophile Croisetière inaugurait, à Buckingham, une nouvelle salle, réservée à la projection cinématographique, à l’étage d’un bâtiment appelé Cameron’s Hall : le National Theatre. L’ouverture de ce scope a passé presque inaperçue dans la presse locale. Croisetière utilisait un projecteur de marque Cameragraph, procédé Vitascope, fabriqué par Edison. Deux ans plus tard, il construira un nouveau cinéma au 68, rue Main, juste en face de la rue qui conduisait alors au pont qui enjambait la rivière du Lièvre, et le nommait Oasis.
À Aylmer, c’est apparemment Emmanuel Lavigne qui inaugure la première salle de projection de films en 1909. L'année suivante, Alphonse Moussette, futur maire de Hull, ouvre un scope à Masson : l'Eldorado. À Pointe-Gatineau, les vues animées apparaissent en 1911 avec l'établissement d'un certain Albert Crevier.
Quant au cinéma sonorisé, il est apparu à Gatineau en 1929, au cinéma-théâtre Laurier, propriété de Donat Paquin. Il avait été doté du système de sonorisation « Pacent » qui permettait de présenter du cinéma sonore et parlant au moyen d’enregistrements sur disques ou encore sur pellicule de film. Le 12 octobre, le Laurier a affiché un film qui contenait des segments sonorisés, mais au moyen du système RCA Photophone, et ce, pour la première fois en Outaouais. Ce film, qui avait été banni par le Bureau de censure de l’Ontario, avait un titre on ne peut plus provocateur : The Godless Girl (doublé en français en 1930 avec pour titres La fille sans dieu ou Les damnés du cœur). Tourné par Cecil B. DeMille, il met en vedette l’actrice Marie Prévost, née en 1898 à Sarnia, Ontario, que son gérant fait faussement passer pour une Canadienne-Française.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 06/03/2021
Par
ouimet-raymond
Le 06/03/2021
Je vais ici traiter des délices des amours interdites, car il est bien connu que dans la femme des autres, le diable met une cuillerée de miel et qu’un amant a toutes les qualités et les défauts qu’un mari n’a pas. Un proverbe finlandais dit : l’amour est un champ fleuri et le mariage un champ d’orties. Et c'est au pied de l'autel ou au palais de justice, que les personnes qui unissaient autrefois leur destinée se promettaient réciproquement fidélité.
Cette conception du mariage, dans lequel la fidélité doit jouer un rôle de premier plan, est apparue avec les philosophes classiques de la Grèce antique. Toutefois, les hommes ont toujours voulu croire que l'exclusivité sexuelle concernait surtout les femmes, particulièrement leur conjointe. La Bible a d'ailleurs fortifié leur conviction. Ainsi, Sarah qui était stérile dit un jour à Abraham : « Voici que le Seigneur m'a empêchée d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Que demander de mieux ? Abraham ne se fait pas tirer l'oreille longtemps et partage la couche de sa servante. Si nos aïeules n'ont pas eu la même complaisance que Sarah envers leur conjoint, il n'empêche que l'exemple d'Abraham n'est pas resté stérile !
Les personnes qui commettent l'adultère prennent généralement beaucoup de précautions pour assurer la confidentialité de leurs amours illicites et conserver une réputation irréprochable. Ils vont parfois jusqu'à accomplir des prouesses acrobatiques pour cacher leurs rencontres lubriques. Mais, en dépit d'efforts louables, des amants ont vu leurs relations coupables étalées au grand jour. En voici un exemple.
L'affaire Arsène Daoust
Arsène Daoust était un homme bien connu à Aumond (près de Maniwaki) où il opérait, depuis 1887, un moulin à farine sur la rivière Saint-Joseph. Âgé de 29 ans, il était allé chercher sa femme, la belle Ernestine Raymond, de 8 ans sa cadette, loin de chez lui, à Saint-André d'Argenteuil à l'hiver de 1888.
On s'imagine bien que pendant un certain temps Arsène et Ernestine ont vécu des nuits et des jours heureux. Mais 14 ans après les épousailles, les amours s'étaient, semble-t-il, quelque peu émoussées. Non pas qu'Ernestine n’était plus désirable – oh que non ! –, mais l'amour, si jamais amour partagé il y eut un jour, avait peut-être déjà fait place à l'habitude.
Ernestine était encore à l'âge où les femmes prennent plus de plaisir à commettre les péchés des sens... qu'à les confesser ! De Damase Roy, son cadet d'un an et hôtelier du village, elle s'est fait un amant zélé qui ira jusqu'à lui prodiguer des caresses voluptueuses sous le toit du… mari. Arsène Daoust soupçonnait-il son épouse d'avoir pris un amant? Espérait-il la prendre en flagrant délit? Gageons qu'il ignorait tout des agissements de sa tendre moitié. Car cela va de soi, le mari trompé n'est-il pas toujours le dernier à connaître son infortune ?
Un soir de janvier 1902, Arsène est revenu à la maison plutôt qu'on 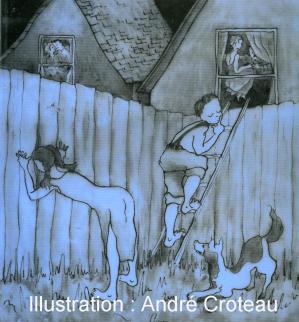 l'y attendait, et surtout plutôt que l'on y espérait. À la fenêtre d'une chambre du deuxième étage de la maison, on a aperçu le mari qui se dirigeait vers son logis où la moiteur capiteuse du corps repu de la belle Ernestine s'était, selon toute vraisemblance, soudainement transformée en sueurs froides. Ah! ciel, mon mari ! aurait-elle pu s'exclamer – mais c'est plutôt l'enfer qui s'annonçait. Et Ernestine de faire sortir, tout de go, son amant de la maison. C'est à ce moment-là que le meunier de la rivière Saint-Joseph a vu se dérouler, sous ses yeux que nous supposons ébahis, une scène digne des récits de Georges Courteline (1858-1929), fameux romancier français : Damase Roy sortant de chez lui à l'aide d'une corde faite de couvertures de lit et attachée à une fenêtre du deuxième étage de sa maison. Jean de Lafontaine a eu bien raison d'écrire : « Amour, amour quand tu nous tiens, on peut bien dire : « Adieu, prudence! »
l'y attendait, et surtout plutôt que l'on y espérait. À la fenêtre d'une chambre du deuxième étage de la maison, on a aperçu le mari qui se dirigeait vers son logis où la moiteur capiteuse du corps repu de la belle Ernestine s'était, selon toute vraisemblance, soudainement transformée en sueurs froides. Ah! ciel, mon mari ! aurait-elle pu s'exclamer – mais c'est plutôt l'enfer qui s'annonçait. Et Ernestine de faire sortir, tout de go, son amant de la maison. C'est à ce moment-là que le meunier de la rivière Saint-Joseph a vu se dérouler, sous ses yeux que nous supposons ébahis, une scène digne des récits de Georges Courteline (1858-1929), fameux romancier français : Damase Roy sortant de chez lui à l'aide d'une corde faite de couvertures de lit et attachée à une fenêtre du deuxième étage de sa maison. Jean de Lafontaine a eu bien raison d'écrire : « Amour, amour quand tu nous tiens, on peut bien dire : « Adieu, prudence! »
On ne sait comment l'époux trompé a réagi sur le coup de sa découverte, mais l'affaire n'en est pas restée là et toute la vallée de la Gatineau a été mise au courant des plaisirs luxurieux de la chaude Ernestine, des prouesses de l'hôtelier et de l'infortune du meunier de la rivière Saint-Joseph. Parions que dans les chaumières d'Aumond on a chanté en chœur : « Meunier tu dors, ton moulin bat trop vite... »
La surprise a vraisemblablement été difficile à avaler et le mari, justement courroucé, a engagé des poursuites à l'encontre de l'hôtelier séducteur. Maître Arsène Daoust exigeait en guise de dédommagement la somme de 5 000 dollars pour la perte de... l'affection de sa meunière ! Bien entendu, Damase Roy a contesté haut et fort les allégations du mari dépité. Mais voilà, les deux personnes qui doivent témoigner en sa faveur lui ont fait faux bond et le juge a du donner raison au meunier.
On ne sait pas sur quel critère le juge s'est fondé pour évaluer le niveau de perte d'affection d'Arsène Daoust, mais ce dernier a eu droit à la piètre compensation de… 250 dollars ! Et la population d'Aumond, bonne enfant et compatissante aux malheurs de son meunier, l'élira, trois ans plus tard, à la mairie du village ! Quant à la belle Ernestine, elle choisira de continuer sa vie maritale avec son mari et n'aura pas d'enfant. Faute de mie, il faut savoir se contenter de la croûte !
SOURCES
OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull éd. Vent d’Ouest, 1994.
La crise du logement 1936-1952 : le cas du Creekside
![]() Par
ouimet-raymond
Le 13/02/2021
Par
ouimet-raymond
Le 13/02/2021
La Ville de Gatineau est aux prises avec une crise du logement depuis plusieurs années[1]. Rien de nouveau sous le soleil : à la suite de la dépression économique de 1929, la construction domiciliaire était au point mort de sorte qu'une crise de logement sans précédent s'ensuivit. Ainsi, le logement est devenu le plus grave problème social auquel était confrontée la population de l'ancienne ville de Hull, problème en partie causé par le conseil municipal lequel, en 1936, avait modifié le zonage et interdit la construction d'immeubles à logements multiples dans la majorité des quartiers de la ville.
Dès le début de 1937, des familles érigent des maisons rudimentaires, pour ne pas dire des cabanes, sur la rive ouest du ruisseau de la brasserie, entre le boulevard Montclair et le pont du sentier du ruisseau de la Brasserie (alors un pont de chemin de fer). En 1941, ce secteur de la ville devient un véritable bidonville, nommé Creekside, où vivent dans un grand dénuement plus d'une centaine de personnes. Surnommé, avec mépris, Punaiseville et Puceville, le Creekside est qualifié de honte de la ville par les bien-pensants de tous bords pour qui les pauvres sont les artisans de leur propre malheur. Quoi qu'il en soit, en dépit de la relance de l'économie suscitée par la guerre, la crise de logement ne se résorbe pas. En effet, selon le journal The Standard Magazine (Montréal), du 12 décembre 1942, 34,5 % des logements de Hull sont alors surpeuplés.
En décembre 1944, la Commission des prix et du commerce en temps de guerre déclare la région de Hull « région surpeuplée » et interdit à toute famille, qui n'y vivait pas avant le 26 février 1945, d'y louer ou d'y occuper un logement sans permis. Mais ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement provincial ne comptent alors un programme de construction de logements à bas prix, ce qui fait dire à l'ancien maire Raymond Brunet (1940-1948) : « Pour la guerre, on avait de l’argent, mais pour des maisons, on n'en a plus ! » En effet, alors que la dette du gouvernement du Canada était de 5 milliards de dollars en 1939, elle est de 18 milliards en 1944. Toutes ces sommes ont été englouties dans la guerre. En 1951, alors qu'au cours des 7 premiers mois de l'année le gouvernement fédéral a accumulé un surplus budgétaire de 700 millions de dollars, il n'y a toujours pas d'argent pour loger les familles pauvres du Creekside. Ce n'est qu'en 1969 que la ville de Hull aura ses premiers logements à caractère social, lesquels serviront d'abord à loger les expropriés par la « rénovation urbaine ».
Une ville surpeuplée
En dépit de l'interdiction de s'établir à Hull, la population du Creekside ne cesse de croître alors que d'autres familles ont érigé des cabanes à l'extrémité est du parc Jacques-Cartier, et sur le chemin du lac Leamy. En 1951, le Creekside abrite 234 personnes, au début de 1952, plus de 300 et en mai de la même année, il en compte au-delà de 400 ! Les autorités municipales avaient pourtant fait tout ce qu'elles pouvaient pour abriter les sans-logis au cours des années quarante : dans les casernes de pompiers, sous des tentes empruntées à l'armée, au manège militaire et même à l'hôtel de ville. Mais le problème était resté entier faute de construction domiciliaire importante pendant la guerre.

Le redémarrage de la construction ne suffit pas à loger tous les sans-abri. C'est ainsi qu'avec des matériaux récupérés – carton, pièces de bois disparates, tôle, etc. –, des familles se sont construit des abris de fortune, d'autres de pauvres maisonnettes. Pas d'eau courante ni toilettes reliées aux égouts dans ces masures le plus souvent dépourvues d'électricité. Les toilettes sont dehors, on s'éclaire à la lampe à l'huile, on lave les vêtements avec les eaux polluées et sales du ruisseau de la Brasserie. Pour éviter de faire de nombreux aller-retour entre bicoques et ruisseau, on ne change pas d'eau pendant le lavage, ce qui fait que les derniers vêtements lavés sont noircis par la crasse laissée par les hardes lavées plus tôt. L'hiver, on pratique des trous dans l'épaisse couche de glace du ruisseau pour se procurer de l'eau. Quant à l'eau potable, on va la chercher dans les maisons des propriétaires compréhensifs les plus proches, soit à 300 mètres au moins du bidonville.
Pour le journal Le Droit, le Creekside est le refuge de la vermine – cafards, souris et rats – et de la malpropreté. Les bicoques, qui abritent des familles souvent nombreuses, sont pour beaucoup toutes petites et plusieurs sont dépourvues de plancher. Ces gens n'ont pas les moyens de manger plein leur ventre ni de varier leur menu : « Sur la porte du fourneau on voit une soupière décoiffée remplie de nouilles aux tomates », ajoute le scribe du journal Le Droit. À l'une de ses questions, la dame de la maison répond que le contenu de la soupière doit durer de six à huit jours. Elle ajoute : « Nous mangeons suivant nos moyens. » Et cette cabane n'appartient même pas au couple, dont le chef de famille travaille ; il paie un loyer mensuel de douze dollars !
Une colonie d'indésirables ?
Des groupes de pression de la bien-pensance, convaincus que le Creekside est une source de promiscuité, d'immoralité et de délinquance juvénile, poussent la Ville à déloger, à expulser les résidents du Creekside, puis à détruire la centaine de cabanes dressées le long du ruisseau. Il n'y a pourtant pas de raison de croire qu'une expulsion puisse aider ces familles à se trouver un logement décent.
Le 4 septembre 1951, le conseil municipal de Hull décide de démolir toutes les masures construites sans permis sur son territoire. On estime leur nombre à environ 110 ou 115, peut-être plus. Le 15 janvier 1952, la Ville ordonne aux résidents du Creekside d'évacuer leur logis au plus tard le 1er mai suivant. L'expulsion de ces familles n'atténuera en rien la pauvreté de ces gens puisqu'au lieu de la combattre elle s'attaque aux pauvres,
L'expulsion
Le 26 mai 1952, démolisseurs et policiers se présentent au Creekside. Mais les résidents ne se laissent pas faire. Devant l'opiniâtreté de ces gens, la Ville n'a pas le choix de remettre à plus tard leur éviction : elle prolonge de deux mois l'échéance, car elle doit aussi tenir compte du fait qu'une partie importante de la population appuie les gens qui résistent à l'éviction.
Enfin, tout au cours de l'été, la police locale voit à la démolition du Creekside de sorte que le 23 septembre 1952, le chef de police, Adrien Robert, peut annoncer que toutes les familles ont enfin quitté le bidonville. Mais on n’en a pas fini avec les taudis qui logent encore presque 300 personnes : il reste la cinquantaine de masures, appelées camps, situées au lac Leamy et à Silver Beach, ainsi que des baraques érigées à la Gatineau Boom. Mais c'est là une autre histoire.
Pour en savoir plus, voir la revue Hier encore, numéro 8, 2016, La misère du Creekside.
Sources :
Archives de la Ville de Gatineau, dossier H005, Bureau du greffier, Ville de Hull ; H015, fonds du Service des arts et de la culture, Ville de Hull ; P120, fonds Théodore Lambert.
ANDREW, Caroline, André BLAIS et Rachel DESROSIERS, « L'information sur le logement public à Hull », Recherches sociographiques, vol. 16, n° 3, 1975, p. 375-383.
LAPOINTE, Pierre-Louis, « Les "Favelas" hulloises », Outaouais, Institut d'histoire régional de l'Outaouais, janvier 1986, p. 25-28.
Le Droit (Ottawa), 1949-1952, 1957.
La Revue (Hull), 1949.
The Ottawa Citizen (Ottawa), 1949.
[1] Extrait d'un article publié dans Hier encore, no 8, 2016, sous le titre de La misère du Creekside.
Le pape chez les Servantes de Jésus-Marie
![]() Par
ouimet-raymond
Le 08/02/2021
Par
ouimet-raymond
Le 08/02/2021
Jean-Paul II aura été le pape qui a sans aucun doute le plus marqué le XXe siècle. En 1984, il est venu saluer la population outaouaise grâce aux initiatives de l'ancien maire de Hull, Michel Légère, et de l'évêque du diocèse de Gatineau-Hull, Mgr Adolphe Proulx.
Plus d’un spécialiste de l’histoire et de la politique tient Jean-Pault II pour le responsable du démantèlement du « rideau de fer » et de l’effondrement du communisme. C’est aussi le pape qui a le plus voyagé. Son pontificat est le deuxième plus long de la papauté. Le plus long a été celui de Pie IX (31 ans : juin 1846 à février 1878). Toutefois, certains prétendent que le pontificat de saint Pierre a duré encore plus longtemps, mais c’est loin d’être assuré.
Jean-Paul II a été le 268e pape (il y a eu 33 antipapes – tous ne s’entendent pas sur le nombre de papes) de l’Église catholique romaine et le 9e pape du XXe siècle. Quand il a été élu le 16 octobre 1978 par le Sacré Collège, il est devenu le premier non italien, depuis 1522, à occuper le siège dit de « saint Pierre ». Son prédécesseur étranger était Adrien VI, un Allemand élu en… 1522 !
Karol Wojtyla dit Jean-Paul II
Né en 1920, Karol Wojtyla aura été le premier pape polonais de l’histoire de l’Église catholique romaine. Notons que 212 papes (dont 112 Romains, 56 « étrangers) étaient originaires de la péninsule italienne. Il n’était donc pas facile de devenir pape sans être Italien. Encore aujourd’hui, les Italiens sont majoritaires au Sacré Collège. Il faut dire que le pape est l’évêque de Rome. Et quand les papes résidaient à Avignon (1378-1429), ils étaient tous originaires du sud de la France.
La tradition veut que le premier pape de l’Église romaine ait été saint Pierre lui-même. Mais plusieurs historiens mettent aujourd’hui cette affirmation en question. D’abord parce que saint Jacques, le frère de Jésus, aurait été le premier dirigeant de la petite communauté de Jérusalem et, surtout, parce que l’on ne compte pas la moindre donnée historique sur les trois premiers papes. Ce n’est d’ailleurs qu’en 177 qu’Irénée, évêque de Lyon, a dressé une liste des papes. Tous les papes des quatre premiers siècles ont eu droit au titre de saint, à l’exception d’un seul : Libère (352-366). Le mieux connu des papes des deux premiers siècles est saint Clément (88-97). Il a d’ailleurs écrit une Épître, datée de 95 ou 96, qui est le plus ancien texte chrétien original connu. Toutefois, la plus grande partie de sa vie a plus à faire avec la légende qu’avec la vérité.
Libère (352-366). Le mieux connu des papes des deux premiers siècles est saint Clément (88-97). Il a d’ailleurs écrit une Épître, datée de 95 ou 96, qui est le plus ancien texte chrétien original connu. Toutefois, la plus grande partie de sa vie a plus à faire avec la légende qu’avec la vérité.
Jean-Paul II a été un pape très médiatique. Mais savez-vous que le premier à être filmé a été Léon XIII, et cela a été fait à sa demande (1810-1903, troisième règne le plus long, 25 ans et 5 mois) ?
Souverain pontife est l’un des titres du pape. Ce titre lui vient directement de Rome où les empereurs étaient des Maximus Pontifex. De fait, la papauté est une monarchie absolue où seuls les princes (cardinaux) sont invités à choisir le pape. On pourrait dire que l’Église catholique est l’héritière de l’Empire romain qui s’est perpétué à travers elle. Cette monarchie, sans doute la plus ancienne de notre histoire, fascine toujours les peuples même si elle est quelque peu anachronique. Et quand le pape voyage, il attire des foules plus qu’aucun autre chef d’État.
Chez les Servantes de Jésus-Marie
Septembre 1984, le pape Jean-Paul II fait une visite au Canada. Il est prévu qu’il vienne à Ottawa, mais pas du côté québécois de la rivière des Outaouais, et cela chagrine une partie de la population catholique pratiquante. Et ce, d’autant plus que l’Église catholique outaouaise est plus ancienne que l’Église ottavienne : la paroisse de Montebello a ouvert ses registres en 1815 alors que celle d’Ottawa date de 1827.
Le maire de Hull, Michel Légère (maire de juin 1981 à novembre 1991), croyant et pratiquant, commence alors des tractations avec les autorités religieuses pour obtenir que le pape vienne rencontrer la population outaouaise. Rapidement, il s’aperçoit qu’à l’exception de l’évêque de Hull, Mgr Adolphe Proulx, les autorités religieuses d’Ottawa, archevêque en tête, ne favorisent pas la visite du pape Hull.
Le maire Légère est un homme qui ne manque pas de front. Ainsi décide-t-il de s’adresser directement au pape. C’est ainsi qu’il lui envoie un long télégramme lui demandant de bien vouloir faire une visite à Hull, ville où l’immense majorité des citoyens est catholique. À Ottawa, certaines autorités religieuses ne sont pas trop contentes de l’intervention du maire qui, contre toute attente (son conseil municipal était plutôt sceptique quant à ses chances), finit par obtenir une réponse favorable. Afin de ne pas déplaire aux autorités religieuses d’Ottawa, on décide en haut lieu ecclésiastique que le pape viendra à Hull non pas pour y rencontrer les autorités religieuses ou civiles hulloises, mais les humbles Servantes de Jésus-Marie. Cet ordre de contemplatives a été fondé par Éléonore Potvin, en collaboration avec l'abbé Alexis-Louis Mangin, à Masson en 1895 et s’est établi à Hull moins de 10 ans plus tard.
La visite du pape chez les Servantes de Jésus-Marie, religieuses, que la population a longtemps considérées comme les paratonnerres de Hull, se fait dans l’enthousiasme et avec la participation d’une foule nombreuse évaluée à 70 000 personnes. Les cris de « Vive le pape » retentissent, des petites drapeaux blancs et jaunes sont brandis dans les airs à la vue du pape qui salue de gauche à droite ceux qui sont venus l'accueillir aussi chaleureusement.
Même si le pape sort du couvent avec plus d'une heure de retard sur l'horaire prévu, les milliers de personne venues le voir à son arrivée en fin d'après-midi sont encore là à 20 heures 50. « Viens nous voir, Jean-Paul II » [...] « mon cher Jean-Paul, c'est à ton tour...» chantent-ils quand le pape sort du monastère.
En souvenir de sa visite, le conseil municipal offre à Jean-Paul II un vélo, blanc et or, fabriqué ici par Cycle Bertrand. Le pape fera don de la bicyclette aux religieuses. Comme elles sont pour la plupart âgées et qu’elles ne peuvent pas s’en servir, le conseil municipal leur a échangé contre deux tricycles. Le vélo du pape est maintenant exposé au Centre sportif de Gatineau.
SOURCES :
BARBEZIEUX, Alexis de, Histoire de la province ecclésiastique d'Ottawa et de la colonisation dans la vallée de l'Ottawa, Ottawa, 1897.
Hier encore (Gatineau), no 10, 2018.
Papauté, Encyclopædia Universalis.fr
Site Web, ServantesdeJésus-Marie.org
Wikipédia.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 18/01/2021
Par
ouimet-raymond
Le 18/01/2021
C'était le bon temps ?
Nous avons bien souvent une vue idyllique des années qui ont suivi la Grande Guerre et que l’histoire appelle les Années folles et nos grands-parents ou arrière-grands-parents, le bon vieux temps. Évidemment, c’était une époque pleine de promesses... qui n’ont guère été tenues.
 Au temps des Années folles, on danse le charleston sur une musique endiablée, et on écoute en rougissant les chansons polissonnes de Maurice Chevalier – Elle avait de beaux petits tétons...– celles plus romantiques de Lucienne Boyer – Parlez-moi d’amour... C’est le temps des changements vestimentaires révolutionnaires, du moins chez les femmes. Elles rangent au grenier les robes à corset, qui leur cachaient le corps du cou jusqu’aux chevilles, et les remplacent par des robes sacs qui découvrent leurs genoux. Et, elles portent désormais les cheveux courts. Les hommes délaissent les guêtres et leur cravate se porte désormais sous le col de chemise. Ils remplacent définitivement la pipe par la cigarette que même des femmes osent fumer en public : « Tu vas brûler en enfer avec ta cigarette », disait alors Zoé Chaput, scandalisée, à sa fille Léonie Mainville ! La montre-bracelet remplace définitivement celle de poche au grand dam des voleurs à la tire qui voient leur travail se compliquer singulièrement.
Au temps des Années folles, on danse le charleston sur une musique endiablée, et on écoute en rougissant les chansons polissonnes de Maurice Chevalier – Elle avait de beaux petits tétons...– celles plus romantiques de Lucienne Boyer – Parlez-moi d’amour... C’est le temps des changements vestimentaires révolutionnaires, du moins chez les femmes. Elles rangent au grenier les robes à corset, qui leur cachaient le corps du cou jusqu’aux chevilles, et les remplacent par des robes sacs qui découvrent leurs genoux. Et, elles portent désormais les cheveux courts. Les hommes délaissent les guêtres et leur cravate se porte désormais sous le col de chemise. Ils remplacent définitivement la pipe par la cigarette que même des femmes osent fumer en public : « Tu vas brûler en enfer avec ta cigarette », disait alors Zoé Chaput, scandalisée, à sa fille Léonie Mainville ! La montre-bracelet remplace définitivement celle de poche au grand dam des voleurs à la tire qui voient leur travail se compliquer singulièrement.
Le canon réduit au silence, la grippe espagnole vaincue, on est convaincu que le pire est passé. Le monde a besoin d’air et de plaisirs. Ces années folles, années d’insouciances si on en croit le cinéma américain, ne sont pas aussi heureuses que l’on croit, du moins pour les classes laborieuses qui comptent pour la grande majorité de la population. On est si pauvre que les hommes attendent l’âge de 27 ans, en moyenne, pour prendre épouse. Car, ne l’oublions pas, à cette époque, le mâle joue généralement le rôle de pourvoyeur unique de la famille. Et puis, il y a la maladie, dont une fait des ravages épouvantables : la tuberculose.
Un avenir radieux
À Hull, les bordels font des affaires d’or sous l’oeil bienveillant des autorités municipales. Rue du Pont (Eddy), on joue dans des barbottes et on s’amuse ferme dans de petits bals à l’huile. La science et la technique moderne, qui devaient rendre le monde infiniment heureux, révolutionnent la vie quotidienne. La radio fait son apparition et le cinéma muet attire des foules de plus en plus nombreuses. La population fréquente les cinémas Éden, Odéon ou encore Talbotoscope à Hull, Family Theatre à Aylmer ou Oasis à Buckingham où elle s’entiche du célèbre acteur Rudoph Valentino. Le théâtre aussi est populaire et on vient en grand nombre à la Salle Notre-Dame (Hull), qui compte pas moins de 824 sièges et 4 loges, voir les Léonard Beaulne, René Provost, Ernest Saint-Jean et Wilfrid Sanche qui jouent dans la Légende de Frésimus ou Michel Strogoff. Le dimanche après-midi, la foule vient écouter la fanfare du régiment de Hull, au kiosque du parc Eddy.
Les spectacles sportifs attirent de plus en plus les foules. Au parc Woods, rue Laurier, à Hull, jouent de nombreuses équipes de baseball dont le B. B. surnommé les « bébés roses ». En 1925, on accourt en foule au parc Dupuis pour voir des héros sportifs américains : des joueurs de baseball des Yankees de New York, les célèbres Babe Ruth  et Lou Gehrig. Puis c’est l’inauguration du fameux parc Luna (Moussette) qui attire des foules enthousiastes dans ses manèges, dont de superbes montagnes russes, sur sa piste de danse et son pavillon de patin à roulettes.
et Lou Gehrig. Puis c’est l’inauguration du fameux parc Luna (Moussette) qui attire des foules enthousiastes dans ses manèges, dont de superbes montagnes russes, sur sa piste de danse et son pavillon de patin à roulettes.
On s’organise
De plus en plus, les travailleurs se rendent compte que pour améliorer leur sort ils doivent faire front commun, c’est-à-dire se syndiquer. Les syndicats internationaux – américains en fait – ont enrôlé nombre de travailleurs québécois. Depuis peu, l’Église reconnaît aux travailleurs le droit d’améliorer leur sort. Et pour contrer le syndicalisme américain, elle appuie activement la fondation de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada – la future Confédération des syndicats nationaux (CSN) – qui a lieu au cours d’un congrès qui se tient à Hull du 24 au 29 septembre 1921.
Les travailleurs ont beau se syndiquer, les grosses entreprises n’acceptent pas facilement de partager pouvoir et profits. C’est ainsi que se déroule à Hull, en 1924, la grève des 275 allumettières de la E.B. Eddy Matches qui luttent avec l’appui de l’ensemble de la population et des autorités municipales. La solidarité des allumettières leur vaut de gagner plusieurs points. Mais cette victoire sera brève : en 1928, la E.B. Eddy vend la Eddy Matches qui ferme ses portes pour les rouvrir à Pembroke, en Ontario. Heureusement, une nouvelle entreprise s’était établie l’année précédente en Outaouais, la Compagnie internationale de papier (C.I.P.), qui est à l’origine de la fondation de Gatineau erronément appelé Gatineau Mills par la population. Puis, c’est le krach de 1929 qui pousse au chômage des dizaines de millions de travailleurs. Les années folles sont finies.
SOURCES :
Multiples, dont les livres de Lucien Brault sur la région, divers numéros de la revue Hier encore, mes recherches sur les Allumettières et les cinémas de Gatineau. La première photographie vient de ma collection. la seconde de BAnQ-Outaouais, P74 D120 P5.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 14/01/2021
Par
ouimet-raymond
Le 14/01/2021
Au cours des sept premiers mois de l'année 1955, les incendies firent 10 morts dans l'ancienne ville de Hull aujourd'hui devenue Gatineau. C'était un record dans I'histoire de la ville, qui avait alors moins de 50 000 habitants, à I'exception de 1910, année d'une terrible explosion.
Hull était alors en pleine décadence économique ; depuis une vingtaine d'années, les usines fermaient et la population s'appauvrissait. Le vieux Hull était dans un état de « taudification » avancée qui donnait prise au feu. Et pourtant, c'est dans un quartier récent qu'une grande tragédie frappa alors une famille hulloise.
Le soir du 23 juillet 1955, une partie de la famille Laurin s'était attardée à une soirée de fiançailles chez des parents. Étaient restés à la maison, rue Caron, 7 enfants âgés de 2 à 14 ans en compagnie de leur grand-père, Ferdinand Blais, et d'un chambreur, Jacques Nault. En fin de soirée, tous dormaient : les enfants à l'étage supérieur, Ie grand-père dans sa chambre et Ie chambreur sur Ie divan du salon. Malheureusement, Ie four électrique était resté allumé, et une tranche de pain oubliée dedans prit feu.
Il faisait chaud cette nuit-Ià. Vers 2 h 30, un voisin, Claude Labelle, qui était assis sur son balcon, comme Ie faisait généralement les Hullois en temps de canicule quand la chaleur du jour avait trop chauffé l'intérieur des maisons, aperçut une grande lueur venant de chez les Laurin. II crut d'abord que l'on venait d'allumer la lumière, mais alla tout de même voir de plus près. Le feu faisait rage dans la cuisine ! Labelle revint chez lui en vitesse, appela les pompiers et téléphona chez les Laurin dans l'espoir de réveiller la maisonnée. Comme personne ne répondait, il courut à la maison et vit que Ie chambreur venait de s'éveiller. Ahuri, ce dernier pensa tout de suite aux enfants qui dormaient à I'étage. II tenta de se rendre à leur chambre, mais les flammes I'en empêchèrent.
Arrivés sur les lieux, les pompiers réussirent à sauver d'une mort certaine Ie grand-père, âgé de 79 ans. Puis, ils combattirent l'incendie a l'aide de cinq puissants jets d'eau et Ie maîtrisèrent vers 3 h 30. Ils entrèrent ensuite dans la maison où ils firent les macabres découvertes : près de la porte du sous-sol, Ie cadavre de Gilles, 7 ans ; autour de la cuisinière électrique, Lise, 2 ans, et Annette, 14 ans ; dans l'escalier, Nicole,13 ans ; et dans Ie placard de leur chambre, Suzanne, 10 ans, Paulette, 9 ans, et Diane, 5 ans. Peut-on imaginer I'effondrement des parents à leur retour ?
Une mauvaise réputation
Cet incendie qui anéantit une partie de la famille Laurin, et  d'autres - comme celui de la famille Larcher en 1966 - qui firent plusieurs victimes ont contribué à donner à tort une mauvaise réputation à la ville de Hull en matière de sécurité incendie.
d'autres - comme celui de la famille Larcher en 1966 - qui firent plusieurs victimes ont contribué à donner à tort une mauvaise réputation à la ville de Hull en matière de sécurité incendie.
Cette tragédie ne fut pas la dernière de 1955. À cette époque, la rue Montcalm était bordée de constructions de toutes sortes : écoles, hôtel, usines, édifices à logements, maisons, stations-service, magasins. Cette rue, qui débouchait au sud sur la rue Principale et à I'ouest sur Ie boulevard Saint-Joseph, était très animée, car elle reliait l'île de Hull au secteur appelé Wrightville et était située dans un quartier densément peuplé.
La nuit du 17 novembre 1955, une neige mouillée tombait abondamment sur la ville. Vers minuit quarante-cinq, Ie feu éclata au deuxième étage d'un immeuble à logements de trois étages, situé au 124, de la rue Montcalm. Très rapidement, Ie feu se propagea dans un corridor et gagna Ie troisième étage.
L'incendie finit par s'éteindre sous les tonnes d'eau déversées par les pompiers. L'immeuble carbonisé ne brillait plus. Ses fenêtres et ses portes béantes ressemblaient à des ouvertures de tombeaux. Puis, les cris se turent. Le ronronnement des camions à incendie et les sanglots étouffés avaient fait place à un triste silence. Au sommet d'une échelle, un pompier apparut, Ie corps d'une fillette morte dans ses bras. Dans la foule, une femme s'affaissa. Puis, les pompiers sortirent Ie corps d'un garçon, suivi de celui d'un homme. La foule retenait son souffle. Un jeune homme s'écarta brusquement. « Qu'as-tu ? », lui demanda-t-on. Il s'arrêta, les yeux hagards. « On descend Ie corps de mon père », répondit-il. Et il se tourna en sanglots contre Ie mur d'une maison voisine.
Malgré Ie sacrifice suprême d'un Lucien Deriger, Ie bilan de I'incendie était lourd : 5 morts et 8 blessés. Parmi les morts : Ie jeune Yvon Belisle, Ie garçon qui avait alerté sa mère. On Ie trouva affaissé sur le sol, étouffé par la fumée. Outre Lucien Dériger, les autres victimes étaient Antonin Parent, son épouse Monique Côté et leur fille Diane. L'enfant, que Ie policier avait attrapé, était leur fils Georges, désormais orphelin. Aux funérailles des trois membres de la famille Parent, les pompiers, profondément émus, accompagnèrent les dépouilles mortelles à leur dernier repos.
Quinze morts en une année, on n'avait jamais vu cela à Hull. Mais avant que l'année 1955 prenne fin, elIe en fit encore deux autres. Cette série d'incendies mortels sans précédent poussa Ie maire Thomas Moncion à ordonner au service d'incendie d'être plus sévère dans les inspections des bâtiments et de mettre en œuvre une campagne de prévention. La décision du maire semble avoir porte-fruit puisqu'au cours des six années suivantes, il n'y eut que 7 décès causés par Ie feu, et Ie funeste record de l'année 1955 n'aura jamais été battu.
Source:
OUIMET, Raymond, Une ville en flammes, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1997, pages 176, 177, 202 à 205.
La conscription de 1917 en Outaouais
![]() Par
ouimet-raymond
Le 31/10/2020
Par
ouimet-raymond
Le 31/10/2020
1917 : depuis trois ans, le Canada est en guerre et, malgré l’entrée imminente des États-Unis dans le conflit, rien ne laisse présager une victoire finale des Alliés aux dépens de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. La Russie est exsangue et la révolution gronde. Le Canada a déjà fourni 400 000 soldats aux alliés. Mais ce n’est apparemment pas assez. À la suite d’une conférence impériale tenue à Londres, le premier ministre canadien, le conservateur Robert Borden, veut envoyer 100 000 soldats additionnels sur les champs de bataille d’Europe pour défendre la « liberté » !
Le pays a de la difficulté à trouver ces hommes. La majorité des Canadiens ne veut pas servir de chair à canon, car c’est à ça que les soldats servent dans cette guerre. Aussi, le premier ministre parle-t-il d’enrôler de force les Canadiens, ce qui a pour effet de déclencher des manifestations dans tout le pays : Montréal et Québec, bien sûr, mais aussi Hawkesbury, Windsor et Vancouver. Et ce sont les classes ouvrières qui protestent les plus forts : elles exigent la tenue d’une consultation.
Les hommes ont de nombreuses raisons pour ne pas aller à la guerre. D’abord, soulignons qu’aucun belligérant n’avait attaqué ou déclaré la guerre au Canada. Les autorités canadiennes prétendaient alors que nous devions combattre pour protéger les libertés démocratiques. Or, justement, c’est d’abord ici que la liberté des Canadiens-Français était en péril parce que l’on avait interdit l’enseignement en français tant en Ontario (Règlement 17) qu’au Manitoba. Et on l’interdira en Saskatchewan en 1918. De plus, tant les Britanniques  que les Français brimaient la liberté de nombreux peuples. Par exemple, n’occupaient-ils pas par la force des armes l’Irlande et le Maroc, pour ne nommer que ces deux pays ? Enfin, on demandait aux Canadiens de se porter à la défense de nos mères patries… Parlons-en de nos mères patries : les Britanniques nous ont envahis alors que la France nous a abandonnés ! Nos arrières grands-parents n’avaient donc aucune raison d’aller risquer leur peau de l’autre côté de la grande mare.
que les Français brimaient la liberté de nombreux peuples. Par exemple, n’occupaient-ils pas par la force des armes l’Irlande et le Maroc, pour ne nommer que ces deux pays ? Enfin, on demandait aux Canadiens de se porter à la défense de nos mères patries… Parlons-en de nos mères patries : les Britanniques nous ont envahis alors que la France nous a abandonnés ! Nos arrières grands-parents n’avaient donc aucune raison d’aller risquer leur peau de l’autre côté de la grande mare.
Manifestations à Hull
En Outaouais, c’est à Hull qu’ont eu lieu les plus importantes manifestations dans le sillage du journal Le Droit qui se prononce contre la conscription dès le mois de mai 1917. Le 22 mai 1917, au cours d’une réunion organisée par l’Association libérale et l’Association ouvrière, le Dr Joseph-Éloi Fontaine, candidat libéral et président de la réunion tire à boulets rouges sur le gouvernement conservateur. Les orateurs enflamment la salle qui se prononce contre la conscription. Le 25 mai, l’Association ouvrière de Hull se prononce contre la conscription « tant et aussi longtemps que le peuple n’aura pas été consulté ».
Le 27 mai, vers minuit, quelques dizaines d’ouvriers placardent la ville : « À bas la conscription ! » et « Réveillons-nous, à bas la conscription ! » Ils invitent la population à une manifestation au parc de l’hôtel de ville. Le lendemain soir, le parc de l’hôtel de ville est envahi par la population locale. À 20 heures, défilent quelques centaines d’ouvriers l’Union Jack et le tricolore en tête. Sur les pancartes on peut lire : « À bas la conscription », « Suivez-nous » et « Le Canada avant tout ». Une voix entonne soudain le « Ô Canada », suivies par de milliers d’autres (chant qui deviendra, longtemps plus tard, notre hymne national). Puis on demande au maire Archambault de prendre la parole. Il se prononce ouvertement contre la conscription et demande aux manifestants de « Faites les choses en gentilshommes et toute la population se joint à vous et vous acclame ». Puis, il leur recommande de ne pas sortir du territoire de la ville. Ensuite vient le discours mitigé du député Devlin qui demande aux ouvriers de faire confiance aux… députés !
Enfin, le cortège s’ébranle. Plus de 4 000 personnes défilent en bon ordre dans les rues bordées par de milliers de spectateurs – plus de la moitié de la Ville de Hull est présente. La foule crie, à s’époumoner : « À bas la conscription ! » Le défilé s’arrête un instant et les manifestants écoutent, ravis, les discours « anticonscriptionnistes » du Dr Fontaine et de l’échevin Stafford. Une pétition circule dans la foule qui la signe avec enthousiasme. Puis, les manifestants se dispersent au chant de l’Ô Canada.
Un choc évité
Il s’en est fallu de peu pour que la manifestation dégénère, car à Ottawa on avait suivi de près les agissements des leaders hullois et on avait lancé la rumeur que les manifestants envahiraient les rues d’Ottawa. Donc, le soir de la manifestation de Hull, une foule de jeunes gens, plus forte à défendre les mesures appréhendées de conscription que de s’enrôler dans l’armée, commence à vociférer contre les francophones. À 22 heures, la foule a énormément grossi. Déçue de ne pas voir les Hullois envahir les rues de la capitale, voilà que quelques activistes se mettent à crier : « À Hull ! ». La foule, composée de civils et de soldats, descend la rue Bay. Rue Wellington, elle rencontre un détachement d’un bataillon du génie, armé de pics et de haches, qui vient grossir la foule des contre-manifestants dont le capitaine Kenneth McPherson, de l’armée de Sa Majesté, prend la tête. Puis, soudainement, le capitaine recommande à la foule de ne pas aller à Hull, mais d’attendre les Hullois qui, eux…, sont déjà entrés dans leurs foyers. La foule hésite puis commence à se disperser à son tour. Quelques dizaines de personnes continuent à gueuler et crient vouloir prendre d’assaut la ville de Hull. Enfin arrive un détachement de police qui a l’heur de refroidir les ardeurs belliqueuses : à minuit moins quart, le silence fait place au tohu-bohu.
La population finit par se soumettre à la conscription. Elle n’avait pas le choix… Mais elle n’en pensait pas moins. Ainsi, sur les 117 104 Québécois appelés en 1917, 115 707 ont réclamé l’exemption en invoquant le statut d’étudiant, de cultivateur, de soutien de famille, de pieds plats, de souffle au cœur, etc. En Ontario, sur 125 750 hommes appelés, 118 128 ont réclamé l’exemption. Ce qui prouve que les anglophones de souches canadiennes ne souhaitaient pas plus que les Québécois à se faire zigouiller pour le roi d’Angleterre !
Sources :
ROBILLARD, Jean Denis, Violence au Québec, Les éd. JDR, 2006.
Le Droit (Ottawa) 1917 et 1972.
Nos Racines
Amour, amour, quand tu nous tiens...
![]() Par
ouimet-raymond
Le 16/10/2020
Par
ouimet-raymond
Le 16/10/2020
A beau mentir qui vient de loin, dit un vieux dicton. Mais l’amour est aveugle et n’en tient que rarement compte.
Septembre 1895, une jeune fille du nom d'Amanda Labelle, fiancée depuis une dizaine de mois à Joseph Raymond, tombe éperdument amoureuse de Camille Dubois, un latteur d'une trentaine d'années qui lui fait la cour avec empressement. Les amoureux se plaisent tellement qu'ils décident de s'épouser au plus tôt. Ils demandent de publier les bans, mais, voilà, comme ni l'un ni l'autre ne sont originaires de Hull (elle de Chénéville et lui de Chicago), le père Ludger Lauzon, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, exige des amoureux impatients un certificat prénuptial pour s'assurer de leur habileté à contracter mariage. Cette exigence de l'oblat n'a pas eu l'heur de plaire à Dubois qui, beau parleur, réussit à convaincre la jeune de faire bénir leur union par le révérend Loucks, pasteur à l'église anglicane Christ Church à Ottawa, et de quitter la région par la suite.
On ne sait si le repas ou la nuit de noces, ou les deux ont été indigestes, mais le lendemain du mariage, la jeune mariée tombe malade, ce qui empêche Dubois de mettre à exécution la seconde partie de son plan. Le grain de sable vient d'enrayer la mécanique. Le samedi, le nouveau marié se rend au travail comme à l'habitude. Mais dans le cours de la journée, il est mis en état d'arrestation et conduit dans une geôle du poste de police où il avoue avoir femme et enfants à Chicago. Le même soir, au presbytère, le curé Lauzon fait lecture d'une lettre à Amanda Labelle, lettre qu'il a reçue de Chicago et qui dit que Camille Dubois est marié depuis dix ans et père de trois enfants !
Dès le lundi matin, Camille Dubois comparait en cour municipale devant le recorder Champagne à qui il avoue, sans aucune réticence, son imposture. Le mardi, on appelle à la barre des témoins la pauvre épouse qui déclare qu'elle ne savait pas que Dubois était marié et qu'elle l'avait appris du curé Lauzon. Elle ajoute que « [...] Dubois était un très bon garçon depuis deux mois qu'elle le connaissait. »
Déjà marié ?
Pourquoi Dubois a-t-il quitté sa première épouse, se demande-t-on ? Eh bien, Ce serait parce que sa femme avait apparemment des relations avec un pensionnaire qui demeurait chez lui. Quand il en fait la remarque à son épouse, celle-ci lui aurait rétorqué qu'elle aimait le pensionnaire et que « [...] si lui n'était pas satisfait, il n'avait qu'à quitter la maison. »
Amoureuse, la belle Amanda mandate un avocat, nommé Cloutier, pour plaider pour elle et... le prisonnier ! Il paraît même que « des femmes » se sont mêlées de défendre le beau Camille Dubois. Avait-il le charme d'un Casanova ou celui d'un bel exilé ? On a beau dire, mais, venu de loin, un personnage exerce souvent une irrésistible séduction sur le sexe opposé. Souvenez-vous d'Alexis Labranche alias Jos. Branch, l'exilé du Colorado dans le téléroman de Claude-Henri Grignon, Les belles histoires des Pays d'en-haut. Déjà, le « rêve américain » fascinait tout autant que le charme du personnage.
Au cours de l’enquête, Amanda déclare que jamais son mari ne lui a avoué qu'il était déjà marié. Le 14 novembre, le magistrat remet la cause à huit jours plus tard, car il lui est impossible de condamner le prévenu à partir des preuves déposées, et ce, même si Dubois a candidement avoué sa supercherie. Le 22 novembre, la cause de bigamie est de nouveau entendue et l'avocat prétend que le mariage contracté par les deux amants, à Ottawa, est invalide, ce que réfute le juge. Mais voilà, on n’a pas encore prouvé, hors de tout doute, la culpabilité du Franco-Américain même si une seconde missive, en provenance de la Ville des Vents, affirme qu'il est bel et bien marié. En effet, aucun certificat de mariage n'accompagne la lettre. Devant l'insuffisance de la preuve, le juge remet Dubois en liberté sous caution et reporte la cause au mercredi suivant.
Mais lequel des deux est bigame ?
L'affaire prend soudain une tournure tout à fait imprévue parce que, semble-t-il, Amanda est pourvue de grâces et d'attraits auxquels Joseph Raymond, le fiancé éconduit, est toujours sensible. En effet, la jeune femme n'est pas sans charmes. Un journal local la décrit en ces termes : « courte, grassouillette et fort attrayante. » On comprend mieux que l'ancien fiancé ait risqué de passer pour la cinquième roue du carrosse aux yeux de la population hulloise qui suivait de fort près l'enquête dans les journaux locaux.
Quoi qu'il en soit, ou bien Joseph Raymond n'avait pas perdu espoir de faire revivre ses amours d'antan et sait faire renaître, dans le cœur d’Amanda, un peu d'affection pour sa personne, ou, les oblats ont usé de leur influence et, surtout, de leur autorité pour faire cesser le scandale dont se délectait un quotidien d'Ottawa.
Le mercredi 30 novembre, le tribunal ecclésiastique d'Ottawa se réunit et invalide le mariage d'Amanda Labelle6. Le même soir, à l'église Notre-Dame-de-Grâce, Amanda épouse Joseph Raymond.
L’affaire de bigamie n’est toutefois pas finie. En effet, le 3 décembre 1895, Camille Dubois comparaît en cour pour la dernière fois dans cette affaire. La police n'a pas encore réussi à se procurer le certificat du premier mariage du prévenu. Devant l'absence d'une preuve irréfutable, le juge n'a d'autre choix que de relaxer le prisonnier et de lui accorder le bénéfice du doute.
Devant la Loi, Camille Dubois n'est donc pas bigame. Or, comme il ne l'est pas, Amanda doit certainement l'être étant donné que les raisons invoquées pour invalider son mariage se trouvent anéanties par le jugement de la Cour ! On semble avoir tout simplement fermé les yeux devant ce qui risquait de devenir un ridicule imbroglio.
Dubois était-il véritablement bigame ? Eh oui ! J’ai réussi à découvrir qu’il s’était marié avec Julie Parent le 9 juillet 1884 à Chicago !
Le jour du mariage d’Adélard Godin avec Dorilda Levert[1], en 1909 à Hull, les invités à la noce sont loin de se douter que la vie ne fera pas de cadeaux au jeune couple. Peu instruit, Adélard est un homme ingénieux, un patenteux comme on disait dans le temps. Il a construit, seul, un très beau canot automobile qu'il fait voguer sur la rivière des Outaouais. Son sens inné de la mécanique l'a conduit à travailler dans la carrière de la Federal Stone où il dirige des travaux de concassage.
Après sept ans et demi de mariage, les Godin forment un couple heureux entouré de trois beaux enfants. Le matin du 24 mai 1915, Dorilda a toutes les raisons de croire que la vie continue à lui sourire. Dehors, ça sent bon le printemps et, dans son ventre, elle a peut-être commencé à sentir les premiers remuements du bébé dont elle est enceinte depuis un peu plus de trois mois. Comme elle ne perd jamais une occasion de montrer à son mari combien elle l'aime, Dorilda a préparé, pour le dîner, un beau gâteau, car c'est le jour du vingt-neuvième anniversaire de naissance d’Adélard[2]. Mais midi est passé et Adélard n'est pas revenu à la maison. Dans la rue, elle a vu la plupart des maris des voisines regagner le foyer conjugal. Mais le sien n'est pas parmi ceux-là qui, étrangement, devisent à voix basse. Enfin, un homme s'approche de Dorilda et lui annonce que son mari vient de se faire tuer accidentellement à la carrière. La douleur est immense.
Qu’était-il était arrivé au jeune contremaître de la carrière ? Il semble qu’il se tenait près d’un concasseur mécanique quand sa chemise s’est coincée dans la courroie d’entraînement de cette puissante machine. Il aurait eu beau crier « Au secours ! », « Help ! », les ouvriers de la carrière, qui étaient tous unilingues d’origine polonaise, n’auraient pas compris les appels à l’aide d’Adélard. Aussi, a-t-il été broyé par le concasseur.
tenait près d’un concasseur mécanique quand sa chemise s’est coincée dans la courroie d’entraînement de cette puissante machine. Il aurait eu beau crier « Au secours ! », « Help ! », les ouvriers de la carrière, qui étaient tous unilingues d’origine polonaise, n’auraient pas compris les appels à l’aide d’Adélard. Aussi, a-t-il été broyé par le concasseur.
Du jour au lendemain, la vie devient très difficile pour la jeune veuve qui vient tout juste d'avoir vingt-cinq ans. Mais Dorilda est une femme courageuse et pour subvenir aux besoins des siens, elle transforme une partie de son logement en épicerie. C'est peut-être derrière son comptoir que, deux ou trois ans après la mort de son mari, la jeune épicière fait la connaissance d'un jeune homme veuf, Philippe Boucher.
Catastrophe familiale
Philippe Boucher s'amourache de la jeune veuve et un jour de l'été 1918, il la demande en mariage. Dorilda n'hésite sans doute pas à accorder sa main à cet homme qui l'aime assez pour lui proposer d'adopter les quatre enfants qu'elle a eus de son défunt mari, Adélard. Au mois d'août de la même année, le mariage est célébré à l'église Notre-Dame-de-Grâce de Hull. Dorilda croit renouer avec le bonheur. Mais un mois et demi plus tard, la grippe espagnole fait son apparition au Québec et, dès le 7 octobre, la panique commence à s'emparer de la population hulloise, car on compte dans la ville environ 700 cas de grippe. Une dizaine de jours plus tard, Dorilda Levert se sent malade à son tour et le 20 octobre elle ferme les yeux pour ne plus jamais les rouvrir.
Pour Philippe Boucher, c'est la catastrophe. En deux mois et demi, il a été marié, il a pris en charge quatre enfants et il est redevenu veuf. Que faire? Il n'est pas le père légal des enfants de sa femme parce que, dit-on, la famille s'est opposée à leur adoption – on a probablement voulu s'assurer que l'homme était capable d'être un bon père. Quoi qu'il en soit, il est facile de comprendre qu'à cette époque il était difficile, voire impossible pour un homme seul, de travailler et d'élever en même temps quatre enfants. Boucher est donc mis devant un problème difficile à résoudre. Et c'est là que les témoignages divergent sur le comportement du malheureux époux. Les uns disent qu'il les a lâchement abandonnés[3] et d'autres affirment qu'en homme de coeur il a voulu les garder avec lui[4], mais que la famille légale s'y est opposée. Quoi qu'il en soit, les enfants sont dispersés, placés à l'orphelinat et plus tard, chez les parrains et marraines.
Qu'est-il vraiment arrivé? Dorilda était propriétaire de sa maison située au 115, rue Saint-Laurent (aujourd’hui boulevard des Allumettières). Elle n'avait sûrement pas eu le temps de faire un testament avant sa mort et on aurait peut-être craint que son mari s'empare de la maison. Comme les familles Godin et Levert avaient des droits sur la maison, on n'aurait pas voulu que les titres de propriété soient transférés à Philippe Boucher. Mais ce n’est là que pure spéculation. En effet, qui peut se vanter connaître le fin fond de l’histoire sans document à l'appui ?
[1] Il était le fils de François Godin et d’Herménéline Vanasse et elle la fille de Jean-Baptiste Levert et de Délima Lacasse.
[2] Communication de Thérèse Godin-Séguin à l'auteur, le 28 juin 1993.
[3] Communication de Monique Godin Robidoux à l’auteur en janvier 2010.
[4] Communication de Cécile Brazeau Godin à l’auteur en octobre 1997.
Hull, le soir du 25 avril 1900. La famille Guimond - Napoléon, 21 ans, son épouse Malvina Forget, 19 ans, et leur enfant de 8 mois, Lorenzo -, quittait la Petite Ferme pour emménager au 101 de la rue Chaudière (Saint-Rédempteur), sur la falaise surplombant le petit lac Minnow. Le lendemain matin – un jeudi –, un soleil radieux luttait contre le fort vent du nord-ouest qui balayait les toits de bardeaux noircis des maisonnettes. Jusqu'à ce jour, le printemps avait été plutôt doux, et en ce matin tragique du 26 avril le mercure indiquait 17,2°C. Napoléon Guimond s'était levé de bon matin pour aller travailler. La plupart des hommes étaient au travail et les femmes à la maison avec les enfants.
Vers 10 heures 45, la jeune épouse de Napoléon activa le poêle pour préparer le dîner. Mais la cheminée qui était prit feu une quinzaine de minutes plus tard. De l'autre côté du lac Minnow, une dame Robinson essaya, par des gestes larges et des grands cris, d'avertir la jeune femme qui, occupée à la préparation du repas du midi, ne s'était aperçue de rien. Des voisines, qui avaient entendu les cris puis remarqué les langues de feu léchant les planches de bardeaux, alertèrent l'infortunée locataire. Mais comme le vent soufflait à plus de 65 km à l'heure, les flammes embrasèrent rapidement le toit de la maisonnette pour se communiquer à une grange, puis aux maisons avoisinantes qui étaient entassées les unes contre les autres.
Les pompiers furent promptement appelés sur les lieux. Mais, à leur arrivée, l'incendie était déjà devenu conflagration. On manda tout de suite à Hull la brigade des pompiers d'Ottawa qui, malgré ses deux pompes à incendie, ses huit dévidoirs à boyaux et sa voiture à échelle pivotante, fut tout aussi impuissante devant l'océan de flammes qui déferlait sur la ville. La chaleur était telle qu'aucun pompier ne pouvait s'approcher à moins de 30 mètres du brasier. Puis la brigade des pompiers E.B. Eddy et la brigade Union sont entrées en action, sans plus de succès. L'incendie se déplaçait à un rythme d'enfer. Des fragments de bardeaux en feu, poussés par le vent, se détachaient des toits des maisons pour aller choir sur d'autres toits de bardeaux qui s'enflammaient à leur tour. Les scieries firent alors entendre leurs sifflets dont le chant, lugubre appelait les milliers de travailleurs à combattre l'incendie qui menaçait les grandes industries des Chaudières. Devant l'intensité des flammes qui enveloppaient les maisons les unes après les autres et la chaleur insupportable qui leur grillait le visage, les pompiers retraitaient. À 11 heures 30, le feu avait déjà consumé une partie des rues Chaudière, Wright, Wellington et Main (promenade du Portage). Au milieu des maisons qui flambaient comme des torches pour ensuite s'effondrer dans d'affreux craquements, la population apeurée se hâtait de mettre ses meubles à l'abri. Des gens affolés et chargés de ce qu'ils avaient de plus précieux emplissaient les rues, se coudoyant, se bousculant et semant ici et là des parties de leur fardeau. Des femmes effarées sortaient de leur maison en toute hâte et imploraient les passants de sauver leurs biens. Le crépitement des flammes, l'écroulement des maisons, le hennissement des chevaux effrayés, accompagnés par le roulement d'une centaine de voitures chargées d'effets mobiliers qui défilaient dans les rues produisaient un vacarme assourdissant. Ceux qui n'avaient pas de voitures transportaient leurs effets d'un endroit à l'autre, et au fur et à mesure que l'élément destructeur progressait.
Le tiers de la ville en feu
La ville baignait dans une atmosphère épouvantable. Vers 11 h 45, le feu s'attaqua aux cours à bois de la compagnie Eddy et de la Hull Lumber. Puis, une colonne de feu traversa la rue Bridge (Eddy) pour s'attaquer à la manufacture de papier où elle brûla 10 000 tonnes de papier. Ce fut ensuite au tour de la manufacture d'allumettes à prendre feu; elle contenait 20 000 caisses de bâtonnets phosphorés. À 13 heures, le tiers de la ville était la proie des flammes furieuses et vociférantes qui ravageaient tout sur leur passage; Hull était devenue une immense fournaise. Les petites maisons de bois s'enflammaient comme des boîtes d'allumettes et ne mettaient pas plus d'une douzaine de minutes à brûler. Celles construites en pierres vomissaient, par leurs fenêtres crevées, des tourbillons de fumée grise et noire. La ville brûlait dans un ronflement formidable et le feu courait le long des trottoirs de bois comme des torrents sortis de l'enfer.
Le vent soufflant du nord-ouest projeta une nuée de débris embrasés de l'autre côté de la rivière. Cela mit le feu à un hangar de la scierie Booth et aux innombrables piles de planches de bois qui propagea la conflagration dans tout le Flat et les faubourgs environnants - Rochesterville et Hintonburg -, jusqu'à la Ferme expérimentale.
 L'incendie était terrifiant. Les flammes, poussées avec rage par le vent qui rugissait, s'étendaient de Hull à Ottawa sur une distance de six kilomètres. C'était une véritable mer de feu déchaînée; 75 millions de mètres de planches de bois brûlaient. On aurait dit que la terre elle-même flambait. De la colline parlementaire, on aurait dit que toute la ligne d'horizon était en feu. L'intensité des flammes était telle que les poutres de fer du pont des Chaudières se tordaient sous l'effet de la chaleur, écrasant la pompe à incendie de la E.B. Eddy après avoir coupé la retraite à plusieurs pompiers d'Ottawa. L'atmosphère était remplie de feu et l'air était suffocant malgré le vent.
L'incendie était terrifiant. Les flammes, poussées avec rage par le vent qui rugissait, s'étendaient de Hull à Ottawa sur une distance de six kilomètres. C'était une véritable mer de feu déchaînée; 75 millions de mètres de planches de bois brûlaient. On aurait dit que la terre elle-même flambait. De la colline parlementaire, on aurait dit que toute la ligne d'horizon était en feu. L'intensité des flammes était telle que les poutres de fer du pont des Chaudières se tordaient sous l'effet de la chaleur, écrasant la pompe à incendie de la E.B. Eddy après avoir coupé la retraite à plusieurs pompiers d'Ottawa. L'atmosphère était remplie de feu et l'air était suffocant malgré le vent.
Peu après minuit, les flammes s'apaisèrent faute de vent et de combustible. Plus de 12 000 personnes étaient désormais privées d'abri alors qu'une dizaine de citoyens avait péri.
Source :
Ouimet, Raymond, Une ville en flammes, Hull, éd. Vents d'Ouerst, 1994.
Depuis le début du mois de mars, nous sommes aux prises avec une épidémie, celle de la grippe COVID-19. Ce virus n’est pas le premier à frapper la région. Il y a eu celui de la grippe espagnole en 1918, de la grippe asiatique en 1957, de la grippe de Hong-Kong en 1968 et le SRAS en 2003. La grippe asiatique A(H2N2) a créé un véritable remue-ménage en Outaouais en 1957.
Le 13 juin 1957, à la une, Le Devoir signale qu'une épidémie de grippe se propage à une vitesse foudroyante en Asie. Un biochimiste anglais écrit, dans le Lancet, que le nouveau virus pourrait être l'une des conséquences des retombées radioactives provenant des expériences nucléaires. Deux jours plus tard, voilà de premiers cas de grippe aux États-Unis provenant de voyageurs descendus de bateau quelques jours plus tôt à San Francisco.
Jusqu'à la fin de juillet, on ne parle plus de grippe ; l'heure est aux vacances. Mais, bientôt, il faut y revenir. Le directeur adjoint de l'Institut microbiologique de Montréal, Jean Tassé, affirme que l'épidémie est la pire que le monde ait connue depuis la grippe espagnole de 1918 et on songe à fabriquer un vaccin. Il dit : « Bien que très peu ou pas de mortalités accompagne la propagation de la grippe, relativement peu de personnes ont pu l'éviter dans les pays affectés (sic). » L'Association médicale américaine souligne que la grippe touche maintenant « plusieurs villes américaines », mais qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer pour l'instant.
Asiatique
Ce n'est qu'à la mi-août que la grippe « asiatique » – on l'appelle ainsi pour la première fois – commence à occuper beaucoup d'espace dans la presse écrite. À Huntsville, au nord de Toronto, à l'occasion d'un grand rassemblement de 1600 jeunes filles venues de 16 pays fêter le centenaire de l'Association des guides du Canada, plus de 150 d'entre elles attrapent la grippe. Par bonheur, aucune n'en meurt. Les malaises sont toujours les mêmes : forte fièvre à l'occasion, maux de tête et de gorge, malaises musculaires, rhume. Mais rien de plus.
Au tout début de septembre, un paquebot en provenance du Havre (France) et de Southampton (Angleterre), l'Ivernia, jette l’ancre à Québec. Soixante-quatre des 945 passagers sont atteints de la grippe. On oblige ceux-ci à débarquer et à se faire soigner dans quatre hôpitaux de la région. Le bateau file à Montréal et cinq autres passagers présentent les mêmes symptômes à leur descente.
Le 8 septembre, une semaine après la rentrée scolaire, le Séminaire de Trois-Rivières ferme ses portes à cause de l'épidémie de grippe et les 350 pensionnaires sont isolés pour une période de temps indéfinie.
Au Québec et en Ontario
À Hull, on fait état de nombreuses absences dans la semaine du 15 septembre. Le 16 septembre on ferme l’école Larocque de même qu’une école à Masham. À Ottawa, le taux d’absence est resté au beau fixe. Mais on ne parle pas encore d’épidémie au Canada. Pourtant, à Sudbury, il y a déjà 5 000 personnes touchées par la grippe asiatique. À Kirkland Lake, le taux d’absence des élèves des écoles de la ville est de 25 p. 100. Le 20 septembre, on signale trois morts en Ontario. Ottawa est touchée : 1 200 élèves sont grippés. Le lendemain, on estime qu’un Ottavien par foyer et la moitié des infirmières des hôpitaux de la ville sont aux prises avec le virus A(H2N2). On ferme de plus en plus d’écoles pour arrêter la progression du virus : le 23 septembre c’est au tour de toutes les écoles d’Aylmer.
Au mois d’octobre, le taux d’absence dans les écoles d’Ottawa est de l’ordre de 10 %. À Hull, la situation s’aggrave ; les religieuses ferment l’hôpital du Sacré-Cœur le 1er octobre et n’acceptent plus que les cas d’extrême urgence et de maternité. Le lendemain, c’est au tour de l’hôpital Général d’Ottawa de fermer ses portes. Le 3 octobre, on ferme les 18 écoles de Hull.
Heureusement, il y a fort peu de décès. Le 4 octobre, on en dénombre 8 en Ontario, 4 au Québec, et 1 en Colombie-Britannique. On commence à vacciner la population, mais on n’a pas commandé suffisamment de vaccins pour inoculer l’ensemble de la population. Le vaccin est diffusé par priorité : d’abord les employés des hôpitaux et… la famille royale qui arrivera à Ottawa à la mi-octobre.
Le remède miracle n’existe pas. Les standards téléphoniques des Unités sanitaires du Québec et les pharmacies sont débordés d’appels. Il y a des ventes records d’aspirines et de désinfectants. Les religieuses du couvent Sainte-Jeanne-d'Arc de Shawinigan auraient trouvé le remède miracle : porter sur soi un morceau de camphre. « Il semble que toutes les élèves aient profité du conseil. Quelques rares cas de grippe ont été signalés », écrit le quotidien Le Nouvelliste.
Dès le 10 octobre, l’épidémie de grippe asiatique s’affaiblit en Outaouais. Les journaux en parlent de moins en moins et consacrent leurs premières pages à la visite royale. Le 15 octobre la reine Elizabeth II passe à Hull en coup de vent. Ce jour-là, toutes les écoles de la ville ont ouvert leurs portes et les élèves de l’Île de Hull sont massés sur le parcours du couple royal pour accueillir Sa Majesté.
La mortalité
On estime que, dans le monde, la grippe asiatique a fait environ 1 500 000 morts, dont 98 000 aux États unis. Et selon le journal Le Droit du 22 octobre 1957, il n’y aurait eu que 52 mortalités au Canada, dont 26 en Ontario et 11 au Québec.
SOURCES
Le Devoir (Montréal), 22 août 2009.
Le Droit (Ottawa), septembre et octobre 1957
Le Nouvelliste (Trois-Rivières), septembre et octobre 1957.
La Presse (Montréal), septembre et octobre 1957
Un service d'incendie mal aimé à Hull
Le projet de construction d’une nouvelle caserne d’incendie dans l'ancienne Ville de Hull en 2011 a fait couler beaucoup d’encre. Ce n’était cependant pas la première fois que la construction d’un tel équipement était rejetée dans l’histoire de la ville. Bien souvent, quand on a voulu moderniser le service d’incendie, des voix se sont élevées pour en contester la nécessité.
Le 10 août 1906, une partie de la ville de Hull était la proie des flammes ; 38 maisons avaient brûlé dans ce que l’on a appelé le « feu du calvaire ». C’était la troisième fois, en six ans, que les Hullois voyaient leur ville menacée de destruction ; en 1900, un incendie avait rasé plus de 1 300 bâtiments. En dépit de ces destructions, les autorités municipales font peu pour améliorer les services de lutte contre l’incendie qui n’ont qu’une seule caserne, une pompe à incendie manuelle et quelques voitures hippomobiles à échelles.
Un seul politicien a compris qu'il faut de toute urgence améliorer la protection contre le feu : le docteur Urgel Archambault. Le docteur est relativement nouveau en politique, car il a fait son entrée au conseil municipal en janvier 1905 comme représentant du quartier 3. En 1907, il propose l'emprunt de 20 000 dollars pour la construction de deux casernes d'incendie, l'achat d'une pompe à vapeur et de l’équipement. Le conseil municipal adopte, du bout des lèvres, la proposition du médecin. L'emprunt devant être soumis par référendum à la population, on lui accole un autre règlement d'emprunt pour l'achat d'un nouveau concasseur, l'installation de nouvelles lumières électriques, etc., qui fait grimper le tout à 68 000 dollars alors que le budget de la municipalité n'est que de 108 000 dollars.
Douze jours après l'adoption de la proposition du docteur, des citoyens, sous le couvert de l'anonymat, engagent dans les journaux une lutte contre les dépenses prévues aux deux règlements d'emprunt, en prenant bien soin de ne pas contester l'utilité des achats envisagés par la ville. Ils clament bien fort que les pauvres feront les frais de l'emprunt, car on devra augmenter les taxes du fait que la construction de casernes provoquerait l'embauche de pompiers supplémentaires, parce qu'il est dangereux de confier une coûteuse pompe à vapeur à des pompiers inexpérimentés, parce que... n'importe quoi !
Un référendum
La population n'a plus tellement confiance dans son conseil municipal. Celui-ci a engouffré plus d'un demi-million de dollars dans un nouveau système d'aqueduc peu efficace. On sait que des conseillers municipaux se servent de l'équipement de la ville pour leur propre entreprise, et ce, à des coûts de location franchement bon marché. On décide de tenir un référendum. Comme on le sait, le premier référendum de l'histoire a été remporté par Barabas contre Jésus ! Rien d'encourageant. Aussi, le référendum attendu a lieu le 2 octobre et le règlement d'emprunt pour l'amélioration du service d'incendie est battu par 368 voix contre 28 !
Le conseil municipal se contente alors de voter un montant de 500 dollars pour continuer à louer, à Tétreauville, un hangar pour remiser la vieille pompe Victoria et un dévidoir à boyaux. Mais Urgel Archambault est tenace. Il sait que les conflagrations coûtent beaucoup plus cher à la collectivité qu'un emprunt d'une vingtaine de milliers de dollars. En juillet 1908, il propose de nouveau l'achat d'une pompe à incendie à vapeur, et ce, au grand dam de la majorité des membres du conseil municipal qui l'accuse de ne pas tenir compte de l'avis exprimé par les électeurs au référendum. Mais, à vrai dire, la population est partagée. Le conseil s'en tient cependant à l'amélioration de l'aqueduc, incapable de comprendre que l'une des nécessités n'exclue pas l'autre, mais la complète. Les compagnies d'assurances qui prennent encore le risque d'assurer des bâtiments hullois ne cessent d'accroître leurs primes et recommandent fortement au conseil, elles aussi, d'investir dans l'achat d'une pompe à vapeur. Mais, celui-ci fait encore la sourde oreille et rejette la proposition du docteur par un vote de 6 contre 4.
Une nouvelle ère
En 1909, le docteur Archambault quitte la scène politique municipale. L’année suivante, l'échevin Joseph Gravelle, président du comité de police, feu et lumière prend la relève du docteur dans la campagne pour l'amélioration du service d'incendie, et propose l'achat d'une pompe à incendie. Enfin, le conseil adopte la proposition de Gravelle et la nouvelle pompe est mise à l'essai le 20 juin.
En 1911, le docteur Urgel Archambault revient en politique et conquiert la mairie. Il n'attend pas de midi à quatorze heures pour mettre son programme électoral en oeuvre. Dès le printemps de la même année, il propose d'emprunter une somme de 42 000 dollars pour construire deux casernes d'incendie, acheter des chevaux et de l'équipement. Soumis à la population, le règlement reçoit l'assentiment de la majorité. Archambault porte ensuite le nombre de pompiers de 9 à 15. Les énergiques interventions du nouveau maire profitent rapidement à la ville de Hull, puisque des compagnies d'assurance diminuent leurs prix de 5% en 1912, année de l'ouverture des deux nouvelles casernes, et que la ville n'a plus subi de conflagrations depuis ce temps.
SOURCES :
Procès verbaux du conseil municial de Hull, 1906 à 1912, 2011.
Une provocation orangiste à Hull en 1911
De nombreuses organisations religieuses ont pour caractéristique première un certain fanatisme, ce qui les pousse à considérer leurs croyances comme la seule valable. Et quand des fidèles se sentent lésés dans leur croyance, il arrive qu'ils fomentent des provocations. Voilà pourquoi on parle tant, ces temps-ci, d’accommodements raisonnables.
L’Ordre d’Orange est une société fraternelle protestante fondée en 1795 en Irlande pour commémorer la victoire de Guillaume d'Orange (Guillaume III d’Angleterre 1650-1702, né Orange-Nassau aux Pays-Bas) sur les catholiques lors de la bataille de la Boyne en 1690. Pendant l'insurrection irlandaise de 1798, l'ordre d'Orange est devenu le principal lien entre le gouvernement britannique et les protestants d'Irlande, alors que les orangistes remplissaient les rangs de la milice volontaire et occupent la majorité des postes de la fonction publique.
La Grande Loge d’Orange d'Amérique du Nord britannique a été fondée en janvier 1830 à Brockville dans le Haut-Canada (Ontario). En 1844, l'influence électorale des orangistes était telle que John A. Macdonald (premier ministre) est devenu membre de l'ordre. Cet ordre réputé ultra-protestant et fanatique est franchement hostile aux catholiques et aux francophones. On peut même dire qu’il a eu des prises de position racistes au cours du XXe siècle.
Provoquer pour provoquer
Année après année, l’Ordre a l’absurde tradition de défiler dans les rues des quartiers catholiques de Belfast, en Irlande du Nord, pour rappeler à ses habitants leur défaite de 1690. C’est évidemment une belle façon de mettre le feu aux poudres…
Au printemps 1911, les orangistes décident de venir célébrer dans l’ancienne ville de Hull (Gatineau) la victoire de leurs coreligionnaires à la bataille de la Boyne. On s’attend à ce que 10 000 à 12 000 orangistes pourraient défiler dans les rues de la ville le 12 juillet, et ce, dans le but de « faire l’éducation du peuple » ! Rapidement s’élève un concert de protestations. Se sentant provoquer dans leur foi catholique, le Cercle Reboul, l’Alliance nationale, l’Ordre des forestiers du Canada, la Congrégation des jeunes gens de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, et même la Commission scolaire locale demandent au maire Urgel Archambault d’intervenir et d’empêcher les orangistes de venir célébrer à Hull, ville dont la population est à plus de 90% catholique.
L’ultramontain maire Archambault (il consacrera la ville au Sacré-Cœur), qui anticipe du désordre, écrit alors au grand maître des orangistes, un certain T. S. Sproule, pour qu’il dissuade son organisation de venir célébrer en Outaouais en tentant de lui faire comprendre que défilé prévu est offensant pour les catholiques. Sproule lui répond que les orangistes n’ont aucunement l’intention de provoquer la population hulloise, mais veulent tout simplement « jouir des droits que tout libre sujet britannique dans un pays protestant qui, par sa constitution, garantit liberté et droits égaux à tous ». Enfin, Sproule écrit qu’il n’a pas le pouvoir de modifier les décisions de son ordre et que le 12 juillet suivant, les Hullois n’auront qu’à vaquer à leurs occupations habituelles…
L'impuissance du maire
Il y a dans la lettre de Sproule un air de mauvaise foi. En effet, quelques jours plus tard, les citoyens apprennent que le défiler des orangistes traversera toute la ville et qu’il passera même devant l’église Notre-Dame-de-Grâce !
Les autorités religieuses catholiques de la ville demandent aux fidèles de ne pas intervenir dans la fête orangiste. La population est indignée et le maire Archambault déclare solennellement :
Je me ferais un devoir de saluer et de souhaiter la bienvenue à des anglicans ou des méthodistes qui viendraient célébrer à Hull une fête de leur culte, mais je veux qu’il soit compris que les orangistes viennent ici sans notre autorisation et qu’en même temps, il est impossible de les empêcher de célébrer leur fête dans nos murs.
Le maire veut que ses commettants comprennent que c’est malgré lui que les orangistes viendront fêter à Hull. Un peu plus tard, il demande à ses concitoyens de déserter les rues le 12 juillet suivant. De fait, le maire ne voit pas d’objection à ce que les orangistes tiennent leur pique-nique annuel à Hull, mais estime que leur défilé est une provocation à l’endroit des catholiques et, plus particulièrement, à l’endroit de la petite minorité irlandaise catholique de Hull, ce en quoi il avait raison.
Le journal Le Temps appuie évidemment le maire de Hull. Mais les journaux de langue anglaise estiment que ce défilé aura une influence salutaire sur la population en général et sur le maire et la police en particulier. Un pasteur méthodiste exhorte les orangistes à ne pas battre en retraite et déclare : « Cette colonie est anglaise […] ! Et il a raison : le Canada est toujours une colonie anglaise sans constitution, sans nationalité, sans drapeau, sans hymne national.
Le 11 juillet, soit la journée précédant l’anniversaire de la bataille de la Boyne, l’Ordre d’orange annonce, qu’invité par la loge locale, ses membres défileront à Hull le lendemain et qu’ils seront très nombreux. Dix mille à douze mille membres d’un ordre réputé pour être fanatique qui promet de défiler dans les rues d’une ville d’environ 14 000 âmes a de quoi faire frémir plus d’un maire, plus d’un policier.
Le 12 juillet 1911, comme promis, les orangistes défilent à Hull. Mais au lieu des 10 000 à 12 000 membres promis, il y en a que quelques centaines qui marchent dans la ville. Et à la demande des orangistes locaux, le défilé s’abstient de passer devant l’église paroissiale. Les rues de la ville sont désertes. Il n’y a qu’un seul incident vite étouffé par la police locale. Quant au pique-nique, il n’attire que 1 200 à 1 300 orangistes. L’un des organisateurs de la fête, le révérend Boyce, conclut la journée en déclarant qu’il fallait rendre justice aux catholiques romains qui n’avaient déclenché aucun incident pouvant offenser les orangistes. Et il ajoute que le maire de Hull avait sérieusement besoin d’un tonique pour ses nerfs !
Sources
Historica.
Le Temps (Ottawa) 4, 5, 6, 11, 12 et 13 juillet 1911.
Le journal Le Droit : une histoire de famille
Nous avons appris, cet été, que le groupe Capitales Médias s'est mis sous la protection de la loi sur les faillites. Cela signifie que le quotidien régional interprovincial, Le Droit, pourrait bien disparaître. Ce serait, me semble-t-il, catastrophique, parce que nous serions en grande partie privés de nouvelles locales d'autant plus que ce journal est le seul qui dessert les Gatinois.
Ma famille fréquente le journal Le Droit depuis ses tout débuts. Ce quotidien a été fondé à Ottawa en 1913 pour donner une voix aux francophones en lutte contre le Règlement 17 qui restreignait l'utilisation du français dans les écoles ontariennes. La mère nourricière de mon grand-père paternel, Virginie Taillefer Ouimet, a fait partie des gardiennes de l'école Guigues, armée d'une aiguille à chapeau pour interdire aux sbires du gouvernement ontarien d'intervenir contre les enseignantes.
Une femme de coeur
Virginie s'intéressait, sans aucun doute, à l'instruction puisqu'elle a maintenu mon grand-père, David Turgon dit Ouimet, aux études jusqu'à l'âge de 16 ans, ce qui était assez rare à l'époque. Cette femme avait du courage à revendre : outre mon grand-père, fils de sa sœur Louisa, morte trop jeune, Virginie a aussi pris en élève trois autres enfants soit ceux de son autre sœur, Sophie, aussi décédée dans la fleur de l'âge. Avec une telle mère nourricière, il n'est pas étonnant que mon grand-père ait aussi été un fier abonné au journal Le Droit.
Ma mère a aussi grandi dans un foyer nourricier – elle était orpheline de mère –, celui de sa tante Adéline Mainville et de son oncle Aimé Godin qui vivait à Hull. Lui était marchand de glace et elle, femme de maison. Bien que tante Adéline n'ait fréquenté l'école que deux ans – elle était originaire de l'Île-aux-Allumettes –, et son mari jusqu'à l'âge de dix ans, ils lisaient consciencieusement Le Droit. Cet exercice a fait qu'Adéline a même un jour pu lire avec plaisir la biographie de Châteaubriand, preuve que la lecture quotidienne développe le niveau de compréhension et de culture du lecteur. Par contre, mon grand-père maternel savait à peine lire – il a commencé très tôt à travailler dans les chantiers de l'Outaouais comme marmiton et est devenu veuf à l'âge de 31 ans avec 4 enfants en bas âge. Je me souviens le l'avoir entendu qualifier le journal de « tapisserie » !
Lire pour apprendre
J'ai donc évidemment grandi dans un foyer abonné au journal Le Droit, quotidien que mes parents lisaient assidûment, et ce, presque jusqu'à leur mort survenue à l'âge de 85 ans. Devant un tel exemple, j'ai commencé à lire Le Droit jeune, c'est-à-dire vers l'âge de sept ans. Je me souviens ne pas avoir alors compris la prononciation du groupe de lettres « ent », parce que parfois il fallait prononcer « en » et parfois « e ». C'est ma mère qui m'a montré à faire la distinction entre le mot qui finit en « en » et le verbe qui se termine en « ent ». Beaucoup plus tard, c'est avec fierté que j'ai participé à la rédaction de la chronique Mémoire vive dudit journal dans les années 1990.
Il n'est donc pas étonnant que j'appuie le journal Le Droit dont nous avons besoin pour connaître et comprendre l'actualité locale. Une solution : la transformation du journal en coopérative des employés, de préférence à Gatineau où se trouve la grande majorité de son lectorat.
Des communistes à la prison de Hull
Au cours des années 1930, les luttes sociales au Canada n’étaient pas très différentes de celles qui avaient cours dans d’autres pays du monde. Il y avait des communistes, nombreux (16 000 membres en règle en 1939), et des fascistes (environ 3 000 membres), moins nombreux. Les communistes inquiétaient le pouvoir politique en place parce qu’ils remettaient en question l’ordre social et le capitalisme. Quant aux fascistes, ils inquiétaient moins : plusieurs politiciens, policiers et militaires partageaient leurs idées d’extrême droite et leur racisme, et, de plus, les fascistes étaient… anticommunistes !
Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie attaque la Pologne, suivie par l’Union soviétique (l’actuelle Russie), prenant ainsi en sandwich les Polonais. Trois semaines plus tard, la Pologne est dépecée. Le 10 septembre, le Canada déclare la guerre à l’Allemagne (10 septembre), mais fait inexplicable, pas à l’Union soviétique qui est pourtant aussi un agresseur.
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) estime alors qu’il y a un sérieux danger que des sympathisants d’organisations internationales gênent les efforts du Canada dans la guerre. Dans l’esprit de la GRC, les « sympathisants d’organisations internationales » sont les communistes et leurs alliés ; les fascistes ont au moins la qualité de croire dans un « semblant de capitalisme ».
À la suite des pressions de la GRC, du ministère de la Défense et de politiciens, le gouvernement canadien interdit le parti communiste en juin 1940, de même que l’Ukrainian Farm-Labour Temple Association et, enfin les partis fascistes et nazis. Bien qu'à tendance pro-communiste, les membres de l’organisation ukrainienne ne sont pas communistes pour la plupart.
Les communistes dans la région
Dès le 17 octobre 1939, je journal Le Droit, dont une grande partie des dirigeants sont membres de l’Ordre de Jacques-Cartier, réclame l’interdiction immédiate du communisme et des communistes (mais pas des fascistes). Pour l’éditorialiste, le communisme suscite la haine entre les classes sociales et s’attaque au droit de propriété, à la famille, à la morale et aux sentiments religieux. Du même souffle, il suggère l’internement de tous les communistes. Deux ans plus tôt, l’Ordre de Jacques-Cartier, dont le siège social est situé à Ottawa, clamait que le « pire ennemi de l’Église et du Canada français est le communisme. » Admettons-le, l’Ordre n’avait pas tout à fait tort.
Pour l’Église catholique canadienne, le communisme est toute forme de pensée qui permet de propager l’esprit païen ! Pour la bourgeoisie, c’est toute forme de pensée qui remet en cause la propriété privée. Avec des définitions aussi larges, toute personne ayant des préoccupations sociales pouvait facilement être accusée de communisme. On estime alors que les communistes canadiens, manipulés par Staline, militaient contre l’entrée en guerre du Canada. C’était là une excuse pour se débarrasser le plus rapidement de chefs communistes. Mais il y avait aussi le projet non avoué de casser certains syndicats et des raisons raciales à l’égard des Ukrainiens.
Quoi qu’il en soit, dès septembre 1939, la GRC commence à procéder à l’arrestation de leaders communistes canadiens de même que de membres de l’Association ukrainienne. Ces personnes sont emprisonnées à Petawawa, près de Pembroke (Ontario), avec des fascistes, dont des membres des colonies allemandes et italiennes du Canada. Évidemment, fascistes et communistes ne font pas bon ménage. La tension est si forte à Petawawa que les autorités n’ont d’autre choix que celui de séparer les camps ennemis.
À cette époque la prison de la rue Saint-François, à Gatineau (secteur Hull), est neuve et encore inoccupée à la suite de problèmes de construction. Le 20 août 1941, les autorités canadiennes y déplacent par train 89 prisonniers communistes, dont 33 Ukrainiens et 15 Juifs. Ceux-ci descendent à la gare du ruisseau de la Brasserie, peu après le souper, sous les yeux d’une importante garde militaire et policière.
Les prisonniers sont bien traités à Hull et certains se voient même employer aux travaux d’élargissement de la rue Saint-François pour lesquels ils sont payés. Les gardiens en viennent même à fraterniser avec leurs prisonniers : ils leur achètent des livres et jouent souvent aux cartes avec eux. En mai 1942, les autorités remettent aux prisonniers un appareil radio et des haut-parleurs.
Tout n’est quand même pas rose. Le courrier est censuré et les autorités vont jusqu’à placer des agents provocateurs et de faux prisonniers parmi les vrais pour les espionner. De plus, les prisonniers n’ont pas droit à des visites, même celle de leur famille, avant l’automne 1941. Enfin, les prisonniers manquent de soins médicaux.
Le 22 juin 1941, Hitler envahit l’Union soviétique. Ainsi, Staline devient alors notre allié. Les prisonniers communistes demandent leur libération afin de participer à l’effort de guerre canadien. Le gouvernement fait la sourde oreille. En décembre 1941, des prisonniers canadiens-français expriment même le désir de s’enrôler pour combattre le fascisme. Des journaux commencent à écrire que ça n’a pas de bon sens de garder ces gens en prison. L’Église Unie du Canada demande leur libération. Mais la GRC et le ministre C. D. Howe, de même que l’Ordre de Jacques-Cartier s’y opposent. En avril 1942, le Parti communiste appuie le plébiscite de Mackenzie King sur la conscription. Au mois de septembre, le gouvernement commence à libérer les prisonniers communistes au grand dam du journal Le Droit et du Comité paroissial d’action catholique de Notre-Dame de Hull.
Sources :
Centre région al d'archives de l'Outaouais, fonds Raymond Brunet.
MARTIN, Michael, The Red Patch, Politiva ; imprisonment in Hull, Québec, during World War II, Gatineau, 2007.
Le pont Royal Alexandra : lien centenaire entre Gatineau et Ottawa
Il y a à peine deux ans, on projetait d'illuminer le pont Interprovincial, dont le nom officiel est Royal Alexandra, d'autant plus que les autorités fédérales et locales le considéraient comme un joyau patrimonial. Puis, il y a moins d'un mois, les autorités fédérales ont annoncé qu'elles prévoient le détruire d'ici cinq à dix ans, et ce, sans avoir consulté les autorités locales, pour le remplacer par une nouvelle structure. On peut dès lors penser que la voix des citoyens et celles des autorités locales ne pèseraient pas lourd dans les décisions s'il fallait que la région soit englobée dans un district fédéral. C'est une habitude à la Commission de la capitale nationale de décider sans tenir compte des populations locales.
C'est en 1868 que le gouvernement du Québec commence à réfléchir à la construction d'un second pont sur l'Outaouais pour relier le canton de Hull à la capitale fédérale, Ottawa. Ce projet de pont ne suscite guère d'intérêt chez les Hullois d'abord soucieux d'obtenir un pont sur la Gatineau alors que les autorités de Pointe-Gatineau font la promotion d'un pont qui relierait leur village à Ottawa. Toujours est-il qu'en 1890, un regroupement d'hommes d'affaires, de députés, de sénateurs et de quelques citoyens proposent de construire un pont à péage pour les trains, les voitures et les piétons entre la pointe Nepean, à Ottawa, et la ville de Hull. Les conseils municipaux de Hull et d'Ottawa approuvent le projet, bien que le Sénat mettent en question son esthétique, qui prévoit que le début de la construction du pont commence en 1892 pour se terminer en 1895.
La construction du pont
Le lancement des travaux a lieu le 20 avril 1892, mais la construction  est sitôt reportée de plusieurs années à cause de problème de financement. Grâce à l'investissement de la Ottawa Northern and Western Railway, danjs la compagnie Ottawa Interprovincial Bridge, l'entreprise H.J. Beemer, de Montréal, entreprend les travaux le 7 octobre 1899. Le montage de la structure d'acier est confié à la compagnie Dominion Bridge de Lachine. La construction des fondations constitue une tâche difficile à cause d'une couche de dépôts de bran de scie et de déchets, accumulée au fond de la rivière depuis un siècle, qui pouvait atteindre une épaisseur de plus de 15 mètres.
est sitôt reportée de plusieurs années à cause de problème de financement. Grâce à l'investissement de la Ottawa Northern and Western Railway, danjs la compagnie Ottawa Interprovincial Bridge, l'entreprise H.J. Beemer, de Montréal, entreprend les travaux le 7 octobre 1899. Le montage de la structure d'acier est confié à la compagnie Dominion Bridge de Lachine. La construction des fondations constitue une tâche difficile à cause d'une couche de dépôts de bran de scie et de déchets, accumulée au fond de la rivière depuis un siècle, qui pouvait atteindre une épaisseur de plus de 15 mètres.
Le pont doit avoir 5 travées, large de 19 mètres et d'une longueur de 563 mètres. La voie ferrée passera au centre avec une seule voie pour les voitures alors que le tramway électrique passera de chaque côté. La travée principale du pont, de 169 mètres, est la plus longue au Canada en 1901 et la quatrième au monde. Les tours des piliers culminent à 29 mètres. Le Grand feu de 1900, qui détruit 40% de la Ville de Hull, ralentit à peine les travaux de construction du pont. En effet, le 12 décembre 1900, une locomotive y fait un parcours d'essai et le 18 février 1901, à 9h19, on ouvre officiellement le pont à la circulation. Un certain Noël Valiquette, propriétaire de l'Hôtel Cottage, à Hull, brise la traditionnelle bouteille de champagne sur la locomotive du premier train régulier qui franchit le pont le 22 avril 1901. Outre  la locomotive et son fourgon, le convoi, en provenance de Gracefield, était composé de quatre wagons neufs de passagers. Un certain Jean Lauzon, de la rue Saint-Hyacinthe, a été le premier hullois à acheter son billet de train pour se rendre à Ottawa.
la locomotive et son fourgon, le convoi, en provenance de Gracefield, était composé de quatre wagons neufs de passagers. Un certain Jean Lauzon, de la rue Saint-Hyacinthe, a été le premier hullois à acheter son billet de train pour se rendre à Ottawa.
Un changement de nom
À l'inauguration du pont, celui-ci est tout simplement appelé pont Interprovincial. Mais de nombreuses personnes l'appellent du nom de son constructeur, Beemer. Puis en septembre 1901, on change son nom pour Royal Alexandra, en l'honneur de l'épouse du roi George X, Alexandra du Danemark (1844-1925), durant la visite du duc de Cornwall (il deviendra le roi George V en 1910), fils de ladite reine. Toutefois, jusque dans les années 1980, tant la population que les médias continuent à l'appeler pont Interprovincial.
Le pont Interprovincial est sans contredit le pont le plus imposant de la rivières des Outaouais. Alors que celui de Québec, inauguré en 1917 et dont la structure est aussi métallique,  a été désigné lieu historique national du Canada en 1995, Travaux publics Canada prétend que le pont Royal Alexandra coûte trop cher en entretien. Plus que celui de Québec ? On peut se permettre d'en douter d'autant plus qu'il est connu que les ponts à structure d'acier[i] peuvent être réparés par section au lieu d'être démolis. Alors, quel est l'objectif caché du gouvernement fédéral dans ce dossier ?
a été désigné lieu historique national du Canada en 1995, Travaux publics Canada prétend que le pont Royal Alexandra coûte trop cher en entretien. Plus que celui de Québec ? On peut se permettre d'en douter d'autant plus qu'il est connu que les ponts à structure d'acier[i] peuvent être réparés par section au lieu d'être démolis. Alors, quel est l'objectif caché du gouvernement fédéral dans ce dossier ?
Sources :
BRAULT, Lucien, Les liens entre deux villes - les ponts historiques entre Ottawa et Hull, co-édition Ville de Hull et City of Ottawa, 1989.
FRANCOEUR, Louis-Gilles, « Les pont d'acier ne sont plus de mise au Québec », dans Le Devoir du 23 avril 2009, Montréal.
Le Temps (Ottawa), 1896-1901.
[i] Le tablier du pont Royal Alexandra a été refait en 1946 et en 2009-2010.
L'assassinat du courrier de la Banque Provinciale
La crise économique commencée en 1929, perdure. La vie dans l'ancienne ville de Hull[1] est bien difficile ; outre son taux de chômage qui frôle les 37% de la main d’œuvre active, son taux de mortalité est de 18,2 pour 1 000 habitants, soit le plus élevé du Québec[2]. Pour subvenir à ses besoins, une famille de 5 personnes a besoin de 2 000 $ par année, mais peu d’emplois permettent de gagner un tel revenu. Par exemple, les hommes qui ont le bonheur (?) de travailler dans les chantiers sont traités comme des serfs. Les syndicats catholiques protestent, en 1932, contre les salaires qui y sont payés dans la région de la Gatineau où les employés de la forêt touchent de 0,06 $ à 6 $ par mois.
Pendant ce temps-là, les riches font preuve de talent à défendre leurs biens, ce qui contraste avec la soumission et la patience qu’ils prêchent aux pauvres. Des marchands haussent les prix. Un propriétaire de maisons à logements, rue Laval, augmente ses loyers de 22% en 1931 et de 23% l'année suivante.
Si les chômeurs rêvent d’un avenir meilleur, les petits travailleurs,  qui œuvrent pour un salaire de misère, n’aspirent pas moins à de plus beaux jours eux aussi. Et que faire pour réaliser leurs souhaits si ce n’est que de prendre exemple sur la politicaillerie et les affairistes qui manipulent les lois selon leur bon plaisir et, malgré la dépression, arrivent, grâce à des combines immorales, à se payer champagne, femmes et voitures ?
qui œuvrent pour un salaire de misère, n’aspirent pas moins à de plus beaux jours eux aussi. Et que faire pour réaliser leurs souhaits si ce n’est que de prendre exemple sur la politicaillerie et les affairistes qui manipulent les lois selon leur bon plaisir et, malgré la dépression, arrivent, grâce à des combines immorales, à se payer champagne, femmes et voitures ?
Le braquage du courrier
Le 4 décembre 1935, Paul Lafleur, 28 ans, et Armand Nadeau, 19 ans, quittent la Banque Provinciale de la rue Principale vers 10 heures. Ils transportent une sacoche remplie d’argent – 16 610 $ – qu’ils doivent remettre à l’Hôtel des monnaies. Ces deux jeunes hommes sont comme cul et chemise : ils ont travaillé ensemble à la Banque Provinciale de Verdun et ont été mutés, ensemble, 8 mois plus tôt à Hull.
À la sortie du pont Interprovincial qui relie Hull à Ottawa, l’automobile emprunte la rue Saint-Patrick. Au coin de la rue McKenzie, juste en face de l’Imprimerie nationale, le feu de circulation passe au rouge et l’automobile des commis s’arrête. Revolver au poing, un homme parlant anglais s’engouffre brusquement dans l’automobile par une portière arrière. L’arme pointée en direction du conducteur, il lui ordonne de faire demi-tour et de revenir à Hull.
L’automobile des commis de banque reprend le chemin de Hull sous la menace d’un bandit armé : Nathan Boverman, un Étasunien d’origine russe vivant à Springfield, Mass. L’automobile des commis est suivie par une voiture occupée par deux autres bandits : Charles Donnelly (des Cèdres) et Émile Lajoie, de Montréal.
 L’automobile emprunte le chemin de la Pointe-Gatineau (bd Fournier) puis s’engage dans un sentier derrière le cimetière. Les bandits prennent la sacoche, bandent les yeux de Lafleur et retournent à leur véhicule, sauf un, Nathan Boverman, qui a peur d’être reconnu parce que le jeune Nadeau l’avait regardé avec insistance dans le rétroviseur. Il braque son arme sur la tête du jeune commis qui le supplie de ne pas le tuer, mais de seulement lui tirer dans les jambes. Boverman, un dur de dur, ne l’écoute pas et abat le jeune homme de trois balles dans la tête, puis rejoint ses comparses.
L’automobile emprunte le chemin de la Pointe-Gatineau (bd Fournier) puis s’engage dans un sentier derrière le cimetière. Les bandits prennent la sacoche, bandent les yeux de Lafleur et retournent à leur véhicule, sauf un, Nathan Boverman, qui a peur d’être reconnu parce que le jeune Nadeau l’avait regardé avec insistance dans le rétroviseur. Il braque son arme sur la tête du jeune commis qui le supplie de ne pas le tuer, mais de seulement lui tirer dans les jambes. Boverman, un dur de dur, ne l’écoute pas et abat le jeune homme de trois balles dans la tête, puis rejoint ses comparses.
Arrestation des bandits
Les bandits en fuite, Lafleur qui est anéanti par la mort de son collègue, se rend sur le chemin de la Pointe-Gatineau en criant : « Police, police, j’ai été volé ! » Un automobiliste arrête et le prend en charge.
La police est convaincue que les bandits ont bénéficié de l’aide de complices à l’intérieur de la banque. Trois jours après le braquage, le fameux chef des détectives de la Police provinciale, Louis Jargailles annonce : « Les révélations que nous ferons bientôt frapperont de stupeur le Canada tout entier… »
L’un des membres du gang, peut-être tenaillé par des remords, se met à table et dénonce ses complices. Le 8 décembre, la police provinciale trouve la cachette du bandit étasunien, Nathan Boverman, alias Ted Montin, rue Sherbrooke, à Montréal. Comme il a juré que jamais on ne le prendrait en vie, les policiers ne prennent pas de risque et l’abattent de deux balles alors qu’il tente d’atteindre son arme. Le lendemain, le chef Jargailles, annonce avoir arrêté onze personnes dont deux femmes, et le lendemain, trois autres hommes.
Le dévoilement des noms des membres du gang cause une véritable commotion dans la ville parce que plusieurs des truands sont des jeunes hommes issus de bonnes familles de Hull acoquiné au milieu des bars de la région et de gangsters de Montréal. Et pour cause : dans cette liste apparaissent les noms deux compagnons de travail de Nadeau et un ancien employé de la Banque Provinciale. Le premier d’entre eux est… Paul Lafleur, celui-là même qui conduisait Nadeau et neveu d’un député bien connu ; le deuxième, Jean Beausoleil, 21 ans, employé de la Banque Provinciale ; un troisième, Georges Chénier, 21 ans, fils d’un restaurateur bien connu et ancien employé de la Banque provinciale, et un quatrième, Georges Potvin, 33 ans, vendeur d’automobiles. Les autres membres du gang sont de Montréal et d’Ottawa.
Multiples condamnations
De fait, l’affaire a mal tourné. Le complot a bel et bien été ourdi à Hull, mais il n’était pas prévu que l’un des hommes abatte Nadeau. Boverman était un ancien boucher qui, la prohibition venue, s’était recyclé dans la contrebande d’alcool. Celle-ci abolie, il n’est pas revenu à ses anciennes amours. Il s’est plutôt spécialisé dans le vol à main armée aux quatre coins de la Nouvelle-Angleterre. Sa tête mise à prix, il s’est rabattu sur Montréal.
Sous la pression du premier ministre Taschereau, les autorités de la Justice annoncent qu’ils vont faire diligence. Le premier procès commence à la Saint-Valentin 1936. On y apprend que le jeune Armand Nadeau ne faisait pas partie du complot de vol et que les membres du gang qui travaillaient à la banque devaient recevoir 3 500 $ pour leur travail.
La Justice a tenu parole et les bandits sont rapidement condamnés. Lafleur est puni de 20 ans de prison ; Chénier, 15 ans ; Beausoleil, 10 ans ; Émile Lajoie, prison à vie ; Charles Donnelly, 25 ans . Les autres seront condamnés au temps passé en prison, sauf Potvin et 2 autres comparses qui seront relaxés par manque de preuves.
Toutefois, la police ne mettra jamais la main sur l’un des chefs de la bande, un certain Hermann Laroche. Enfin, de nombreuses personnes concluront que si les banques payaient plus leur personnel, leurs employés seraient plus honnêtes.
Source :
BAnQ, fonds Romulus Beauparlant, P022, art. 6.
Le drame de l'Allumière Canada Match
15 mars 1933. Les employés de l’Allumière Canada Match – fabrique d’allumettes située dans l’actuelle rue Dumas, à Gatineau *secteur Hull) –, se rendent à l'usine comme tous les jours. Germaine Cyr, 26 ans, a le cœur léger. La veille, ses amis l'ont fêtée en prévision de son mariage prochain. Fiancée depuis Noël, elle s'amuse, chemin faisant, à comparer sa bague de fiançailles avec celle d'une compagne de travail. Émile Paquette, qui a célébré ses 36 ans la veille, doit être aussi joyeux que Laura Lacelle qui elle a 39 ans ce jour-là.
À 7 h 30, tous les employés sont à leur poste. L'usine est divisée en plusieurs pièces réparties entre le premier étage et le rez-de-chaussée : à l'étage se trouvent le réfectoire qui sert de vestiaire, l'atelier de composition chimique, l'atelier de trempage et d'empaquetage des allumettes et un bureau; le rez-de-chaussée comprend l'atelier de préparation du bois et l'entrepôt d'allumettes. Dans l'atelier principal, une machine trempe les bâtonnets dans une solution composée de phosphore et de soufre puis les dépose sur une courroie où ils sèchent avant d'être mis dans des boîtes empaquetées ensuite dans des caisses.
Il est environ 10 h 30 quand un paquet d'allumettes s'enflamme brusquement au poste de travail d'Anita Bertrand. Le feu prend aussitôt aux vêtements de la malheureuse, se communique aux milliers d'allumettes qui se déplacent sur la courroie et atteint les boîtes d'allumettes empaquetées qui s'enflamment dans un éclair terrifiant.
Une peur panique
La panique s'empare des employés. Les ouvrières se mettent à crier d'effroi et au lieu de courir vers la porte extérieure, plusieurs courent au réfectoire chercher leurs manteaux pendant que d'autres se blottissent près d'un mur, loin des fenêtres. Le feu se propage rapidement  à toute l'étage, dressant un rideau de flammes devant les sorties extérieures ou celle du rez-de-chaussée où les employés auraient pu y trouver refuge. Deux hommes, le chimiste Steve Hulquist et le surintendant Émile Paquette tentent en vain d'apaiser le personnel affolé. Au mépris du danger, ils fraient un chemin jusqu'aux fenêtres à plusieurs des allumettières qui peuvent ainsi sortir de l'usine devenue un bûcher ardent. Un voisin de l'usine, Émile Tessier, installe une échelle sous une des fenêtres du bâtiment (les fenêtres étaient à plus de 3,5 mètres du sol) et en aide plusieurs à s'échapper. Une fille, prise de panique, plonge à travers une fenêtre en brisant les carreaux. Elle meurt sur le coup, la veine jugulaire tranchée. D'autres la suivent et se cassent bras et jambes.
à toute l'étage, dressant un rideau de flammes devant les sorties extérieures ou celle du rez-de-chaussée où les employés auraient pu y trouver refuge. Deux hommes, le chimiste Steve Hulquist et le surintendant Émile Paquette tentent en vain d'apaiser le personnel affolé. Au mépris du danger, ils fraient un chemin jusqu'aux fenêtres à plusieurs des allumettières qui peuvent ainsi sortir de l'usine devenue un bûcher ardent. Un voisin de l'usine, Émile Tessier, installe une échelle sous une des fenêtres du bâtiment (les fenêtres étaient à plus de 3,5 mètres du sol) et en aide plusieurs à s'échapper. Une fille, prise de panique, plonge à travers une fenêtre en brisant les carreaux. Elle meurt sur le coup, la veine jugulaire tranchée. D'autres la suivent et se cassent bras et jambes.
Le lendemain de l'incendie, une allumettière raconte à un reporter du journal Le Droit (16 mars 1933) : Croyant leur dernière heure venue et terrifiées par la vue des flammes, mes compagnes [...] appelaient désespérément leur mère à l'aide et s'agenouillaient au milieu des flammes pour réciter leur acte de contrition [...]
Les pompiers tentent d'entrer dans la fabrique, mais comme les portes sont verrouillées de l'intérieur, ils perdent du temps à les défoncer à coups de hache. Ils ne peuvent plus rien faire pour soustraire à la mort les ouvrières restées dans le bâtiment, car l'incendie dégage une chaleur épouvantable. Les fenêtres crevées crachent de longues flammes jaunes et rouges alimentées par le phosphore et le soufre, ce qui rend impossible une intervention par ces ouvertures, sans compter le danger d'explosion. Des pompiers dirigent deux jets d'eau devant six de leurs collègues qui pénètrent dans le bâtiment en flammes pendant que d'autres pompiers lancent huit jets d'eau dans les ouvertures des fenêtres brisées. À 11 h 07 exactement, on trouve le corps d'une première victime puis ceux de quatre autres femmes : Anita Bertrand, 20 ans, Germaine Cyr, 26 ans, Thérèse Labelle, 19 ans, Laura Lacelle, 39 ans et la très jeune Marie-Paule Laviolette, 15 ans. Un mois plus tard, une sixième personne, Léo Larouche, 39 ans, succombera à ses blessures. Bilan final de l'incendie de l'Allumière Canada : 6 morts et 22 blessés.
Défense des propriétaires
Les propriétaires de la compagnie trouvèrent le moyen de blâmer les victimes pour leur triste sort et l'un d'entre eux déclara à un journaliste du journal Le Droit (17 mars 1933) : ...le terrible holocauste aurait pu être évité si quelqu'un eut la présence d'esprit de faire descendre les ouvrières au sous-sol (rez-de-chaussée) où il y a deux portes de sortie.
Facile à dire quand on n'a pas le feu aux trousses ! Le soir même de l'incendie, le coroner commence son enquête. Des employés déclarent avoir trouvé les portes verrouillées en essayant de s'enfuir. Mais la compagnie le nie. À part l'escalier qui conduisait au rez-de-chaussée et les fenêtres, les employés n'avaient pas d'autres issues pour sortir facilement de la fabrique. L'étage ne comptait qu'une porte qui donnait sur l'extérieur et celle-ci avait été calfeutrée à l'aide de guenilles pour l'hiver. Pire, cette sortie était à 3 mètres du sol et n'avait pas d'escalier extérieur ! Le 17 mars, on révèle que l'Allumière Canada a souvent été avertie par le Commissaire aux incendies « ...du danger que constitue leur produit, en ce sens que leur degré de combustion dans la composition employée est au-dessous du niveau reconnu. »
L'enquête tourna en queue de poisson et le 4 avril 1933, la construction d'une nouvelle fabrique d'allumettes commença à l'endroit maudit : sur ce même emplacement, une fabrique d’explosifs avait auparavant explosé trois fois en 15 ans !
SourceS :
Documentation personnelle.
Le Droit (Ottawa), 1933.
Le poète hullois Antonio Desjardins
L'Outaouais, et plus particulièrement Gatineau, peut s’enorgueillir d’avoir donné naissance à plusieurs poètes dont la qualité des écrits se compare avantageusement avec ceux des meilleurs poètes canadiens. L’un d’entre eux sort du lot : Antonio Desjardins que les spécialistes du domaine rapprochent du célèbre Émile Nelligan.
Marie Joseph Dollard Antonio Desjardins naît à Gatineau (Hull) le 22 septembre 1894 du mariage de Michel Desjardins, avocat, avec Aglaé Chevrier. Poète, journaliste, littérateur et philosophe, Michel Desjardins transmet ses qualités artistiques à trois de ses cinq enfants, Rosemonde, Rosalba et Antonio. Si les deux filles sont musiciennes (Rosemonde fera une remarquable carrière de cantatrice en Europe), le fils lui est assez éclectique, comme on le verra.
Antonio fait ses études au collège Notre-Dame, à Hull, puis s’inscrit au cours classique et au cours commercial à l’université d’Ottawa en 1910. Il ne semble pas avoir achevé ses études, mais il fait cependant une année de droit à l’université Laval à Montréal en 1914-1915.
Antonio écrit un premier texte en 1914, puis un premier recueil, intitulé Crépuscules, paraît en 1924 à compte d’auteur aux éditions Le Progrès de Hull. Ce n’est pas un succès, car les ventes sont à peu près nulles. Mais cela n’est pas étonnant : non seulement le circuit de distribution de livres est à peu près inexistant, mais la poésie ne fait pas vivre qui que ce soit au Québec. De plus, le recueil est ignoré dans la presse et n’obtient aucune critique. Désabusé, Desjardins cesse d’écrire et se tourne vers la politique. Dans une note que l’auteur André Couture a trouvée, Desjardins a écrit : « Au midi de mes années sur terre De 1925 à 1938 Au fil des mois mon cœur n’écrivit plus de poèmes […] »
Le pain quotidien
Célibataire, Desjardins vit avec ses deux frères, aussi célibataires, Dauray et Eudore. Comme il a choisi de se consacrer à la poésie, il n’aura occupé qu’un seul emploi dans sa vie : celui d’épicier au service de son frère Dauray. L’épicerie Desjardins était située au 274, rue Champlain. Vêtu d’un vieux chandail attaché avec des « épingles à couche » et une crémone[1] autour du cou, Antonio faisait son entrée dans l’épicerie familiale tous les jours. Sa machine à écrire dans un coin, il s’y installait pour taper ses textes entre quelques sucreries vendues à des enfants et de la bière à des adultes. Mal accoutré au travail et chez lui, au 211, rue Laurier, il ne se présentait jamais en public sans être tiré à quatre épingles. Son passe-temps favori était le… bingo !
Antonio Desjardins se lance dans la politique municipale et il est élu conseiller du quartier Laurier pour la première fois le 23 mai 1932. Il sera réélu à nombreuses reprises – c’est-à-dire à tous les deux ans à cette époque – jusqu’à ce qu’il retire le 25 avril 1951. L’homme est humble. Par exemple, lors du 150e anniversaire de l'ancienne ville de Hull, les politiciens en profitent pour « immortaliser » leur nom en nommant des rues en leur… honneur, sauf les conseillers Antonio Desjardins, Léo Labelle et l’homme de théâtre François-Ernest Saint-Jean.
Quand il revient à la poésie, il travaille en secret à son œuvre qui n’a de ressemblance avec rien qui se faisait dans la région ou même à Montréal. Dans la note dont je vous ai parlé plus tôt, il a aussi écrit : « […] Puis en 1939 – Mon cœur recommença à écrire […] Non seulement travaille-t-il encore à sa première œuvre, Crépuscules, mais il écrit aussi une œuvre intitulée Prélude en vers écrit en offrande d’hommage à Walt Whitman génial poète américain du XIXe siècle…. Et quelle œuvre ! Une brique de plus de… 700 pages qu’il traduit lui-même en anglais et qui est publiée pour la première fois en 2008 grâce à l’auteur gatinois André Couture. Un spécialiste de la poésie, André Gaulin, a écrit à propos de l’œuvre de Desjardins, dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec : « Depuis Nelligan, rarement la poésie québécoise aura atteint une telle musicalité, un pareil jeu de la couleur […] »
Pour que vous vous fassiez une toute petite idée de l’œuvre de Desjardins, voici un extrait du poème intitulé Cette nuit-là.
Cette nuit-là
La vieille lune coulait ses ors
Sur les soupirs de votre taille
Se pâmant toute sous mon corps
Les bois sont doux comme les plumes
De mon désir mordant ta bouche
Dans l’encre blanche d’un nid de mousse
Où nos baisers trempent leur plume.
Source :
COUTURE, André, Les doux fantômes d’un grand regret, Gatineau, 2008.
[1] Écharpe de laine.
Les Algonquins de la vallée de l'Outaouais
Quatre mille ans avant notre ère, c’est-à-dire il y a 5 600 ans, donc longtemps avant l’arrivée des Blancs, des humains occupaient déjà le territoire de l’Outaouais. Nous avons appelé leurs descendants Amérindiens.
On trouve des vestiges archéologiques anciens non seulement à Gatineau, mais aussi à Plaisance, à l’île aux Allumettes, aux Rapides-des-Joachims et de nombreux autres endroits. Ces vestiges démontrent une occupation continue de l’Outaouais depuis plus de 5 000 ans. Ces humains des temps anciens pourraient être les ancêtres des six groupes algonquins
Origine du mot algonquin
Quand Jacques Cartier se rend à Hochelaga (Montréal) le 2 octobre 1535, il y trouve des Iroquoiens qui vivent dans un gros village fortifié. Ces Iroquoiens lui disent que sur l’Outaouais, il y a des mauvaises gens « armées jusque sus les doigts ». « Mais c’est Champlain qui est le premier à attribuer le nom d’Algonquins (Algoumekins) à un groupe spécifique d’autochtones rencontré à Tadoussac en 1603. Cependant, ces Amérindiens s’identifient eux-mêmes comme Anishnabeks. On pense que le mot Algoumekin s’agit d’un terme malécite (etchemin) qui signifie « ceux-ci sont nos alliés. »
La nation algonquine de la vallée de l'Outaouais était composée de nombreuses communautés dont les Oueskarinis, dans la Petite Nation, les Onontcharonons (nom que les Hurons leur  donnaient) dans le bassin de la South Nation ; les Kinouchepirinis dans les environs du lac Muskrat ; les Matou8eskarini sur la Madawaka et, à l’île aux Allumettes, les Kichesipiris qui tirent leur nom de Kichesipi ou « grande rivière » ; au nord-ouest des Allumettes de même que sur les rives de la Coulonge et de la Dumoine, ce sont les Kotakoutouemis. On estime cette population algonquine était composée, au XVIIe, d'environ 5 000 personnes.
donnaient) dans le bassin de la South Nation ; les Kinouchepirinis dans les environs du lac Muskrat ; les Matou8eskarini sur la Madawaka et, à l’île aux Allumettes, les Kichesipiris qui tirent leur nom de Kichesipi ou « grande rivière » ; au nord-ouest des Allumettes de même que sur les rives de la Coulonge et de la Dumoine, ce sont les Kotakoutouemis. On estime cette population algonquine était composée, au XVIIe, d'environ 5 000 personnes.
L’unité de base de la nation algonquine était et est encore la famille. Celle-ci, peu nombreuse, comptait en moyenne de quatre à six individus, les femmes allaitant pendant deux à trois ans. La monogamie était la norme, mais la bigamie n’était pas exclue. Les femmes jouissaient d’une grande liberté sexuelle avant le mariage et le divorce était aussi facile à obtenir pour elle que pour les hommes.
Pas d’institution de justice chez les Algonquins ni de prison. C’était à la famille de venger l’affront : on tuait le coupable s’il y avait eu meurtre ou on exigeait de lui ou de sa famille des compensations d’ordre matériel.
Comme les Algonquins dépendaient de la nature, ils la respectaient. Ainsi, pas étonnant qu’ils aient été animistes : ils croyaient que tout ce qui les entourait, ou presque, possédait une âme : l’eau, la terre, les animaux, le tonnerre et même les objets fabriqués. De juin à septembre, les Algonquins se réunissaient au bord de l’eau et vivaient alors de poisson et de gibier ainsi que de petits fruits (bleuets, fraises, etc.) L’hiver, ils se cabanaient dans les bois là où ils savaient qu’il y avait des proies.
Une promesse non respectée
Si les Algonquins ont beaucoup apporté aux Européens en leur permettant de même de survivre au cours des premiers hivers de leur établissement au pays le scorbut, ces derniers leur ont aussi beaucoup donné, même des cadeaux empoisonnés. D’abord et avant tout le chaudron ainsi que nombre de produits manufacturés comme les miroirs et les armes à feu dont ils sont devenus rapidement dépendants. Ensuite, des catastrophes : la religion catholique qui a contribué à la désarticulation systématique des Algonquins de l’Outaouais dès le XVIIe siècle ; et de nombreuses maladies, dont la variole, le choléra, la grippe et la typhoïde. En 1639, une épidémie de variole a fait tellement de ravages que les Algonquins se sont vus forcés d’abandonner aux chiens les corps sans sépulture de leurs propres parents. C’est pendant ces moments de maladie que leurs ennemis, les Iroquois, ont choisi de fondre sur eux. Tessouat, le grand chef des Algonquins de l’île aux Allumettes, sera obligé de se réfugier chez les Français et d'accepter, en échange de leur protection, de se faire baptiser !
L'arrivée de l'homme blanc et les attaques iroquoises ont presque signé la mort des Algonquins de l'Outaouais. La nation algonquine a éclaté et a dû se disperser. Les missionnaires en ont alors profité pour les convertir à la foi catholique. Après la grande paix de 1701, les Algonquins sont revenus en Outaouais et ont fait de la mission des Deux-Montagnes (Oka) leur lieu de rassemblement. Toutefois, ils étaient convaincus que leur droit de propriété sur le territoire outaouais n’avait pas été altéré. En 1763, les autorités britanniques leur ont garanti « la possession entière et paisible des parties qui ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus […] comme territoire de chasse. » En Outaouais, le seul territoire concédé avait été la seigneurie de la Petite Nation.
Les Britanniques n'ont pas respecté leur promesse et dès 1820, les Algonquins dénonçaient en vain le viol de leur espace ancestral parce que les terres outaouaises étaient concédées aux Blancs alors qu'eux-mêmes, confinés dans deux réserves (Maniwaki et Témiscamingue), s'étaient vus définitivement privés de leurs terres.
Sources :
Histoire de l’Outaouais, iqrc,1992.
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, les véritables héroïnes et héros de notre coin de pays ont rarement une rue ou une école à leur nom. Ces distinctions honorifiques sont généralement réservées aux politiciens, aux gens d’affaires et aux vedettes du sport. Je veux aujourd’hui rappeler la mémoire de quelques-unes de ses personnes dont deux sont allés jusqu’au sacrifice suprême. Croyez-le ou non, il est arrivé que l’on rende hommage à la victime sauvée plutôt qu’à ses sauveteurs.
Nous sommes le 22 avril 1896, à la Pointe-Gatineau. La rivière Gatineau déborde sur le chemin qui passe juste devant l’église Saint-François-de-Sales. Ce jour-là, la marquise d’Arberdeen, Ishbel Maria Marjoribanks[1] (1857-1939), épouse du gouverneur général du Canada, sir John Campbell Hamilton Gordon, marquis d’Aberdeen et de Temair, est en visite chez le curé Champagne. En effet, le couple aimait beaucoup à s’entretenir avec Isidore Champagne qui avait la réputation d’être un très bon musicien. Non seulement allait-il visiter le curé à son presbytère, mais le couple l’accueillait aussi à Rideau Hall. Le pieux Lord Aberdeen avait fait installer un nouvel orgue dans sa chapelle privée et avait voulu le faire essayer par le curé Champagne. À cette époque, les orgues n’étaient pas encore munies de souffleur électrique ; il fallait donc actionner le soufflet. On raconte que pendant que le curé Champagne se livrait à sa passion musicale et qu’il se livrait à de nombreuses improvisations, lord Aberdeen actionnait le soufflet. C’est alors que le curé a songé que le gouverneur n’était pas son bedeau. Il a immédiatement de cessé de jouer l’instrument pour trouver le gouverneur tout en transpiration.
Donc, le 22 avril 1896, le marquis et son épouse sortent du presbytère Saint-François-de-Sales pour embarquer dans leur calèche accompagner du capitaine John Sinclair et de leur cocher, les chevaux prennent le mors aux dents et partent à l’épouvante. Trois braves pointes-gatinois s’adonnaient à passer par là au même moment. N’écoutant que leur courage, Charles Carrière, Bénoni Tremblay et Félix Bigras se précipitent sans hésiter à l’aide des victimes qu’ils sauvent de la noyade (les chevaux se sont noyés).
Pour témoigner de sa gratitude, les d’Aberdeen et John Sinclair remettent à la paroisse Saint-François-de-Sales, une cloche de 1 464 livres, fondue à Londres et bénie le 9 mai 18977 en présence des d’Aberdeen, du premier ministre Wilfrid Laurier, de ministres et de 2 000 personnes. La cloche est alors nommée Ishbel en l’honneur de la marquise.
Et, quand il s’est agi de désigner le pont qui enjambe la Gatineau près de l’église, c’est le nom Aberdeen qui a été retenu. Quant aux trois héros du sauvetage du 22 avril 1896, seuls deux livres notent au passage leur rôle de sauveteurs.
Le sacrifice ultime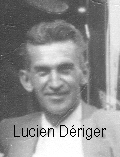
Quel sacrifice que celui de risquer sa vie pour sauver celle de son prochain ! J’ai connaissance de deux héros totalement ignorés dans nos villes. Marie Crevier, en religion sœur Cécile (religieuse de la Providence), travaillait à l’hôpital du Sacré-Cœur (rue Laurier, à Gatineau, là où passe aujourd’hui le pont Cartier Macdonald) quand, le 25 décembre 1928, le feu se déclare dans une chute à linge de l’immeuble. N’écoutant que son courage, elle sauve de l’incendie des bébés de la pouponnière, dont une collègue généalogiste, Jeannette Thibault, et meurt en combattant les flammes. Marie Crevier n’a ni rue ni monument à son nom.
1955. Les maisons de cette ville qu’on appelait Hull et qui comptait au plus 50 000 habitants brûlent. Il y a de nombreux incendies qui font, cette année-là, pas moins de 17 morts ! Pour Lucien Dériger, le destin frappe à sa porte le 17 novembre 1955. Cette nuit-là, une neige mouillée tombe abondamment sur la ville de Hull (aujourd'hui Gatineau). Vers minuit quarante-cinq, le feu éclate au deuxième étage de l’immeuble à logements qui en compte trois[2] et où il est locataire, c’est-à-dire au 124, de la rue Montcalm.
Très rapidement, le feu se propage dans un couloir et gagne le deuxième étage. Un garçonnet de neuf ans, Yvon Bélisle, qui habite au premier étage avec sa mère, ses frères et ses sœurs, se réveille et sent la fumée qui envahit le logis. Il court réveiller sa mère qui se met à chercher le feu. En ouvrant la porte du couloir de l'immeuble, elle voit des flammes. Elle réveille ses filles, dont une est sourde et muette. Au même moment, son fils Prospère arrive à la maison en compagnie d'un ami quand il entend des cris. Il regarde vers les fenêtres du haut de l'immeuble et y voit sa mère et ses deux sœurs. Le restaurateur Eugène Blondin, voisin de l'immeuble en flammes, crie à la famille Bélisle de sauter. La mère saute. Son fils et le restaurateur amortissent sa chute. Puis, les filles sautent à tour de rôle. Mais Yvon ne se montre pas à la fenêtre. Où est-il, se demande Prospère nerveux et inquiet ? Pourquoi ne saute-t-il pas ? Il déclarera plus tard à un journaliste : « De tous les bruits qu'il y avait, je ne peux me souvenir que des hurlements et des cris. C'était terrible. J'en étais malade[3]! »
Lucien Dériger, qui vit au deuxième étage du bâtiment en flammes, tire du sommeil sa femme et lui dit de sortir avec les enfants par la chambre de Robert et court réveiller les occupants de l'immeuble. Il va porter secours à ses voisins. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois peut-être, il entre dans le bâtiment où le feu fait rage pour conduire des enfants, des femmes, des vieillards aux différentes issues d'où ils peuvent sortir ou sauter. La troisième ou quatrième fois, un plafond en flammes s'abat sur lui et le tue net.
Malgré le sacrifice suprême de Lucien Dériger, le bilan de l'incendie est lourd : 5 morts et 8 blessés. Parmi ces morts, le jeune Yvon Bélisle, le garçon qui a alerté sa mère. On le trouve affaissé sur le sol, étouffé par la fumée. Outre Lucien Dériger, les autres victimes sont Antonin Parent, son épouse Monique Côté et leur fille Diane. Ni immeuble, ni rue, ni place ne rappellent le sacrifice de Lucien Dériger !
Détruire une identité qu'ailleurs on cherche
Les débats qui entourent la préservation du patrimoine du quartier du Musée m'ont amené à me poser la question suivante : combien sont-ils ceux qui estiment le patrimoine inutile ? Hélas, ils m'apparaissent trop nombreux, et ce, dans toutes les couches de la société québécoise. Dans les officines du pouvoir économique, on considère bien souvent passé et patrimoine comme choses insignifiantes, et les historiens comme des empêcheurs de tourner en rond. Néanmoins, je brûle d'ajouter mon grain de sel à ce débat, parce que la destruction quasi systématique du passé gatinois met en jeu l'identité de notre ville.
J'estime qu'à trop nier le passé, à en faire disparaître les vestiges, nous rendons peu à peu notre monde inintelligible. À Gatineau, où l’automobile et le béton règnent en maître, de plus en plus de gens se sentent dépourvus d'amarres, un peu à la  dérive du temps qui passe. Le centre-ville administratif a été dilué dans l’ailleurs depuis belle lurette et le soir venu, il devient un néant bitumineux. Il y a plusieurs années, l'architecte néerlandais Aldo Van Eyck avait constaté que plusieurs de nos villes occidentales n'étaient devenues que : « Rien que des milliers de nulle part organisés et personne ne sent plus qu'il est quelqu'un habitant quelque part.[1] » Est-ce cela que nous voulons pour Gatineau ?
dérive du temps qui passe. Le centre-ville administratif a été dilué dans l’ailleurs depuis belle lurette et le soir venu, il devient un néant bitumineux. Il y a plusieurs années, l'architecte néerlandais Aldo Van Eyck avait constaté que plusieurs de nos villes occidentales n'étaient devenues que : « Rien que des milliers de nulle part organisés et personne ne sent plus qu'il est quelqu'un habitant quelque part.[1] » Est-ce cela que nous voulons pour Gatineau ?
Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, on cherche de plus en plus son identité, ses racines dans les témoignages du passé. Des villes ont même reconstruit en partie leur patrimoine à la suite des destructions engendrées par les guerres (ex. : Varsovie), par des séismes (ex. Népal) ou par une mauvaise conception du progrès (ex. :Singapour). Pourquoi ? Parce que les dirigeants politiques tout comme les citoyens de ces villes ont compris que le patrimoine architectural constitue l'âme et l'individualité qui manquent tant aux villes neuves. Pour cette raison, le patrimoine architectural représente une partie importante de l'écosystème de la personne humaine d'aujourd'hui et sa sauvegarde prend un intérêt tout nouveau et devient capitale[2].
Comme beaucoup de citoyens, je crains que les lobbies de la promotion immobilière, avides de profits, ne fassent disparaître définitivement les traces des citadins qui nous ont précédés. Le patrimoine architectural du quartier du Musée est un héritage culturel que nous a transmis le passé et il constitue une partie essentielle de la mémoire des citoyens d'aujourd'hui. À  mon avis, il serait étonnant qu'une société sans mémoire ait de l'avenir, car si elle devient semblable à la personne atteinte par l'Alzheimer, elle finira elle aussi par perdre son identité.
mon avis, il serait étonnant qu'une société sans mémoire ait de l'avenir, car si elle devient semblable à la personne atteinte par l'Alzheimer, elle finira elle aussi par perdre son identité.
Enfin, il me semble que la disparition du patrimoine architectural du quartier du Musée ne peut se faire qu'en contradiction avec la logique la plus élémentaire. En effet, comment pouvons-nous nous enorgueillir d'avoir, dans notre ville, le Musée de l'histoire canadienne si nous sommes incapables de protéger notre patrimoine qui, plus est, se situe juste en face du fameux musée fédéral ? Comme le maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, l'a si bien dit : « [le patrimoine] c'est ce qui enrichit les villes, qui met notre différence en valeur ».
[1] « Comment on a tué la ville », dans L'Événement du jeudi, no 482, 27 janvier au 2 février 1994, p. 81.
[2] Site internet www.icomos.org/monumentum/vol15-16/vol15-16_4.pdf
Il était une fois l'industrie forestière outaouaise
Pendant une centaine d'années, la population outaouaise a principalement vécu de l'exploitation de la forêt de la Gatineau, de la Petite Nation et du Pontiac. En effet, la forêt outaouaise a consisté en majeure partie de grands pins blancs et de chênes qui, une fois équarris, étaient exportés en Europe où ils ont été employés, de 1806 à 1840, à maintenir l'hégémonie des flottes commerciales et militaires de l'Empire britannique. Puis, ces arbres, de même que d'autres essences, ont été découpés en planches et exportés principalement vers les États-Unis. C'est cette industrie qui a véritablement donné naissance à nombre de municipalités outaouaises dont Gatineau, l'ancienne ville de Hull et Maniwaki.
 C'est Philemon Wright qui, le premier, expédie à Québec, par la rivière des Outaouais depuis l'embouchure de la rivière Gatineau, le premier train de bois équarri le 11 juin 1806 ; il le nomme Columbo. Il est composé de 50 cages qui forment un train ; les gens qui pilotent ces trains sont alors désignés sous le nom de raftsmen, c'est-à-dire cageux. Une chanson, la préférée de mon grand-père maternel, a immortalisé ces hommes intrépides :
C'est Philemon Wright qui, le premier, expédie à Québec, par la rivière des Outaouais depuis l'embouchure de la rivière Gatineau, le premier train de bois équarri le 11 juin 1806 ; il le nomme Columbo. Il est composé de 50 cages qui forment un train ; les gens qui pilotent ces trains sont alors désignés sous le nom de raftsmen, c'est-à-dire cageux. Une chanson, la préférée de mon grand-père maternel, a immortalisé ces hommes intrépides :
Là ousqu'y sont, tous les raftsmen ?
Là ousqu'y sont, tous les raftsmen ?
Dans les chanquiers y sont montés.
Bing sur la ring ! Bang sur la rang !
Laissez passer les raftsmen
Bing sur la ring ! Bing, bang !
Et par Bytown y sont passés
Et par Bytown y sont passés
Avec leurs provisions achetées [...]
Les trains de bois vogueront sur l'Outaouais jusqu'en 1908. Toutefois, la J.R. Booth les ressuscitera provisoirement en 1925 et 1930 pour expédier en Grande-Bretagne le bois nécessaire à la construction des ponts des navires de guerre britannique.
Les Chaudières
Dès les années 1850, le site des chutes des Chaudières, à cheval sur la frontière Québec-Ontario, se voient occupés par plusieurs scieries – il y en aura jusqu'à 7 à la fois – qui comptent, en 1871, 1 200 scies activées par la seule force hydraulique. À l'usine d'allumettes de la E.B. Eddy, on fabriquait plus de 3 700 allumettes à la minute en 1869. Onze années plus tard, les scieries des Chaudières emploient environ 5 000 travailleurs et un millier de plus en 1888. On y scie alors pas moins 90 millions de mètres linéaires de planches et fabrique aussi des allumettes, des douves, des planches à laver, des portes, des sceaux, etc. Les Chaudières sont alors le complexe industriel le plus important au Canada. En 1901, l'Outaouais façonne aussi d'autres produits dérivés du bois dont 414 877 traverses de chemin de fer, 296 444 cordes de bois et 125 922 poteaux.
Pour fournir cette industrie en bois, plus de 8 000 personnes travaillaient dans les chantiers forestiers de l'Outaouais l'hiver et, au printemps, 3 500 draveurs assuraient le flottage et le transport des billes de bois sur les rivières (le flottage du bois disparaît en 1992-1993). Métier dangereux que celui de ces hommes : en 1845, la drave a entraîné la mort de plus de 80 draveurs, et en 1846 celle d'une cinquantaine d'entre eux soit par écrasement, noyade où à la suite d'une explosion. En effet, la plupart des draveurs ne savent pas nager et, pour défaire les plus gros embâcles de billes, il leur faut employer des explosifs dont les effets ne sont pas toujours prévisibles. Ces embâcles pouvaient être impressionnants. Par exemple, au printemps 1900, sur la rivière Gatineau, à la hauteur de Cascades, un embâcle de 500 000 billes s'était formé sur une distance d'environ 800 mètres et avait atteint, par endroit, près de 10 mètres de hauteur !
Des employés et des forêts surexploités
La vie dans les grandes scieries n'était pas des plus faciles et les employeurs ne respectaient guère leurs employés. À la seule E.B. Eddy, il y a eu pas moins de 562 accidents mortels de 1858 à 1888 dont certains concernent des enfants de moins de 14 ans ! Et que dire des allumettières et de leurs collègues masculins qui se voyaient aux prises avec la nécrose maxillaire (genre de mangeuse de chair) causée par le phosphore blanc qui ne sera interdit qu'en 1913 ?
Non seulement les employés – ils travaillent de 12 à 15 heures par jour pour un maigre salaire – étaient exploités par les industriels, mais ces derniers volaient aussi le gouvernement québécois, c'est-à-dire le contribuable. Par exemple, en 1888, un inspecteur s'était rendu compte qu'aux scieries Eddy on coupait plus de bois que l'industriel déclarait en avoir récolté sur les terres publiques, fraudant ainsi la province de milliers de dollars. Ruggles Wright, pourtant juge de paix, faisait la même chose dans les années 1840.
maigre salaire – étaient exploités par les industriels, mais ces derniers volaient aussi le gouvernement québécois, c'est-à-dire le contribuable. Par exemple, en 1888, un inspecteur s'était rendu compte qu'aux scieries Eddy on coupait plus de bois que l'industriel déclarait en avoir récolté sur les terres publiques, fraudant ainsi la province de milliers de dollars. Ruggles Wright, pourtant juge de paix, faisait la même chose dans les années 1840.
La forêt outaouaise a été surexploitée et, dès le début du XXe siècle, la production de planches s'est mise à rapidement baisser parce que les réserves de bois de bonne qualité étaient pratiquement épuisées. Ezra Butler Eddy avait prévu le coup, car des 1889, il a commencé à transformer ses scieries pour produire du papier.
Aujourd'hui, il ne reste plus de scierie à Gatineau et seulement quelques unes dans le reste de l'Outaouais. Mais il y a toujours deux papetières à Gatineau qui emploient moins de 500 personnes. Des grands barons du bois des Chaudières, qui faisaient la pluie et le beau temps en Outaouais, il n y a que leur nom qui, à Gatineau, identifie des rues : Booth, Eddy, Leamy, McLaren...
Sources
Histoire forestière de l'Outaouais, site Internet http://www.histoireforestiereoutaouais.ca/d3/ consulté le 29 mai 2017.
LAPOINTE, Pierre-Louis, L'homme et la forêt, Québec, Les éditions Gid, 2015.
LEE, David, Lumber Kings & Shantymen, Toronto, James Lorimer and Company Ltd., Publishers, 2006.
LES EXPÉDITIONS MILITAIRES FRANÇAISES
Un grand danger guettait les voyageurs qui naviguaient sur l’Outaouais : l’Iroquois qui détruit la Huronie en 1648-1649 et qui est en guerre avec les Français et leurs alliés. Pour échapper au massacre, 400 Hurons s’exilent à l’île d’Orléans, en 1649, par le chemin de l’Outaouais. La magnifique chute des Chaudières est devenue un lieu de tragédies. En 1642, une Algonquine, dont l’Histoire n’a malheureusement pas retenu le nom, est faite prisonnière par des Iroquois qui dévorent ses enfants. Désespérée, elle se jette dans le tourbillon de la chute d’où les guerriers ennemis la retirent pour la tuer de leurs mains.
Une embuscade
En 1661, les célèbres aventuriers Médard Chouart des Groseillers et Pierre-Esprit Radisson,  ainsi que leurs alliés algonquins, tombent dans une embuscade qui leur est tendue près de l’actuel pont Interprovincial, à Hull. Les deux hommes étaient alors en route pour le lac Supérieur. Le voyage s’était poursuivi sans incident jusqu’aux Chaudières quand, à la tête du premier portage, l’avant-garde de l’expédition est accueillie par des coups de fusil et par des cris. Radisson écrit, plus tard : « Un canot va d’un côté, un autre va de l’autre. Quelques hommes atterrissent et courent de tous côtés. C’est la confusion générale. » La troupe se ressaisit rapidement et réussit à mettre pied sur la terre ferme. Elle construit, en moins de deux heures, un petit fortin avec des arbres abattus en toute hâte.
ainsi que leurs alliés algonquins, tombent dans une embuscade qui leur est tendue près de l’actuel pont Interprovincial, à Hull. Les deux hommes étaient alors en route pour le lac Supérieur. Le voyage s’était poursuivi sans incident jusqu’aux Chaudières quand, à la tête du premier portage, l’avant-garde de l’expédition est accueillie par des coups de fusil et par des cris. Radisson écrit, plus tard : « Un canot va d’un côté, un autre va de l’autre. Quelques hommes atterrissent et courent de tous côtés. C’est la confusion générale. » La troupe se ressaisit rapidement et réussit à mettre pied sur la terre ferme. Elle construit, en moins de deux heures, un petit fortin avec des arbres abattus en toute hâte.
Les Iroquois observent les Français et les Algonquins tapis dans leur réduit. Ils capturent un Algonquin téméraire qu’ils rôtissent pour ensuite le manger. À la faveur de la nuit, des Groseillers, Radisson et leurs alliés algonquins réussissent à s’échapper de leur fortin à la barbe des Iroquois.
À la conquête de la baie d’Hudson
Des convois de fourrures, des expéditions militaires amérindiennes et françaises sillonnent régulièrement la rivière des Outaouais. L’une des plus spectaculaires expéditions du XVIIe siècle à franchir les Chaudières est celle du chevalier de Troyes. En 1685, des marchands anglais, dirigés par le traître Radisson, s’établissent à la baie d’Hudson où ils construisent un certain nombre de forts. Le gouverneur de la Nouvelle-France, le marquis de Denonville, décide d’expulser les Anglais de la baie et confie le commandement de l’expédition au chevalier Pierre de Troyes. La troupe, composée de 30 soldats des troupes de la Marine et de 70 miliciens, quitte Montréal le 30 mars 1686. Ses officiers sont Canadiens : le premier lieutenant est Jacques Lemoyne de Sainte-Hélène et le second, le fameux Pierre Lemoyne d’Iberville. Les deux frères ont amené avec eux leur frère cadet, Paul, sieur de Maricourt. De Troyes raconte que le 19 avril « ...nous décampames de fort bonheur pour aller à un lieu nommé la chaudière [...] Nous passames la rivière du lièvre [...] et nous fumes camper à deux lieues plus haut (rivière la Blanche) où tous les canots à cinq ou à six nous vinrent joindre le lendemain. »
 Le 21 avril, l’expédition s’arrête au pied de la chute des Chaudières où le père Silvy y dit la messe. La troupe ne se remet en branle que le surlendemain. Elle franchit la chute de la Grande-Chaudière, les rapides de la Petite-Chaudière puis les rapides des Chesnes. Le 24 avril, elle atteint le portage des Chats (Quyon). Enfin, le 19 juin, après avoir effectué plus d’une centaine de portages, l’expédition arrive à la baie James qu’elle reconquiert de brillante façon.
Le 21 avril, l’expédition s’arrête au pied de la chute des Chaudières où le père Silvy y dit la messe. La troupe ne se remet en branle que le surlendemain. Elle franchit la chute de la Grande-Chaudière, les rapides de la Petite-Chaudière puis les rapides des Chesnes. Le 24 avril, elle atteint le portage des Chats (Quyon). Enfin, le 19 juin, après avoir effectué plus d’une centaine de portages, l’expédition arrive à la baie James qu’elle reconquiert de brillante façon.
Les dernières expéditions
Quatre ans après l’expédition militaire du chevalier de Troyes, une autre expédition prend le chemin de l’Outaouais pour porter secours au poste de Michillimakinac, menacé par les Iroquois. Le comte de Frontenac, alors gouverneur de la Nouvelle-France, décide d’y faire parvenir du secours. Il y dépêche le sieur de Louvigny, avec une troupe de 113 hommes, qui quitte Montréal le 22 mai 1690. Le 2 juin, la troupe fait halte à 3 lieues au-dessus des Chats (Quyon). On aperçoit deux canots iroquois au bout d’une pointe. Louvigny décide d’envoyer à leur rencontre une trentaine d’hommes montés dans 3 canots et une soixantaine d’hommes par voie de terre pour prendre l’ennemi à revers. Devant le feu nourri des Iroquois, la flottille n’a d’autre choix que celui de se retirer après avoir perdu 4 hommes. Pendant ce temps, l’expédition terrestre donne en plein dans une embuscade. Le choc est brutal, le combat sanglant. Après avoir tué une trentaine d’ennemis, les Français retraitent dans leurs canots en amenant avec eux 4 prisonniers dont un sera mangé par les Hurons et les Outaouais. Enfin, l’expédition atteint Michillimakinac sans autres difficultés.
En juin 1728, une grande expédition militaire française traverse notre région pour la dernière fois. Elle compte pas moins de 400 soldats et miliciens, de même que 700 à 800 Amérindiens. Commandée par le major de Ligneris, elle se rend en Indiana pour y soumettre les Amérindiens de la nation des Renards.
AU TEMPS DES PREMIERS EXPLORATEURS FRANÇAIS
La rivière des Outaouais est sans doute l’un des plus beaux cours d’eau de l’est du Canada. Depuis sa source, à l’est du réservoir Dozois, jusqu’au lac des Deux-Montagnes, la rivière parcourt pas moins de 1 130 kilomètres. Au XVIIe siècle, les Français ont emprunté la rivière pour explorer l’Amérique du Nord de la baie d’Hudson au golfe du Mexique, de Montréal jusqu’aux contreforts des montagnes Rocheuses, et ainsi changer l’histoire du continent. Les explorateurs les plus célèbres de l’histoire de la Nouvelle-France ont voyagé sur l’Outaouais et fréquenté les rives de nos parages, dans de frêles canots d’écorces à la recherche de fourrures, d’or et même de la route de la Chine.
Les premiers Français qui sillonnent l’Outaouais sont loin de se douter que les Amérindiens en occupent le bassin hydrographique depuis au moins 6 000 ans. Samuel de Champlain a appelé le peuple qui habite l’Outaouais du XVIIe siècle et toute la rive nord du Saint-Laurent, Algoumequins (Algonquins), peuple qui s’identifiait lui-même par le nom Anishnabek, qui signifie « les vrais hommes » ! En Outaouais, trois tribus composaient ce peuple nomade : les Oueskarinis, ou Petite nation, les Kichesipirinis et les Kotakoutouemis.
Les Chaudières
Le Français Étienne Brûlé est, sans aucun doute, le premier Européen à remonter une bonne partie du cours de l’Outaouais, en 1610, et à franchir les chutes des Chaudières (à Hull). L’année suivante, il est suivi par l’interprète Nicolas du Vignau qui passera l’hiver à l’île aux Allumettes, 150 kilomètres en amont des chutes. Mais c’est Samuel de Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France qui, le premier, laisse un témoignage écrit de son périple sur l’Outaouais et une description de la chute des Chaudières, alors qu’il se rend jusqu’aux Allumettes en 1613. Dans son récit de voyage, il écrit :
« ...nous passâmes un saut [...] large de demie lieue et qui descend de six à sept brasses de haut [...] L’eau tombe en un endroit de telle impétuosité sur un rocher qu’il s’y est cavé par succession de temps un large et profond bassin : si bien que l’eau courant là-dedans circulairement et au milieu y faisant de gros bouillons, a fait que les sauvages l’appellent Asticou, ce qui veut dire chaudière. Cette chute d’eau mène un tel bruit dans ce bassin que l’on l’entend à plus de deux lieues [...] »
Après le passage de Champlain aux Chaudières, des centaines d’aventuriers, d’explorateurs et de missionnaires français remontent le cours de l’Outaouais pour y chercher des fourrures, découvrir l’immense territoire américain et évangéliser les Amérindiens. En 1615, le récollet Joseph le Caron, dit la première messe, célébrée dans le diocèse de Gatineau-Hull, au pied des chutes des Chaudières. Mais bien avant le Caron, les Amérindiens y tiennent des cérémonies à caractère religieux. À leur arrivée au pied des Chaudières, les Amérindiens faisaient la quête de pétun (tabac) parmi les leurs. Puis, il le plaçait sur un plat de bois autour duquel tous chantaient et dansaient. Après avoir harangué les siens, un chef prenait le plat et jetait son contenu au milieu du tourbillon du « Trou du diable » pour obtenir des faveurs et la protection des esprits qui y habitent.
d’explorateurs et de missionnaires français remontent le cours de l’Outaouais pour y chercher des fourrures, découvrir l’immense territoire américain et évangéliser les Amérindiens. En 1615, le récollet Joseph le Caron, dit la première messe, célébrée dans le diocèse de Gatineau-Hull, au pied des chutes des Chaudières. Mais bien avant le Caron, les Amérindiens y tiennent des cérémonies à caractère religieux. À leur arrivée au pied des Chaudières, les Amérindiens faisaient la quête de pétun (tabac) parmi les leurs. Puis, il le plaçait sur un plat de bois autour duquel tous chantaient et dansaient. Après avoir harangué les siens, un chef prenait le plat et jetait son contenu au milieu du tourbillon du « Trou du diable » pour obtenir des faveurs et la protection des esprits qui y habitent.
Des chutes splendides
Plus d’un personnage s’émerveille devant la splendeur des chutes des Chaudières dont le nom français est la traduction des mots Algonquins Asticou et Hurons Anoò ; les Iroquois l’appelaient Tsitkanajoh, c’est-à-dire « chaudière flottante ». Le frère récollet, Gabriel Sagard, qui franchit la chute pour la deuxième fois, en 1624, s’extasie :
« ...le saut de la Chaudière, que nous allons présentement trouver, le plus admirable, le plus dangereux et le plus épouvantable de tous : car il est large de plus d’un grand quart de lieue et demie [...] l’eau tombe de telle impétuosité sur un rocher au milieu de la rivière, qu’il s’y est causé un large et profond bassin : si bien que l’eau courant là dedans circulairement, y fait de très puissants bouillons qui produisent des grandes fumées de poudrin de l’eau qui s’élèvent en l’air. [...] Cette chute d’eau mène un tel bruit dans ce bassin qu’on l’entend plus de deux lieues. »
 Ce n’est pas facile de voyager sur l’Outaouais aux eaux entrecoupées de nombreuses chutes et de rapides. Pour remonter son cours jusqu’au lac Témiscamingue, il faut affronter plus d’une vingtaine de portages, et pour atteindre le lac Supérieur, plus d’une cinquantaine, sans compter les nuées de moustiques. Ces portages, qui se font le plus souvent à travers bois, nécessitent des efforts exténuants. Non seulement les portageurs doivent-ils transporter les canots à bout de bras pour franchir et contourner les obstacles, mais aussi de nombreuses marchandises, c’est-à-dire deux à trois sacs par personne et pesant environ 41 kg chacun. (À suivre...)
Ce n’est pas facile de voyager sur l’Outaouais aux eaux entrecoupées de nombreuses chutes et de rapides. Pour remonter son cours jusqu’au lac Témiscamingue, il faut affronter plus d’une vingtaine de portages, et pour atteindre le lac Supérieur, plus d’une cinquantaine, sans compter les nuées de moustiques. Ces portages, qui se font le plus souvent à travers bois, nécessitent des efforts exténuants. Non seulement les portageurs doivent-ils transporter les canots à bout de bras pour franchir et contourner les obstacles, mais aussi de nombreuses marchandises, c’est-à-dire deux à trois sacs par personne et pesant environ 41 kg chacun. (À suivre...)
Préserver le patrimoine gatinois
Au Québec, et plus particulièrement à Gatineau, il semble que nous ayons oublié que le monde existait bien avant la « Révolution tranquille » et la télévision. Au nom de la liberté, les générations de l'après-guerre ont fait sauter les valeurs traditionnelles et elles ne laissent aucun cadre de vie à ceux qui les survivront. « Depuis que le monde est monde, les fils se veulent différents des pères. Mais rarement aura-t-on vu, dans l’Histoire, une jeunesse (génération) en si grande rupture avec ses aînés et vice-versa. La faille culturelle donne le vertige : césure brutale d'une tradition par l'anémie des hiérarchies parentales, scolaires, civiques, et qui fait que la jeunesse ne trouve plus même à quoi désobéir...»
Il est urgent de protéger notre patrimoine. Mais qu'est-il ? La Ville de Gatineau définit le patrimoine comme suit : L'ensemble des éléments, culturels ou naturels, matériels ou immatériels, possédant une valeur de mémoire, reconnus en tant que témoins du passé, de la culture et de l'identité d'une communauté et qui, appropriés et transmis collectivement, méritent d'être protégés, conservés et mis en valeur.
Pourquoi protéger ce patrimoine ? Parce que sans patrimoine, le monde serait privé de son passé, c'est-à-dire de son histoire, de sa mémoire. Or, l'histoire est utile à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Depuis des millénaires, des femmes et des hommes se sont efforcés à améliorer leur sort et de laisser à leurs enfants un monde plus hospitalier. Ainsi, l'histoire nous permet-elle d'apprendre de leurs expériences, d'éviter leurs erreurs et de poursuivre leurs efforts pour laisser à celles et ceux qui nous suivront un monde meilleur.
Pour paraphraser l’écrivain canadien, John Saul, je dirais qu'à Gatineau « Nous avons une élite qui s’est édifiée sur – et aux dépens de – la mort de la mémoire. Pas seulement la mémoire du passé lointain. Celle du passé récent aussi [...] Le  souvenir et l’avenir font partie d’un réseau indissociable qui nous aide à nous rappeler précisément les fondements sur lesquels s’est édifiée notre civilisation et partant, à orienter nos actions de manière à satisfaire nos besoins et à servir nos intérêts. « Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, disait le philosophe espagnol George Santayana, sont condamnés à la revivre. » Par ailleurs, les patrimoines architecturaux, artistiques ou techniques servent à découvrir le savoir-faire des hommes du passé pour s'en inspirer.
souvenir et l’avenir font partie d’un réseau indissociable qui nous aide à nous rappeler précisément les fondements sur lesquels s’est édifiée notre civilisation et partant, à orienter nos actions de manière à satisfaire nos besoins et à servir nos intérêts. « Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, disait le philosophe espagnol George Santayana, sont condamnés à la revivre. » Par ailleurs, les patrimoines architecturaux, artistiques ou techniques servent à découvrir le savoir-faire des hommes du passé pour s'en inspirer.
Jamais le genre humain n’a eu des moyens de communication aussi puissants que ceux dont il dispose aujourd’hui. Mais ces moyens ne visent qu’un but : celui de faire consommer.
Individualisme et consommation
Notre monde devient de plus en plus inintelligible. Autrefois, les parents avaient de nombreux enfants, aujourd’hui, ce sont les enfants qui ont de nombreux parents et grands-parents. Certains gamins ne savent même pas ce qu’est un grand-oncle. Ils connaissent parfois un ou deux cousins germains ? « Mais c'est quoi un grand oncle ? » m’a un jour demandé un jeune... adulte !
L’individualisme actuel est un conditionnement mis de l’avant, entretenu et exploité par les grandes entreprises transnationales qui cherchent à isoler les gens pour pouvoir mieux les contrôler, les dominer et, surtout, les faire consommer. Ce qui a pour effet d’engendrer une solitude qui mène parfois au suicide.
Le patrimoine, l'histoire et les archives se veulent des instruments de culture qui contribuent à la préservation de la mémoire collective et de notre identité régionale. Et dans un monde où la vie communautaire est en régression, cette mémoire prend encore plus d’importance, car c’est une forme de thérapie contre l’anonymat des grandes villes et la perte des liens familiaux, un refus de la dépersonnalisation.
Disons tout de suite qu'il n'y a pas de petite et de grande l'histoire ni de petits et de grands patrimoines. Il y a l'histoire, il y a le patrimoine, c'est tout. Selon le professeur de cégep Pierre Corbeil, l'histoire c'est : « ...la perpétuelle reconstruction d'une illusion nécessaire, celle de la continuité de la réalité à travers les générations. C'est la lutte pour préserver l'équilibre mental de tout un univers. [...] C'est la frontière entre l'être et le néant. » Aussi, perdre notre patrimoine, qu'il soit architectural, archivistique ou culturel, c'est perdre une partie de notre identité, une partie de notre différence, c'est sombrer dans l'Alzheimer social.
Aussi, perdre notre patrimoine, qu'il soit architectural, archivistique ou culturel, c'est perdre une partie de notre identité, une partie de notre différence, c'est sombrer dans l'Alzheimer social.
La recherche de l'identité, d'un sentiment d'appartenance à un groupe, à une culture, passe par la connaissance du passé sur laquelle brode l'imaginaire. Les sociétés et les individus prennent de plus en plus conscience de vivre, de passer, dans le temps, et tous les témoignages de leur passé sont pour eux des repères indispensables. Ainsi le patrimoine peut-il faire comprendre aux immigrants comment la société d'accueil s'est organisée pour survivre, avec son génie et son courage. Elle a résolu les problèmes qui se sont posés dans le temps et dans l'espace, concernant le milieu naturel, les possibilités techniques et la société globale.
Comment préserver ce patrimoine
Comment préserver notre patrimoine ? Dans un premier temps, il faut pouvoir l'identifier pour ensuite le faire connaître. Par la suite, il faut sensibiliser les Gatinois à l'importance de sa protection, puis le promouvoir, le valoriser et le sauvegarder en étant créatif (transformation de l'usage), par exemple en développant un guide du patrimoine et de rénovation de qualité à l'usage des propriétaires, en créant un musée régional d'histoire, etc. Enfin, il faut instaurer des politiques et des cadres juridiques, mettre eu œuvre des aides financières et reconnaître les efforts de celles et ceux qui le protègent.
Il y a quand même des choses qui se font à Gatineau. La Ville s'est dotée d'une politique culturelle qui comprend une politique du patrimoine. Elle appuie divers organismes qui font la promotion du patrimoine comme des musées, sociétés d'histoire, la revue Hier encore, etc. Mais peu de bâtiments sont protégés. Il reste donc beaucoup à faire dans ce domaine. Enfin, sachons que la préservation du patrimoine est l'affaire de tous.
Sources :
L'Actualité, 1er mai 1994, page 5, éditorial pris de la revue française « Le Point ».
L'Agora, « Le seul texte d'histoire que vous aurez jamais à lire », vol. 1, no 4, décembre 1993-janvier 1994, page 8.
Conserver le patrimoine pourquoi ?, Site Internet consulté le 17 novembre 2016 à l'adresse suivante : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/28Npatrimoine.pdf
SAUL, John, Les bâtards de Voltaire, éd. Payot & Rivages, coll. Essai, Paris, 1993, p. 478.
C’est au cimetière que l’on se rend compte que la vie a une fin et que personne n’échappe à la mort. En dépit de son caractère définitif, il y a beaucoup à voir dans une nécropole, et même de très belles choses. Dans les cimetières reposent toutes les peines, tous les espoirs et toutes les vanités du genre humain ; l’homme y perpétue l’image qu’il se fait de lui. Fidèle reflet de nos villes, le cimetière immortalise l’individu, mais aussi sa classe sociale et parfois son appartenance ethnique. On trouve là des stèles de toutes les époques de notre histoire locale, des pierres qui marquent les lieux de sépulture d’illustres personnages d’autrefois, des croix de fer si rouillées qu’on n’y distingue plus les noms qui y ont été gravés jadis et, bien souvent, une fosse commune où on y ensevelit les sans-le-sou, les plus humbles de notre société où les pendus, et les individus non identifiés.
Longtemps, les morts ont été inhumés dans un cimetière qui était situé tout autour de l’église. À cause de la communion qui unit tous les fidèles, l’Église désirait que les morts demeurent près des vivants. Les « meilleures places » étaient celles qui entouraient le mur de l’église, car elles « reçoivent la pluie du ciel qui a dégouliné sur le toit d’un édifice béni… »
On a aussi inhumé dans les églises. La tradition veut que les plus pieux (ou les plus… riches ou encore les plus puissants…) soient enterrés le plus près possible du chœur et ainsi de suite par cercles concentriques jusqu’aux limites du cimetière. Dans la région, on trouve dans la cathédrale Notre-Dame, à Ottawa, les tombes des évêques et archevêques.
Le silence de la mort n’a pas toujours été le principal attribut des cimetières.  Adjacents aux églises, les cimetières avaient, au moyen-âge, un droit de franchise et d’immunité. Ainsi, plus d’un délinquant y vivait de longues années pour échapper au châtiment des autorités (voir à ce sujet La Chambre des dames de Jeanne Bourrin) en vaquant à leurs activités de travail ou de loisirs. Les proscrits y tenaient donc des échoppes ; des foires et même des marchés saisonniers s’y tenaient épisodiquement.
Adjacents aux églises, les cimetières avaient, au moyen-âge, un droit de franchise et d’immunité. Ainsi, plus d’un délinquant y vivait de longues années pour échapper au châtiment des autorités (voir à ce sujet La Chambre des dames de Jeanne Bourrin) en vaquant à leurs activités de travail ou de loisirs. Les proscrits y tenaient donc des échoppes ; des foires et même des marchés saisonniers s’y tenaient épisodiquement.
Nos cimetières regorgent d’art et d’histoire et pourtant nous les visitons si peu. Dans celui de Montebello, le calvaire est l’œuvre du réputé sculpteur sur bois Louis Jobin (1845-1928) dont l’atelier était situé à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le Calvaire est composé de trois personnages : un Christ en croix, la Vierge et Marie-Madeleine. Jobin a aussi sculpté une sainte Anne en compagnie de sa fille Marie.
On trouve encore dans nos cimetières le souvenir de nombreux personnages de notre histoire. Ainsi, dans le cimetière de St. James, boulevard Taché, à Hull, se dresse fièrement, dans un enclos borné par des clôtures de fer, un obélisque de granit rose qui indique le lieu de sépulture des fondateurs de Hull, Philemon Wright, et son épouse, Abigail Wyman. L’obélisque est entouré de monuments plus petits qui marquent les tombes de ses nombreux descendants. Une vieille pierre nous rappelle la mémoire du matelot, Reuben Traveller, qui a participé à la fameuse bataille navale de Trafalgar, en 1805, quand l'amiral Nelson a vaincu la flotte de Napoléon. L’escalier de pierre qui mène à la sépulture de la famille William Francis Scott, ancien maire de Hull, est envahi par des pousses d’arbres et d’arbustes. Plus ou moins bien entretenu, St. James ressemble de plus en plus à un décor pour films d’horreur.
Boulevard Fournier, à Hull, se trouve le cimetière Notre-Dame d’une superficie de 13 hectares ; malheureusement, il manque d’arbres comme plusieurs autres cimetières de l’Outaouais. On a commencé à y enterrer les morts en 1872 et de 1886 aux années 1930, on y aurait recueilli plus de 45 000 dépouilles ! Le portail d’entrée en pierre taillée a été construit en 1902 d’après les plans de l’architecte hullois, Charles Brodeur. Il est surmonté d’une statue de l’Ange de la mort sonnant la trompette du jugement dernier. Fabriquée en cuivre martelé, la statue a été réalisée par le fameux sculpteur montréalais Arthur Vincent, (1852-1903) dont c’est la dernière œuvre d’importance.
Pas aussi lugubre que l'on pense
De nombreuses personnalités sont inhumées au cimetière Notre-Dame de Hull. Parmi celles de stature nationale, notons la comédienne, auteure et critique Laurette Larocque, mieux connue sous le nom de Jean Despréz (1906-1965), et le fondateur du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), Marcel Chaput (1918-1991). Parmi les personnalités locales, notons le père Louis-Étienne Reboul (1827-1877), fondateur de la paroisse de Hull ; l’acteur et metteur en scène René Provost (1903-1966), père du comédien Guy Provost ; la pianiste et poétesse Clara Lanctôt (1886-1958) ; l’allumettière Donalda Charron (1886-1967) qui a dirigé la fameuse grève des « faiseuses d’allumettes » de la E.B. Eddy en 1924 ; Marcelline Dumais (1850-1916), propriétaire de la maison où a commencé le Grand feu de Hull en 1900, le peintre Jean Alie (1925-1997), etc.
 Chacun des cimetières de la région a ses particularités et ses célébrités. À Aylmer, le cimetière Saint-Paul est un véritable jardin public de 4,5 hectares. Créé en 1840, il invite les promeneurs à retrouver l’ancienne coutume de visiter ses morts. Dans le cimetière catholique de Buckingham, se trouve la tombe de deux syndicalistes assassinés le 8 octobre 1906 par les sbires de la MacLaren : Thomas Bélanger et François Thériault. À Bryson (Pontiac), une pierre noire en forme de deux cœurs enlacés rappelle le souvenir de la famille... Jolicoeur !
Chacun des cimetières de la région a ses particularités et ses célébrités. À Aylmer, le cimetière Saint-Paul est un véritable jardin public de 4,5 hectares. Créé en 1840, il invite les promeneurs à retrouver l’ancienne coutume de visiter ses morts. Dans le cimetière catholique de Buckingham, se trouve la tombe de deux syndicalistes assassinés le 8 octobre 1906 par les sbires de la MacLaren : Thomas Bélanger et François Thériault. À Bryson (Pontiac), une pierre noire en forme de deux cœurs enlacés rappelle le souvenir de la famille... Jolicoeur !
Il n’y a pas que les grands cimetières, il y en a aussi des petits : dans le West Templeton Cemetery, chemin du rang 3 (sur le bord de l’autoroute 50), reposent les restes de quelques familles d’origine écossaise et plus particulièrement la famille Kerr. Route 148, près du Cheval blanc, se trouve un cimetière privé où sont inhumés les membres de la famille Dunning. Et rue de l’Épée, à Gatineau, on trouve un tout petit cimetière dans lequel il y a les tombes, des familles Barber, Davidson et Langford.
Il y a aussi en Outaouais une chapelle funéraire privée, celle des Papineau. Construite en 1855 à Montebello, on y a inhumé non seulement le patriote Louis-Joseph Papineau et plusieurs de ses enfants, mais aussi son épouse, Julie, qui a fait l’objet d’une biographie et d’un roman à succès, ce dernier intitulé Le roman de Julie Papineau.
Tout n'est pas lugubre dans un cimetière, loin de là. Il y a même de quoi sourire sinon rire. Par exemple, à l'entrée du cimetière de Shawville (Pontiac), une pancarte avertit le visiteur : « Entré (sic) à vos propres risques ». À Huberdeau se trouve la tombe d'un certain bien nommé « Mourez », au cimetière anglican de Papineauville on y a inhumé Joseph E. Tuer ! Et à Farrelton on peut voir le monument de Margaret Rose épouse de Norman Blue. Bref, les cimetières sont le miroir des territoires d'autrefois.
Quelqu’un a dit que celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la répéter. Il y a 44 ans, la population outaouaise montait aux barricades dans le cadre de la campagne l’Outaouais à l’urgence. Et pourtant, il reste encore de sérieux problèmes dans le domaine de la santé en Outaouais.
L’Outaouais à l’urgence est un mouvement qui a vu le jour au début des années 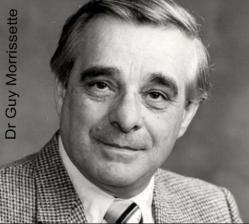 1970, dans l'ancienne ville de Hull, dans le but d’obtenir des services de santé adéquats dans la région. L’affaire a débuté par une menace de démission du personnel médical et infirmier de l’hôpital du Sacré-Cœur (Hull). En décembre 1972, le courageux docteur Guy Morrissette déclare :
1970, dans l'ancienne ville de Hull, dans le but d’obtenir des services de santé adéquats dans la région. L’affaire a débuté par une menace de démission du personnel médical et infirmier de l’hôpital du Sacré-Cœur (Hull). En décembre 1972, le courageux docteur Guy Morrissette déclare :
La clinique d’urgence est bondée […] les ambulanciers, faute de lits disponibles, doivent « décharger » des patients dans des chaises (sic) roulantes, alors qu’il devraient être étendus […] 621 noms figurent sur la liste d’attente actuelle de l’hôpital pour être hospitalisés […] des 350 lits actuels de l’hôpital plusieurs sont occupés par des malades chroniques, des vieillards ou des cas sociaux qui devraient se trouver dans des maisons spécialisées.
De fait, la région de l’Outaouais était dépendante des services de santé de la province voisine et le gouvernement québécois d’alors préférait verser des millions en frais d’hospitalisation au gouvernement ontarien plutôt que de les investir dans la région. Et en 1966-1967, le taux de mortalité infantile en Outaouais était de 28,5 pour 1 000 naissances alors qu’il était de 25 pour l’ensemble du Québec. Au point de vue de santé, l’Outaouais comptait parmi les régions défavorisées, ce qui est encore le cas en 2016.
Trois hôpitaux
À cette époque, il n’y avait que trois hôpitaux sur le territoire de l'actuelle ville de Gatineau : Sacré-Cœur et Pierre-Janet (Hull) et Saint-Michel (Buckingham). Ainsi, dès 1972, le conseil d’administration de l’hôpital Sacré-Cœur demande la construction d’un autre hôpital. Le député-ministre du comté de Hull, Oswald Parent, tente de désamorcer la crise en minimisant les problèmes. Devant la cécité du député-ministre et l’immobilisme de Québec, la région s’organise et en janvier 1973, des représentants de 18 syndicats, mouvements et associations communautaires se réunissent au Centre diocésain autour d’une table ronde intitulée « Outaouais à l’urgence »
Le mouvement vient de prendre son envol. Les députés régionaux, inefficaces dans ce dossier, sont dénoncés. Une grande offensive est lancée : l’opération 25 000, qui consiste à recueillir sur une pétition la signature des personnes « désireuses de voir les politiciens se réveiller ». Pour le député-ministre Oswald Parent, insensible aux problèmes de santé de ses commettants, « La crise à Sacré-Cœur c’est la faute aux religieuses et aux agitateurs ! »
Le ministre de la Santé, Claude Castonguay vient faire une visite en Outaouais pour désamorcer la crise. Il est escorté dans un autobus placardé ; « Aujourd'hui, on est tous médecins » ; « On est tannée (sic) ». L’Outaouais à l’urgence remet au ministre la pétition qui ne compte pas moins de… 43 000 signatures ! Celui-ci, propose un plan d’action de 19 millions de dollars : création de neuf CLSC dans la région, ajout de 159 lits à l’hôpital du Sacré-Cœur, ajout de 16 lits à l’hôpital Pierre-Janet, la disponibilité de 110 lits pour malades chroniques et de 400 autres pour les personnes âgées. Bien que le ministre refuse la construction d’un autre hôpital, dans l’ensemble, le mouvement Outaouais à l’urgence est satisfait. Le docteur Guy Morrissette pouvait être fier des résultats qu’il avait obtenus en si peu de temps, en collaboration avec de nombreux organismes de la région.
Lâché par ses pairs
Les services de santé dans la région sont terminés. Du moins affectait-on de le croire. Mais le docteur Morrissette, président du conseil des médecins et dentistes de l’hôpital Sacré-Coeur, n’était pas dupe et savait qu’il y avait encore loin de la coupe aux lèvres c’est-à-dire que des promesses restaient des promesses tant qu’elles n’avaient pas été réalisées. Celui-ci veut continuer la lutte, mais il est abandonné par le frileux corps médical. Afin de garder les coudées franches, Morrissette démissionne de la présidence de son conseil et continue à militer dans le cadre de l’Outouais à l’urgence.
 À l’automne 1974, la liste d’attentes de l’hôpital du Sacré-Cœur compte près de 2 000 cas. Les employés sont surchargés de travail et il y a pénurie de personnel médical. Les infirmières de la salle d’urgence menacent de démissionner si les patients (40) des urgences ne reçoivent pas de meilleurs traitements.
À l’automne 1974, la liste d’attentes de l’hôpital du Sacré-Cœur compte près de 2 000 cas. Les employés sont surchargés de travail et il y a pénurie de personnel médical. Les infirmières de la salle d’urgence menacent de démissionner si les patients (40) des urgences ne reçoivent pas de meilleurs traitements.
La situation continue de se détériorer. En janvier 1975, 310 employés de l’hôpital du Sacré-Cœur démissionnent de leur poste. Au cours d’une réunion publique, l’Outaouais à l’urgence appuie les démissionnaires. Quelques jours plus tard, le gouvernement québécois met en tutelle l’hôpital du Sacré-Cœur.
La crise commence à se résoudre à partir du moment où la population outaouaise se prend en main et fait connaître son mécontentement à l’élection générale provinciale de 1976 : le député-ministre et parrain de la région est défait après 20 ans de règne. Un nouveau député, celui de Chapleau, Jean Alfred, se met rapidement à la tâche et le ministre de la Santé peut annoncer, le 24 mai 1978, la construction d’un nouvel hôpital de 300 lits à Gatineau, hôpital dont la construction s’amorce en 1980. Mais, tout n’aura pas été réglé, parce que la population va se satisfaire de peu et sombrer dans l'apathie. En effet, des problèmes importants subsistent encore aujourd’hui.
Sources :
POIRIER, Roger, Qui a volé la rue principale ? Montréal, Les éditions Départ, 1991.
Histoire de l’Outaouais, IQRC, 1994 ; 310 démissions ! Pourquoi elles ont démissionné de l’hôpital de Hull ? CSN, Montréal, 1975.
Le Droit (Ottawa), 16 février 1973.
L'amour est sûrement l'un des plus beaux sentiments qui soient. Mais quand il est révélé par le coup de foudre, il est assurément le plus déraisonnable. Mais, au fait, qu'est-ce que le coup de foudre? C'est quelque chose comme un désir subit et irrésistible du cœur de se fusionner tout entier, sans partage, à la personne avec laquelle on tombe soudainement en amour. Selon Platon, chaque être humain aurait été, à l'origine, composé de deux êtres. Ils auraient été séparés et, depuis, les deux moitiés se cherchent l'une et l'autre. Le coup de foudre se produit donc quand ces deux moitiés sont mises en présence l'une de l'autre. Alors là, quelle ivresse ! On a souvent l'impression que seuls les jeunes gens peuvent vivre le coup de foudre, car il fait faire parfois des folies jugées incompatibles avec l'attitude des personnes d'un certain âge. Mais en fait, ce sont surtout les jeunes gens qui ont une telle opinion, car dans la vie le cœur conserve généralement tant ses désirs, ses espoirs que ses rêves de jeunesse.

Un des meilleurs médecins de Hull, le docteur Gustave Paquet, âgé de quarante-sept ans, était veuf depuis quatre ans et Annonciade Routhier, quarante-neuf ans, depuis quinze ans quand des amies communes aux deux personnes s'étaient mises dans la tête de former un couple de ces âmes esseulées. Très adroitement, les deux dames avaient ménagé une rencontre entre Annonciade et Gustave, laquelle eut lieu un mardi soir. Contre toute attente, à part le fol espoir des deux entremetteuses, le médecin et la jeune veuve se plurent tant qu'on ne peut expliquer la suite des événements que par le coup de foudre réciproque. En effet, ils résolurent de s'épouser, comme ça, le plus rapidement possible, et pourquoi pas le lendemain même de la rencontre. Et le mercredi 15 août 1906, les nouveaux amoureux réussirent à signer un contrat de mariage, à obtenir une dispense de trois bans de mariage et... à se marier en soirée à l'église Notre-Dame-de-Grâce de Hull. Au Texas, on n’aurait pas fait mieux.
Sam et Sarah
Hier comme aujourd'hui, les amoureux prévoyaient généralement la date et le déroulement de la cérémonie du mariage avec précision de sorte qu'aucune mauvaise surprise ne vienne entraver ou ternir le grand jour des épousailles. Mais l'avenir est imprévisible, surtout quand il dépend en partie d'une autre personne.
Sam Renaud, un cultivateur du canton de Masham âgé de soixante ans et veuf depuis un certain temps, avait fait la connaissance, à la fin de l'été de 1908, d'une veuve de quarante et un ans du village de Masham et nommée Sarah Meunier. Les deux âmes esseulées ne s'étaient vues qu'à deux reprises en trois semaines quand ce ratoureur de Cupidon, se mettant de la partie, avait poussé Sam à demander Sarah en mariage. Enchantée d'avoir trouvé un protecteur, la veuve avait accepté avec empressement la proposition du sexagénaire. Cependant, en femme d'expérience, elle avait mandaté son notaire pour qu'il rédige un contrat de mariage dans lequel son soupirant lui ferait la donation d'une somme de 200 dollars, condition préalable à la bénédiction nuptiale. Sans se faire prier le moins du monde et dès le lendemain de la requête de Sarah, c'est-à-dire un vendredi, Sam s'était rendu chez le notaire Timoléon Piché, du canton de Wakefield, où, de sa croix d'illettré, il avait signé le contrat de mariage. Le marché conclu, l'amour de Sam pour Sarah n'eut que plus de valeur. « Nous nous marierons dimanche après la messe », avait dit Sam. « Très bien, cher! » lui avait répondu Sarah! Et le couple s'était séparé pour attendre ce jour où l'un et l'autre consentiraient à nouer l'indissoluble lien conjugal.
proposition du sexagénaire. Cependant, en femme d'expérience, elle avait mandaté son notaire pour qu'il rédige un contrat de mariage dans lequel son soupirant lui ferait la donation d'une somme de 200 dollars, condition préalable à la bénédiction nuptiale. Sans se faire prier le moins du monde et dès le lendemain de la requête de Sarah, c'est-à-dire un vendredi, Sam s'était rendu chez le notaire Timoléon Piché, du canton de Wakefield, où, de sa croix d'illettré, il avait signé le contrat de mariage. Le marché conclu, l'amour de Sam pour Sarah n'eut que plus de valeur. « Nous nous marierons dimanche après la messe », avait dit Sam. « Très bien, cher! » lui avait répondu Sarah! Et le couple s'était séparé pour attendre ce jour où l'un et l'autre consentiraient à nouer l'indissoluble lien conjugal.
Le sort - ou est-ce la raison? - devait décider autrement de l'avenir des amoureux d'âge mûr. Le dimanche matin, soit le 13 septembre 1908, Sam et Sarah assistaient à la messe en l'église Sainte-Cécile à Masham. Rouge de contentement, Sarah avait pris place à l'avant de l'église et Sam, l'humeur morose, s'était assis tout à l'arrière. Juste au moment où la messe s'achevait, quand le prêtre prononça l'Ite missa est, Sam s'imagina que Cupidon lui avait joué un mauvais tour. Il se leva, hésita un instant puis sortit de l'église sans autre cérémonie, laissant là, l'angoisse au cœur, seule et bouleversée, celle qui prétendait faire le bonheur de sa vie.
Bien sûr, Sarah s'était sentie humiliée. Qui ne l'aurait pas été à sa place? Elle n'avait pas d'autre choix que de prendre son mal, sa honte en patience et laisser le temps guérir son cœur gonflé de chagrin. Mais voilà, à peine six semaines après l'outrageuse fuite de son ancien prétendant, Sarah apprit que Sam avait épousé une autre femme - elle aussi du village de Masham - en la personne de la veuve Agnès Desjardins. Et à celle-ci, il avait préalablement fait une donation de... 500 dollars. C'en était trop. La veuve ne pouvait plus laisser l'affront impuni et, surtout, son cœur meurtri sans soins, du moins sans consolation. Elle était donc venue à la conclusion que si le temps ne parvenait pas à guérir sa peine d'amour... propre, l'argent saurait bien laver l'affront et rendre son malheur plus confortable. Mais comment obtenir réparation? Elle confia ses états d'âme à un avocat hullois qui déposa une plainte à l'endroit de Sam Renaud pour bris de promesse de mariage. À son avis, seul un dédommagement de 999 dollars pouvait rétablir la cadence des battements de cœur de sa cliente et lui rendre la vie plus supportable. Mais le juge Champagne, de la cour supérieure à Hull, qui croyait que c'était là trop demandé pour un organe qui battait quand même depuis un certain temps, jugea qu'une somme de 375 dollars suffirait à cicatriser la peine d'amour de la quadragénaire de Masham.
Source :
Ouimet, Raymond, Histoires de coeur insolites, Hull, éd. Vent d'Ouest, 1994.
Les chagrins d'amour, qui parfois « durent toute la vie », ne sont pas toujours dus à l'intransigeance des parents. De tout temps, il y a eu des jeunes hommes volages pour briser le coeur de leur fiancée et des jeunes filles capricieuses pour faire subir mille tourments à leur soupirant. L'inconstance amoureuse est au moins aussi ancienne que les relations homme-femme, comme le prouve la plus vieille histoire d'amour de l'Outaouais.
Il y a de nombreuses lunes, bien avant l'arrivée de l'Européen dans notre région, le territoire de la ville de Gatineau était couvert d'une dense forêt giboyeuse, parsemée de lacs poissonneux. Une paisible tribu algonquine y coulait des jours heureux sur le bord d'un lac aux eaux limpides et profondes, le lac des Fées. Ik8é, la fille du chef, était aimée de deux braves et vaillants guerriers de sa nation. Mais la jeune Amérindienne à l'humeur volage tardait à jeter son dévolu sur l'un ou l'autre de ses valeureux prétendants et elle avait demandé à son père quelle épreuve les deux guerriers devraient subir pour mériter son cœur.
–Ik8é, dit le père, viens t'asseoir près de moi que je te raconte les  méchancetés que notre peuple a subies. Il y a longtemps, nous étions une nation aimable qui vivait en paix avec ses voisins. Mais de cruels guerriers ont expulsé nos pères de leur territoire de chasse. Ils tuèrent nos hommes les plus braves et amenèrent nos femmes en captivité. Voilà que nos ennemis reviennent une fois de plus. Je dois mobiliser tous mes guerriers et repousser loin de nos rivages cette cruelle nation. De tes amoureux je ferai des chefs dont les noms seront honorés pour toujours. Si par chance l'un deux revenait, sa main tu ne devras jamais repousser.
méchancetés que notre peuple a subies. Il y a longtemps, nous étions une nation aimable qui vivait en paix avec ses voisins. Mais de cruels guerriers ont expulsé nos pères de leur territoire de chasse. Ils tuèrent nos hommes les plus braves et amenèrent nos femmes en captivité. Voilà que nos ennemis reviennent une fois de plus. Je dois mobiliser tous mes guerriers et repousser loin de nos rivages cette cruelle nation. De tes amoureux je ferai des chefs dont les noms seront honorés pour toujours. Si par chance l'un deux revenait, sa main tu ne devras jamais repousser.
–Mais père ! dit la jeune femme, s'il fallait que mon destin soit de traverser seule ce monde terrestre? Mon cœur se briserait et je me jetterais volontiers tout au fond du lac sur les bords duquel nous avons vécu de nombreux jours heureux. Je ne pourrais jamais vivre seule et il serait trop tard pour que je puisse me repentir de mon inconstance.
Juste à ce moment, un messager arriva en hâte pour informer le vieux chef que l'ennemi était en vue, qu'il dévalait les collines de la Petite Rivière et atteindrait bientôt la Grande Chaudière (rivière des Outaouais, près du pont des Chaudières). Le chef laissa sa fille en pleurs pour mobiliser ses guerriers qu'il lança contre les hordes ennemies. Alors commença la plus sanglante des batailles dont fut témoin la rivière des Outaouais. Le combat fit rage toute la journée près des chutes de la Grande Chaudière et ne prit fin que lorsque mille braves eurent succombé.
Les deux guerriers amoureux étaient au nombre des morts et leur corps avait été laissé, sans sépulture, sur le champ de bataille. Assise au bord du lac où campait sa tribu, la jeune fille redoutait d'apprendre le sort que la bataille avait réservé à ses soupirants. Angoissée, il lui semblait entendre son cœur crier : « Oh! Trop tard! » Quand enfin son père revint, ses faibles espoirs s'évanouirent.
 –Viens Ik8é, viens t'asseoir près de moi, lui dit son père, que je te raconte le déroulement du combat et la mort de tes amoureux qui sont tombés près de moi pendant la bataille. Leur bravoure a stimulé nos guerriers.
–Viens Ik8é, viens t'asseoir près de moi, lui dit son père, que je te raconte le déroulement du combat et la mort de tes amoureux qui sont tombés près de moi pendant la bataille. Leur bravoure a stimulé nos guerriers.
–Va, dit-elle, aucune parole ne pourra me consoler cher père. Pardonne-moi. Mes jours sont arrivés à leur terme. Je ne puis vivre plus longtemps. La forêt s'est tue, la nature m'appelle : « Pardonne! Pardonne! Adieu! Adieu! »
Et d'un seul bon, comme une biche effrayée, Ik8é se jeta dans les eaux du lac où elle repose encore aujourd'hui tout au fond, souriante. Depuis ce jour, on raconte que les deux vaillants guerriers amoureux montent la garde autour du lac et rôdent dans les boisés environnants en implorant le Manitou de leur rendre Ik8é disparue à tout jamais. En vain ils continuent à chercher tous deux, sous la neige et la pluie, leur bien-aimée, celle qui de son vivant n'a pas su choisir. Mais telle une fée, Ik8é rôde autour du lac sans pouvoir les consoler. Condamnée à les voir, elle ne peut être vue d'eux et son amour restera toujours sans retour.
Tel a été et sera le destin de cette fille volage pour des siècles et des siècles. La légende ajoute que si Ik8é avait sagement choisi, ses deux amoureux s'en seraient mieux portés et elle n'aurait pas si chèrement payé son éternité. Les jeunes filles d'aujourd'hui – et pourquoi pas les jeunes hommes? – devraient prendre le temps d'arrêter un moment leurs pas quand elles se promènent près du lac des Fées pour réfléchir au sort d'Ik8é qui, pour avoir refusé de choisir, a perdu le repos éternel.
Note :
Ik8é (Ikoué) est un mot algonquin qui signifie femme (communication de M. Bernard Assiniwi à l'auteur). Anson Gard a donné à l'héroïne le nom de Womena, ce qui est peu vraisemblable. En effet, pourquoi un nom algonquin aurait-il eu une racine étymologique anglaise ?
Source :
Adapté de Gard, Anson, A., The Legend of Fairy Lake dans The pioneers of the Upper Ottawa and the Humors of the Valley, South of Hull and Aylmer Edition, Ottawa, 1906, pp. 105, 106 et 107.
On a peine à imaginer, aujourd’hui, à quoi ressemblaient les rives de la rivière des Outaouais, à Hull et même à Ottawa, à la fin du XIXe siècle. Elles sont alors occupées par de hautes piles de planches coupées par les scieries – 6 millions de mètres dans les années 1850, 61 millions en 1871 –, pour la plupart situées aux Chaudières, c’est-à-dire de part et d’autre des chutes des Chaudières. Ces planches sont coupées par 1 200 scies activées par la seule force du courant des chutes. Dans les années 1880, les Chaudières constituent un immense complexe industriel où plus de 5 000 ouvriers suent sang et eau.
De nombreuses scieries sont établies à Hull. La vie des travailleurs de ces scieries est un véritable enfer digne des romans les plus sombres d’Émile Zola : l’ombre de Germinal planait sur les Chaudières ! On y travaille de 12 à 15 heures par jour, 6 jours par semaine, mais seulement 6 mois par année. Les accidents sont nombreux. Rien que dans les scieries de la E.B. Eddy, on a estimé à 562 le nombre d’ouvriers morts dans des accidents de travail de 1858 à 1888 ! Et bien que la loi interdise le travail des enfants avant l’âge de 12 ans, la réalité est tout autre. Dès l’âge de 10 ans, on les emploie dans les cours à bois, dans les écuries des grandes scieries ou au déblocage des machines enrayées parce que leur petite taille leur permet de se faufiler entre les engrenages des mécanismes... qui parfois se remettent en marche subitement. Quand un enfant meurt dans un accident de travail, on déclare qu’il s’est imprudemment aventuré dans la scierie en jouant !
de ces scieries est un véritable enfer digne des romans les plus sombres d’Émile Zola : l’ombre de Germinal planait sur les Chaudières ! On y travaille de 12 à 15 heures par jour, 6 jours par semaine, mais seulement 6 mois par année. Les accidents sont nombreux. Rien que dans les scieries de la E.B. Eddy, on a estimé à 562 le nombre d’ouvriers morts dans des accidents de travail de 1858 à 1888 ! Et bien que la loi interdise le travail des enfants avant l’âge de 12 ans, la réalité est tout autre. Dès l’âge de 10 ans, on les emploie dans les cours à bois, dans les écuries des grandes scieries ou au déblocage des machines enrayées parce que leur petite taille leur permet de se faufiler entre les engrenages des mécanismes... qui parfois se remettent en marche subitement. Quand un enfant meurt dans un accident de travail, on déclare qu’il s’est imprudemment aventuré dans la scierie en jouant !
Les allumettières
Si les conditions de travail des hommes sont abominables, celles des femmes, qui œuvrent dans les fabriques d’allumettes, ne sont pas meilleures. La technique de fabrication des allumettes, au début du XXe siècle, est très dangereuse. Les commencements d'incendie sont si fréquents que chaque allumettière travaille à côté d’une chaudière remplie d’eau pour éteindre les commencements d’incendie qui se produisent dix et même vingt fois par jour. Les vapeurs de soufre qui emplissent l’air de la fabrique, très nocives à forte concentration, empoisonnent, parfois mortellement, les ouvrières. C’est ce qui arrive à une jeune hulloise de 17 ans, Catherine de Champlain, qui en meurt le 8 août 1889. Des jeunes filles de 12 ans, employées à l’emballage des boîtes, reviennent à la maison, le soir, fourbues, les mains écorchées par le carton et les doigts tailladés par le papier.
Les allumettières, qui trempent les petits bâtonnets de bois dans le phosphore blanc pour en faire des allumettes, sont aussi sujettes à une terrible maladie : la nécrose maxillaire, une maladie semblable à la terrible mangeuse de chair. Un écrivain a décrit la nécrose comme : « ...la mort gluante qui se répand dans la bouche. » Il n’y avait qu’une seule façon d’arrêter la nécrose de la mâchoire : l’ablation de l’os atteint, ce qui avait aussi pour effet de défigurer le malade parfois tout autant que la maladie.
Au XIXe siècle, les Chaudières étaient bien différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui ; le fameux barrage, appelé « ring dam », n’était pas encore construit et au printemps, les eaux de la grande Chaudière bouillonnaient avec une impétuosité impressionnante. On dit que, la nuit venue, quand les scieries s’étaient tues, le bruit de l’eau qui tombait avec fracas sur les rochers s’entendait à cinq kilomètres à la ronde.
Spectacle aux Chaudières
Les chutes Chaudières constituaient à elles seules un spectacle impressionnant. C’était alors un merveilleux endroit pour accomplir un exploit. D’autant plus que la ville d’Ottawa, devenue depuis peu la capitale du Canada-Uni, comptait parmi sa population une pléthore de correspondants de presse à l’affût de nouvelles spectaculaires.
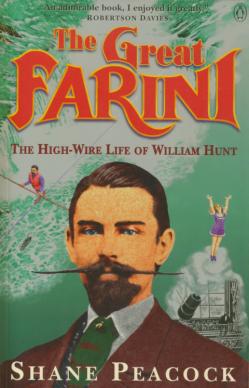 La nouvelle notoriété d’Ottawa y attire le funambule Guillermo Farini, de son vrai nom William Leonard Hunt, un homme originaire de Port Hope, Ontario, qui veut hausser sa popularité au pays en franchissant les chutes des Chaudières sur un fil de fer. Farini, 28 ans, n’en est pas à ses premières armes comme casse-cou. À l’été de 1860, il a franchi les célèbres chutes du Niagara à plusieurs reprises devant des milliers de spectateurs ébahis.
La nouvelle notoriété d’Ottawa y attire le funambule Guillermo Farini, de son vrai nom William Leonard Hunt, un homme originaire de Port Hope, Ontario, qui veut hausser sa popularité au pays en franchissant les chutes des Chaudières sur un fil de fer. Farini, 28 ans, n’en est pas à ses premières armes comme casse-cou. À l’été de 1860, il a franchi les célèbres chutes du Niagara à plusieurs reprises devant des milliers de spectateurs ébahis.
Le 9 septembre 1864, Farini entreprend de franchir les Chaudières. Il tend, au-dessus des chutes de la grande Chaudière, un câble d’acier de 5 centimètres de diamètre et de 225 mètres de long, à 36 mètres au-dessus de l’eau. À 15 heures tapant, devant une dizaine de milliers de spectateurs, pour la plupart entassée du côté hullois de la rivière des Outaouais, Farini commence à marcher avec nonchalance sur le filin d’acier et se rend jusque de l’autre côté de la rivière. Puis il revient sur ses pas et s’arrête juste au milieu des chutes où, après avoir effectué diverses manœuvres acrobatiques, il se suspend au câble d’une seule une main, au-dessus des tourbillons des Chaudières, sous les applaudissements d’une foule enthousiaste.
Le même soir, Farini donne un second spectacle à 21 heures. La foule est aussi dense qu’en après-midi. Au moment où le funambule éclairé par des centaines de flambeaux s’engage sur le câble d’acier, la foule réussit à monter sur le pont Union (site de l’actuel pont des Chaudières) d’où elle a été exclue lors de la première exhibition. De cet endroit, le spectacle est encore plus impressionnant. Étant incapables de contrôler l’affluence des spectateurs sur le pont et ayant peur que celui-ci ne s’effondre sous leur poids, les autorités demandent à Farini de couper court à son spectacle, ce qu’il accepte de bonne grâce ne voulant pas associer son triomphe à une catastrophe.
Trente ans après Farini, un certain Louis Beauchamp réussit, à son tour, à captiver la population hulloise quand il plonge dans la rivière des Outaouais du haut du pont des Chaudières, le 7 mars 1894, devant 5 000 spectateurs. On dit qu’il avait mangé deux bananes sous l’eau avant de remonter à la surface. Dix ans plus tard, il répète son exploit et nage jusqu’au pont Interprovincial (Royal Alexandra). En 1933, quatre jeunes gens d’Ottawa sautent à l’eau sous le pont des Chaudières et se laissent emporter par le courant, à une vitesse de 25 kilomètres à l’heure, jusqu’au pont Interprovincial. Ils voulaient démontrer le caractère insubmersible du maillot de bain Triton.
Sources
OUIMET, Raymond, Une Ville en flammes, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1974.
PEACOCK, Shane, The Great Farini, Toronto, Penguin Books, 1995.
Journaux : Le Spectateur (Hull) et Le Temps (Ottawa).
Joseph Savignac était un drôle de zigoto. Dans le recensement du Canada de 1901, pour la ville d’Ottawa, il se déclare être Hydro Physician (hydrothérapeute ?) né en France le 28 janvier 1868, ce qui est faux. De fait, notre homme est issu de parents québécois pure laine et a vu le jour dans le comté de Lanaudière au Québec.
La famille de notre antihéros semble avoir été touchée par l’instabilité psychique ; plusieurs membres de sa famille ont été soignés à l'asile de Joliette et celle de Longue-Pointe. Évidemment, cette caractéristique familiale n’est pas sans avoir eu un certain ascendant sur Joseph qui était toutefois loin d’être débile.
En effet, on peut avoir un grain de folie tout en étant intelligent et même très intelligent. C’était sans doute le cas de notre homme qui a fait des études au Collège presbytérien de Montréal. Il y a tant et si bien réussi qu’il a été ordonné pasteur vers 1893. On dit même que Savignac parlait couramment l’hébreu en sus du français et de l’anglais. Pendant six mois, iI a exercé son ministère à Montebello et, à ce titre, il a sans aucun doute été en relation avec Joseph Amédée Papineau, qui, on le sait, avait tourné capot.
Puis, notre homme a quitté subitement Montebello pour Lowell, aux Massachusetts où il a pris en charge une paroisse de confession baptiste pendant un an. Ensuite, Savignac s’est établi à Ottawa où il a fait la rencontre d'une fille de Templeton, Georgiana Mitchell, qu’il épouse en 1895 à l’église presbytérienne de Hull.
Sitôt marié, Savignac quitte Ottawa pour la Floride où il y cultive des oranges sans grand succès puisqu’il revient à Ottawa en 1897. Il ouvre alors des... bains turcs, rue Albert, qu’il déménagera rue Slater en 1899. Savignac, qui se fait appeler tour à tour « professeur », « hydropathic physician » et « docteur » songe même un instant à construire un navire... transatlantique !
Les affaires ne rapportant pas trop bien, le « docteur » Savignac se voit dans l’obligation de cesser ses activités. Il décidé de quitter à nouveau la capitale canadienne pour la Californie. Mais voilà, ses beaux-parents ne veulent pas voir leur fille quitter une seconde fois le pays et celle-ci a décidé qu’elle ne le suivrait pas. Et voilà notre homme en beau… maudit !
Savignac en arrive à perdre les pédales d’autant plus que depuis quelques jours, il a déjà commencé à vendre les meubles du ménage pour payer les frais de voyage. À ce moment, le couple vit au village de Janeville, le futur quartier Vanier à Ottawa.
Un coup de folie
Nous sommes le 25 septembre 1906 ; 15 heures viennent de sonner à l’horloge du parlement. Il fait beau et le soleil luit de tous ses rayons au-dessus de la capitale. Dans un dernier effort, Savignac tente de convaincre sa femme de le suivre. Mais voilà, sur l’entre fait arrivent les beaux-parents. La belle-mère prend alors à partie son gendre en lui disant qu’il peut bien aller aux États, mais que sa fille ne le suivra pas. Et Savignac de répondre : « C’est bien, je vais voir à ça. » Il quitte alors la maison sans rien ajouter à son propos. Les beaux-parents se dépêchent à aider leur fille à empaqueter ses affaires, quand soudain Savignac entre dans la maison en coup de vent, revolver à la main. Il tire sur sa femme qu’il atteint à un bras et sur sa belle-mère qu’il blesse au dos.
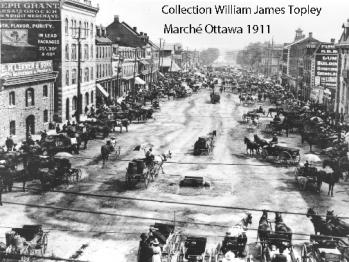 À son beau-père qui lui demande ce qu’il vient de faire, il répond : « Si ma femme ne veut pas venir avec moi en Floride, elle n’ira nulle part ailleurs. » Puis, il dirige son arme en direction du beau-père… et quitte la maison sans tirer.
À son beau-père qui lui demande ce qu’il vient de faire, il répond : « Si ma femme ne veut pas venir avec moi en Floride, elle n’ira nulle part ailleurs. » Puis, il dirige son arme en direction du beau-père… et quitte la maison sans tirer.
Quelques heures plus tard, toutes les polices de la capitale et de l’Outaouais se mettent aux trousses du « docteur » Savignac. Elles sont suivies et parfois devancées par une meute de journalistes de notre région qui rapporte tous les prétendus déplacements du fuyard.
Un bataille digne des western
Un jour, des rapports indiquent que Savignac se terre à Ottawa, le lendemain à Orléans et sur le surlendemain, à Cornwall ou à Montebello Le pasteur « hydrothérapeute », qui lit les journaux, ri dans sa barbe. Six jours après ses crimes, il reste toujours introuvable. Enfin, les journaux de la capitale annoncent que des policiers d’Ottawa, Dicks et Ryan, viennent de partir en mission secrète pour procéder à l’arrestation du fugitif.
La scène se passe aux environs de Beauharnois, dans la ferme d’Arthur Hainault. Savignac s’y terre depuis quelques jours, cherchant un moyen de franchir la frontière étasunienne. Renseignés par un batelier du Saint-Laurent, un certain Lalonde, les policiers s’approchent de la ferme en question. Il est 18 heures et la pluie tombe à torrents d’un ciel sombre qui permet aux policiers de camoufler leur arrivée. Les policiers frappent à la porte du fermier qui ouvre. Assis au bout d’une table, les jambes allongées sur une chaise, les vêtements en lambeaux, mais la barbe rasée, le fugitif lit un journal tout grand ouvert et ne porte pas attention aux visiteurs.
Le batelier présente les policiers au fermier Hainault. Au même moment, Dicks saute sur Savignac qui se défend promptement. « C’est vous Dicks et Ryan ? », lance le fugitif en ricanant. « C’est vous autres qui voulez ma tête, eh bien, si vous la voulez, gagnez-la. » Un de ses pieds atteint Ryan an plein visage alors que d’un crochet, droit ou gauche, il frappe Dicks solidement à la mâchoire. Table et chaises volent à travers la cuisine dans une scène de lutte indescriptible. Épuisé, Savignac tombe par terre. Il sort de sa poche son revolver dont il arme le chien. Un des policiers parvient à l’immobiliser en l’assommant pour ensuite le désarmer. La bataille est finie et l’« hydrothérapeute » vaincu.
Le prisonnier est ramené à Ottawa où il est accusé de tentative de meurtre à l’égard de sa belle-mère. L’épouse de Savignac a refusé de témoigner dans la cause de son mari, ce dont elle a droit, et refuse tout autant de porter plainte contre lui.
Joseph Savignac est jugé en janvier 1907. Son avocat plaide alors la folie, c’est-à-dire la « démence temporaire ». Et bien que plusieurs témoins doutent de la santé psychique de l’accusé, les aliénistes ne s’entendent pas entre eux et Savignac se voit condamner à sept ans de bagne après que le jury l’ait recommandé à la clémence de la cour.
Sources :
Le Temps (Ottawa) 25, 26, 27, 28 et 19 septembre, 1er, 2, 3 et 4 octobre 1906, 31 janvier, 1er et 2 février 1907
The Ottawa Evening Journal (Ottawa) 25, 26, 27 et 29 septembre, 1er et 4 octobre 1906, 31 janvier, 1er et 2 février 1907.
Documentation personnelle.
La rentrée dans les années 1950 et 1960
En Outaouais urbain, l'Exposition du Canada central, qui avait lieu à Ottawa, annonçait la fin prochaine des vacances estivales et la rentrée scolaire. Elle commençait par un long défilé de chars allégoriques, de fanfares et de majorettes qui partait de l'aréna de Hull et qui se rendait au parc Lansdown, à Ottawa. Une bonne partie de la population d'Aylmer, de Gatineau et de Hull traversait les trois ponts de la rivière des Outaouais pour aller s'égayer à l'Exposition annuelle. Et chaque année, les organisateurs de cet événement annonçaient qu'il y aurait plus de français l'année suivante, ce qui ne se produisait jamais et ne s'est jamais produit.
Des milliers de jeunes prenaient d'assaut les dizaines de manèges alors que les plus vieux essayaient de gagner des prix dans des kiosques où ils pouvaient tester leur dextérité à la carabine, à la balle ou encore aux anneaux, ce qui était difficile. D'ailleurs, les tenanciers embauchaient des figurants qui montraient les cadeaux qu'ils avaient faussement remportés pour inciter les gens à jouer. Les femmes, elles, s'adonnaient au bingo où le jeu était plus honnête, car un prix était remis à chaque partie . Ces dames marquaient leurs cartes à l'aide de grains de maïs séchés.
. Ces dames marquaient leurs cartes à l'aide de grains de maïs séchés.
Dans l'un des pavillons, la foule pouvait assister à des concours de bestiaux, dans un autre à des performances sportives, ou visiter ceux qui présentaient des meubles, des fleurs et de la bouffe. Des musiciens et des danseurs divertissaient les spectateurs gratuitement au kiosque à musique. De multiples petits restaurants sous tente répandaient sur le terrain du parc d'attractions des odeurs de viandes cuites, de hot-dog, d'oignons frits et de frites. Ailleurs, on trouvait crème glacée et barbe à papa. L'après-midi et le soir, il y avait spectacles au Grand Stand. Enfin, les enfants revenaient à la maison avec des babioles que leurs parents leur avaient achetées.
La rentrée scolaire
Au même moment ou presque avaient lieu les Olympiques des enfants dans les parcs de l'Organisation des terrains de jeux où les enfants des divers terrains de jeu entraient en compétition. Puis, les parcs redevenaient silencieux, les familles revenaient des chalets et des enfants, qui avaient passé des vacances en colonies, réintégraient leur famille. Les municipalités fermaient les barboteuses et commençaient à retirer des parcs les équipements comme les balançoires. Bientôt, on y installera les bandes des patinoires en prévision de l'hiver à venir.
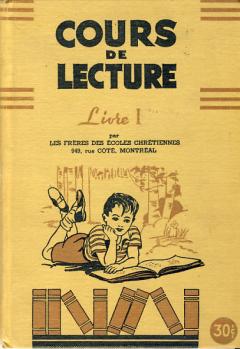 L'école recommençait le lendemain de la fête du Travail. Pour être admis en première année, il fallait avoir six ans au 30 juin précédant la rentrée. Et ce n'était pas gratuit : il en coûtait 25¢ par semaine dans les années 1950. Tous les livres étaient cependant gratuits, mais les parents devaient munir leurs enfants de cahiers ou de feuilles mobiles pour cartables, de crayons à mine de plomb, d'un crayon bleu et aussi d'un crayon rouge, d'une gomme à effacer, brune ou... rose, d'une règle à mesurer qui servait le plus souvent à tracer des lignes bleues ou rouges, d'un encrier, de plusieurs pointes de fer et manches de stylets (jusqu'au début des années 1960, les écoles ont interdit l'emploi de la plume fontaine), et, pour les plus vieux un nécessaire à géométrie.
L'école recommençait le lendemain de la fête du Travail. Pour être admis en première année, il fallait avoir six ans au 30 juin précédant la rentrée. Et ce n'était pas gratuit : il en coûtait 25¢ par semaine dans les années 1950. Tous les livres étaient cependant gratuits, mais les parents devaient munir leurs enfants de cahiers ou de feuilles mobiles pour cartables, de crayons à mine de plomb, d'un crayon bleu et aussi d'un crayon rouge, d'une gomme à effacer, brune ou... rose, d'une règle à mesurer qui servait le plus souvent à tracer des lignes bleues ou rouges, d'un encrier, de plusieurs pointes de fer et manches de stylets (jusqu'au début des années 1960, les écoles ont interdit l'emploi de la plume fontaine), et, pour les plus vieux un nécessaire à géométrie.
Les filles portaient alors un costume composé d'une blouse blanche et d'une robe bleu marine ; les garçons étaient simplement vêtus proprement ; jeans et espadrilles étaient interdits. Au secondaire, les adolescents devaient porter veston, chemise blanche, cravate et pantalon ; les jeunes filles continuaient à porter leurs costumes bleu marine. Puis lentement, chacun reprenait ses occupations : les journaux ajoutaient des pages à leurs éditions, radio et télévision (en noir et blanc) remettaient à l'antenne leur programmation régulière. La vie faite de labeurs reprenait ses droits et au fur et à mesure que la fraîche remplaçait la chaleur estivale, les balcons des maisons se voyaient déserter jusqu'à l'été suivant.
L'été des années 1950 dans le Vieux Hull
Dans les années 1950, il n’y avait ni Nintendo ni télévision 24 heures par jour. La belle saison se vivait le plus souvent à jouer dehors. C’est l’heureuse époque où l’on pouvait se réunir en famille le dimanche puisque ce jour-là était férié pour tous ou presque.
L’été commençait pour vrai le 22 juin, dernier jour d’école. Mais les vacances des uns, à une époque où la famille standard comptait en moyenne quatre enfants, étaient un temps très occupé pour les mères qui passaient alors tout leur temps avec la marmaille.
L’école terminée, tous ceux et celles qui avaient accès à un vélo enfourchaient leur monture pour l’été. À cette époque, il y avait, grosso modo, quatre types de vélos populaires : le vélo ordinaire (1 vitesse,), celui à pneus dit « semi-ballounes », ceux dit à pneus « ballounes » et les bicyclettes dites automatiques, c’est-à-dire à plusieurs vitesses, généralement trois, qui étaient l’apanage des plus riches. Les vélos à pneus « ballounes » étaient généralement enfourchés par les filles.
Le vélo servait à s’affranchir de la maison, du voisinage pour aller à la découverte  de la ville et pour faire la baignade au parc Moussette que l’on appelait alors « Luna », ou au Flat Rock dit aussi les « quatre piscines » (sur les bords de la rivière Rideau) ou encore à Mooney’s Bay et à Britannia ; les plus aventureux allaient se baigner à la Gappe (baie sur les terrains des usines Eddy) aux divers « ponts noirs » (ponts ferroviaires) de la région : rivière Gatineau, rivière Rideau. Les jeunes allaient aussi à la pêche au quai de Hull ou à celui de Pointe-Gatineau, au pont Alonzo-Wright, etc.
de la ville et pour faire la baignade au parc Moussette que l’on appelait alors « Luna », ou au Flat Rock dit aussi les « quatre piscines » (sur les bords de la rivière Rideau) ou encore à Mooney’s Bay et à Britannia ; les plus aventureux allaient se baigner à la Gappe (baie sur les terrains des usines Eddy) aux divers « ponts noirs » (ponts ferroviaires) de la région : rivière Gatineau, rivière Rideau. Les jeunes allaient aussi à la pêche au quai de Hull ou à celui de Pointe-Gatineau, au pont Alonzo-Wright, etc.
Tout en étant simples, les jeux des enfants faisaient appel à l’imagination : les filles jouaient à la maman avec des poupées ou avec des personnages découpés dans les catalogues de Dupuis ou Eaton, au paradis (carreaux tracés sur le sol, à la corde à danser, au « bolo » ou au ballon-prisonnier, alors que les petits garçons jouaient aux cowboys (tous les garçons avaient au moins une arme-jouet), dans le sable avec des camions-jouets en fer, à la balle-molle, etc.
Certains enfants avaient le bonheur (pas toujours volontaire) de passer une semaine ou deux dans une colonie de vacances. Les familles de l’Île de Hull, qui en avaient les moyens ou qui étaient assez pauvres pour obtenir la gratuité, envoyaient leurs enfants au camp Saint-Stanislas, à Low, propriété des Oblats. Là, les enfants étaient répartis en divers dortoirs, selon leur âge et leur sexe.
Pendant que les ados parcouraient la ville à vélo, les enfants qui demeuraient en ville et dont les parents n’avaient pas de chalet ou de maison d’été (l’immense majorité), bénéficiaient de l’animation de l’Oeuvre des terrains de jeu (OTJ).
Les parcs de nombreuses villes du Québec étaient animés par l’OTJ où des moniteurs et monitrices, dont certains étudiaient au scolasticat dans le but de devenir prêtres, prenaient la responsabilité des enfants de 9h à 12 h et de 13 h à 16 h, du lundi au vendredi.
Chanter le bonheur
Moniteurs et monitrices organisaient des matchs de balle, de ballon, racontaient des histoires fantastiques, prêtaient des balles, des gants de balle, des bâtons, des raquettes. Et ils faisaient chanter les enfants :
Lundi matin, l’empereur, sa femme et son p’tit prince…
Ne pleure pas Jeannette, allez zim boum boum...
Quand tu sortiras, biquette, biquette, biquette, quand tu sortiras biquette de ce trou-là…
Va va ma petite Jeannette, va va le printemps reviendra…
Au parc Fontaine, il y avait, sans doute vers 1958 ou 1959, un moniteur barbu que les rockers du coin avaient pris en grippe, mais que la plupart des jeunes adoraient. Ce moniteur était un fan de Guy Béart dont il nous chantait les chansons en s’accompagnant à la guitare : L’eau vive, Le chapeau, Le quidam…
Évidemment, nous apprenions par cœur ces belles chansons de Béart. Un jour, les enfants en avaient ramené une nouvelle à la maison dont les paroles étaient : Qu’on est bien, dans les bras d’une personne du sexe opposé, qu’on est bien dans ces bras-là… Or, cette chanson était interdite de diffusion sur les ondes radio. Je vous laisse imaginer les réactions des mères qui entendaient leurs enfants chanter à tue-tête, au rythme du va-et-vient des balançoires…
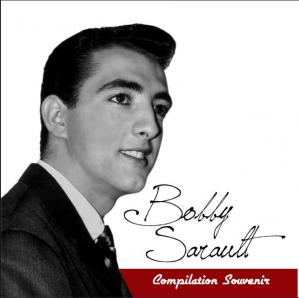 La saison des terrains de jeux se terminait par l’élection (pratique de la démocratie) d’un maire et d’une mairesse du terrain dont l’un a vécu quelques instants de célébrité : le chanteur Robert Bobby Sarault dont la reine était Carole Boivin (parc Fontaine). Enfin, des olympiques municipaux clôturaient la saison des terrains de jeu.
La saison des terrains de jeux se terminait par l’élection (pratique de la démocratie) d’un maire et d’une mairesse du terrain dont l’un a vécu quelques instants de célébrité : le chanteur Robert Bobby Sarault dont la reine était Carole Boivin (parc Fontaine). Enfin, des olympiques municipaux clôturaient la saison des terrains de jeu.
Les belles soirées d'été
Les soirées étaient plus calmes parce que l’on mettait les enfants au lit tôt, même avant le coucher du soleil. De nombreuses soirées se passaient au parc Fontaine, dit alors Flora, où les équipes de balle-molle (fast-ball) de la Ligue commerciale s’affrontaient de nombreux soirs par semaine. Certains matchs attiraient jusqu’à 3 000 personnes qui s’assoyaient tout autour du champ de balle dans des chaises de parterre. Et c’était gratuit ! La saison 1957 a été lancée par Amanda Allarie, la fameuse maman du populaire téléroman Les Plouffes.
Des enfants, qui avaient installé dans leur brouette des cuves remplies de glace et de breuvages, circulaient entre les spectateurs en criant : Coke, Pepsi, Seven-Up, Ginger Ale... Derrière l’arrêt-balle, M. Romanuk dit Jos. Patates, faisait frire les meilleures patates en ville dans sa voiture tirée par l’unique cheval de Hull alors que dans une petite bicoque de la rue Papineau, les Nault vendaient de la bière d’épinette maison.
Dans l’Île de Hull, les soirées se passaient assis sur le perron avant de la maison à jaser entre mêmes membres de la famille, avec les voisins ou ceux qui se promenaient dans le quartier. Les ados fréquentaient les cinémas, à Hull : le Laurier, le Cartier, le Montcalm, ou le cinéma de Paris ; à Gatineau : le Laurentien, et à Ottawa : le Français où les rats disputaient la vedette aux acteurs ou encore le Rideau. D’autres passaient leur soirée à la Salle Notre-Dame ou Saint-Joseph, à pratiquer de la boxe ou du judo, ou encore dans des réunions de la J.E.C. alors que d’autres se divertissaient dans les nombreuses salles de billard et de quilles de la ville.
Tous savaient que l’été tirait à sa fin quand la radio et les journaux annonçaient le début de l’Exposition du Canada central. Elle commençait par un défilé de fanfares et chars allégoriques qui partait de l’aréna de Hull pour se diriger au parc Landsdowne à Ottawa.
Pendant plus d'un siècle, de nombreuses carrières ont été en exploitation à Gatineau, particulièrement dans le secteur Hull. Elles appartenaient à la famille Wright, à un certain Gibbons et à l'International Cement Co. devenu avant sa fermeture Ciment Lafarge Canada. Pour extraire de ces carrières les matériaux de construction – pierre, en chaux et ciment –, il fallait de puissants explosifs. C'est pourquoi, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, une industrie d'explosifs a pris naissance à Hull.
L'une des entreprises d'explosifs, la General Explosives Company of Montreal Ltd, a laissé de mauvais souvenir. Elle s'installe à Hull en 1906, à l’extrémité sud de l’actuelle rue Émile-Bond, et ce, au grand dam des autorités municipales qui ne veulent plus d'une telle usine sur leur territoire. Elle a beau créer des emplois, mais le risque que font courir ses opérations est trop élevé. Devant l'obstination de la compagnie à poursuivre ses activités, le conseil municipal soumet l'affaire aux tribunaux en alléguant que la fabrique constituait une menace à la sécurité de la population. La compagnie prétend que son produit, qu'elle appelle « virite », ne présente aucun danger d'explosion et se met en frais de le prouver.
Les dirigeants de l’entreprise réussissent à persuader le tribunal d'assister à une expérience. Comme on pouvait s'y attendre, la compagnie « met le paquet » et l'expérience est positive et très spectaculaire. Un chimiste, avec une boîte contenant l'explosif, monte sur le toit d'un immeuble et la laisse tomber. On cligne des yeux... Ouf ! Rien. Puis, il craque une allumette et met le feu sous la boîte... L'explosif brûle sans exploser. Ensuite, test suprême, il prend un pistolet, vise consciencieusement la boîte, puis tire dessus. Pan ! Pan ! Toujours rien. La fameuse « virite » reste inerte ! Étonnant, stupéfiant devait-on se dire devant les agents satisfaits et souriants de la compagnie.
Or, on le sait bien, les explosifs sont faits pour exploser. Mais le tribunal est tellement impressionné par la performance du chimiste qu'il oublie cette finalité et fait fi des avertissements de l’oblat Alexandre Lajeunesse, professeur de sciences et mathématiques à l’Université d’Ottawa. Jamais le Tribunal ne s'inquiète de la façon dont cet explosif détonne et permet à la General Explosive de continuer ses opérations. Bien que les dirigeants de la fabrique d’explosifs aient crié sur toutes les tribunes que leur produit n'était pas dangereux, ils ne sont pas assez bêtes, on s'en doute bien, pour vivre dans les parages de l'usine : le président habite à Ottawa. Or, il avait évité de dire que du fulminate de mercure, l'agent détonateur de la « virite », était aussi entreposé dans les bâtiments de cette usine, avec les explosifs !
C'était un dimanche...
Le dimanche 8 mai 1910, une foule d'environ 2 000 personnes assiste à une joute de base-ball au parc de la Petite Ferme, sur la rive droite du ruisseau de la Brasserie, à quelques centaines de mètres à l'est des cinq bâtiments de la fabrique. Il est environ 17 h 30 quand la joute prend fin. Quelques minutes plus tôt, un incendie s'est déclaré dans les bureaux de la fabrique d’explosif. Un certain Lafranchise, qui habite près de là, appelle les pompiers. La borne-fontaine la plus proche étant à 900 mètres de la fabrique, les pompiers ne peuvent donc pas intervenir efficacement.
Les spectateurs quittent le terrain de balle quand un groupe d'hommes remarque un feu de broussailles entourant les bâtiments de la General Explosives de l'autre côté du ruisseau de la Brasserie. Entraînant avec lui une foule de curieux que les pompiers auront du mal à contenir, le groupe se dirige vers l'incendie dans l'intention de prêter main-forte aux pompiers. Mais ces derniers n'ont pas besoin d'aide et ne veulent surtout pas que la foule s'approche, car ils connaissent le danger d'explosion. Les policiers aidés des pompiers entreprennent d'éloigner les curieux. Soudain, quelqu'un crie que la poudrière va sauter.
Presque coup sur coup, vers 17 h 45, trois détonations secouent l'atmosphère sur un rayon de cinq à six kilomètres et sèment, en un clin d’œil, des cadavres et des pauvres corps mutilés. Ces explosions propulsent, à une vitesse folle et dans toutes les directions, les blocs de pierre de l'entrepôt qui s'abattent un peu partout sur la ville, particulièrement sur les maisons des ouvriers de la Petite Ferme, tuant et blessant une quarantaine de personnes. De grosses pierres de 100 et même 200 kilos tombent dans la rue Chaudière (Saint-Rédempteur).
La panique
Pendant un instant, c’est le silence, morne et accablant. Revenue de sa surprise, la population du Vieux-Hull panique. Des femmes, des hommes et des enfants pris de terreur se mettent à courir dans les rues, les bras chargés de vêtements ou d'autres objets de ménage, à la recherche d'un abri. Des lamentations, des pleurs de désespoir se font entendre dans les rues, dans les maisons éventrées. Certains sont convaincus que la comète de Halley – qui devait apparaître à la fin du mois – vient de heurter la Terre. D'autres, en proie à une crise de nerfs, s'attendent à ce qu'une nouvelle explosion détruise toute la ville. La plupart des maisons sises dans la partie nord de la rue Chaudière sont soit détruites, soit lourdement endommagées. D'autres maisons de l'île de Hull, principalement dans les rues Adélaïde, Ann (Garneau) et Papineau ont subi de lourds dégâts. Certains bâtiments sont si endommagés qu'ils seront tout simplement démolis. À Ottawa, la foule court se masser sur la colline du Parlement, comme d'habitude en pareils moments, d'où elle cherche à voir le déroulement de la catastrophe.
L’explosion a fait 11 morts, dont plusieurs enfants, ainsi qu’une trentaine de blessés. Peu de temps après, un journal de la capitale prétendera que l'explosion avait hâté la mort de deux femmes malades d'Ottawa, mortes de frayeur. Enfin, quelqu'un a voulu préserver cette tragique histoire et en a fait une complainte :
C'était le 8 de mai une alarme fut sonnée
La foule y accourut avec empressement
Et se précipita vers les plus grands dangers
Risquant d'être engloutie presque soudainement…
Pour en savoir plus :
Du même auteur, Une ville en flammes, Hull, Éditons Vents d'Ouest, 1997.
26 avril 1900. Jusqu'à ce jour, le printemps est plutôt doux, et en ce matin tragique le mercure indique 17,2°C à Hull (aujourd'hui un secteur de Gatineau).
Vers 10 heures 45, la jeune épouse de Napoléon Guimond, Malvina Forget, active le poêle de la cuisine du 101, rue Chaudière pour préparer le dîner. Mais la cheminée qui est défectueuse prend feu une quinzaine de minutes plus tard. Comme le vent souffle à plus de 65 km à l'heure, les flammes embrasent rapidement le toit de la maisonnette pour se communiquer à une grange, puis aux maisons avoisinantes entassées les unes contre les autres.
Les pompiers sont promptement appelés sur les lieux. Mais, à leur arrivée, l'incendie est déjà devenu conflagration. On mande tout de suite à Hull la brigade des pompiers d'Ottawa qui, malgré ses deux pompes à incendie, est tout aussi impuissante devant l'océan de flammes qui déferle sur la ville. La chaleur est telle qu'aucun pompier ne peut s'approcher à moins de 30 mètres du brasier. Puis les brigades de pompiers des usines entrent en action, sans plus de succès. L'incendie se déplace à un rythme d'enfer. Des fragments de bardeaux en feu, poussés par le vent, se détachent des toits des maisons pour aller choir sur d'autres toits de bardeaux qui s'enflamment à leur tour. Les scieries font alors entendre leurs sifflets pour que des milliers de travailleurs combattent l'incendie qui menacent les grandes industries des Chaudières. Devant l'intensité des flammes qui enveloppent les maisons les unes après les autres et la chaleur insupportable qui leur grille le visage, les pompiers retraitent.
À 11 heures 30, le feu a déjà consumé une partie des rues Chaudière (Saint-Rédempteur), Wright, Wellington et Main (du Portage). Au milieu des maisons qui flambent comme des torches pour ensuite s'effondrer dans d'affreux craquements, la population apeurée se hâte de mettre ses meubles à l'abri. Des gens affolés et chargés de ce qu'ils ont de plus précieux emplissent les rues, se coudoyant, se bousculant et semant ici et là des parties de leur fardeau. Des femmes effarées sortent de leur maison en toute hâte et implorent les passants de sauver leurs biens. Le crépitement des flammes, l'écroulement des maisons, le hennissement des chevaux effrayés, accompagnés par le roulement d'une centaine de voitures chargées d'effets mobiliers qui défilent dans les rues produisent un vacarme assourdissant. Ceux qui n'ont pas de voitures transportent leurs effets d'un endroit à l'autre, et au fur et à mesure que l'élément destructeur progresse.
plus précieux emplissent les rues, se coudoyant, se bousculant et semant ici et là des parties de leur fardeau. Des femmes effarées sortent de leur maison en toute hâte et implorent les passants de sauver leurs biens. Le crépitement des flammes, l'écroulement des maisons, le hennissement des chevaux effrayés, accompagnés par le roulement d'une centaine de voitures chargées d'effets mobiliers qui défilent dans les rues produisent un vacarme assourdissant. Ceux qui n'ont pas de voitures transportent leurs effets d'un endroit à l'autre, et au fur et à mesure que l'élément destructeur progresse.
La ville baigne dans une atmosphère irréelle. Vers 11 h 45, le feu s'attaque aux cours à bois de la compagnie Eddy et de la Hull Lumber. Puis, une colonne de feu traverse la rue Bridge (Eddy) pour s'attaquer à la manufacture de papier où elle brûle10 000 tonnes de papier. La chaleur est telle que l'un des rouleaux de 7 tonnes de la machine à papier numéro 5 casse en deux. C'est ensuite au tour de la manufacture d'allumettes à prendre feu; elle contient 20 000 caisses de bâtonnets phosphorés. À 13 heures, le tiers de la ville est la proie des flammes.
Des milliers de personnes sont massées sur les hauteurs d'Ottawa; elles croient que la rivière des Outaouais suffira à protéger la capitale de la conflagration. Mais, le vent soufflant du nord-ouest projette une nuée de débris embrasés de l'autre côté de la rivière qui communique le feu à un hangar de la scierie Booth et aux innombrables piles de planches de bois qui propagent la conflagration dans tout le Flat et les faubourgs environnants – Rochesterville et Hintonburg –, jusqu'à la Ferme expérimentale.
À Ottawa
L'incendie est terrifiant. Les flammes, poussées avec rage par le vent qui rugit, s'étendent de Hull à Ottawa sur une distance de six kilomètres. C'est une véritable mer de feu déchaînée ; 75 millions de mètres de planches de bois brûlent. On fait appel aux pompiers de Montréal, de Brockville, et de Peterborough par télégramme.
Vers les 14 heures, la rivière des Outaouais paraît s'embraser : des piles de planches et des billots en flammes, libérés par la destruction des glissoirs et l'effondrement des quais, descendent le cours d'eau ballottés violemment par les eaux turbulentes, et propagent l'incendie sur les deux rives de l'Outaouais. Vers les 16 heures, le vent change de direction et se met à souffler du sud-est. Il pousse les tisons, provenant des amas de planches enflammées qui descendent la rivière, sur les piles de bois entreposées dans les cours des scieries Gilmour et Hughson. La lutte est ardue parce que la pression d'eau est faible à cause du trop grand nombre de bornes-fontaines laissées ouvertes dans le centre-ville vu la retraite précipitée des pompiers.
 À l'usine de pompage de Hull, située sur un petit ilôt du ruisseau de la Brasserie, les employés municipaux François Bélanger, Paul Miron et Isaïe Trudel sont restés au poste en dépit du drame qui se déroule sous leurs yeux : de l'usine, ils peuvent voir leur famille aux prises avec la conflagration et même leur maison brûler! Puis, vingt fois l'usine et le ponceau qui les relient à la terre ferme prennent feu. Et vingt fois, ils éteignent les flammes. Poussés par un sens d'abnégation et une conscience civique extraordinaire, les trois courageux Hullois – véritables héros du Grand Feu – réussirent à maintenir la pression d'eau de l'aqueduc à 45 kilogrammes, donc à alimenter les bornes-fontaines de la ville tout au long de cette horrible journée. À 18 h 20, les flammes s'attaquent à l'hôtel de ville, dans l'indifférence générale.
À l'usine de pompage de Hull, située sur un petit ilôt du ruisseau de la Brasserie, les employés municipaux François Bélanger, Paul Miron et Isaïe Trudel sont restés au poste en dépit du drame qui se déroule sous leurs yeux : de l'usine, ils peuvent voir leur famille aux prises avec la conflagration et même leur maison brûler! Puis, vingt fois l'usine et le ponceau qui les relient à la terre ferme prennent feu. Et vingt fois, ils éteignent les flammes. Poussés par un sens d'abnégation et une conscience civique extraordinaire, les trois courageux Hullois – véritables héros du Grand Feu – réussirent à maintenir la pression d'eau de l'aqueduc à 45 kilogrammes, donc à alimenter les bornes-fontaines de la ville tout au long de cette horrible journée. À 18 h 20, les flammes s'attaquent à l'hôtel de ville, dans l'indifférence générale.
Après le feu
Comme le vent s'est apaisé, on réussit peu après minuit à maîtriser les flammes. Après plus de 12 heures de lutte acharnée, pompiers et combattants sont épuisés. Enfin, la conflagration est terminée. Les ruines fumeront pendant près de deux mois et les pompiers ont fort à faire pour empêcher le feu de reprendre. Près de la moitié de la ville de Hull (42%) et du cinquième (20%) de celle d'Ottawa ne sont plus que débris fumants; 14 000 personnes sont désormais sans abri. Des masses énormes de cendres rouges couvrent le sol à perte de vue. On ne peut plus distinguer le tracé des rues à cause de l'amoncellement des ruines. Pans de chaux brûlants, rochers effrités, arbres noircis et quelques cheminées dressées constituent la plus grande partie du paysage hullois. Rue Chaudière, la maison qu’occupaient les Guimond narguent les passants : elle n'est qu'à moitié détruite. Rue du Lac (Laval), les deux propriétés de Philorum Daoust, restées debout, dégoulinent de saumure, de vinaigre et de mélasse, produits qui se sont avérés de bons pare-feu.
Des centaines de personnes traversent à Ottawa par le bateau-passeur pour trouver un abri dans la basse-ville ou dans de grands édifices de la capitale. La plupart des familles sinistrées sont cependant restées à Hull et 400 d'entre elles s'installent, plutôt mal que bien, sur les bords des petits lacs Flora et Minnow, pour y passer la nuit en plein air. Des hommes et des femmes, assis sur des chaises ou des malles, contemplent les tourbillons de fumée et les langues de feu qui emportent avec eux leurs souvenirs. De jeunes enfants épuisés dormaient sur des matelas sauvés des flammes, d'autres reposent recroquevillés sur des malles.
Source :
Voir mon ouvrage, Une ville en flammes, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1997.
À combien d’endroits peut-on traverser la rivière des Outaouais à pied sec sans emprunter un traversier ? Nous pouvons traverser la rivière à onze endroits : Témiscaming-Thorne (barrage), Rapides-au-Joachim (barrage), le pont de l’Île-aux-Allumettes (île aux Allumettes-Pembroke), Portage-du-Fort (barrage), le pont Champlain, le pont ferroviaire Prince-de-Galles, le pont des Chaudières, le pont du Portage, le pont Interprovincial (dit Royal Alexandra), le pont Cartier-Macdonald et le pont du Long-Sault (Grenville-Hawkesbury) qui a remplacé le vieux pont Perley.
Le plus intéressant de ces ponts, du moins pour l’histoire, est le pont Chaudière. Autrefois appelé Union, il est le premier pont à franchir la rivière des Outouais. Commencée en 1826 sa construction se termine en 1828. Ce pont est composé d’une série de sept ponts sautant entre les îles et les promontoires rocheux. La travée la plus longue est celle qui franchit la chute de la « Grande Chaudière » sur une distance de 70 mètres. La série de ponts est construite sur des arches de pierre, mais aussi sur des arches de bois, avec un tablier en madriers. Six ans après son inauguration, le pont est en mauvais état et on étend deux chaînes sous la structure pour la renforcer. Un accident est évité de justesse quand on le ferme à la circulation le 5 mai 1836, car il s’écroule l’après-midi du 18 mai.
C’est sur le premier pont Union que Jos. Montferrand a livré bataille, seul contre une cinquantaine de shiners, au-dessus de la travée qui franchit la chute de la « Grande Chaudière ». L’historien canadien Benjamin Sulte a écrit qu’après cette bataille, le sang coulait du parapet du pont dans la rivière !
Les travaux du deuxième pont Union ne commenceront qu’en mai 1843. Il s’agit d’un pont suspendu à de gros câbles d’acier retenant la superstructure. Le pont est inauguré avec éclat le 17 septembre 1844. Chose intéressante, le pont est surveillé par un ingénieur qui, matin et soir, resserre ou desserre les câbles d’acier pour compenser la dilatation ou la contraction dues aux écarts de température. En 1899, le pont, miné par l’humidité des chutes et la fumée des usines, est remplacé par un pont en poutre d’acier, semblable à celui que nous voyons aujourd’hui et reçoit le nom de pont Chaudière. Très endommagé dans le Grand feu du 16 avril 1900, il est réparé avant d’être remplacé en 1919 par l’actuel pont (série de six ponts). Soulignons qu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, le pont Chaudière était l’endroit privilégié par les dépressifs pour s’y suicider.
Le pont Interprovincial
Le deuxième pont le plus intéressant est sans contredit le pont Interprovincial aussi appelé pont Royal Alexandra. En 1880, pendant la construction du pont Prince-de-Galles sur la ligne ferroviaire de la compagnie Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental (qui sera vendu au Canadian Pacific en 1882), la compagnie Pontiac, Pacific Junction Railway, qui exploitait un chemin de fer entre Aylmer et Waltham, reçoit l’autorisation d’étendre son service jusqu’à Ottawa. Un groupe de 27 hommes d’affaires de la région, dont le président de la compagnie ferroviaire dépose une proposition en mars 1890 pour construire un pont à péage pour les trains, les voitures et les piétons entre la Pointe Nepean et le petit village amérindien à Hull.
Les travaux de construction du pont devaient commencer en 1892 et se terminer en cinq ans. Le 20 avril 1892, on lève la première pelletée de terre en même temps sur les deux rives de l’Outaouais. Mais à cause de problèmes de financement, la construction est reportée de plusieurs années. En 1894, la Ville d’Ottawa souscrit 150 000 dollars à la construction du pont à la condition express que les droits de péage soient abolis. À Gatineau (Hull), un groupe d’hommes d’affaires, mené par le marchand Basile Carrière, s’oppose en vain à la construction du pont en arguant qu’il aura pour effet de détourner leur clientèle commerciale vers le centre-ville d’Ottawa. (L’avenir a donné raison à Basile Carrière.)
terminer en cinq ans. Le 20 avril 1892, on lève la première pelletée de terre en même temps sur les deux rives de l’Outaouais. Mais à cause de problèmes de financement, la construction est reportée de plusieurs années. En 1894, la Ville d’Ottawa souscrit 150 000 dollars à la construction du pont à la condition express que les droits de péage soient abolis. À Gatineau (Hull), un groupe d’hommes d’affaires, mené par le marchand Basile Carrière, s’oppose en vain à la construction du pont en arguant qu’il aura pour effet de détourner leur clientèle commerciale vers le centre-ville d’Ottawa. (L’avenir a donné raison à Basile Carrière.)
La construction du pont est confiée à H.J. Beemer de Montréal alors que la structure d’acier est fabriquée par la fameuse Dominion Bridge de Montréal. Les travaux de construction commencent le 7 octobre 1899. Ils s’avèrent plus difficiles que prévu parce que le fond de la rivière compte une couche de dépôts (bran de scie, écorces, etc.) d’environ 18 mètres de profondeur. Le pont est à cinq travées, larges de 19 mètres et d’une longueur totale de 563 mètres. La voie ferrée passe entre deux voies pour voitures et tramways. La travée principale du pont, qui est de 169 mètres, est, en 1901, la plus longue au Canada et la quatrième au monde. Pour construite l’approche à la pointe Nepean, il a fallu miner 39 500 verges cubes de roc. En novembre 1900, 400 hommes travaillaient à la construction du pont sur lequel il y aura eu un accident mortel.
Enfin, la construction du pont est achevée le 12 décembre 1900. Le pont, que l’on appelle tout simplement Interprovincial, est inauguré le 18 février 1901 soit deux mois avant le début de la circulation ferroviaire régulière (22 avril 1901). En septembre 1901, le nom du pont est changé pour celui de Royal Alexandra (reine de l’époque) durant la visite du duc de Cornwall (futur George V). Toutefois, la population conservera le nom d’Interprovincial bien que d’anciens travailleurs l’aient aussi appelé Beemer. Le pont Interprovincial est sans doute le plus beau de la région.
Ce fameux pont Interprovincial a subi au moins deux incendies. Il faut savoir que le tablier du pont d’acier était fait de longues planches de bois. Pas étonnant qu’il ait brûlé. Le premier incendie a lieu le 15 mai 1907. On pense que des tisons échappés de la cheminée d’un train en auraient été la cause. Le deuxième incendie a lieu le 29 mars 1946. C’est un incendie spectaculaire. Comment a-t-il commencé ? Voici ce qu’en m’a dit un témoin de l’époque qui a longtemps gardé le secret pour lui de peur de ne pas être cru (on peut s’imaginer la bataille judiciaire qui aurait suivi entre la Hull Electric et la E.B. Eddy, si cet homme parlé à cette époque). Ce jour-là, mon témoin, M. Majeau, barbier chez M.S. Fortin, rue Laurier, s’adonne à regarder dehors. Que voit-il ? Un p’tit char électrique (tramway) de la « Belt Line » (Hull Electric) qui effectue un virage rue Baillot. D’une boîte située au-dessus des boggies du tramway s’échappe de l’étoupe enflammée. Lui même éteint de ses pieds une « touffe » de feu sur la rue. Il y en a d’autres qui tombent sur le pont. Et c’est peu après le passage du tramway que le feu a éclaté sur le tablier du pont.
Et quel feu spectaculaire ? Non seulement détruit-il une partie du tablier du pont, mais il se communique à la pitoune entassée dans la cour à bois de la E.B. Eddy. Pendant plusieurs heures, on a eu peur de voir le Grand Feu de 1900 se répéter. L’incendie ne dure pas moins de quatre jours et consume 15 000 cordes de bois. Une fois l’incendie éteint, les pompiers de Hull n’ont jamais plus redémarré le moteur de deux autopompes une fois arrêté. Ils ont dû en faire installer de nouveaux.
Un nouveau pont ?
Enfin, vous savez sans doute que notre chère Commission de la capitale nationale (CNN), qui me semble peu au courant du protocole de Kyoto puisqu’elle doit croire qu’il n’y a pas assez de véhicules dans notre région, a commandé une étude pour la construction de deux autres ponts entre Gatineau et Ottawa. Saviez-vous que c’est en décembre 1935 que les autorités municipales de Deschênes, avec l’appui des députés de leur circonscription, ont demandé la construction d’un pont entre Britannia et le village de Deschênes ? À l’époque, on estimait que ce pont aurait une longueur de 500 mètres et qu’il coûterait 100 000 dollars. L’histoire radote, n’est-ce pas ?
Sources :
Brault, Lucien, Les liens entre deux villes, 1989.
Le Temps (Ottawa), 1899-1901.
Documentation personnelle
En 1970, les entreprises Dasken veulent construire, dans l'ancienne ville de Hull, six immeubles en hauteur, quatre de dix étages et deux de seize étages, sur un terrain de la rue Saint-François dont le zonage ne serait pas apparu clair. Le maire Marcel D'Amour fait alors appel au conseiller juridique de la Ville, Me Roy Fournier (il est aussi député-ministre libéral), pour obtenir une opinion que le premier magistrat de la Ville ne trouve pas suffisamment explicite. Le Conseil municipal demande alors un deuxième avis juridique à son conseiller qui répond que la Ville peut accorder un permis de construction sur le terrain en question. C'est ainsi que débute la célèbre « affaire Dasken » qui éclaboussera la gent politicienne hulloise.
L'Association des propriétaires des Jardins Taché, dirigée par l'avocate Renée Joyal et représentée par de brillants avocats dont Ronald Bélec, est contre ce projet qu'elle contestera, avec succès, jusqu'en Cour suprême. Mais comme la Ville a accordé un permis de construction en toute bonne foi, le maire estime qu'il ne doit pas laisser tomber le promoteur qui a déjà investi deux millions de dollars et refuse d'accorder un permis de démolition de l'immeuble inachevé tel que l'ordonne la Cour suprême le 20 décembre 1971. Le député fédéral de Matane, Pierre de Bané, exige la démission des autorités municipales et principalement celle du maire D'Amour.
La Ville organise alors une consultation des propriétaires hullois qui, à 76 %, sont en faveur de la réalisation du projet Dasken. Le 22 février 1972, le conseil municipal adopte une résolution pour autoriser le conseiller juridique de la ville, Me Roy Fournier, député et ministre du gouvernement québécois, à envoyer une telle requête à Québec. C'est le député libéral de Hull, Oswald Parent, qui en fait la demande au gouvernement de Robert Bourassa.
Au mois d'août 1972, la Ville organise un référendum dans les secteurs concernés par le règlement de zonage pour le changer. Les résidants refusent le changement. La Ville conteste les victoires juridiques de l'Association en allant voir le ministre et le sous-ministre des Affaires municipales pour obtenir l'adoption d'un projet de loi privé qui légaliserait la construction du projet Dasken. Ministre et sous-ministre sont d'accord avec la demande hulloise. Puis le Conseil municipal obtient un rendez-vous avec le premier ministre Robert Bourassa pour obtenir son accord à l'adoption du projet de loi privé. Juste avant la rencontre, le député-ministre Roy Fournier a un entretien avec Robert Bourassa. Or, quand le maire et des membres de son conseil entrent dans le bureau du premier ministre, ils n'y trouvent pas Roy Fournier qui est soudainement devenu injoignable pour le Conseil municipal et même pour le premier ministre, pour qu'il vienne expliquer lui-même l'avis juridique qu'il avait auparavant donné au Conseil municipal de Hull. La station radiophonique CJRC crie au scandale :
On assiste maintenant à un tripotage en règle au niveau politique. On ne peut accuser les contribuables de chercher noise à des décisions municipales [...] l'erreur fut commise, que ce soit à cause de favoritisme politique, partisan ou non.
Le barreau du Québec dénonce cette ingérence politique pour annuler une décision de la Cour suprême. Le barreau a gain de cause. Les demandes sont rejetées par l'Assemblée nationale. Le maire, qui admettra qu'un avocat puisse errer, n'accepte pas qu'il se cache pour ne pas avoir à s'expliquer ni soutenir son avis juridique. L'affaire Dasken éclabousse terriblement Marcel D'Amour. Il se voit attaquer de toute part, particulièrement par la presse dont un journaliste de Québec, Benoît Lavoie, résume ce qui est convenu d'appeler « L'affaire Dasken » :
...tous les acteurs de cette pénible affaire ont [...] un lien commun, un lien sacré qui est celui du parti libéral du Québec. Il y a d'abord Marcel D'Amour, maire de Hull, qui, avant son accession à la mairie et alors qu'il exerçait un commerce dans l'un des immeubles appartenant aux frères Bourque, avait dû fermer ses portes ou à défaut, consentir une cession volontaire de ses biens; selon la déclaration de M. Pierre Bourque, en décembre 1970, M. D'Amour leur devait toujours la somme de $12,000 pour loyer, laquelle ne lui était pas réclamée. M. Pierre Bourque était secrétaire trésorier de l'exécutif de l'Association libérale du comté de Hull et ami intime de M. Oswald Parent, député de Hull, ministre d'État aux Affaires intergouvernementales et membre du Conseil du Trésor. Selon des informations non démenties de l'époque, c'est grâce à l'organisation de M. Parent que M. D'Amour dut sa réélection à la mairie en novembre 1970. Il faut nommer enfin Me Roy Fournier, député libéral de Gatineau et solliciteur général du Québec qui fut conseiller juridique de la municipalité de Hull jusqu'au 29 avril 1970 alors que Me Marcel Beaudry, président de l'Association libérale de Hull et organisateur en chef de M. Parent, prenait la relève.
Marcel D'Amour doit alors révéler ses affaires personnelles pour éliminer les malveillantes insinuations qui sont colportées à son égard sur ses relations avec les frères Bourque, premiers détenteurs du terrain Dasken, et démontre qu'il a contracté une dette envers la Banque Provinciale pour payer la faillite de son commerce. La famille D'Amour souffre énormément de cette affaire commentée ad nauseam par les médias. Les enfants sont mal à l'aise et souffrent des quolibets que leurs camarades d'école leur adressent. Marcel D'Amour quitte alors la mairie et accepte un poste que l'on lui offre à la Commission de révision du bureau de l'évaluation, à la Communauté régionale de l'Outaouais. Il remet sa démission le 13 septembre 1972. Quant à Roy Fournier, il quitte la politique le 2 août 1972, puis est nommé... juge à la Cour provincial du Québec !
Cette bataille terminée, il restait une dernière étape : faire démolir, aux frais de Dasken, les édifices en construction, soit un bâtiment de deux étages et un autre de sept étages. Dasken ayant déclaré faillite, ce sont les membres de l’Association qui firent démolir les édifices, en partie à leurs frais. L’entrepreneur chargé de la démolition sera accueilli par une foule enthousiaste massée sur la rue Saint-François.
De l'affaire Dasken, il reste aujourd'hui un monument – Enfin le soleil – fait des restes de l'immeuble démoli et un enseignement étudié dans les cours d'urbanisme et de droit municipal du Québec.
Sources :
Barrière, Carole, Justice et politique ou l'affaire Dasken in Revue juridique Thémis, no 3, 1972.
Le Droit (Ottawa), 21 décembre 2012.
L'Affaire Tissot : une campagne antisémite
Pendant les noires années 1930, les taux de chômage oscillent entre 20 % et 35 %. Cette situation est propice à l’émergence de groupuscules d’extrême droite qui tiennent la communauté juive responsable à la situation économique ! On a oublié que l’Outaouais a eu, elle aussi, ses antisémites.
Le Canada n’est pas imperméable au courant idéologique d’extrême droite qui déferle sur l’Europe. En 1933, des Swastikas Clubs voient le jour au Canada anglais. À Montréal, en 1934, un illuminé, Adrien Arcand, fonde le Parti national socialiste chrétien : ce sont les « chemises bleues ».
Le nationalisme d’Arcand est résolument fédéraliste et… antisémite. Il faut dire que Mussolini et Hitler ont la cote auprès de nombreux politiciens, même au Canada. Par exemple, en 1935, l’année même où Hitler supprime les droits civiques des Juifs en Allemagne, William Lyon Mackenzie King, le premier ministre 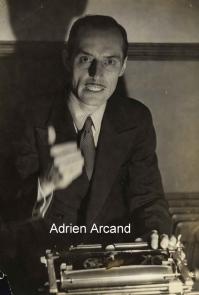 du Canada, écrit dans son journal : « Hitler et Mussolini, quoique dictateurs, se sont vraiment efforcés de procurer aux masses [divers bienfaits] et ainsi s’assurer leur appui. […] La manière dictatoriale était peut-être nécessaire afin de retirer ces bienfaits aux privilégiés qui les monopolisaient jusque-là […] » Les supposés privilégiés sont évidemment les démocrates et les… Juifs.
du Canada, écrit dans son journal : « Hitler et Mussolini, quoique dictateurs, se sont vraiment efforcés de procurer aux masses [divers bienfaits] et ainsi s’assurer leur appui. […] La manière dictatoriale était peut-être nécessaire afin de retirer ces bienfaits aux privilégiés qui les monopolisaient jusque-là […] » Les supposés privilégiés sont évidemment les démocrates et les… Juifs.
Bien avant King, le premier ministre du Canada, R.B. Bennett, chef du Parti conservateur, a même été l’un des bailleurs de fonds du journal fasciste Le Goglu d’Adrien Arcand et de Joseph Ménard ! Cet hypocrite n’hésitera pourtant pas à assister à l’ouverture de la United Palestine Appeal, en novembre 1934, au côté du commerçant juif d’Ottawa, A. J. Freiman.
Comme la crise qui a débuté à la fin de 1929 perdure, on cherche des coupables. Les Swastikas Clubs, Canadian Nationalist Party et Parti national socialiste chrétien ont trouvé le responsable de nos malheurs : le Juif ! Il faut dire que les Juifs de cette époque ont le dos large. Rappelons-nous que les catholiques récitaient encore une prière à l’intention des juifs « perfides » au cours de leurs cérémonies du Vendredi saint, prière qui ne sera abolie qu’en 1960. Je souligne toutefois que ces organisations fascistes ne comptent pas beaucoup de membres. On pense qu’au plus fort de son existence, le Parti national socialiste chrétien aurait compté tout au plus 2 000 adhérents.
Adrien Arcand et Joseph Ménard publient, à partir de 1934, le journal montréalais Le Patriote lequel est aussi diffusé à Ottawa. Ce journal est avant tout un organe antisémite qui ne cesse d’injurier les commerçants juifs. Par exemple, le numéro du 11 juillet 1935 : Un autre pouilleux [Juif] qui se lamente ; le 25 septembre 1935 : Les Juifs « Fils de Satan » ; le 3 août 1935 : Protégez vos filles et vos femmes ! Évitez-leur tout contact avec le Juif !, etc.
Antisémitisme à Ottawa
C’est dans ce cadre que débute, à Ottawa, à l’hiver 1935, une campagne antisémite d’une rare violence verbale.
Dans la capitale fédérale se trouve une minorité raciste. Celle-ci s’exprime à travers deux médiums : L’Achat chez-nous, organisation apparemment créée pour défendre les commerces canadiens-français (mais qui s’attaque aux commerces juifs), et le journal Le Patriote (Montréal) dans lequel paraît une « Chronique d’Ottawa » rédigée le plus souvent par un ou des auteurs anonymes. Celui qui assure la diffusion du journal à Ottawa est un policier, Jean Tissot.
 Né en Belgique, le policier Tissot arrive au Canada avec son épouse et deux enfants en 1908. Il se joint aux forces policières de la Ville d’Ottawa où il devient détective. Cet excellent catholique, membre du Tiers-Ordre de Saint-François, de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de la Ligue du Sacré-Cœur, a toutefois une idée fixe délirante portée par la haine. Pour lui (et je cite), « […] le Juif est un chancre dans la société qu’il faut extirper au plus vite si la paix et la prospérité doivent revivre. »
Né en Belgique, le policier Tissot arrive au Canada avec son épouse et deux enfants en 1908. Il se joint aux forces policières de la Ville d’Ottawa où il devient détective. Cet excellent catholique, membre du Tiers-Ordre de Saint-François, de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de la Ligue du Sacré-Cœur, a toutefois une idée fixe délirante portée par la haine. Pour lui (et je cite), « […] le Juif est un chancre dans la société qu’il faut extirper au plus vite si la paix et la prospérité doivent revivre. »
Comment est-il arrivé à cette conclusion ? Il l’a lui-même expliqué dans une lettre adressée au journal Le Devoir (Montréal) le 12 août 1935 : « Durant mes vingt-cinq années de service, j’eus l’occasion d’observer le parasite le plus destructeur de la création : la gent hébraïque. J’ai vu le Juif de près […] Je l’ai vu à l’œuvre s’emparant du commerce chrétien, s’enrichissant au moyen de l’incendie, la banqueroute frauduleuse, l’usure, le recel, la contrebande, le trafic du vice. » Notons que ce personnage est un membre de La Patente dont le nom officiel est l’Ordre de Jacques-Cartier.
Chef de file de l’Achat chez-nous à Ottawa, le policier est aussi devenu chroniqueur du journal antisémite montréalais Le Patriote et distribue de la documentation raciste et haineuse. Poursuivi en justice par A. J. Freiman, propriétaire du célèbre magasin à rayons Freiman, rue Rideau, pour libelle, le policier est suspendu de ses fonctions, condamné pour libelle et enfin contraint à démissionner.
La commanderie Dollard de l’Ordre de Jacques-Cartier, autrement appelé La Patente (organisme secret visant la promotion des Canadiens-Français), met alors sur pied un Comité de défense qui organise des assemblées dans les salles paroissiales de la région et au Monument national où l’on prononce des discours antisémites et anticommunistes.
L’accusation de libelle n’amoindrit pas le moins du monde les convictions racistes de l’ex-policier qui, à la demande de la Patente, se présente comme candidat anticommuniste aux élections fédérales de 1935 dans le comté d’Ottawa-Est. Le Belge a l’appui de l’avocat Joseph-Ulric Vincent, fondateur du Monument national et de plusieurs hommes d’affaires.
Il lance sa campagne électorale au Monument national entouré de deux membres du Parti national socialiste chrétien : l’avocat montréalais Saluste Lavery et le Dr Paul-Émile Lalanne, médecin avorteur et bras droit d’Adrien Arcand. Toutefois, le journal Le Droit, propriété des O.M.I., appuie son adversaire, le député libéral Edgar Chevrier. Bien que défait, l’ex-policier obtient quand même 3 899 voix. Chevrier étant nommé quelques mois plus tard au poste de juge à la Cour suprême de l’Ontario, l’ex-policier représente sa candidature dans Ottawa-Est en 1936. Défait, cette fois par le Libéral Pinard, il obtient quand même 3 449 voix.
Au lendemain de sa seconde défaite électorale, l’ex-policier est aux abois. Il n’a plus d’emploi et le journal Le Patriote a cessé de paraître. La Patente vole à son secours. Le secrétaire de la commanderie Dollard écrit, avec la permission de la Chancellerie, à tous les membres de l’Ordre : « […] vient faire un appel pressant aux XC (commanderies) - sœurs en faveur d'un de ses frères, M. Jean Tissot, que son dévouement, pour l'expansion économique des Canadiens-Français dans la Capitale a rendu victime de son patriotisme. […] à, la suite de la distribution d'un de ces derniers [pamphlets], dans lequel il attaquait avec tant de raison en particulier le juif Frieman (sic) d'Ottawa […] il fut poursuivi pour libelle. Entre-temps, des influences juives, afin de mieux terrasser ce Canadien-Français qui mettait à découvert toutes leurs turpitudes, réussirent à lui faire perdre sa position à l'hôtel de ville qu'il occupait depuis près de 25 ans. »
La campagne d’Achat chez nous conduite par l’Ordre de Jacques-Cartier est un échec. Et le journal Le Patriote est bien obligé d’admettre que la majorité des Canadiens français n’hésite pas à faire ses achats dans des magasins propriétés de Juifs, ce qui est tout à l’honneur des NÔTRES.
Source :
OUIMET, Raymond, L'Affaire Tissot : Campagne antisémite en Outaouais, Montpellier, Écrits des Hautes-Terres, 2006.
Louis Riel et ses complicités outaouaises
Mars 1874. Les membres de la Chambre des communes, à Ottawa, sont sur le qui-vive : des rumeurs font état de la présence du chef métis Louis Riel, fondateur du Manitoba, à Hull et à la Pointe-Gatineau. Or, celui-ci est activement recherché par la police de l’Ontario pour l’exécution, en 1870, de Thomas Scott, un rebelle orangiste qui avait tenté de renverser, par la force, le gouvernement provisoire du Manitoba dirigé par Riel.
La population métisse a confiance en Louis Riel et n’hésite pas à en faire son représentant au gouvernement fédéral. En février 1874, Riel est élu une seconde fois député de Provencher. Peu après, le chef métis se rend à Ottawa où il est accueilli à la gare de chemin de fer par un ancien confrère du petit séminaire de Montréal, le docteur Joseph Beaudin, qui le cache chez lui, à Hull, rue Principale (promenade du Portage).
Lorsque s'ouvre la session du Parlement du Canada, le 26 mars 1874, la grande question est de savoir si Riel aura l'audace de venir occuper son siège à la Chambre des communes comme représentant de la circonscription électorale manitobaine de Provencher. Le 30 mars, Riel, accompagné du docteur Fiset, député de Rimouski, et de plusieurs compagnons agissant comme garde du corps, se rend au parlement pour prêter serment.
Riel sait bien qu’il ne peut officiellement se présenter à la Chambre sans être arrêté par la police d’Ottawa. D'ailleurs, un certain Fred Davis a demandé l’émission d’un mandat d’arrestation à son encontre et une assemblée d’orangistes a lieu pour convoquer tous les « frères et amis » de l’Ontario. Sommé par la Chambre des communes de prendre son siège et d’expliquer sa conduite, Louis Riel évite sagement d’obtempérer à l’ordre pour le moins perfide.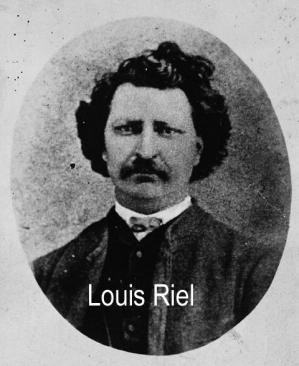
De plus, un député conservateur de l’Ontario, et grand-maître du fanatique ordre d’Orange, Mackenzie Bowell, présente une motion demandant l'expulsion immédiate du député Riel, absent de son siège. Les discours succèdent aux discours. Certains sont violents. Bien que Riel n'ait pas encore été trouvé coupable du crime dont on l’accuse et que le premier ministre John A. Macdonald ait promis l’amnistie aux membres du gouvernement provisoire du Manitoba, Riel, qui ne s'y trouve pas autrement qu'en esprit, est expulsé de la Chambre des communes par un vote de 123 voix contre 68 et le siège de Provencher déclaré vacant. Mgr Alexandre-Antonin Taché, évêque de Saint-Boniface, outré du comportement de Macdonald au sujet de ses promesses d'amnistie, écrit à un collègue : « Le Très honorable John A. Macdonald a menti (excusez le mot) comme ferait un voyou. »
Recherché par les polices ontariennes qui, motivées par la haine plus que par la justice, ont juré de mettre la main sur le défenseur des Métis, mort ou vif, Riel change de cachette tous les jours ou presque pour brouiller les recherches et ne sort qu’accompagné d’une garde du corps composée de quelques patriotes dirigés par les Hullois Michel Navion et Damien Richer. Cela ne l’empêche toutefois pas d’assister à des séances de la Chambre des communes du haut de la galerie des spectateurs.
Selon Adrien Moncion, contemporain de Louis Riel, ce dernier se rend au parlement presque tous les soirs « ...habillé comme un gentleman, le tuyau de castor sur la tête, la chaîne de montre au bedon, la canne à la main ; tantôt, il se déguisait en bon habitant, avec des habits râpés et des souiers de boeu aux pieds. » Sous différents déguisements, Riel nargue la police. On dit même qu’un certain soir, en sortant de la Chambre des communes, il a demandé une chique à un policier sans que celui-ci ne se doute un instant de l’identité de son interlocuteur.
Un réseau de complicités
Le 7 avril, environ 500 francophones s’assemblent au village de Hull pour appuyer Riel. Une autre réunion a lieu en même temps à la Pointe-Gatineau. Jamais les policiers ontariens n’auraient pu arracher Louis Riel des mains de ces hommes parce que, d’après Adrien Moncion, « ...pour nos gâs (sic), se battre c’était comme aller aux noces. » La population est aux aguets et une centaine d’hommes se donnent le mot pour venir au secours de Riel au cas où on s’en prendrait à lui. Ils ont convenu de se rassembler à l’appel d’un certain Joseph Pariseau, gardien de la pompe à incendie, rue Duke (Leduc), à Hull.
Mais les sbires orangistes ont flairé les traces de Riel et celui-ci convient qu’il vaut mieux quitter Hull. Accompagné d’Isaïe Richer et d’Adrien Moncion, Riel se rend à Angers, chez Xavier Moncion, père d’Adrien, où il reste environ deux semaines. Puis il revient dans la région de Hull. Il loge d’abord chez un certain Dumontier de la Pointe-Gatineau et ensuite chez Aldebert Quesnel qui demeurait rue Wellington, à Hull. Comme on peut le constater, Louis Riel bénéficie d’un réseau de complices bien organisé. Et ce réseau est non seulement composé d’amis, mais aussi de parents bien ancrés dans la région. En effet, une tante de Louis, Marie-Louise Riel – surnommée la Sauvagesse et aussi l’Ange gardien de la rivière (Lièvre) – qui a épousé Robert Richard McGregor en 1826 à Oka, a trois enfants et vit habituellement au lac McGregor.
Riel retourne à la Pointe-Gatineau où sa tante, Marie-Louise Riel, lui a fixé un rendez-vous. Celle-ci, accompagnée de son petit-fils Régis McGregor, le conduit à Buckingham, probablement chez François Latour époux d’Élisabeth McGregor. Enfin, Louis Riel gagne Montréal où il loge chez sa tante Lucie Riel, épouse de John Lee, avant de partir pour Saint-Paul, au Minnesota, où il arrive le 19 mai 1874.
Les pendards
De retour au Manitoba, Riel est réélu pour une troisième fois député de Provencher. Mais le gouvernement fédéral a proscrit le chef métis qui s’exile aux États-Unis où il y épouse une jeune métisse, Marguerite Monet dite Belhumeur. Rentré au Canada, Riel participe à rébellion des Métis et des Amérindiens de l’Ouest en 1885. Mais les rebelles sont défaits par les troupes canadiennes beaucoup plus nombreuses. Riel se rend alors à la police à cheval du Nord-Ouest.
Louis Riel est jugé à Regina pour haute trahison et condamné à mort. La condamnation soulève un tollé de protestations presque partout au Québec, protestations auxquelles le premier ministre conservateur du Canada, John A. Macdonald, qui est favorable aux orangistes pour des raisons bassement électorales, aurait répondu : « Même si tous les chiens de la province de Québec aboient, Riel sera pendu. » Le 16 novembre 1885, Riel est pendu haut et court.
SOURCES :
Boutet, Edgar, Le bon vieux temps à Hull, tome 1, Hull, éd. Gauvin, 1971.
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11.
Lalonde, Violet, Louis Riel, manuscrit dactylographié, incomplet, ANQ-O, P1000, D65.
Lapointe, Pierre-Louis, Buckingham, ville occupée, Hull, éd. Asticou, 1984.
Le Droit (Ottawa) 27 février et 13 mars 1924, témoignages de Florimond Desjardins et d’Adrien Moncion.
Ouimet, Raymond, Hull : Mémoire vive, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1999.
La grippe espagnole en Outaouais et à Ottawa
Depuis plusieurs semaines, le coronavirus Covid-19 fait les manchettes des médias d’information du monde entier, car c’est là une maladie contagieuse qui peut être mortelle. Ce n’est pas la première fois, dans notre histoire qu’une maladie mortelle aura frappé notre continent. En 1918, c’est la grippe espagnole qui a fait des siennes en tuant entre 20 millions et 40 millions de personnes en 1918-1919. L’Outaouais n’a pas échappé à cette grippe.
Le terme « grippe » vient du mot allemand grippen (saisir) et il a été introduit en Europe lors de l’épidémie de 1742. Il met en relief la soudaineté de l’affection. Les Italiens ont donné à cette maladie le nom d’influenza qui souligne l’influence du froid dans le déclenchement des épidémies. Les Anglo-Saxons l’ont adopté pour en faire l’abréviation flu. La grippe, qualifiée à tort d’espagnole, a pris naissance en Extrême-Orient. À l’automne de 1917, les Allemands l’ont signalé sur le front de l’est, en Russie, et en avril 1918 elle fait son apparition en Allemagne et en France. En mai suivant, elle frappe à Madrid au moment même où une grande affluence de personnes vient visiter la capitale espagnole et dans l'ouest des États-Unis.
Le 18 septembre 1918, une nouvelle nous parvient des États-Unis à laquelle on n’accorde pas trop d’attention. Elle traite de nombreux cas de grippe circonscrits à l’intérieur des camps militaires. Le 23 septembre, on parle de marins américains morts sur leur navire, dans le port de Québec, et transportés à la morgue municipale sans que des précautions n’aient été prises pour pallier les dangers de la contagion. Dès le 22 septembre, la grippe a déjà fait un premier mort à Victoriaville en la personne de Lucien Deshaies, 17 ans, du 169, rue Saint-Patrick, à Ottawa.
Dans l’Outaouais et l’Est ontarien, on signale les premières manifestations de la grippe espagnole à Ottawa, le 26 septembre, et à Hull vers le 1er octobre. Le 2 octobre, la ville d’Aylmer dénombre déjà cinq décès dus à l’épidémie. À Hull, comme ailleurs au Québec, on ne croit pas que l’épidémie de grippe puisse prendre des proportions extraordinaires. Le 7 octobre, le docteur Aubry déclare au journal Le Droit que la grippe espagnole : « [...] n’a généralement pas le caractère de gravité qu’on semble lui donner, si elle est bien traitée et si l’on prend les soins et le temps nécessaire afin d’arriver à la guérison complète [...] »
La grippe se répand très rapidement. À Aylmer, les autorités dénombrent 500 cas de grippe et 14 décès. À Ottawa, les dirigeants municipaux ordonnent la fermeture des écoles et des théâtres dès le 5 octobre. Le village de Quyon compte 3 morts les 5 et 6 octobre. Le journal Le Droit du 2 octobre précédent fait état de 800 morts à Boston, dont 152 en 24 heures !
Le 7 octobre, on compte déjà 700 cas de grippe en traitement à Hull. Les absences dans les écoles sont très élevées. À l’école Saint-Thomas-d’Aquin, une institutrice a signalé l’absence de 19 enfants de sa classe; les autres classes se trouvent dans le même état. Le 9 octobre, le Conseil municipal ordonne la fermeture des écoles de la ville.
Une mortalité en forte hausse
Le 11 octobre, le Bureau de santé de la ville d’Ottawa signale l’apparition de 600 à 700 nouveaux cas de grippe espagnole et 14 décès au cours des deux derniers jours. La situation est telle que Mgr J. O. Routhier, administrateur du forte diocèse d’Ottawa, décide d’annuler tous les offices religieux dominicaux dans les églises de la capitale.
 Des familles entières sont frappées par l’épidémie qui donne un surcroît de travail considérable aux médecins et aux pharmaciens. Ces derniers se plaignent de l’abondance des appels téléphoniques qu’ils reçoivent « à propos de tout et de rien ». « On oublie, a déclaré l’un d’eux, que nous avons actuellement quatre fois plus d’ouvrage qu’en temps ordinaire et on paraît s’être donné le mot pour nous faire faire de longues et nombreuses courses pour porter des petites commandes. Nous sommes fatigués par le surcroît nécessaire de travail [...] »
Des familles entières sont frappées par l’épidémie qui donne un surcroît de travail considérable aux médecins et aux pharmaciens. Ces derniers se plaignent de l’abondance des appels téléphoniques qu’ils reçoivent « à propos de tout et de rien ». « On oublie, a déclaré l’un d’eux, que nous avons actuellement quatre fois plus d’ouvrage qu’en temps ordinaire et on paraît s’être donné le mot pour nous faire faire de longues et nombreuses courses pour porter des petites commandes. Nous sommes fatigués par le surcroît nécessaire de travail [...] »
Le 15 octobre, le Bureau de santé de Hull ordonne l’inhumation, dans les 24 heures suivant le décès, des corps des victimes de la grippe espagnole. Quatre jours plus tôt, on avait appris que la ville de Québec comptait 156 décès depuis le début du mois et qu’Ottawa dénombrait 4 341 cas de grippe. Du 15 au 22 octobre, cette dernière ville comptera 336 décès. À Hull, les choses ne vont guère mieux puisque du 13 au 19 octobre, on inscrit 53 décès dans les registres des cimetières catholiques de la ville.
Le Droit du 25 octobre écrit qu’il est nécessaire « [...] que chacun reconnaisse la main de Dieu appesantie sur le monde entier et implore le Tout-Puissant d’éloigner l’épidémie. » Les oblats de Hull estiment, quant à eux, que c’est Dieu lui-même qui a envoyé ce terrible fléau au monde pour le châtier et n’hésitent pas à ajouter que ne pas le reconnaître serait pousser trop loin l’aveuglement.
Dans l’ancienne ville de Hull, la grippe a causé près de 200 décès d'octobre 1918 à janvier 1919. Dans l’ensemble du Québec, 406 074 personnes ont été atteintes par la grippe et 13 139 en sont mortes. L’épidémie semble avoir touché un peu plus durement l’Outaouais que l’ensemble du Québec. Dans l’ancien comté d’Ottawa, 20,3 % (3,4 % en sont mortes) de la population a été touchée par la grippe contre 17,4 % dans la province. À Hull, c’est le groupe des 18-39 ans qui a été la cible privilégiée de l’épidémie avec 37,1 % des décès. En temps normal, ce groupe ne comptait pourtant que pour 6,5 % des décès. Et la très grande majorité de ces jeunes personnes demeuraient en quartier ouvrier. Chose intéressante, aucun médecin de la ville ni aucun prêtre, infirmière ou pharmacien n’a succombé à cette grippe.
Sources :
Annuaire statistique du Québec, 1918, 1919 et 1920.
Le Droit (Ottawa), septembre 1918 à mars 1919.
Le Spectateur (Hull), 1911 et 1912.
Registres des inhumations du cimetière Notre-Dame de Hull, 1900 à 1921.
Registre des inhumations du cimetière Très-Saint-Rédempteur de Hull, automne 1918.
Au cours des dernières semaines, deux articles du journal Le Droit, écrit à la suite d'une plainte d'un citoyen gatinois ont semé un certain émoi dans la population. En effet, un conseiller municipal et un citoyen ont de la difficulté à accepter comme noms de rues ceux de Philipp-Lenard et d'Alexis-Carrel. En effet, ces deux personnages, bien que récipiendaires de prix Nobel, sont loin d'incarner des modèles de vie. Le premier, Lenard (1862-1947), d'origine austro-hongroise, a remporté le prix Nobel de physique en 1905. Mais il a été un nazi antisémite et idéologue de la physique aryenne dans les années 1930 et 1940. Le second est le Français Alexis Carrel (1873-1944) qui a obtenu le prix Nobel de médecine en 1912. Pétainiste, pronazi et antisémite, il a aussi fait la promotion de l'eugénisme, c'est-à-dire de l'élimination pure et simple d'humains qu'il estimait indésirables.
La Ville de Gatineau devrait-elle faire remplacer ces noms de rues par d'autres noms plus acceptables aux yeux des citoyens ? Si elle décidait de le faire, il faudrait qu'elle en fasse disparaître d'autres pour les mêmes motifs ou pour des raisons tout aussi valables. Par exemple, le propriétaire de l'ancien journal hullois Le Spectateur, Ernest-Eugène Cinq-Mars (1873-1925), a commis quelques articles antisémites dans son journal au début du siècle passé. Et que dire des boulevard et parc Moussette ? Ils ont été nommés d'après l'ancien maire de Hull, Alphonse Moussette (1892-1952), lequel a été condamné en 1943 pour avoir protégé le vice commercialisé dans sa ville. Il y a aussi l'ancien maire de Hull Edmond-Stanislas Aubry (1860-1936), dont une place et une rue portent son nom. Il a été déchu de sa charge, en 1895, pour corruption.
Ces « grands » personnages
Mais il n'y a pas que ces personnages qui ont une rue à leur nom sans l'avoir méritée. Certains de ceux-là ont fait ce qu'on appelle la « grande histoire » militaire ou politique et leurs noms apparaissent dans les dictionnaires. Pensons au général britannique Jeffrey Amherst (1717-1797) : il méprisait au plus haut point les Amérindiens. Devenu commandant en chef des troupes britanniques, il forme le plan ignoble d'exterminer les Amérindiens. En effet, dans sa correspondance avec le colonel Bouquet, un mercenaire suisse employé par les Britanniques, on trouve le dialogue suivant : « Ne pourrions-nous pas tenter de répandre la petite vérole parmi les tribus indiennes qui sont rebelles ? Il faut en cette occasion user de tous les moyens pour les réduire. »
– Je vais essayer, répond le colonel, de la répandre, grâce à des couvertures que nous trouverons le moyen de leur faire parvenir.
– Vous ferez bien de la répandre ainsi, dit le général, et d’user de tous autres procédés capables d'exterminer cette race répugnante.
On peut ajouter à cette courte liste le nom de la reine Victoria (1819-1901). En effet, c'est sous son règne que le Royaume-Uni est devenu l'une des puissances les plus agressives du monde et que les Britanniques ont créé les premiers camps de concentration en Afrique du Sud. Ils y enfermaient les femmes, les vieillards et les enfants des Boers, et des membres de tribus indigènes alliées.
puissances les plus agressives du monde et que les Britanniques ont créé les premiers camps de concentration en Afrique du Sud. Ils y enfermaient les femmes, les vieillards et les enfants des Boers, et des membres de tribus indigènes alliées.
Changer le nom d'une rue pour une autre parce que son titulaire n'a pas eu un comportement respectable n'est pas chose facile, car on sait souvent peu de choses sur les personnages que l'on honore. Et si nous nous mettions à fouiller dans la vie de toutes les personnes, nous trouverions sans doute beaucoup de choses qui nous scandaliseraient – combien de ces hommes glorifiés ont battu leur femme ? Mais ce qui scandalise aujourd'hui ne scandalisait pas nécessairement autrefois. Ainsi, devrait-on changer les toponymes qui portent le nom de Pierre-Elliot Trudeau (1919-2000), ancien premier ministre du Canada, parce que celui-ci a déjà été antisémite dans sa jeunesse et qu'il a déjà frappé son épouse ?
Évidemment, un toponyme ça se change. En 1967, quand le général et président de la République française Charles de Gaulle a crié, au balcon de l’hôtel de ville de Montréal, « Vive le Québec libre ! », on a changé le nom de la rue qui portait son nom à Ottawa. Toutefois, on trouve de nos jours, dans la capitale fédérale, un… Amherst Crescent ! Cherchez l’erreur…
Sources :
Banque de toponymie de la Ville de Gatineau.
Le Droit (Gatineau-Ottawa), 17 septembre 2014. Article de Mathieu Bélanger.
LESTER, Normand, Le livre noir du Canada anglais, Montréal, Les Intouchables, 2001, p. 44 à 46.
Metro (Montréal), 20 avril 2010.
Nuit Blanche (Montréal), numéro 118, printemps 2010, http://72.10.139.201/AfficherPage.aspx?idMenu=0&idPage=347
Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration#mediaviewer/File:LizzieVanZyl.jpg
Chaque année, en septembre, les cimetières de la région programment une cérémonie-souvenir. Autrefois, cette cérémonie attirait des milliers de personnes qui venaient se recueillir sur la tombe de parents et amis. Aujourd’hui, elle attire moins de monde et les cimetières sont peu fréquentés. Et pourtant, pour qui sait lire et sait voir, il y a là de belles choses à voir, des histoires à raconter.
À l’entrée d’un cimetière, j’ai lu un jour : « Vous qui passez ici, priez Dieu pour les trépassés ; ce que vous êtes ils ont été, ce que sont, un jour serez[1]. » C’est au cimetière que l’on se rend compte que la vie a une fin et que personne n’échappe à la mort.
En dépit du caractère définitif du cimetière, il y a beaucoup à voir dans une nécropole, et même de très belles choses. Dans les cimetières reposent toutes les peines, tous les espoirs et toutes les vanités du genre humain ; l’homme y perpétue l’image qu’il se fait de lui. Fidèle reflet de nos villes, le cimetière immortalise l’individu, mais aussi sa classe sociale et parfois son appartenance ethnique. On trouve là des stèles de toutes les époques de notre histoire locale, des pierres qui marquent les lieux de sépulture d’illustres personnages d’autrefois, des croix de fer si rouillées qu’on n’y distingue plus les noms qui y ont été gravés jadis et, bien souvent, une fosse commune où on y ensevelit les sans-le-sou, les plus humbles de notre société ou les pendus, et les individus non identifiés.
Longtemps, les morts ont été inhumés dans un cimetière qui était situé tout autour de l’église.  À cause de la communion qui unit tous les fidèles, l’Église désirait que les morts demeurent près des vivants. Les « meilleures places » étaient celles qui entouraient le mur de l’église, car elles « reçoivent la pluie du ciel qui a dégouliné sur le toit d’un édifice béni… »
À cause de la communion qui unit tous les fidèles, l’Église désirait que les morts demeurent près des vivants. Les « meilleures places » étaient celles qui entouraient le mur de l’église, car elles « reçoivent la pluie du ciel qui a dégouliné sur le toit d’un édifice béni… »
On a aussi longtemps inhumé dans les églises. La tradition veut que les plus pieux (ou les plus riches ou encore les plus puissants) soient enterrés le plus près possible du chœur et ainsi de suite par cercles concentriques jusqu’aux limites du cimetière.
Le silence de la mort n’a pas toujours été le seul attribut des cimetières. Adjacents aux églises, les cimetières avaient, au moyen-âge, un droit de franchise et d’immunité. Ainsi, plus d’un délinquant y vivait de longues années pour échapper au châtiment des autorités (voir à ce sujet La Chambre des dames de Jeanne Bourrin) en vaquant à leurs activités de travail ou de loisirs. Les proscrits y tenaient donc des échoppes ; des foires et même des marchés saisonniers s’y tenaient épisodiquement.
Les cimetières de l'Outaouais
Nos cimetières regorgent d’art et d’histoire et pourtant nous les visitons si peu. Dans celui de Montebello, le calvaire est l’œuvre du réputé sculpteur sur bois Louis Jobin (1845-1928) dont l’atelier était situé à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le Calvaire est composé de trois personnages : un Christ en croix, la Vierge et Marie-Madeleine. Jobin a aussi sculpté une Sainte-Anne en compagnie de sa fille Marie.
On trouve encore dans nos cimetières le souvenir de nombreux personnages de notre histoire. Ainsi, dans le cimetière de St. James, boulevard Taché, à Hull, se dresse fièrement, dans un enclos borné par des clôtures de fer, un obélisque de granit rose qui indique le lieu de sépulture des fondateurs de Hull, Philemon Wright, et son épouse, Abigail Wyman. L’obélisque est entouré de monuments plus petits qui marquent les tombes de ses nombreux descendants. L’escalier de pierre qui mène à la sépulture de la famille William Francis Scott, ancien maire de Hull, est envahi par des pousses d’arbres et d’arbustes.
Boulevard Fournier, à Hull, se trouve le cimetière Notre-Dame d’une superficie de 13 hectares. On a commencé à y enterrer les morts en 1872 et de 1886 aux années 1930, on y aurait recueilli plus de 45 000 dépouilles ! Le portail d’entrée en pierre taillée a été construit en 1902 d’après les plans de l’architecte hullois, Charles Brodeur. Il est surmonté d’une statue de l’Ange de la mort sonnant la trompette du jugement dernier. Fabriquée en cuivre martelé, la statue a été réalisée par le sculpteur québécois Arthur Vincent (1852-1903) dont c’est la dernière œuvre d’importance.
 De nombreuses personnalités sont inhumées au cimetière Notre-Dame de Hull. Parmi celles de stature nationale, notons la comédienne, auteure et critique Laurette Larocque, mieux connue sous le nom de Jean Despréz (1906-1965), et le fondateur du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), Marcel Chaput (1918-1991). Parmi les personnalités locales, notons le père Louis-Étienne Reboul (1827-1877), fondateur de la paroisse de Hull ; l’acteur et metteur en scène René Provost (1903-1966), père du comédien Guy Provost ; la pianiste et poétesse Clara Lanctôt (1886-1958) ; l’allumettière Donalda Charron (1886-1967) qui a dirigé la fameuse grève des « faiseuses d’allumettes » de la E.B. Eddy en 1924 ; Marcelline Dumais (1850-1916), propriétaire de la maison où a commencé le Grand feu de Hull en 1900, le peintre Jean Alie (1925-1997), etc. Le plus beau cimetière de la région est sans doute le Beechwood. On y trouve un monument au Parti communiste du Canada (ML) preuve que le communisme est bien mort !
De nombreuses personnalités sont inhumées au cimetière Notre-Dame de Hull. Parmi celles de stature nationale, notons la comédienne, auteure et critique Laurette Larocque, mieux connue sous le nom de Jean Despréz (1906-1965), et le fondateur du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), Marcel Chaput (1918-1991). Parmi les personnalités locales, notons le père Louis-Étienne Reboul (1827-1877), fondateur de la paroisse de Hull ; l’acteur et metteur en scène René Provost (1903-1966), père du comédien Guy Provost ; la pianiste et poétesse Clara Lanctôt (1886-1958) ; l’allumettière Donalda Charron (1886-1967) qui a dirigé la fameuse grève des « faiseuses d’allumettes » de la E.B. Eddy en 1924 ; Marcelline Dumais (1850-1916), propriétaire de la maison où a commencé le Grand feu de Hull en 1900, le peintre Jean Alie (1925-1997), etc. Le plus beau cimetière de la région est sans doute le Beechwood. On y trouve un monument au Parti communiste du Canada (ML) preuve que le communisme est bien mort !
Chacun des cimetières de la région a ses particularités et ses célébrités. À Aylmer, le cimetière Saint-Paul est un véritable jardin public de 4,5 hectares. Créé en 1840, il invite les promeneurs à retrouver l’ancienne coutume de visiter ses morts. Dans le cimetière catholique de Buckingham se trouve la tombe de deux syndicalistes assassinés le 8 octobre 1906 par les sbires de la MacLaren : Thomas Bélanger et François Thériault. À Bryson (Pontiac), une pierre noire en forme deux cœurs enlacés rappelle le souvenir de la famille... Jolicoeur !
Il n’y a pas que les grands cimetières, il y en a aussi des petits : dans le West Templeton Cemetery, chemin du rang 3 (sur le bord de l’autoroute 50), reposent les restes de quelques familles d’origine écossaise et plus particulièrement la famille Kerr. Route 148, près du Cheval blanc, se trouve un cimetière privé où sont inhumés les membres de la famille Dunning. Et rue de l’Épée, à Gatineau, on trouve un tout petit cimetière abandonné dans lequel il y a trois ou quatre monuments, pour la plupart renversées, soit celles des Barber, Davidson et Langford. À Papineauville, se trouve le monument de Benjamin Papineau, en son temps premier ministre du Canada-Uni.
Il y a aussi en Outaouais une chapelle funéraire privée, celle des Papineau. Construite en 1855 à Montebello, on y a inhumé non seulement le patriote Louis-Joseph Papineau et plusieurs de ses enfants, mais aussi son épouse, Julie, qui a fait l’objet d’une biographie et d’un roman à succès, ce dernier intitulé : Le roman de Julie Papineau.
POUR EN SAVOIR PLUS
Cimetière Barber : https://sites.google.com/site/cimetierefamilialbarber/
Jardins du souvenir : http://lesjardinsdusouvenir.com/
SOURCES
Documentation personnelle.
GAGNON, Serge, Mourir hier et aujourd'hui, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1987.
MÉTAYER, Christine, Au tombeau des secrets, Paris, éd. Albin Michel, 2000.
L'incendie de l'église Notre-Dame de Hull : accident ou crime ?
Il y avait, autrefois à Gatineau, dans le secteur Hull, aux intersections des rues Victoria, Laurier et Notre-Dame-de-l'Île, une splendide église appelée Notre-Dame-de-Grâce. C’était la troisième église construite dans ce quadrilatère. La première, dite chapelle de chantiers, avait été érigée en juin 1846 et était dédiée à Notre-Dame-de-Bonsecours. Transformée en école paroissiale en 1869, elle est détruite en 1873 à la suite d'un incendie. En 1868, on a commencé la construction du deuxième temple, une vaste église en pierre, qu'un incendie détruira le 5 juin 1888 dans la conflagration du « feu du marché ».
Construite de 1888 à 1892, la nouvelle et dernière église a été inaugurée le 25 décembre 1892. De style romano-byzantin, elle mesurait 58 mètres de long et son clocher culminait à 79 mètres. Cette église, qui pouvait contenir par moins de 3 100 personnes dont 1 134 au sous-sol, avait un maître-autel surmonté d’une gigantesque statue de Notre-Dame-de-Grâce, qui tenait dans ses bras l’Enfant-Jésus, fichée dans une niche bleu ciel et encadrée par deux archanges dorés. Un extra-terrestre qui serait entré dans cette église aurait conclu que les Hullois avaient pour principale divinité une femme. Il faut se rappeler que la paroisse Notre-Dame-de-Grâce était dirigée par les Oblats de Marie-Immaculée (O.M.I.), un ordre religieux consacré à la mère de Jésus.
Incendie accidentel ou criminel ?
Le dimanche 12 septembre 1971, vers 5 heures 30, le curé Gilles Hébert appelle les pompiers parce qu’il a vu de la fumée s’échapper de l’extrémité du clocher, plus précisément du socle sur lequel reposait la croix lumineuse. Il communique de suite avec l’employé de la paroisse qui se rend aussitôt sur les lieux. Ce dernier veut monter au clocher, convaincu en tant qu’électricien il peut éviter le déclenchement d’un incendie sérieux. Mais le directeur du Service des incendies le lui interdit. Le directeur, accompagné d’un de ses hommes, s’aventure alors à l’intérieur du clocher, qui abrite de grosses cloches, pour repérer la source de la fumée. Cet à ce moment-là que les flammes jaillissent de la flèche du clocher qui, en quelques minutes, est transformée en torche.
 Montés dans l’échelle de 30 mètres, les pompiers constatent vite que les jets d’eau ne peuvent atteindre la flèche du clocher, trop haute (je rappelle que le clocher culminait à 79 mètres au-dessus de la rue). Pire encore, à cause de travaux, rue Champlain, la pression de l’aqueduc – un problème récurrent à Hull – était réduite. Vers 7 heures 30, le clocher et ses quatre cloches, qui pèsent ensemble quatre tonnes, s’effondrent, dans un énorme fracas, partie sur le toit de l’église, partie sur la pelouse du bâtiment. Les flammes s’attaquent ensuite à la structure de bois du toit et aux pièces de cuivre qui le recouvre. Les trois lustres qui pendent au-dessus de la nef se détachent de la voûte et s’effondrent dans l’allée centrale. Mais la voûte et l’intérieur de l’église résistent aux flammes et bien que sérieusement endommagée, l’église n’est pas irréparable.
Montés dans l’échelle de 30 mètres, les pompiers constatent vite que les jets d’eau ne peuvent atteindre la flèche du clocher, trop haute (je rappelle que le clocher culminait à 79 mètres au-dessus de la rue). Pire encore, à cause de travaux, rue Champlain, la pression de l’aqueduc – un problème récurrent à Hull – était réduite. Vers 7 heures 30, le clocher et ses quatre cloches, qui pèsent ensemble quatre tonnes, s’effondrent, dans un énorme fracas, partie sur le toit de l’église, partie sur la pelouse du bâtiment. Les flammes s’attaquent ensuite à la structure de bois du toit et aux pièces de cuivre qui le recouvre. Les trois lustres qui pendent au-dessus de la nef se détachent de la voûte et s’effondrent dans l’allée centrale. Mais la voûte et l’intérieur de l’église résistent aux flammes et bien que sérieusement endommagée, l’église n’est pas irréparable.
Toutes sortes de rumeurs ont circulé sur la cause de l’incendie de l’église Notre-Dame-de-Grâce et la plus persistante veut que l’incendie ait eu une origine criminelle. En effet, moins d’un an plus tôt, l’hôtel de ville avait brûlé dans un incendie aux causes si nébuleuses que des fonctionnaires ont cru que la Gendarmerie royale du Canada n'y était pas étrangère : des policiers avaient déjà allumé des incendies, ailleurs au Québec, dans le cadre de la lutte contre le Front de la libération du Québec. Et puis, le député provincial du comté de Hull, Oswald Parent, avait voué le Vieux-Hull à la destruction… Puis trois jours après l’incendie, le curé Hébert, sans doute aiguillé par son conseil provincial, déclarait : « […] est-ce important de reconstruire un édifice de cette envergure sur ce terrain ? » Ainsi a commencé cette rumeur d'incendie criminel.
Des gens ont même témoigné avoir vu un homme marcher sur la toiture de l'église, peu avant l'incendie, après être sorti du clocher de l'église ce qui était impossible. En effet, la pente de la toiture était trop glissante et trop raide pour pouvoir s'y aventurer en marchant. Cela dit, il a été démontré que l’incendie était d’origine électrique. Un mois avant le feu, un témoin avait remarqué que la croix du clocher n’avait pas sa luminosité habituelle. Et un soir ou deux précédant l’incendie, un employé de la paroisse s’était aperçu que les lumières de la croix étaient éteintes. Il s’était dit qu’il irait voir ce qui n’allait pas dès qu’il en aurait le temps.
La démolition
« Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage », prétend un vieux dicton. Ainsi, en février 1972, l’éditorialiste du journal Le Droit, un quotidien alors propriété de la communauté des O.M.I., Claude Saint-Laurent, écrit avec mépris : « Il convient de souligner ici que l’architecture de cet édifice n’impressionne personne et que son seul mérite, ou à peu près, est de représenter un type de construction populaire au XIXe siècle au Québec. »
Bien sûr, la Ville de Hull et la Société historique de l’ouest du Québec se sont opposées à la démolition du temple parce qu’elles reconnaissaient sa valeur historique et patrimoniale. Même le député a cherché à préserver l'immeuble religieux. Mais la paroisse était en voie de disparition, et ce, pour deux raisons : non seulement la pratique religieuse diminuait-elle à un rythme qui s’accélérait, mais de nombreuses expropriations de maisons étaient en cours à Hull. Déjà, une partie du quartier situé autour de la rue Hôtel-de-Ville avait été démolie pour être remplacée par les immeubles Jos-Montferrand, Place d’Accueil et Place du Portage. On avait aussi commencé à exproprier tout le côté ouest de la rue Maisonneuve et le côté sud de la rue Saint-Laurent (des Allumettières). Ainsi, les Oblats ont-ils constaté, avec raison, que la paroisse n’aurait bientôt plus assez de paroissiens pour défrayer les coûts d’entretien d’une église aussi vaste. En 1972, l'église tant aimée succombe sous le pic des démolisseurs. Ses objets de culte et artistiques sont dispersés aux quatre vents : la lampe du sanctuaire se trouve maintenant dans l'église de Montebello.
Avec la destruction des lieux de mémoire identitaires tels l’hôtel de ville, l’église Notre-Dame-de-Grâce et le palais de justice, la ville de Hull a amorcé, au début des années 1970, un déclin qui l’a conduite, trente ans plus tard, à sa disparition, et ce, parce qu’une ville sans mémoire est une ville sans avenir pour ses citoyens.
Sources :
Archives de la Ville de Gatineau.
Documentation personnelle.
Le Droit (Ottawa), septembre 1971, février 1972.
OUIMET, Raymond, Une ville en flammes, Hull, éd. Vents-d'Ouest, 1994.
1914 : la Grande Guerre, les Canadiens français et l'Outaouais
À la suite de l’assassinat de l’archiduc Joseph Ferdinand de Habsbourg et de sa femme, Sophie, le 28 juin 1914 à Sarajevo (voir texte intitulé : Il y a 100 ans : l'attentat qui déclencha la Grande Guerre), l’Autriche-Hongrie sert, le 23 juillet, avec l’accord de l’Allemagne, un ultimatum en dix points à la Serbie avec l’obligation de donner une réponse favorable au plus tard le 26 juillet. Celle-ci, appuyée de la Russie, répond favorablement à l’ultimatum, le 25 juillet, sauf pour un point qui précise que les enquêteurs austro-hongrois pourront enquêter sur le territoire Serbe.
Le 24 juillet la Russie, qui se fait protectrice des populations slaves d’Europe, avait ordonné la mobilisation générale d’une partie de son armée dans le but de faire pression sur l’Autriche-Hongrie. Le 25 juillet l’Autriche-Hongrie, encouragée par les militaires allemands, rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie, puis lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. Ce même jour, un volontaire de 16 ans de l’armée serbe, Dŭsan Donovic, est tué à Belgrade par un coup de fusil tiré d’un vaisseau de la flotte austro-hongrois du Danube.
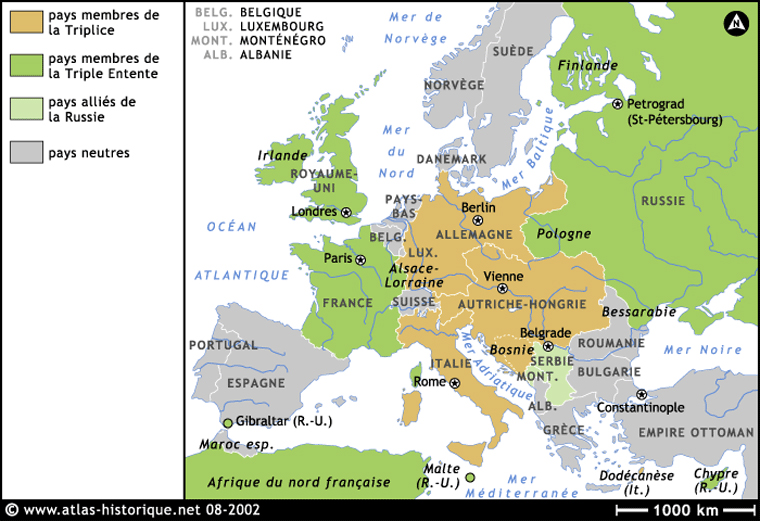
La France, alliée de la Russie (et du Royaume-Uni), ordonne à ses troupes de se retirer à 10 kilomètres des frontières avec l’Allemagne en vue de faire baisser la tension. Le 30 juillet, la Russie ordonne à son armée la mobilisation générale. Inquiète, l’Allemagne qui a peur d’être prise en tenaille par la Russie et la France, proclame « l’état de danger de guerre » et demande à la Russie, qui refuse, de suspendre la mobilisation, et à la France de ne pas soutenir la Russie. À la suite de la réponse négative de la Russie, l’Allemagne lui déclare la guerre le 1er août. La France décrète alors la mobilisation générale. Le 2 août, l’Allemagne, qui a signé une entente avec l’Empire ottoman, envahit le Luxembourg, adresse un ultimatum à la Belgique, dans lequel elle réclame le passage libre de ses troupes, et un autre ultimatum à la France qui réclame sa neutralité. Devant les fins de non-recevoir des Belges et des Français, l’Allemagne leur déclare la guerre le 3 août. Les dés sont jetés : 19 millions d’hommes, de femmes et d’enfants, dont 65 mille Canadiens, perdront la vie à cause du bellicisme des militaires de l’époque dans une guerre qui durera 4 longues années.
Le Canada français et la guerre
Dès que l’Allemagne procède à l’invasion de la Belgique, le Royaume-Uni, qui se tenait garant de la neutralité du petit royaume, déclare la guerre à l’Allemagne. Le Canada, alors colonie de l’Angleterre, entre automatiquement en guerre. Les journaux du pays rapportent que la population est enthousiaste à la participation du Canada à la guerre qui ne compte alors que 3 000 soldats. Tous les belligérants croient que le conflit s’achèvera avant Noël. Erreur !
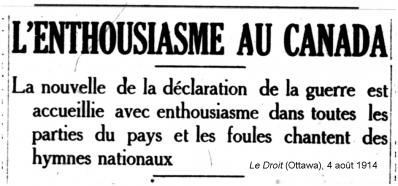 Le journal Le Temps d’Ottawa, favorable à la participation des Canadiens à la guerre écrit, le 5 août : « Le Canada doit envoyer de l’aide à la Grande-Bretagne et un important contingent d’hommes […] » Ce même journal rapporte, dans une autre page, qu’au-delà de 500 jeunes hommes de Hull « […] ont montré le plus grand enthousiasme […] » à la participation du pays à la guerre au cours d’une manifestation dans la cour du collège Notre-Dame.
Le journal Le Temps d’Ottawa, favorable à la participation des Canadiens à la guerre écrit, le 5 août : « Le Canada doit envoyer de l’aide à la Grande-Bretagne et un important contingent d’hommes […] » Ce même journal rapporte, dans une autre page, qu’au-delà de 500 jeunes hommes de Hull « […] ont montré le plus grand enthousiasme […] » à la participation du pays à la guerre au cours d’une manifestation dans la cour du collège Notre-Dame.
Le journal Le Droit est beaucoup moins enthousiaste que son concurrent ottavien. Le 5 août, il écrit :
Et pourquoi les Canadiens français iraient-ils exposer leur vie pour la gloire du peuple anglais ?
Pour prouver notre loyauté à la couronne britannique ?
Nous avons prouvé cette loyauté hors de tout doute en 1775, en 1812 et en 1813. Nous en a-t-on tenu compte ?
À ces époques mémorables, nous avons, nous les Canadiens français, sauvé l’honneur du drapeau anglais, nous avons conservé le Canada à la couronne britannique, et depuis, au nom de cette même couronne, les Anglais n’ont cessé de nous persécuter et de vouloir arracher de nos cœurs les plus nobles sentiments. Ils ont voulu nous étouffer dans les provinces Maritimes (sic), au Manitoba, dans les Provinces (sic) de l’Ouest, et voilà que les forces les plus formidables des Anglais en ce pays coalisent pour empêcher 250,000 Canadiens français de l’Ontario de conserver dans leurs foyers leur langue maternelle…
Le journal Le Temps, favorable à la participation des francophones à cette guerre, répond au journal Le Droit, le 6 août :
À côté de cette prose écœurante, nous avons heureusement le plaisir de lire dans d’autres journaux des phrases qui réflètent (sic) la véritable âme canadienne-française qui puise son patriotisme dans ses attaches françaises et dans sa loyauté à l’Angleterre.
Le journal Le Temps n’était probablement pas au diapason des ses lecteurs, car il disparaît avant la fin de la Grande Guerre. Quant à la population francophone, elle sera en majorité rébarbative à l’enrôlement militaire des siens dans cette guerre qui n’était pas la sienne et dans laquelle elle n’avait rien à gagner.
Sources :
DUROSELLE, Jean-Baptiste, La Grande Guerre des Français 1914-1918, Paris, éd. Perrin, 2002.
Le Devoir (Montréal) 28 juillet 2014.
Le Droit (Ottawa) 5 août 1914.
Le Temps (Ottawa), 5 et 6 août 1914.
PÉPIN, Carl, La guerre des Canadiens-Français dans Revue historique des armées sur le site Internet http://rha.revues.org/7426#tocto1n1
Petite histoire de l'aréna Robert-Guertin
L’aréna Robert-Guertin, situé à Gatineau dans le quartier Île de Hull, fait les manchettes de la presse régionale depuis plus de trois ans maintenant. Sera-t-il démoli et remplacé par un centre multifonctionnel ? Retour sur l’histoire d’un aréna qui a longtemps été au cœur de nombreux événements sportifs, culturels et économiques de l’Outaouais.
L’aréna Robert-Guertin est la troisième patinoire couverte de Gatineau. La première était située rue Laurier, dans l’île de Hull et portait le nom de Parc Royal. Construit en 1905 par un groupe d’hommes d’affaires hullois, le Parc Royal était une patinoire de glace naturelle et couverte et était devenu un « centre multifonctionnel » quand on y a ajouté, en 1908, un théâtre de vaudeville, le plus grand au Canada. En 1921, on y a présenté la pièce à succès Aurore l’enfant martyr. Le Parc Royal est disparu dans un gigantesque incendie en janvier 1928.
À la suite de l’incendie du Parc Royal, il n’y aura pas de patinoire couverte à Gatineau avant 1938, et c'est à... Buckingham qu'il sera construit. En effet, un an après l’incendie qui a détruit le « centre multifonctionnel », s’est produit le fameux krach de la bourse new-yorkaise qui a plongé le monde occidental dans la Grande dépression économique des années 1930 laquelle a été suivie par la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Il n’a donc pas été possible de remplacer le Parc Royal, et ce, au grand déplaisir de Robert Guertin qui déplorait le fait que les équipes et les spectateurs de Hull et de l’ensemble de l’Outaouais devaient se donner rendez-vous à l’Auditorium d’Ottawa. Son rêve était de donner un aréna à sa ville.
En 1938, Buckingham était une municipalité indépendante située à une trentaine de kilomètres de la métropole de l'Outaouais, Hull. Quoi qu'il en soit. il semble bien que ça a été le l’Association athlétique et social Hull-Volant, fondée en 1932, et ce, à l’instigation de Robert Guertin, qui a alors entrepris une campagne de sensibilisation auprès de la population hulloise et de ses dirigeants politiques dans la deuxième moitié des années 1940. Le 17 janvier 1940, la ville tenait un référendum pour obtenir l'assentiment de la population à un emprunt de 230 000 dollars pour la construction d'un aréna. Le règlement d'emprunt est défait 385 à 245 voix. Seuls les propriétaires avaient alors droit de vote.
En 1948, le Hull-Volant déléguait quatre de ses membres, dont Robert Guertin, auprès du conseil municipal pour le convaincre de construire un aréna. À cette même époque ville de Thurso, se dotait d'un aréna. En janvier 1950, la direction du Hull-Volant écrivait à tous les corps publics et les clubs sociaux pour qu’ils fassent pression auprès du conseil municipal pour la construction d’un aréna à Hull. L’année suivante, Guertin se lançait en politique active et posait sa candidature au poste de conseiller municipal représentant le quartier Montcalm. Élu, il a poursuivi sa campagne et en 1952, il formait un comité avec deux autres « échevins » pour la construction d’une patinoire couverte avec glace artificielle.
L’ancienne ville de Hull n’était pas riche, c'est vrai, mais sa population se complaisait dans sa dépendance à l'égard de sa voisine, Ottawa. Il fallait donc convaincre les citoyens de la nécessité d’un tel équipement dont la construction et l’entretien auront des conséquences sur la facture de taxe.
 Quoi qu’il en soit, en 1954, le comité de l’aréna rencontrait Frank Selke, gérant général des Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey, qui a émis conseils et idées au sujet du projet d’aréna et discuté la possibilité d’inscrire une équipe junior dans la Ligue de hockey junior du Québec. Bob Guertin présidait cette rencontre à laquelle assistaient également des membres de divers corps publics. À la suite de cette rencontre, Robert Guertin s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour obtenir du gouvernement provincial une subvention de 100 000 dollars. On espérait que très bientôt la Ville de Hull pourrait se doter d’une patinoire couverte et d’un stade de baseball.
Quoi qu’il en soit, en 1954, le comité de l’aréna rencontrait Frank Selke, gérant général des Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey, qui a émis conseils et idées au sujet du projet d’aréna et discuté la possibilité d’inscrire une équipe junior dans la Ligue de hockey junior du Québec. Bob Guertin présidait cette rencontre à laquelle assistaient également des membres de divers corps publics. À la suite de cette rencontre, Robert Guertin s'est démené comme un diable dans l'eau bénite pour obtenir du gouvernement provincial une subvention de 100 000 dollars. On espérait que très bientôt la Ville de Hull pourrait se doter d’une patinoire couverte et d’un stade de baseball.
Un an plus tard, Guertin avait amassé la jolie somme de 171 000 dollars auprès du gouvernement provincial et de diverses entreprises hulloises. L’année suivante, la Ville consultait la population au moyen d’un référendum en vue d’emprunter la somme de 300 000 dollars. Les contribuables ont répondu positivement à la demande de la Ville qui a rapidement mis en chantier le futur aréna.
Construit par la firme Ed. Brunet (fondée en 1931), l’aréna de Hull, qui compte 3 196 sièges, a été inauguré le 22 novembre 1957 par une équipe de comédiens de la populaire émission de télévision La Rigolade, mettant en vedette Denis Drouin, Marcel Giguère, Roger Turcotte et Élaine Bédard. Il est construit en béton armé et en blocs de béton ; sa toiture est soutenue par une impressionnante « forêt » (structure de bois) peinte en gris. L’extérieur du bâtiment sera achevé dans les années 1975-1980.
En 1959, l’aréna de Hull est devenu la maison des Canadiens Hull-Ottawa de la Ligue professionnelle de l’Est. De futures grandes vedettes de hockey ont fait partie de cette équipe dont les Cesare Maniago, Claude Larose, Claude Pronovost, Robert Rousseau, Gilles Tremblay, etc. D’autres clubs y seront très populaires dont les Festivals de Hull et, évidemment, les Olympiques. Le tournoi des la coupe Memorial s’y est aussi tenu à trois reprises : 1958, 1982 et 1997.
Il n'y a pas eu que du hockey, mais aussi de la lutte, avec les Édouard Carpentier, Jean Rougeau et Hans Schmidt, qui a été très populaire pendant une vingtaine d’années. Gaétan Hart y a boxé et le chanteur d’opérette Georges Guétary est aussi venu y chanter. Il y a aussi eu le fameux Salon du commerce de Hull qui s’y est tenu de 1961 à 1984 et de nombreux « bingos » monstres.
Le vieil aréna sera peut-être démoli bien que sa structure de béton a été conçue pour durer 200 ans. On ne peut pas dire que le développement durable une préoccupation de tous les instants à Gatineau.
Sources :
Archives de la Ville de Gatineau.
Centre régional d'archives de l'Outaouais (CRAO) fonds du Hull-Volant.
Le Progrès de Hull (Hull), 1953.
TROTTIER, Jean-Claude, Le petit Hull-Volant, Gatineau, 2011.
Documentation personnelle.
James Goodwin : le monstre de Clarendon
Le jovialisme de notre début de siècle nous porte à refuser de croire dans la cruauté et la méchanceté des êtres humains. Déjà, au XVIIIe siècle, le philosophe Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) écrivait que « l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. » Pourtant, selon Marc Bekoff, qui étudie le comportement des animaux, ce qui nous en distingue, c'est que « nous sommes les seuls animaux qui cuisons la nourriture, et qu'aucune autre espèce n'est aussi nuisible pour elle-même et les autres espèces[1]. » L’affaire du « Monstre de Clarendon » le démontre amplement.
La municipalité du canton de Clarendon est située dans le comté de Pontiac, à environ 90 kilomètres à l’ouest de Gatineau. Son principal village a pris le nom du premier maître de poste du lieu, un certain James Shaw, pour devenir Shawville. Ce lieu, à forte majorité anglophone unilingue, compte aussi une loge orangiste qui célèbre, de temps à autre, la victoire de la bataille de la Boyne[2] remportée par des protestants sur les catholiques.
Vivait là un certain James Goodwin qui avait épousé Helen Condon en 1825 dans la ville de Québec. Le couple habitait depuis un certain nombre d’années dans ce lieu qui deviendra Shawville. Or, les relations du ménage, qui avait pas moins de sept enfants dont la plus jeune avait douze ans, s’étaient passablement détériorées,  et ce, au point où les chicanes n’en finissaient plus.
et ce, au point où les chicanes n’en finissaient plus.
James Goodwin était du type méchant, capable d’une cruauté sans nom. Cet homme tenait son épouse en si piètre estime, et sans doute les femmes en général, qu’il la traitait infiniment moins bien que ses animaux de ferme. Or, un jour, Helen, qui n'était plus capable d'endurer les méchancetés de son mari, s’enfuie de la maison. Ne trouvant pas à se loger, elle décide de réintégrer le foyer familial. Son mari l’y attend de pied ferme et en guise de cadeau de bienvenue et de fin d’année 1847, lui offre un nouveau logement exotique et même odoriférant : la soue à cochons, contiguë à la maison. Et il l’y enferme. Évidemment, la rumeur se propage rapidement dans le canton au point où elle vient aux oreilles du pasteur du lieu, le révérend Fred Neve, qui se rend au domicile de Goodwin, qu’il connait, pour voir ce qui en retourne de cette histoire. Le pasteur n'en croit pas ses yeux et demande au monstrueux mari ce que sa femme fait dans la soue. James Goodwin lui répond, sans la moindre gêne, que sa femme s'est elle-même enfermée (!) dans la soue et qu’elle peut en sortir comme elle y est entrée. Le pasteur adresse alors de sévères reproches à son paroissien qui réplique en assurant le révérend que la conduite d’Helen a été si mauvaise qu’elle n’a aucun droit de se plaindre.
Un pasteur nonchalant
Évidemment, le pasteur n'a pas cru son paroissien. D’autant plus qu’on apprend au même moment, que le charitable Goodwin permet à ses enfants – quelle sollicitude ! – de donner de la nourriture trois fois par jour à leur mère à travers les fentes des murs de la soue. Pire encore, la soue n’est pas nettoyée et la pauvre femme doit y faire ses besoins. L’odeur de la soue y est si suffocante que les enfants n’y entrent même pas. Nous sommes en plein hiver et la porcherie n’est évidemment pas chauffée ! Or, Goodwin refuse à sa femme les vêtements nécessaires pour se protéger du froid…
Helen a bien sûr essayé de s'évader. Mais le lâche Goodwin veille au grain : il bat sa femme, la fouette même, chaque fois qu’elle tente de sortir de sa geôle. Enfin, le 17 février 1847, les enfants trouvent leur mère morte dans sa prison.
La mort de la pauvre Helen entraîne, bien tardivement, une enquête, celle du coroner. Celui-ci a peine à entrer dans la soue, tant son plafond est bas, pour en sortir le cadavre gelé. Le corps est d’ailleurs si dur qu’il ne pourra en faire l’autopsie sur le champ.
Le procès du mari tortionnaire a lieu un an plus tard. Goodwin est alors reconnu coupable d’homicide… involontaire – les voies de la justice sont impénétrables – et condamné à la réclusion à vie dans un pénitencier. Il faut dire, qu'à cette époque, les lois ne favorisaient pas la femme. En effet, le code britannique, alors en vigueur au Canada, tolérait une certaine violence du mari à l'égard de la femme. La règle du pouce autorisait un homme à battre sa femme avec un bâton d'une épaisseur ne dépassant pas celle de son pouce. Par contre, une femme qui osait tuer son mari, même en légitime défense, voyait son crime qualifié d'abominable.
Dans cette histoire, il faut retenir que si les enfants les plus vieux des Goodwin, le pasteur, la sœur d’Helen et la population de Clarendon avaient dénoncé le sort de la pauvre femme aux autorités judiciaires, Helen aurait vécu. Car elle n’est pas simplement morte de la suite des mauvais traitements que son mari lui a fait subir, mais aussi de celle de l’indifférence de son entourage.
[1] CAVES, Stephen, Le propre de l'homme in La Revue, Paris, avril 2014, p. 92.
[2] 12 juillet 1690, Irlande.
Sources :
FRIGON, Sylvie, L'homicide conjugal au féminin, Montréal, les éditions du remue-ménage, 2004.
GIGUÈRE, Guy, En manchette depuis 150 ans – Plus ça change plus c’est pareil, Boisbriand, Michel Brûlé, 2008.
Le Droit (Ottawa), 14 février 1922.
La Revue (Paris), no 41, avril 2014.
Documentation personnelle
Marie-Thérèse Archambault : une adolescente à la défense du français
Nous avons tous les jours l’occasion de défendre la langue française, langue qui malgré son statut officiel est bafouée quotidiennement en Outaouais. Le faisons-nous ? En avons-nous le courage? Voilà l'histoire d'une jeune adolescente, Marie-Thérèse Archambault, qui n'avait pas froid aux yeux et qui tenait à sa langue.
1917. Le Parlement canadien vote, en juillet, la conscription, loi qui oblige tous les hommes en âge de porter les armes à s’enrôler dans les forces armées pour aller combattre l’Allemand sous les couleurs de l’Union Jack. La loi est impopulaire auprès des francophones du Canada qui sont avant tout Canadiens alors chez les anglophones on se sent souvent Britannique.
De nombreux journaux anglophones reprochent aux Canadiens-Français de refuser de s’engager dans l’armée pour combattre en Europe et les traitent de lâches dans une campagne de dénigrement telle que  l’on dirait que c’est le francophone qui est l’ennemi plutôt que l’Allemand qui a envahi l’Europe. Méprisant, l’Ottawa Journal écrit : « On savait que la grande majorité des gens respectables étaient du côté du gouvernement et que le reste, deux millions et trois quarts de Canadiens français, étaient contre nous[1]. »
l’on dirait que c’est le francophone qui est l’ennemi plutôt que l’Allemand qui a envahi l’Europe. Méprisant, l’Ottawa Journal écrit : « On savait que la grande majorité des gens respectables étaient du côté du gouvernement et que le reste, deux millions et trois quarts de Canadiens français, étaient contre nous[1]. »
Depuis cinq ans, le gouvernement de l’Ontario prohibe l’enseignement et l’emploi de la langue française dans les écoles de la province. Une loi appelée le Règlement 17 a été inspiré par l’évêque irlandais de London, Mgr Fallon. En dépit de l’interdiction du français, les Franco-ontariens doivent se soumettre à la loi de la conscription pour aller combattre et mourir en Europe au nom d’une liberté qui leur est refusée.
Interdiction du français
L’interdiction du français est une vilaine habitude au Canada : aux premiers jours de la pseudo-Confédération canadienne, le Free School Act établit en Nouvelle-Écosse l’école publique neutre et anglophone ; l’enseignement du français est rigoureusement restreint. Le français sera aussi interdit ailleurs au Canada.
1871 : Le Common Schools Act supprime au Nouveau-Brunswick les écoles catholiques et bannit le français comme langue officielle.
1877 : Le Public School Act de l’Île-du-Prince-Édouard interdit le français dans les écoles de la province.
1890 : Le gouvernement du Manitoba abolit les écoles séparées et interdit l’usage officiel de la langue française au mépris de la Constitution.
1892 : Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest fait de l’anglais la seule langue officielle du territoire[2].
1905 : En Alberta, la loi scolaire ne permet l’usage du français comme langue d’enseignement que durant les première et deuxième années du cours primaire.
1912 : Le Keewatin interdit l’enseignement du français.
1916 : Le Manitoba supprime la langue française dans toutes les écoles primaires.
1930 : La Saskatchewan bannit à son tour le français de ses écoles.
Sur la rive gauche de la rivière des Outaouais, au Québec, se trouvait la ville de Hull dont la très grande majorité de la population est francophone et ouvrière. Dans cette municipalité, un maire, Urgel Archambault, père de notre héroïne, fortement appuyé par la Chambre de commerce local, vient de franciser 69 noms de rue de la ville dont les registres d’évaluation sont encore tenus en anglais. Ainsi, les rues Albion, Church, Brewery et Wall deviennent rues Dollard, Saint-Jacques, Montcalm et Papineau. C’est donc dans ce cadre que Marie-Thérèse Archambault, à peine entrée dans l’adolescence, va défendre avec brio la langue française au cœur de la capitale fédérale.
Une jeune fille courageuse et fière
Lundi 24 septembre 1917, 17 heures. Marie-Thérèse Archambault, 13 ans, fille du maire de Hull et petite-fille du sénateur Louis-Auguste Olivier, entre dans les bureaux de la compagnie de tramways d'Ottawa où se trouvent plusieurs personnes : garde-moteurs, conducteurs, commis, d’autres employés et même un inspecteur de l’entreprise de transport.
L’adolescente présente de l’argent à un commis des tramways en lui demandant, en français, une carte d’écolière. Le commis lui refuse la carte et lui dit que si elle veut l’obtenir, elle doit faire sa demande… en anglais ! Marie-Thérèse réplique qu’elle vient acheter des billets, qu’elle a de l’argent et qu’elle a le droit de demander, en français, ce qu’elle désire. Cinq ou six jeunes femmes de bureau se mettent alors à rire et à se moquer en la traitant de « bad girl ».
Comme Marie-Thérèse est à peine sortie de l’enfance, on pense la réduire facilement par l’attente et la fatigue. Aussi, la laisse-t-on poiroter dans le bureau de la compagnie en mettant à l’épreuve sa patience et ses principes. Un des conducteurs, apparemment de langue française et qui a pitié de la jeune fille, s’avance vers elle et lui dit de dire deux mots en anglais et qu’immédiatement, grâce à la magie de ces mots au pouvoir incommensurable, le commis va lui remettre la carte qu’elle veut se procurer. Et il lui offre de lui enseigner ces deux mots si elle les ignore. Il ajoute qu’elle est mieux de les prononcer si elle ne veut pas faire rire d’elle. Car voilà, parler français dans la capitale canadienne s’est s’exposer à faire rire de soi.
 Marie-Thérèse a du caractère, de la volonté, du courage même. Elle répond au conducteur qu’elle sait dire ce qu’elle veut en anglais, comme en français, mais qu’elle a le droit d’obtenir ce qu’elle veut en français, parce que le français est une langue officielle dans tout le Canada et que d’ailleurs le commis l’a très bien comprise quand elle a fait sa demande la première fois. De plus, ajoute-t-elle, si, lui, le conducteur a honte de sa langue, elle, la jeune adolescente, n’en a pas honte. Le conducteur lui offre alors de l’argent pour qu’elle articule les mots magiques en anglais. Elle répond qu’elle ne veut pas de son argent, mais qu’elle veut un billet pour lequel elle paiera volontiers.
Marie-Thérèse a du caractère, de la volonté, du courage même. Elle répond au conducteur qu’elle sait dire ce qu’elle veut en anglais, comme en français, mais qu’elle a le droit d’obtenir ce qu’elle veut en français, parce que le français est une langue officielle dans tout le Canada et que d’ailleurs le commis l’a très bien comprise quand elle a fait sa demande la première fois. De plus, ajoute-t-elle, si, lui, le conducteur a honte de sa langue, elle, la jeune adolescente, n’en a pas honte. Le conducteur lui offre alors de l’argent pour qu’elle articule les mots magiques en anglais. Elle répond qu’elle ne veut pas de son argent, mais qu’elle veut un billet pour lequel elle paiera volontiers.
Le temps s’écoule lentement et les employés de la compagnie de tramways ne voient pas le moment où la jeune fille va céder. Les courageux commis, pleins de délicatesse et de sentiments charitables, essaient un autre moyen pour faire plier la jeune fille : ils éteignent toutes les lumières du bureau espérant que mademoiselle Archambault les quitte sans demander son dû. L’horloge marque 19 heures 30, le bureau ferme. Une commis lui remet une correspondance, mais lui refuse son billet. Marie-Thérèse se voit alors contrainte à quitter le bureau de la compagnie des tramways sans obtenir satisfaction.
L'histoire, rapportée par le journal Le Droit, fait rapidement le tour du Québec. À Verchères, des écolières réagissent à la résistance de Marie-Thérèse Archambault : « Puisque nous sommes les filles de Madeleine de Verchères, puisque nous vivons dans le village qui porte son nom immortel, il est de notre devoir d’exprimer d’une façon tangible l’admiration de toutes les petites Canadiennes-Françaises. »
Le soir du 11 novembre 1917, à la Salle Notre-Dame de Hull et devant de nombreux spectateurs, l’assistant-rédacteur du journal Le Droit, Thomas Poulin, présente à Marie-Thérèse Archambault un médaille d’or frappée expressément pour la circonstance avec une lettre de l’abbé F. A. Baillargé dans laquelle il a écrit : « Puisse la jeunesse canadienne-française être animée partout d’un tel esprit et l’avenir du français est assuré. » Elle répond :
J’étais loin de penser que ma conduite aux bureaux de la compagnie des tramways deviendrait un événement de cette importance. Ce que j’ai fait, je l’ai fait tout naturellement, comme toute petite fille canadienne-française aurait fait dans les circonstances ; il me semble qu’il n’y avait pas d’autres choses à faire, et si c’était à recommencer je le ferai encore.
En 1932, Marie-Thérèse elle devient la première femme laïque en Amérique du Nord à obtenir un doctorat en philosophie, diplôme que lui décerne l’Université d’Ottawa. Puis elle étudie la bibliothéconomie qu’elle enseigne à l’Université de Montréal. Elle meurt dans la métropole québécoise en 1960 et est inhumée au cimetière Notre-Dame, boulevard Fournier, à Gatineau.
[1] 19 décembre 1917.
[2] Le français a été rétabli en 1984.
SOURCES
Le Droit (Ottawa) 1917.
LATRÉMOUILLE, Denise, Dr, Joseph-Urgel Archambault, maire de Hull dans Asticou, cahier no 29, décembre 1983, p. 3 à 9 .
Ottawa Journal (Ottawa), 1917.
À part les nombreux articles consacrés à la famille de Philemon Wright, on sait peu de choses des premiers habitants de Gatineau. Et pourtant, les Wright n’ont pu faire leurs affaires sans un certain nombre d’employés dont plusieurs étaient des francophones ; parmi eux la famille Charron-Miville.
Au nombre des premiers francophones à élire domicile sur le territoire de Gatineau, il y en a eu quelques-uns qui ont voulu participer à la fondation d’un village sur l’emplacement actuel de l’île de Hull, et ce, aussi tôt que 1827. Sans succès. Parmi ces pionniers, une famille a particulièrement retenu mon attention : celle des Charron-Miville. En 1819, un certain Joseph Miville s’établit dans la Petite-Nation avec sa petite famille. Joseph a vu le jour à Louiseville en 1781. Son père, Benjamin, changeait souvent de lieu de résidence : en 1779, il est à Kamouraska, en 1781, à Louiseville ; en 1784, à Saint-Charles-sur-Richelieu ; en 1787, à l’Assomption et, en 1792, à Québec. Il n’est donc pas étonnant que deux de ses fils aient eu, eux aussi, la bougeotte.
Le 25 janvier 1803, Joseph Miville épouse Catherine Rouleau à Québec. Quinze ans plus tard, le voici qu’il dirige un hôtel de pension au 3, des Jardins, dans la haute ville de Québec. Le recensement de 1818 le qualifie alors de « cantinier ». Pour une raison inconnue, Joseph quitte Québec et s’établit dans la seigneurie de la Petite-Nation l’année suivante. Là, il dresse la liste des habitants de Montebello dans le cadre du recensement national de 1825. Trois ans plus tôt, c’est-à-dire le 22 mars 1822 à Oka, sa fille, Sophie Barbe, avait pris époux en la personne de François Charron, né en 1800 à Saint-Benoît des Deux-Montagnes (Mirabel). Le couple Charron-Miville élit lui aussi domicile à Montebello où il s’adonne à l’agriculture. C’est là que Sophie Barbe donne naissance à cinq enfants entre 1822 et 1837.
La plus vieille maison de Hull
La vie est difficile dans la seigneurie de la Petite-Nation où la pauvreté règne en maître à cause de la piètre qualité agricole des terres, ce qui pousse les Charron et les Miville à quitter cet endroit pour aller vivre sous des cieux qui, vus de Montebello, apparaissent plus cléments : les Chaudières. En effet, depuis l’automne 1826, on a entrepris le percement du canal Rideau sur la rive sud de la rivière des Outaouais, ce qui a pour effet d’attirer de nombreux travailleurs sur le territoire des actuelles villes de Gatineau et d’Ottawa. En avril 1827, le couple Charron-Miville  s’établit dans le canton de Hull où il obtient de Philemon Wright, le 23 du même mois, un terrain « à constitut » dans ce qu’on appellera plus tard le « village d’en bas ». Sur son emplacement, François Charron construit une belle maison de pierre qui est sans aucun doute la plus vieille maison du secteur Hull encore debout aujourd’hui[1]. Au même moment, Louis Rémi Miville, frère de Joseph, loue lui aussi un terrain de Wright.
s’établit dans le canton de Hull où il obtient de Philemon Wright, le 23 du même mois, un terrain « à constitut » dans ce qu’on appellera plus tard le « village d’en bas ». Sur son emplacement, François Charron construit une belle maison de pierre qui est sans aucun doute la plus vieille maison du secteur Hull encore debout aujourd’hui[1]. Au même moment, Louis Rémi Miville, frère de Joseph, loue lui aussi un terrain de Wright.
En octobre 1827, Joseph Miville demande à Wright d’utiliser une petit bâtiment en bois à l’embarcadère situé juste en face du canal Rideau, sur le territoire actuel du secteur Hull de la ville de Gatineau. L’année suivante, on le voit avec son frère, Louis Rémi, tenir taverne à Bytown (Ottawa), sans doute à un emplacement situé près de l’angle des rues George et Sussex. Mais, ni Joseph ni Louis Rémi ne semblent avoir laissé une descendance patronymique parmi nous. Notons que Georgette Lamoureux a écrit qu’il y avait à Ottawa, à l’intersection des actuelles rue Dalhousie et Rideau, un lieu que l’on désignait le « village de Mainville en 1826 ».
Échec de la fondation de Hull
On sait que Wright exigeait un loyer passablement élevé de François Charron pour le terrain du « village d’en bas ». l’historien Michael Newton a écrit : « Outre les 50 livres du prix d’achat, chaque propriétaire était tenu de verser un loyer annuel de six livres payable en versements trimestriels. La Philemon Wright and Sons se réservait le droit de saisir la propriété et de la vendre si l’acheteur ne respectait pas les stipulations ci-dessus. » Les exigences financières et l'état des finances de Wright expliquent sans aucun doute son manque d’intérêt momentané pour l’établissement d’un village et poussent alors les premiers résidents de Hull, dont Jean-Baptiste Couturier et Louis Rémi Miville, à s’établir à Bytown avant la fin de l’année 1827.
Furieux contre son oncle, Philemon Wright, à la suite d’une différend commercial, Charles Symmes quitte la colonie de Wright en avril 1827 pour fonder Symme’s Landing (Aylmer) qui deviendra le chef lieu de l’Outaouais. Quant à François Charron, il se voit dans l’obligation de renoncer à son terrain, sur lequel il avait déjà construit sa maison, en faveur de P. Wright and Sons, parce qu’incapable de payer son loyer. Pour toute compensation, il recevra de Wright la somme de 62 livres et 6 shillings. Le 12 mai 1829, Joseph Miville écrit à Ruggles Wright pour l’informer qu’il n’a plus besoin du bâtiment à l’embarcadère, car il « n’en retire aucun bénéfice ».
Le départ des pionniers du village de Hull entraînent, pour longtemps encore, la stagnation de la colonie de Philemon Wright. Cinquante ans après l’arrivée du « fondateur », Hull n’est encore qu’une petite bourgade d’au plus une centaine de personnes employées par les Wright, appelée Chaudières, Wrightstown et parfois Hull (Bytown – Ottawa - compte alors plus de 7 000 habitants). Un certain John J. Bigsby, qui visite le hameau en 1850, écrit qu’il est composé : d’une demi-douzaine de bonnes maisons et magasins, une jolie église épiscopale et plusieurs bâtiments secondaires....
Les Charron quittent le territoire actuel de Gatineau pour s’établir à Fort-Coulonge où Sophie Barbe donne naissance à son quatrième enfant, Louis Damase. Mais dès l’automne 1831, la famille Charron élit domicile à Montebello où elle fait baptiser ce dernier rejeton et y reste au moins jusqu’à la fin des années 1830. Au milieu des années 1840, les Charron s’installent sur les rives rocailleuses du lac McGregor où Sophie Barbe meurt en juillet 1852. Cinq ans plus tard, François Charron se remarie. Âgé de 57 ans, il épouse une jeunesse de 19 ans : Angélique Lepage. François Charron, qui semble avoir de la difficulté à s’établir définitivement, reste un temps dans les environs de Bouchette, en haute Gatineau, puis au début des années 1870, dans la basse ville d’Ottawa. En 1873, on le trouve à Angers et, en 1881, dans le canton de Gatineau.
Quand Angélique Lepage donne naissance à son dernier enfant qu’elle prénomme Malvina, elle a 47 ans et son mari, François Charron, 80 ans ! Bien que leur établissement à Hull ait été un échec, François Charron et Sophie Barbe Miville ont laissé une descendance parmi nous, car le couple a donné naissance à cinq enfants.
Sources :
BMS 2000.
Brousseau, Françine, Historique du nouvel emplacement du Musée national de l’Homme à Hull, Collection Mercure, Histoire no 38, Ottawa, 1984.
Gourlay, John L., History of the Ottawa Valley, s.l., 1896.
Lamoureux, Georgette, Bytown et ses pionniers canadiens-français 1826-1855, Ottawa, 1978.
Newton, Michael, « La maison Charron : symbole d’une vision contrariée » in Outaouais - Le Hull disparu, IHRO, 1987.
Recensement du Canada, 1881, canton de Gatineau, comté d’Ottawa, province de Québec.
Les marchands de glace de jadis
Jadis, la glace n’était pas un produit facile à produire et à conserver, particulièrement en milieu urbain. Dans l'Antiquité grecque et romaine, la neige prélevée sur les montagnes était entreposée dans des fosses et isolée par des matériaux végétaux. Elle restait ainsi durant des mois à l'abri de la chaleur et à la disposition des utilisateurs. On raconte qu'Alexandre le Grand faisait rafraîchir des tonneaux de vin dans des tranchées bourrées de neige afin de donner du cœur au ventre à ses soldats à la veille des batailles.
Le goût des boissons froides et des friandises glacées s'est répandu en Europe au moins dès le XVIe siècle. Aussi la vente de la neige et de la glace est-elle devenue une activité lucrative. Par ailleurs, on a fini par s'apercevoir que le froid favorisait la conservation des denrées alimentaires en enrayant la prolifération des organismes microscopiques. Le temps passant, on a eu de plus en plus recours à la réfrigération, même dans le grand commerce maritime.
Bien que le réfrigérateur électrique ait été inventé en 1913, les marchands de glace sont nombreux en Outaouais urbain jusqu’à la fin des années 1940. Les principaux marchands de glace étaient : Henri Lafrance et Ernest Dubuc à Val- Tétreau, Godin Frères de même que Hector Lafleur dans le Vieux Hull, Joseph Filiou, Lorenzo Tellier et Vipond à Wrightville, Miron à Pointe-Gatineau, etc. On récoltait la glace sur la rivière des Outaouais, sur les rives du parc Moussette et de baie des Paresseux (Squaw Bay), au lac Leamy et sur la rivière Gatineau.
Tétreau, Godin Frères de même que Hector Lafleur dans le Vieux Hull, Joseph Filiou, Lorenzo Tellier et Vipond à Wrightville, Miron à Pointe-Gatineau, etc. On récoltait la glace sur la rivière des Outaouais, sur les rives du parc Moussette et de baie des Paresseux (Squaw Bay), au lac Leamy et sur la rivière Gatineau.
Dès que la glace se formait sur le plan d’eau, les plus professionnels des marchands de glace préparaient leur produit naturel. Par exemple, les frères Godin, Aimé et Raoul, étaient fiers de dire qu’ils « font la glace » et pourtant ils la récoltaient au lac Leamy. Mais voilà, ils entretenaient leur « rond » soigneusement pendant de nombreuses semaines et n’y laissaient jamais la neige s’y accumuler. Si la pluie y laissait une couche de verglas, ils n’hésitaient pas à gratter la croûte friable jusqu’à la glace dure. Et pour la faire épaissir le plus rapidement possible et lui conserver sa limpidité, ils y perçaient des trous et faisaient monter l’eau par dessus.
Habituellement, la glace était prête à récolter peu après les Rois, c’est-à-dire avant la mi-janvier, quand elle avait atteint environ 35,5 centimètres d’épaisseur. Une dizaine de travailleurs, épaulés par trois ou quatre charretiers, prenaient une quinzaine de jours à la découper, la transporter et l’entreposer. Ce n’était pas un travail facile. On commençait l’opération à la barre du jour pour n’arrêter qu’à la brunante. Il faisait très froid sur les plans d’eau gelée et on devait parfois exécuter les travaux pendant des journées de grands vents et de tempêtes de neige.
La récolte de la glace
La glace était découpée au moyen de longues scies en blocs de 0,91 mètre de long, sur 35 centimètres d’épaisseur et 45 de largeur, qui pesaient plus de 200 kilogrammes. Un bon scieur de glace découpait environ 300 blocs par jour qui étaient ensuite poussés au moyen de longues perches jusqu’à une grue, actionnée par le va-et-vient d’un cheval, qui les soulevait et les déposait sur un traîneau tiré par deux chevaux. À partir des années 1930, la  glace sera sortie de l’eau au moyen d’un chargeur-élévateur mécanique, puis chargée sur un camion.
glace sera sortie de l’eau au moyen d’un chargeur-élévateur mécanique, puis chargée sur un camion.
Les vêtements de travail des hommes étaient alors bien différents des nôtres. Généralement faits de laine, ces vêtements imbibaient l’eau et devenaient lourds à porter. Il y avait danger de se couper ou de se faire écraser un pied. Les chevaux travaillaient tout aussi fort que les hommes et au péril de leur vie. Par exemple, dans les années 1940, le marchand Hector Lafleur en a perdu deux qui se sont noyés dans le lac Leamy pour avoir marché sur une glace trop mince.
La glace prélevée, des traîneaux en transportaient chacun une vingtaine de blocs jusqu’à la glacière. Outre leurs propres chevaux et traîneaux, les marchands de glace employaient des charretiers, avec chevaux et traîneaux, venant de la campagne environnante. Les plus assidus étaient les Benedict, de Hull, les Cardinal, de Clarence Creek et les Shouldice de Bourget. Ce transport de la glace, du plan d’eau aux glacières, était suivi de près par les enfants fascinés par le défilé des traîneaux pleins de glace. Montés sur le dernier rang des blocs de glace, jambes écartées, guides en mains, les charretiers dirigeaient les chevaux habilement décorés de clochettes et de fleurs en papier. Mais dès le début des années 1930, ces défilés se feront de plus en plus rares parce que les marchands de glace ont commencé à s’équiper de camions.
Les frères Godin avaient leur glacière rue Charlevoix, juste en face du parc Flora (aujourd’hui Fontaine), depuis 1925. Ils y entreposaient plus de 15 000 gros blocs qui y étaient hissés au moyen d’un palan et ensuite déposés sur un glissoir qui dirigeait les blocs à l’endroit voulu dans le vaste entrepôt. Quand la glacière était pleine, on étendait du bran de scie sur le dernier rang de glace ; certains marchands en étendaient entre chaque rang de blocs de glace.
 Le printemps arrivé, les marchands livraient la glace de porte en porte. Mais, avant la livraison, les gros blocs de glace étaient découpés à la hache, en petits blocs de 8 kilogrammes, par un « débiteur » adroit. Ces petits blocs seront vendus 0,05 dollar pendant les années 1930, et de 0,10 à 0,15 dollar au cours des années 1940.
Le printemps arrivé, les marchands livraient la glace de porte en porte. Mais, avant la livraison, les gros blocs de glace étaient découpés à la hache, en petits blocs de 8 kilogrammes, par un « débiteur » adroit. Ces petits blocs seront vendus 0,05 dollar pendant les années 1930, et de 0,10 à 0,15 dollar au cours des années 1940.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les réfrigérateurs, dont le prix d’achat a diminué, ont gagné rapidement en popularité de sorte que les marchands ont cessé leurs opérations les uns après les autres : les Godin en 1947 et les Lafleur en 1955. L’un des employés de Godin et frères, Emmanuel Émond, qui ne pouvait se résoudre à quitter le monde de la glace dans lequel il avait commencé à travailler en 1932, à l’âge de 14 ans, est devenu commerçant producteur de glace naturelle, puis artificielle. Dernier des marchands de glace de Hull, il a livré son ultime sac de glace en 1990.
Source :
Documentation personnelle.
Les célébrations de l'armistice en 1918
Il y a 95 ans s’achevait la Grande Guerre, celle que l’on croyait être la Der des der… après avoir fait une vingtaine de millions de morts. Commencée le 4 août 1914 dans l’enthousiasme même au Canada, la Grande Guerre s’achève par la reddition de l’Allemagne et de l’empire austro-hongrois le 11 novembre 1918. Le Canada y a perdu pas moins de 56 638 hommes (132 550 blessés). Effroyable ce premier conflit mondial, car les généraux belligérants, pour la plupart incompétents et insensibles à la masse des soldats, ont envoyé des millions d’hommes à la boucherie, sans la moindre chance de s’en sortir indemnes : les seules batailles de Verdun et de la Somme ont entraîné, en 1916, la mort de 470 000 Français et 420 000 Britanniques (dont des Canadiens)… un carnage ! En 1915 seulement, les Français perdaient 4 000 hommes (morts et blessés) par jour (et cela sera pire en 1916) ! La bataille de Passchendaele, du 26 octobre au 10 novembre 1917, aura fait 15 654 morts dans les troupes canadiennes.
Sauf les Canadiens de souches britanniques, la plupart des Canadiens de naissance, et plus particulièrement les Québécois, ne voyaient pas de bonnes raisons de participer à ce conflit étranger. La preuve en est qu’il fallut passer la loi de la conscription, en 1917, pour trouver un nombre suffisant de soldats en remplacement des soldats canadiens morts ou blessés. Et pour cause, ce conflit était d’abord européen et mettait aux prises des pays impérialistes qui dominaient alors le monde (France et Grande-Bretagne et Russie) ou qui voulaient le dominer (Allemagne, Autriche-Hongrie et l’Empire ottoman). Quoi qu'il en soit, environ 93 p. 100 des conscrits canadiens de 1917 auront fait une demande d'exemption (dispense).
Fin de la guerre
11 novembre 1918. En Outaouais et dans la capitale fédérale, la nouvelle de la signature imminente de l’armistice est connue à 3 heures le matin. Quelques minutes plus tard, sifflets et sirènes des usines de même que les cloches des églises retentissent pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens sortent des maisons et demandent ce qui peut bien se passer. La guerre est finie ont disent des gens bien renseignés. À 5 heures, les ouvriers envahissent l’église Notre-Dame-de-Grâce à Hull pour y rendre grâce avant de se rendre au travail.
Ottawa est en liesse. On apprend, dès 3 heures 1 que l’armistice sera signé à 6 heures, heures d’Ottawa. Les cloches de l’église St. Luke’s suivies de celles des autres églises de la ville sonnent alors que les sirènes des usines hurlent. Les gens sortent de leur logis et fraternisent. Rue Sparks, des hommes mettent le feu à une voiture et dansent tout autour. À 14 heures, la population s’assemble devant le Parlement où se réunissent les représentants des nations alliées applaudis par la foule ; les fonctionnaires quittent leur bureau. À 15 heures, commence une cérémonie d’Action de grâce en présence du gouverneur  général. Les fanfares militaires jouent le God Save the King. De nombreux discours saluent la victoire et remercient le Dieu tout puissant du fait qu’après quatre années de lutte et de sacrifices, les troupes de la démocratie, de la justice et de la liberté ont remporté une décisive et complète victoire sur les troupes de l’autocratie militaire et que le jour de la paix est enfin arrivé.
général. Les fanfares militaires jouent le God Save the King. De nombreux discours saluent la victoire et remercient le Dieu tout puissant du fait qu’après quatre années de lutte et de sacrifices, les troupes de la démocratie, de la justice et de la liberté ont remporté une décisive et complète victoire sur les troupes de l’autocratie militaire et que le jour de la paix est enfin arrivé.
En soirée, plus de 5 000 personnes s’assemblent devant les bureaux du journal Le Droit rue George et le Monument national. La fanfare de l’Université d’Ottawa participe à la démonstration. La foule entonna le Magnificat, l’Ave Maria Stella, la Marseillaise, l’Ô Canada et autres chants. Enfin, la fanfare s’ébranle pour se diriger vers le Parlement suivie par une foule réjouie.
En début de soirée, à Hull, il y a célébration d’un Te Deum à l’église Notre-Dame-de-Grâce remplie de fiidèles. Puis la foule se dirige vers l’hôtel de ville où non seulement y célèbre-t-on la victoire, mais aussi le fait que cette ville est la première au Québec à avoir dépassé l’objectif de souscriptions de bons de la Victoire (681 000 $) versée par la population composée en majorité d’ouvriers. Comme prix de son excellente participation, la Ville se voit remettre l’Union Jack, drapeau du Royaume-Uni (le Canada n’a pas de drapeau alors), appelé à flotter sur l’hôtel de ville.
Le maire Archambault fait un discours et demande à la foule de saluer par trois vivats le « plus grand soldat du monde » : le maréchal Foch, tandis que le 70e régiment joue La Marseillaise. Enfin, après les discours des députés, curés et autres « officiels » la population se retire dans le bon ordre ; elle doit travailler le lendemain.
Malheureusement, ce qui devait être la der des ders n’aura été que le prélude à la seconde Guerre mondiale qui éclate le 1er septembre 1939 entre les mêmes belligérants.
Sources :
Actualité de l’histoire, no 21D, septembre-octobre 2008.
Nos Racines.
The Buckingham Post (Buckingham), novembre 1918.
Le bulletin paroissial (NDG, Hull), novembre 1918.
Le Droit (Ottawa) novembre 1918.
The Equity (Shawville), novembre 1918.
The Ottawa Journal (Ottawa) novembre 1918.
Fondée officiellement en 1875, l’ancienne Ville de Hull disparaît en 2002 avec la fusion des municipalités du sud de la région de l’Outaouais. Pourtant, cette ville, dont l’établissement permanent datait de plus de deux siècles, était promise à un bel avenir… industriel.
L’histoire de Hull a évidemment commencé avec le monde amérindien. En effet, de nombreuses recherches archéologiques montrent que les Amérindiens occupaient régulièrement le territoire de l’ancienne ville et y tenaient même des cérémonies. Mais le site de la ville ne sera occupé, d’une manière permanente, qu’à partir de 1800 quand l’Étasunien Philemon Wright, accompagné des siens, s’y établit au printemps 1800. Wright ne cherche pas à fonder une ville, mais à développer une société nouvelle, autosuffisante qui devait prendre appui sur l’agriculture et sur la propriété foncière. En 1842, la grande famille Wright contrôle directement 72 p. 100 du territoire du canton de Hull.
Aucun domaine d’activités n’échappe à la famille, mais ces activités ne produisent pas tous les résultats escomptés. Par exemple, Philemon Wright refuse de vendre les terrains de l’île de Hull qu’elle loue à des conditions si sévères, probablement à cause de difficultés économiques, que les gens préfèrent s’établir à Bytown. De fait, l'arpenteur officiel du gouvernment, Joseph Bouchette, propose, en 1825, d'établir un village (Aylmer) et centre administratif à l'ouest de l'établissement de Wright « vu que les Wright, trop préoccupés par leurs autres entreprises, n’ont toujours pas favorisé l’accroissement de la population et des établissements sur le site de Hull (1). » Ce ne sera donc que le 23 février 1875 que sera officiellement formée la Cité de Hull à la suite des actions concertées du Français et prêtre oblat Louis-Étienne Delille Reboul et de l’industriel étasunien Ezra Butler Eddy
L’avenir de la ville est régulièrement remis en question par de gros incendies en 1880, 1882 (usines Eddy), 1886 et 1900. Celui du 26 avril 1900, par exemple, entraîne la destruction d’une partie des usines de la ville, de 42 p. 100 du territoire et la mise à la rue de près de 6 000 personnes. Plus d’un journal de l’époque prévoit que la ville ne pourra jamais renaître de ses cendres. De fait, la reconstruction sera difficile et le découragement s’emparera de plus d’un dirigeant. Un ancien maire demandera le changement de nom de Hull pour celui d’Ottawa-Nord et l’establishment local, représenté par la Chambre de commerce de Hull qui envie Ottawa, demande et fait la promotion de l’établissement d’un district fédéral qui engloberait Hull. Le curé de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce entre alors dans le débat et dit :
Si quelqu’un dans la ville de Hull nous trouve trop stupides pour administrer nos propres affaires, nous les laisserons libres de traverser de l’autre côté ; mais pour nous, nous sommes satisfaits de dire : Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre !
Les années 1910 ramènent à Hull la prospérité qui déclinera toutefois à partir des années 1920 et surtout à partir du fameux krach d’octobre 1929. Près du tiers de la population active est d’ailleurs en chômage en 1933.
Pour relancer la ville, politiciens et Chambre de commerce concertent leurs efforts pour y attirer des édifices du gouvernement fédéral. Un premier édifice important est construit dans les années 1950 : l’Imprimerie nationale du Canada. La construction de cet immeuble, boulevard Sacré-Cœur, entraîne l’expropriation des résidences de plusieurs familles.
important est construit dans les années 1950 : l’Imprimerie nationale du Canada. La construction de cet immeuble, boulevard Sacré-Cœur, entraîne l’expropriation des résidences de plusieurs familles.
Pour obtenir d’autres immeubles fédéraux et avoir un air de capitale, les dirigeants sont prêts à sacrifier une bonne partie de la population à tel point que les autorités municipales iront jusqu’à exproprier de nombreuses familles dans le nord de l’île de Hull (aire no 6) pour faire place à un édifice du gouvernement qui ne viendra… jamais ! À partir de la fin des années 1960, on exproprie et démolit plus de 1 600 logements pour faire place aux complexes de Place du Portage, Terrasse de la Chaudière et aux nombreux boulevards. En même temps ou presque, c’est-à-dire en 1975, le gouvernement Bourassa procède au regroupement de plusieurs municipalités de l’Outaouais qui fait des villes d’Aylmer et de Gatineau des concurrentes de Hull. Or, dans ce regroupement, Hull, enserrée dans un espace trop petit pour pouvoir grandir, n’obtient qu’un léger agrandissement de son territoire : c’est là la mort annoncée de Hull.
Peu à peu Hull devient le miroir d’Ottawa bien qu’elle se targue d’être la vitrine du Québec. Tournée essentiellement vers la capitale fédérale, Hull ignore la région qui, à son tour, se met à l’ignorer. Or, une ville est aussi forte que le sont ses citoyens, aussi importante, dans sa région que le nombre de personnes qu’elle compte. Et ça, les dirigeants hullois des années 1960 et 1970 l’ont oublié ; les expropriations ont chassé de leur logis de 6 000 à 8 000 personnes dont la majorité, à cause de l’absence de logements et de maisons à prix abordables à Hull, s’est établie à Gatineau. Ainsi, les 65 000 âmes que la ville avait déjà comptées ne seront plus que 56 000 et quelques en 1981 ! L’île de Hull, qui avait dénombré jusqu’à 22 000 personnes, n’en comptera plus que 11 000 en 1986 !
 Ainsi, Gatineau l’ancienne devient peu à peu la ville la plus importante de l’Outaouais avec une population plus grande que celle des villes d’Aylmer et de Hull réunies, et ce, grâce à un vaste territoire et au délogement de milliers de Hulllois. Lentement, mais sûrement, le rôle de capitale régionale glisse vers Gatineau. Quand arrive la fusion d’Aylmer, Hull et Gatineau, la logique du nombre fait que le nom de la nouvelle ville est celui de la municipalité où le poids démographique est le plus important : Gatineau. Hull est disparue.
Ainsi, Gatineau l’ancienne devient peu à peu la ville la plus importante de l’Outaouais avec une population plus grande que celle des villes d’Aylmer et de Hull réunies, et ce, grâce à un vaste territoire et au délogement de milliers de Hulllois. Lentement, mais sûrement, le rôle de capitale régionale glisse vers Gatineau. Quand arrive la fusion d’Aylmer, Hull et Gatineau, la logique du nombre fait que le nom de la nouvelle ville est celui de la municipalité où le poids démographique est le plus important : Gatineau. Hull est disparue.
(1) BÉGIN, Richard, Le chemin et le « port » d’Aylmer : la voie de l’Outaouais supérieur in Histoire Québec, vol. 11, no 1, 1er juin 2005.
À la fin de sa vie, Gilles Rocheleau, ancien maire de la Ville puis, député et ministre, dira publiquement, en parlant des expropriations des années 1960 et 1970 : « On a fait mal à un tas de p’tit monde… ». Eh bien, c’est ce « p’tit monde » qui s’est établi à Gatineau, qui a fait des enfants qui en ont fait à leur tour…
L’ancienne ville de Hull, devenue Gatineau en 2001, a souventes fois eu une triste réputation : ville d’incendies, petit Chicago, capital des plaisirs illicites et même capitale du crime dans les années 1980. Était-ce pire qu’ailleurs ? Sans doute pas.
Plongeons tout de suite au cœur des « belles années » du petit Chicago. Les habitants de Hull, pour la plupart des ouvriers journaliers, dont près du quart sera en chômage pendant la « crise de 1929 », rêvent à des jours meilleurs et salivent devant le train de vie des richards.
Il faut dire que les Hullois ont alors devant les yeux une vitrine bien attrayante : de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, de belles maisons cossues dressaient leur riche devanture à quelques pas des édifices parlementaires. Là, habitaient les hauts fonctionnaires de la fonction publique canadienne que la crise ne touchera guère. Juste en face de l’un des plus pauvres quartiers de Hull, on apercevait la belle maison du premier ministre du pays – le 24, Sussex –, et la luxueuse ambassade de France. La prospérité de quelques-uns contrastait avec la misère des chômeurs.
Comment faire pour s’enrichir, se demandent certains Hullois ? La solution est simple : faire comme l’élite, c’est-à-dire exploiter son prochain et les lois à son avantage. Par exemple : en plein cœur de la crise financière, un propriétaire de maisons à logements augmente ses loyers de 22 p. 100 en 1931 et de 23 p. 100 l'année suivante ! La Hull Electric Company, propriété de la Canadian International Paper, demande la permission d’augmenter ses tarifs à cause d’un déficit d’exploitation de son service de tramways. Une enquête démontrera alors que la Hull Electric n’a jamais cessé de faire de profits.
Les Hullois ont à portée de main un marché très lucratif : celui du vice. Car, voyez-vous, les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont alors plus longues à Hull qu’à Ottawa, et les débits plus nombreux : 1 débit pour 762 habitants à Hull alors qu’il y en a 1/1 194 habitants à Ottawa au cours des belles années du « petit Chicago ». Et même, la prohibition de la vente de l’alcool aura duré beaucoup plus longtemps à Ottawa (1916-1934) qu’à Hull (mai 1918 à juillet 1919). Ainsi donc, c’est par millier que les Ottaviens débarquent alors à Hull pour étancher leur soif insatiable.
Un journaliste du Spectateur écrit en 1909 : « La ville est littéralement remplie de salauds que la police d’Ottawa a chassés de ce côté-ci. La procession des vauriens grossit chaque soir sur les deux ponts qui conduisent à Hull. » On n’hésite pas alors à qualifier Hull de dépotoir d’Ottawa ! Chose à noter, 50 p. 100 des débits de boissons sont alors la propriété d’étrangers, souvent ontariens.
La manne que représentent les fêtards ontariens attire à Hull le crime organisé. Maisons de jeu (dites barbottes) ainsi que les bordels se mettent à pulluler. On les trouve principalement dans la rue du Pont (Eddy), Wellington et d’Youville.
Mais si le crime fleurit à Hull, c’est qu’il bénéficie d’une haute protection. En 1919, un juge sème l’émoi en déclarant en pleine cour que certaines autorités protègent les débits clandestins. Se sentant visé, le conseil proteste de son innocence !
Il y a évidemment des lois au Québec, et quand elles sont appliquées elles montrent que 75 p. 100 des contrevenants sont de l’extérieur de Hull. Elles ne sont pas appliquées parce que les politiciens ont des amis ; ils ne veulent pas amoindrir les profits des tenanciers de débits de boissons, ni fermer les bordels et les barbottes ce qui réduirait l’entrée d’argent dans les coffres de la Ville.
La Police provinciale (PP) tente, tant bien que mal, de faire respecter les lois. Elle traduit les tenanciers devant les tribunaux. En 1930, un journaliste du Droit écrit :
Ce matin dès avant dix heures, on pouvait voir une suite de limousines, autos de qualité, stationner en face du Palais de Justice (sic). Évidemment que le commerce n’a pas été à la baisse depuis le commencement de la guerre puisqu’on ne marche qu’en auto de luxe et en limousine. Le coût élevé de la vie et tout le tremblement n’auront rarement de prise sur les basses passions.
Par tous les moyens, les politiciens hullois tentent de soustraire la ville aux interventions de la PP depuis les années 1910 au moins.
En effet, les descentes de la PP ne font pas l’affaire de la Ville (des politiciens et des tenanciers). Que faire alors pour continuer à bénéficier des vices des Ontariens ? Tout simplement contrôler les opérations policières. Les politiciens hullois, qui ont mis à leur main la police locale depuis les années 1910 au moins, demandent à la PP, par voie de résolution le 9 mai 1936, de cesser ses descentes sur le territoire de la ville de Hull afin de laisser la voie libre… à ses propres policiers ! La PP y consent. Au moyen de son corps de police, la Ville s’assure de bénéficier du crime en évitant de traduire devant les tribunaux ses dirigeants. Ainsi donc, quand la police de Hull fait une descente, elle fait payer une amende fixe aux contrevenants, amende qui entre directement dans les coffres de la Ville tout en évitant de mettre en danger le commerce illicite. Ainsi, en 1937, les policiers procèdent à l’arrestation de 367 personnes pour avoir fréquenté des maisons de jeu et de 1 seul tenancier !
années 1910 au moins, demandent à la PP, par voie de résolution le 9 mai 1936, de cesser ses descentes sur le territoire de la ville de Hull afin de laisser la voie libre… à ses propres policiers ! La PP y consent. Au moyen de son corps de police, la Ville s’assure de bénéficier du crime en évitant de traduire devant les tribunaux ses dirigeants. Ainsi donc, quand la police de Hull fait une descente, elle fait payer une amende fixe aux contrevenants, amende qui entre directement dans les coffres de la Ville tout en évitant de mettre en danger le commerce illicite. Ainsi, en 1937, les policiers procèdent à l’arrestation de 367 personnes pour avoir fréquenté des maisons de jeu et de 1 seul tenancier !
Dès le milieu des années 1930, le maire dicte au chef de police les jours et heures auxquels il doit faire des descentes dans certaines maisons de jeu. Les policiers avertissent désormais les tenanciers des heures auxquelles ils vont procéder aux descentes de police.
Les policiers hullois ne sont pas tous des bénis oui-oui et certains font trop de zèle aux yeux des dirigeants. Ce qui fait qu’en 1939, le maire Moussette abolit le « bureau des détectives » et interdit à la police d’enquêter sur des crimes « vu que cela ne rapporte rien ! »
À partir de la fin des années 1930, des organisations locales lancent une campagne de moralité publique qui culmine à l’automne 1940. 17 000 personnes demandent, au moyen d’une pétition lancée par le Comité diocésain d’action catholique, le nettoyage de la ville. Le maire Moussette répond en déclarant, sans rire, qu’il n’existe aucune maison de jeu à Hull. Les journaux du Canada qualifient Hull de « Beer Town ». Comme au début du siècle, on demande de changer le nom de Hull, qui a mauvaise réputation, pour un nouveau.
Enfin, les Hullois se décident à changer de conseil municipal. La nouvelle administration, dirigée par le maire Raymond Brunet, demande une enquête publique qui sera conduite par le juge Édouard Fabre-Surveyer. Il rend son verdict en 1943 et tient responsable l’ancien maire Alphonse Moussette et les conseillers Dompierre et Morin qu’il condamne aux frais de l’enquête, d’avoir protégé des maisons de prostitution et de jeu, ainsi que d’avoir entravé les policiers dans leur travail.
En quelques années seulement, le maire Brunet aura réussi à nettoyer la ville en faisant envoyer en prison plusieurs tenanciers de maisons de jeu et de prostitution.
L'histoire montre que nous avons souvent les poiliticiens que l'on mérite. En 1948, le maire Brunet quitte la politique. La population le remplace par nul autre que l’ancien maire Alphonse Moussette qui obtient 64 p. 100 des suffrages ! Et aujourd’hui, comme s’il avait été un héros, un boulevard et un parc portent le nom de Moussette.
Sources
BAnQ, dossiers judiciaires du district de Hull, 1926-1938.
Cellard, André, Le petit Chicago, R.H.A.F., vol 45, no 4, printemps 1992.
Le Droit (Ottawa), 1918-1941.