Histoire du Québec
La Mission des crucifiés en Outaouais
![]() Par
ouimet-raymond
Le 02/05/2023
Par
ouimet-raymond
Le 02/05/2023
Il est étonnant de constater la persistance de l’occultisme et des pseudosciences divinatoires dans notre monde moderne pourtant dominé par la science. L’être humain soumis à l’une des deux forces émotionnelles de l’espèce, la sexualité et la religion, est prêt à croire n’importe quoi et n’importe qui.
Dès que l’être humain s’est mis à penser, à essayer de comprendre son environnement, il a essayé de se concilier les forces qu’il estimait mystérieuses et à prévoir son avenir. Le premier grand auteur connu de l’occultisme est Bôlos de Mendès qui vivait en Égypte cent ans avant J.-C. Son livre principal s'appelle Questions naturelles et mystérieuses.
L’occultisme existait au Québec bien avant l’arrivée des populations européennes, car les Amérindiens pratiquaient eux aussi les arts divinatoires. Jongleurs et sorciers avaient mission de prévenir la maladie, de favoriser le triomphe des armes et d’assurer l’abondance de la chasse ; les incantations des sorciers servaient à éloigner les mauvais esprits.
En 1660, en Nouvelle-France, vivait à Beauport un meunier nommé Daniel Vuil. Amoureux de Barbe Hallay, celle-ci l’avait éconduit à cause de sa réputation de sorcier. Repoussé, l’amoureux n’a songé qu’à se venger, ce qu’il aurait fait en infestant la maison de la jeune femme de mille et un démons. On dit que dans la maison des pierres volaient de tous côtés jetées par des mains invisibles (sans blesser personne toutefois). La nuit, Vuil lui apparaissait avec deux autres sorciers. Mais seule Barbe voyait démons et sorciers. Exorcisée, enfermée chez les Hospitalières de Québec, elle finit par se débarrasser de ses démons et se marier avec Jean Carrier dont elle aura au moins cinq enfants.
Soupçonné de sorcellerie et de magie, Daniel Vuil a été condamné à mort comme hérétique, blasphémateur et profanateur des sacrements, puis arquebusé à Québec le 7 octobre 1661. Trente-deux ans plus tard, à Salem, en Nouvelle-Angleterre (États-Unis), les autorités exécuteront 21 « sorcières » pour avoir envoûté une quinzaine de leurs concitoyennes !
Les Crucifiés en Outaouais
Au cours de l’hiver 1931-1932, un comédien et hypnotiseur au chômage, Ovila Girard, s’improvisait gourou et fondait, à Montréal, la Mission des crucifiés. Girard entrait en transe au cours de chaque cérémonie qu’il célébrait dans un pauvre logement du Faubourg à m’lasse. Il prétendait incarner l’esprit du « docteur des Sauvages ». L’esprit de cet Amérindien qui s’appelait Baraboule avait été apparemment sauvé au Bic par la secte quand il avait été poursuivi par 200 Iroquois ! « Êtes-vous contents de me voir ce soir ? » questionnait le gourou enveloppé d’un nuage de fumée ? L’assistance s’approchait de son chef spirituel et lui demandait de guérir leurs maux. Girard répondait parfois « May be » ou bien « You capish » !... L’emploi d’un anglais approximatif avait l’heur d’impressionner les esprits naïfs dont plusieurs prétendront avoir été guéris.
Un jour que des membres de la Mission s’étaient rendus dans le Bas-du-fleuve pour y donner une représentation théâtrale, les fidèles de la secte s’étaient convaincus qu’une étoile d’une grosseur étrange les éclairait personnellement. Profitant de l’occasion, le gourou leur expliqua qu’il avait eu, pendant la nuit, une révélation : cette étoile était celle… des Rois mages et elle brillait pour la première fois depuis la naissance de Jésus-Christ !...
En 1935, la secte des Crucifiés se transportait en Outaouais, plus précisément à Namur où elle disparaîtra à la suite d’un double meurtre commis par un de ses membres, Omer, frère du gourou. Accusé du meurtre prémédité de Léon Leclerc, 82 ans et d’Alfred Dudevoir, 65 ans, Girard sera pendu à Hull le 26 février 1937[1].
Une crédulité partagée
« Même les gens intelligents et cultivés croient en des choses bizarres », a écrit le professeur Michael Shermer, historien de la science, et rédacteur en chef du magazine Skeptic, dont le nom dit tout. Par exemple, dans les années 1990, l’Ordre du temple solaire réunissait des acteurs, des banquiers, des cadres d’Hydro Québec (une vingtaine), des hauts fonctionnaires, des ingénieurs, une journaliste du Journal de Québec, des médecins, des musiciens, des policiers, une psychologue, le maire de Richelieu, etc. Or, il s’y passait des choses difficiles à croire. Les membres de l’Ordre employaient comme engrais les « excréments du Christ », autrement dit ceux de la fille du gourou pour améliorer le rendement du potager biologique de la communauté, convaincus qu’ils avaient un pouvoir magique !
William Lyon Mackenzie King, premier ministre du Canada de 1921 à 1930 et de 1935 à 1948, pratiquait sérieusement le spiritisme et discutait, prétendait-il, avec l’esprit de Léonard de Vinci et celui de Louis Pasteur, rien de moins ! Dans son journal, à la date du 30 juin 1932, il a écrit : « Il ne fait aucun doute que les personnes auxquelles je me suis adressé étaient celles qui me sont chères et d'autres que j'ai connues et qui sont décédées. C'était l'esprit des défunts. »
PHOTO
Ovila Girard (au centre) et deux membres de la Mission des curicifiés photographiés à Namur, en Petite-Nation. Collection Serge Girard.
SOURCES
GABOURY, Placide, L’envoûtement des croyances, Montréal, Les éditions Quebecor, 2000.
LELEU, Christophe, La secte du temple solaire – explications autour d’un massacre, Claire Vigne Éditrice, 1995.
OUIMET, Raymond, L’Affaire des crucifiés, Québec, 2013.
SÉGUIN, Robert-Lionel, La sorcellerie au Québec du XVIIe au XIXe siècle, Montréal, 1978, éd. Leméac.
[1] Une troisième personne a été portée disparue, Annie Greenfield, conjointe d’Alfred Dudevoir.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 20/09/2022
Par
ouimet-raymond
Le 20/09/2022
Bryson est un village du comté de Pontiac situé en face de l’Île-du-Grand-Calumet et qui, en 1909, était le siège du district judiciaire du comté. À ce titre, la municipalité comptait un palais de justice et une prison construits en 1895 par l’entrepreneur hullois Joseph Bourque.
Le 31 août 1909, les autorités judiciaires y incarcéraient un certain Georges Guénette que l’on condamnera à quatre mois de prison avec travaux forcés le 9 septembre de la même année pour avoir commis un vol. Mais voilà, Guénette n’a pas l’intention de moisir longtemps en cellule aux frais du roi Édouard VII. En effet, ses vieux parents sont désargentés et ont besoin de sous, d’autant plus que le paternel est invalide. La prison ne compte alors que deux prisonniers, dont Guénette et un certain Thomas Newton écroué depuis le 12 juillet 1909 et condamné à trois mois de prison pour avoir obtenu de l’argent sous de mauvais prétextes.
Depuis 16 ans, le geôlier Charles Delphis Blondin, 69 ans, gouverne la prison dont son épouse est la matrone. Le tourne-clef est William Bolam, 66 ans. La prison n’est pas totalement entourée d’un mur, qui est par ailleurs facile à franchir, et des fenêtres du bâtiment donnent sur l’extérieur du centre de détention alors que les portes des cellules sont verrouillées par un simple cadenas.
Vers le 14 ou le 15 septembre, Guénette entre en communication, par la fenêtre de sa cellule, avec deux loustics. Il discute avec eux pendant au moins 45 minutes et leur montre un calendrier sur lequel il a souligné la date du 17. Cette date est bien choisie, parce que le geôlier est en congé du 11 au 18 septembre.
L’évasion
Il est 18 heures, le 17 septembre, quand le tourne-clef sert le souper à ses prisonniers dans la salle de séjour de la prison, puis il quitte le bâtiment pour aller manger chez lui. De retour une demi-heure plus tard, il dessert la table des prisonniers auxquels il remet une lampe, puis va s’installer au bureau du shérif, situé dans le même bâtiment.
situé dans le même bâtiment.
Pendant ce temps-là, le prisonnier Newton s’assoit dans le corridor des cellules pour y lire pendant que Guénette reste dans la salle de séjour pour y faire ses prières du soir comme à l’habitude. Mais ce soir-là, il prend plus de temps qu’à l’accoutumée. Aussi, Newton s’en inquiète-t-il, car il est déjà 19 heures 30, c’est-à-dire le temps de réintégrer les cellules. Il va donc aller voir ce que son compère brette. Il se rend compte que ce dernier n’est plus dans la salle et constate que les portes, habituellement cadenassées, sont ouvertes. Il se rend dans la cour où il n’y a pas âme qui vive. Il appelle d’un cri le tourne-clef qui vient tout juste de faire son entrée dans le bloc cellulaire pour y confiner les prisonniers.
Averti de la fuite de Georges Guénette, le shérif adjoint, Cornelius McNally, alerte son père, le shérif Simon McNally, 81 ans, vers 22 heures. Le shérif adjoint se met de suite à la recherche du prisonnier en cavale et se rend à Campbell’s Bay où il croit que Guénette y prendra le train le lendemain matin. Quant au shérif, qui vit au village de l’Île-du-Grand-Calumet, il se rend à Bryson dès le lendemain pour y connaître les détails de l’évasion. Il se rend ensuite à Fort-Coulonge, lieu de rassemblement des hommes de chantier qui se préparent à partir en forêt ou cherchent à se faire embaucher, et alerte les autorités des différents villages des alentours, sans succès
Le 30 septembre, l’inspecteur M. D. Woods lance une enquête sur l’évasion de Georges Guénette. On y apprend que la prison de Bryson a été mal conçue, que l’un des cadenas de la porte nord-ouest de la prison nécessite d’être verrouillé à double tour sinon, il est facilement ouvrable par un prisonnier qui passerait sa main à travers les barreaux de ladite porte. Qu’en grimpant sur les tambours des portes, un prisonnier peut facilement franchir le mur de l’enceinte de la prison ; que les prisonniers n’ont pas d’uniforme ; que le geôlier prenait en pitié Georges Guénette et que le tourne-clef n’avait pas vérifié que les portes donnant sur la cour avaient été verrouillées, etc.
Le 21 octobre suivant, Georges Guénette est arrêté à Sudbury (Ontario), et le 26 du même mois, il est condamné à 2 ans de prison à passer au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul après avoir purgé les 4 mois auxquels il avait été précédemment condamné. Nous ne savons pas non plus ce qu’il est advenu du prisonnier par la suite.
Sources :
BAnQ TP9, S23 et TL198, S1 dossier 456, Georges Guénette, 1909. ANQ Gatineau, fonds Cour du Banc du Roi et fonds Cour de magistrat pour le district de Pontiac (Bryson).
L’auteur tient à souligner qu’il a pris connaissance de cette histoire grâce à la collaboration de Jacinthe Duval, archiviste-coordonnatrice aux Archives nationales du Québec à Gatineau.
![]() Par
ouimet-raymond
Le 24/03/2022
Par
ouimet-raymond
Le 24/03/2022
Pendant que Cadieux et son compagnon faisaient diversion, les frêles embarcations voguaient au beau milieu des bouillons et de l'écume, plongeaient et se relevaient sur la crête des vagues qui les emportaient dans une course folle. Les habiles canotiers évitaient, tant bien que mal, les pointes acérées des rochers et tenaient, avec leurs avirons, les canots d'écorce dans les filets d'eau propices à leur progression. Mais le courant était si puissant que le désastre de la flottille était apparu inévitable. Dans l'une des embarcations, Marie Bourdon priait de tout cœur sainte Anne quand tout à coup apparut, devant les canots, une grande dame blanche qui montra la voie à suivre aux avironneurs. Le convoi était sauvé et en peu de jours tous les voyageurs furent rendus au lac des Deux-Montagnes, hors d'atteinte des ennemis.
Pendant la fuite miraculeuse des leurs en canots, Cadieux et son compagnon s'étaient engagés dans une furieuse bataille avec les Iroquois. Postés à l'abri de taillis, ils avaient abattu un, puis deux Iroquois dès le début de l'escarmouche. Revenus de leur surprise, les Iroquois avaient férocement contre-attaqué et le jeune algonquin était tombé sous leurs coups. Blessé, Cadieux avait réussi à rompre le combat et à se cacher dans les bois. Pendant trois jours, les Iroquois battirent la forêt pour retrouver sa trace et celles des siens. Trois jours et trois nuits le Montréalais était resté aux aguets sans pouvoir dormir ou se reposer. Désespérant de se rendre maître de leurs adversaires et frustrés du fruit de leur expédition, les maraudeurs remirent leurs canots à l'eau pour redescendre la Grande-Rivière.
Jean Cadieux s'était trouvé tout fin seul dans l'île du Grand-Calumet. Épuisé par le combat qu'il avait mené et les blessures qu'il y avait reçues, il lui fallait maintenant lutter contre les éléments de la nature et contre le sort qui lui était fait. Pendant ce temps, au bout de la Grande-Rivière, les siens s'inquiétaient de son retard. En effet, il aurait déjà dû être rendu à bon port, car on avait su que des maraudeurs Iroquois, ceux-là même que Cadieux avait affrontés, étaient de retour dans les parages de Montréal. On envoya donc trois hommes remonter le cours de la Grande-Rivière et porter secours à Jean Cadieux qui, se nourrissant de fruits et d'un peu de  chasse, voyait sa santé se détériorer un peu plus chaque jour.
chasse, voyait sa santé se détériorer un peu plus chaque jour.
Environ deux semaines après l'escarmouche, les trois hommes envoyés à son secours arrivèrent à l'île du Grand-Calumet et se rendirent au Petit-Rocher. Mais ils n'y trouvèrent pas Jean Cadieux qui s'était éloigné de son campement. A son retour, le coureur de bois y vit de la fumée :
Je me dis : ah! Grand Dieu! Qu'est ceci?
Les Iroquois m'ont-ils pris mon logis?
Dissimulé derrière un rideau d'arbres, il surveilla de loin les intrus qui s'apprêtaient à lever le camp quand il s'aperçut que les hommes qu'ils avaient pris pour des ennemis étaient des Français. Mais la joie produisit sur lui un tel choc qu'il était resté sans parole, incapable de signaler sa présence. Après le départ de la petite troupe, Jean Cadieux perdit tout espoir. Sentant la mort approchée, il écrivit son chant de mort, avec le sang ruisselant de ses blessures, sur de l'écorce de bouleau. Ensuite, il planta une croix de bois au pied de laquelle il creusa, de ses mains, une fosse, puis il s'y coucha :
C'est aujourd'hui que l'monde m'abandonne,
Mais j'ai recours en vous Sauveur des Hommes!
Très Sainte Vierge, ah! ne m'abandonnez pas.
Permettez-moi d'mourir entre vos bras.
Deux jours plus tard, les trois Français revinrent sur leurs pas. En repassant près du Petit-Rocher, ils aperçurent une croix faite de rondins dont ils s'approchèrent avec un respect mêlé d'un étonnement étrange : dans une fosse à peine creusée dans le sol gisait le corps encore chaud de Cadieux, à demi-enseveli dans des branches de sapins. Dans ses moins jointes reposait un large feuillet d'écorce de bouleau sur lequel il avait fait le récit de son agonie.
Après avoir inhumé le cadavre du coureur de bois et prié pour le repos de son âme, les trois hommes rapportèrent au poste de fourrures du lac des Deux-Montagnes l'écorce sur laquelle était écrit la complainte de Cadieux. Par la suite, on prit coutume d'entretenir une copie de ce récit, aussi écrit sur de l'écorce de bouleau, attachée à un arbre voisin de la tombe de Jean Cadieux, au portage des Sept-Chutes.
Le voyageur qui se rend aujourd'hui à l'île du Grand-Calumet peut voir, tout juste avant le village du même nom, un monument à la mémoire de Cadieux qui a été élevé, en 1895, par les travailleurs de l'entrepreneur Joseph Bourque, de Hull, lors de la construction du palais de justice de Bryson.
Source :
OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éditions Vents d’Ouest, 1994, p. 141-145, 152, 153.
La légende de Cadieux - première partie
![]() Par
ouimet-raymond
Le 21/03/2022
Par
ouimet-raymond
Le 21/03/2022
Il y a de cela longtemps, très longtemps même, la rivière des Outaouais était l'une des plus importantes voies de communication de la Nouvelle-France[1]. À cette époque, on l'appelait la Grande-Rivière. Aventuriers, coureurs de bois et explorateurs l'empruntaient pour se rendre à la baie d'Hudson, en Huronie, dans la vallée de l'Ohio et même jusque dans la lointaine Louisiane. En sens inverse, les Amérindiens empruntaient cette même voie d'eau pour descendre à Montréal ou à Québec et y échanger des fourrures contre des objets manufacturés dans les Vieux Pays.
Dans cette splendide rivière, grande comme un fleuveet aux nombreux rapides impétueux, qui coule sur une distance de 1 300 kilomètres du lac Eshawaham à celui des Deux-Montagnes, il y a, parmi des centaines d'autres, une grande et très pittoresque île : celle du Grand-Calumet. C'est là qu'a pris naissance la merveilleuse légende de Cadieux qui est malheureusement presque oubliée aujourd'hui.
La course dans les bois a été l'histoire de la vie de Jean Cadieux. La passion des voyages et le goût de l'aventure l'avaient attiré vers les pays des fourrures très jeune. Doué d'une vive intelligence, il avait bénéficié de l'expérience des Amérindiens dans la manière se tirer d'affaire avec peu de ressources. Naturellement, il avait adopté les moyens de transport indigènes, le canot l'été, la raquette l'hiver. Né à Montréal en 1671, il avait épousé Marie Bourdon en 1695 à Boucherville. Dix jours avant son mariage, il s'était engagé pour mener un canot chargé de marchandises au fort de la Louisiane et pour en ramener un rempli de pelleteries à Montréal.
Jean Cadieux, son épouse et quelques amis tant algonquins que français avaient passé l'hiver de 1709 à l'île du Grand-Calumet. Ils y avaient aménagés quelques cabanes au portage des Sept-Chutes, dans un lieu appelé Petit-Rocher, pour y attendre des Amérindiens de la tribu des Courtes-Oreilles qui devaient mener un convoi de pelleteries à Montréal le printemps suivant. Un jour du mois de mai, un jeune Algonquin, qui était allé rôder autour des rapides du portage, était revenu au camp tout essoufflé en criant : Nattaoué! Nattaoué! Les Iroquois ! Les Iroquois !
tant algonquins que français avaient passé l'hiver de 1709 à l'île du Grand-Calumet. Ils y avaient aménagés quelques cabanes au portage des Sept-Chutes, dans un lieu appelé Petit-Rocher, pour y attendre des Amérindiens de la tribu des Courtes-Oreilles qui devaient mener un convoi de pelleteries à Montréal le printemps suivant. Un jour du mois de mai, un jeune Algonquin, qui était allé rôder autour des rapides du portage, était revenu au camp tout essoufflé en criant : Nattaoué! Nattaoué! Les Iroquois ! Les Iroquois !
Un groupe de maraudeurs iroquois était embusqué à environ quatre kilomètres en bas du portage des Sept-Chutes en attente d'un convoi de fourrures à piller[2]. Il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à la bande de guerriers plus nombreuse que la troupe de Cadieux : sauter en canots les dangereux rapides réputés infranchissables. Mais ce n'était pas tout. Pour que la tactique réussisse, pour que le plus grand nombre soit sauvé et, enfin, pour que Marie vive, il fallait que quelqu'un restât sur l'île et se sacrifia. Cadieux, qui savait de quel bois se chauffaient les Iroquois, avait décidé d'assurer, lui-même, une diversion en les attirant dans les bois pour les empêcher de voir les fugitifs descendre les rapides. Un jeune et courageux Algonquin, dans lequel le coureur des bois avait une parfaite confiance, s'était spontanément joint à lui pour faire le coup de feu.
Une fois les préparatifs terminés, Cadieux et son jeune compagnon, armés de leurs fusils, haches et couteaux, étaient partis pour aller au-devant des Iroquois pendant que les autres se recommandaient à la bonne sainte Anne[3]. Il était convenu que les canots se lanceraient dans les rapides des Sept-Chutes[4] dès qu'on entendrait un ou plusieurs coups de fusils dans la direction du portage. Une heure ne s'était pas écoulée qu'un coup de fusil avait retenti, suivi bientôt d'un autre, puis de plusieurs. Les fugitifs avaient tout de suite mis à l'eau les canots et s'étaient engagés dans les terribles courants des Sept-Chutes. (À suivre)
[1] Le présent récit reprend, en partie, celui de Joseph-Charles Taché qui a été publié la première fois en 1863.
[2] Il ne peut s'agir que de maraudeurs, car les nations iroquoises avaient fait la paix avec les Français en 1701.
[3] Devant les périls de la mer et des voyages sur l'eau, les habitants de la Nouvelle-France avaient coutume de prier sainte Anne.
[4] Les rapides des Sept-Chutes n'existent plus aujourd'hui. Ils ont été noyés par la construction d'un barrage hydroélectrique en 1925. Le pont qui relie le village de Bryson à l'île du Grand-Calumet passe juste au-dessus de ce qui étaient les rapides des Sept-Chutes.
La tuberculose : fléau du XXe siècle
La tuberculose, longtemps appelée la peste blanche, a hanté nos parents et nos grands parents. Dès que quelqu’un toussait, crachait du sang, on s’éloignait de lui. Presque éradiquée de l’Amérique du Nord depuis les années 1970, elle revient dans de nombreux pays, dont des villes des États-Unis (New York par exemple) où les pauvres sans le sou ont de la difficulté à recevoir des traitements médicaux.
La tuberculose a été la maladie emblématique du XIXe siècle, que l'on connaissait, au Canada français, sous le nom consomption, et en Europe sous celui de phtisie. C’était la maladie romantique par excellence, affligeant de préférence les poètes et les âmes sensibles. Alexandre Dumas fils, dans son oeuvre maîtresse La dame aux camélias, 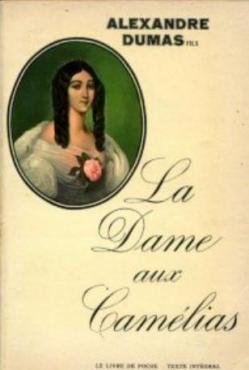 nous en fournit un exemple célèbre. Cette maladie était tellement à la mode que pour ressembler aux tuberculeuses, les femmes évitaient le soleil pour avoir la peau blanche, dessinaient au crayon bleu leurs veines pour les rendre apparentes et mettaient de l’atropine dans leurs yeux pour les rendre plus sombres !
nous en fournit un exemple célèbre. Cette maladie était tellement à la mode que pour ressembler aux tuberculeuses, les femmes évitaient le soleil pour avoir la peau blanche, dessinaient au crayon bleu leurs veines pour les rendre apparentes et mettaient de l’atropine dans leurs yeux pour les rendre plus sombres !
Les sanatoriums
La tuberculose n’était pas une maladie facile à guérir. Un médecin allemand, Herman Brehmer, lui-même guéri de la tuberculose des poumons après un séjour dans l’Himalaya, a ouvert un premier sanatorium en 1856. Convaincu que l’air froid de la montagne l’avait sauvé, le médecin avait mis au point une cure, basée sur l’exposition au grand air, l’alimentation et le repos, qui va se répandre en Europe et faire la fortune de nombreux établissements alpestres. Cela donnait aux médecins l’illusion de faire quelque chose. Au départ, les sanatoriums étaient réservés à une clientèle de privilégiés et ressemblaient à des hôtels de luxe en montagne. À défaut de meilleur remède, la cure sanatoriale s’est propagée aux États-Unis, puis au Canada, où le premier établissement a été construit en 1897 au lac Muskoka.
On ne connaissait pas le caractère contagieux de la maladie qui était tenue pour être une tare héréditaire. Ce n’est qu’en 1865 que le Français Antoine Villemin a prouvé que la tuberculose était causée par un organisme spécifique et contagieuse. Mais il faudra attendre l’Allemand Robert Koch et plus de 45 ans avant que les sceptiques soient convaincus du caractère pernicieux de la maladie.
Dans l’imaginaire populaire, le poitrinaire de l’ère romantique est devenu un cracheur de bacilles, et la maladie de la Dame aux camélias un symbole de la saleté, du désordre et de la promiscuité associé à l’industrialisation. Elle suscitait la honte et le rejet des personnes infectées. Le sanatorium est alors devenu partie d’une vaste stratégie visant à prévenir la contagion en isolant les malades et en leur enseignant l’hygiène.
En 1909, la tuberculose était, au Québec, la maladie infectieuse la plus répandue et la plus meurtrière, responsable d’au moins 33 000 décès entre 1896 et 1906. Un an plus tôt, un premier sanatorium québécois avait vu le jour à Sainte-Agathe. Considérée comme l’ennemi public numéro un, les autorités organisent une véritable croisade contre la tuberculose. Dans les années 1920, on a ouvert des sanatoriums publics. En 1951, on recensait pas moins de 18 sanatoriums dans la province. L’Outaouais s’est vu doté d’un sanatorium en 1935 : le sanatorium Saint-Laurent, à Hull (aujourd’hui l’hôpital psychiatrique Pierre-Janet). À Ottawa, le sanatorium Lady Grey Hospital (rue Carling) avait ouvert ses portes en 1910.
Ces sanatoriums étaient de véritables stationnements à tuberculeux organisés pour recevoir et traiter le plus grand nombre de patients possible. Certains étaient équipés de laboratoires et de salles de chirurgie dits « modernes ». Tout en appliquant la cure, les médecins cherchaient d’autres moyens pour soigner les malades, car les sanatoriums ne suffisaient pas à endiguer l’épidémie.
tuberculeux organisés pour recevoir et traiter le plus grand nombre de patients possible. Certains étaient équipés de laboratoires et de salles de chirurgie dits « modernes ». Tout en appliquant la cure, les médecins cherchaient d’autres moyens pour soigner les malades, car les sanatoriums ne suffisaient pas à endiguer l’épidémie.
Les traitements
Parmi les opérations pratiquées, surtout à partir des années 1930, la plus courante était la collapsothérapie. Cette intervention consistait à provoquer un affaissement du poumon, pour y réduire la quantité d’oxygène. Cette intervention pouvait causer de sérieuses complications et même la mort du malade. Elle entraînait des déformations thoraciques et des déviations de la colonne vertébrale. Parfois, elle semblait contenir l’étendue des lésions ! Parmi les gens atteints de tuberculose active, 50 p. 100 mouraient, 25 p. 100 demeuraient des malades chroniques pendant de longues années et 25 p. 100 connaissaient une guérison spontanée. Le seul fait de se reposer entraînait parfois la guérison.
Tout au long du XXe siècle, la mortalité due à la tuberculose n’a cessé de diminuer. Non pas à cause des sanatoriums, mais surtout à cause des facteurs socioéconomiques, l’amélioration de l’hygiène et l’alimentation, ainsi que la vaccination et les antibiotiques.
Sources :
BOURDON, Marie-Claude, Dans les couloirs du sanatorium, Québec Science (Montréal) avril 2008, pp. 37-40.
CÔTÉ, Louise, En garde ! – Les représentations de la tuberculose au Québec dans la première moitié du XXe siècle, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2000, pp. 32 et 33.
Le Petit Journal (Montréal), 6 novembre 1927.
Le départ des filles du roy pour Québec
On se plaît souvent à croire que toutes les Filles du roi sont venues au Canada volontairement pour y chercher mari. Mais est-ce si sûr ? Ce serait oublier qu’au XVIIe siècle, la France ne manquait pas d’hommes. Ainsi, on peut avancer que ce n’est sans doute pas de façon délibérée que certaines émigrantes ont quitté la France. Tel est le cas de Marie-Claude Chamois, cette jeune femme qui faisait partie du contingent des Filles du roi de 1670. Dix-huit ans après son arrivée en Nouvelle-France, elle a déclaré :
[...] qu’au Commencement du mois de may 1670 ayant esté nommée avec plusieurs autres filles de l’hospital pour aller en Canada par ordre du Roy [...][1]
C’est on ne peut plus clair : Marie-Claude Chamois avait dû se conformer à un ordre du roi ! Dans un document rédigé en 1686 par devant le notaire François Genaple, un témoin hautement crédible a laissé un témoignage important dont voici un extrait éloquent[2] :
...Elle certifie et ateste en son ame et conscience Il a environ les années gbjc soixante & unze soixante douze et soixante quatorze Elle a receu pendant chacune des années lettres de Paris a elle escrites et adressees par une personne nommée la veufve Chamois par lesquelles elle la prioit de s’informer de Marie Chamois sa fille venüe en ce pays quelques années auparavant et de vouloir employer son credit auprès des puissances de ce pays pour la faire repasser en France ; d’autant plus quelle n’avoit passé en ce pays que par les pratiques de son beaufrere et de sa sœur quy s’estoient efforcé de sen defaire par ce moyen...
Qui était ce fameux témoin ? Anne Gasnier en personne, veuve Jean Bourdon et directrice des Filles du roi. Reprenons les dernières lignes du témoignage : quelle n’avoit passé en ce pays que par les pratiques de son beaufrere et de sa sœur quy s’estoient efforcé de sen defaire par ce moyen [...]  Pas d’erreur possible : des membres de la famille de Marie Chamois, dont sa propre sœur, voulaient se débarrasser d’elle. Ils n’ont pas hésité à la chasser du cercle de ses proches et de son milieu ! Peut-on raisonnablement croire que cette Marie Chamois ait été la seule et unique fille du roi à subir ce traitement ? En tout cas, encadrée comme Marie et ses compagnes l’étaient, elles pouvaient difficilement se soustraire à la volonté du roi comme nous allons le voir ci-dessous.
Pas d’erreur possible : des membres de la famille de Marie Chamois, dont sa propre sœur, voulaient se débarrasser d’elle. Ils n’ont pas hésité à la chasser du cercle de ses proches et de son milieu ! Peut-on raisonnablement croire que cette Marie Chamois ait été la seule et unique fille du roi à subir ce traitement ? En tout cas, encadrée comme Marie et ses compagnes l’étaient, elles pouvaient difficilement se soustraire à la volonté du roi comme nous allons le voir ci-dessous.
Des filles étroitement encadrées
Un document conservé au Musée de l’Assistance publique de Paris montre comment les filles à marier envoyées en Amérique étaient encadrées, pour ne pas dire étroitement surveillées. Voici la transcription de ce document inédit[3] :
26 avril 1670
Messieurs de Pujol et Grenapin ont fait récit de ce qui s’est passé hier à la sortie des filles de l’hôpital que l’on envoie au Canada. Qu’à 2 h du matin celles de La Pitié entendirent la messe de monsieur le recteur et ensuite son exhortation. À 4 h elles partirent invitées par le sieur Champagne suivi d’une brigade d’archers et furent jusques au bord de la Seine au droit du pont de Bièvre, où elles trouvèrent celles de la Salpétrière qui venaient d’arriver. Toutes montèrent dans un grand bateau préparé en chantant Veni Creator dans ce bateau elles descendirent le long de la rivière jusques au droit du pont de Louvre ou était un grand foncet de Rouen, sur lequel se trouve monsieur Grenapin administrateur qui avait distribué tous les archers, tant ceux du grand prévost qui doivent escorter les filles jusques à Rouen que ceux de l’hôpital aux environs pour empeschement par l’intrusion et qu’aucun entrat dans le foncet Que les filles pour la commodité desquelles on avait mis 300 bottes de paille on l’avait couvert de toiles bien tendues et divisé en deux parties pour mettre dans l’une les filles de La Salpêtrière et dans l’autre celles de La Pitié et au milieu les hardes. Que mademoiselle de Mouchy après les avoir exhortées leur declara que l’intention du bureau était que celles de La Salpêtrière et de La Pitié fussent soumises à la conduite de le sieur Orienne et qu’à 10 h du matin elles partirent après avoir imploré la bénédiction du Ciel pour leur voyage par le chant de Veni Creator.
Le document laisse entendre que c’est pour leur protection que les filles étaient encadrées par des archers – hommes d’armes chargés d’assurer l’ordre –, c’est-à-dire pour empêcher des personnes, autres que les Filles du roi et leurs accompagnateurs, de pénétrer dans le foncet[4]. Mais, nous venons de le voir, Marie Claude Chamois, qui faisait partie de ce contingent, a bel et bien déclaré être venue en Nouvelle-France par ordre du roi et non de son propre chef.
À SUIVRE...
[1] Archives nationale de France, section ancienne, Parlement de Paris, X3b 1662, cité par Yves Landry, dans Les Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Leméac, 1992, p. 101, d’après un document trouvé par Mme Andrée-Hélène Bizier. Marie Chamois n’avait sans doute pas la mémoire des dates puisque c’est à la fin du mois d’avril que les Filles du roi ont quitté Paris et non au mois de mai. Elle s’est toutefois embarquée sur un transatlantique au mois de mai.
[2] Archives et Bibliothèque nationale du Québec, min. François Genaple, 5 novembre 1686. Sylvio Dumas a cité une partie de cet extrait dans Les filles du roi en Nouvelle-France, Cahiers d’Histoire, Société historique de Québec, Québec, 1972, page 140. Le témoignage en question est d’autant plus étonnant qu’au cours du procès qui s’est déroulé en 1693, la veuve Chamois a refusé de reconnaître sa fille.
[3] Archives de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, Extrait du Bureau de l’Hôpital général, 1656-1790, 45FossD/3 45 D1C, population. L’auteur remercie M. Jean-Claude Trottier qui l’a aidé à en faire la transcription.
[4] Le foncet était un bateau de transport fluvial lourd qui pouvait atteindre des tailles considérables et qui naviguait sur la Seine.
L'historique dépendance de l'Outaouais à l'égard de l'Ontario (suite)
Le village de Bytown, la future Ottawa, située sur la rive sud de la rivière des Outaouais, éclôt lors de la construction du canal Rideau. Le village prend rapidement de l'expansion. Dès 1843, la communauté des oblats de Marie-Immaculée s'y établi suivie deux ans plus tard par les sœurs Grises qui fondent, la même année, un orphelinat et un hôpital général. L'évêché de Bytown est créé en 1847. Pendant ce temps-là, Wright's Town (les Chaudières) peine à se développer. Il faudra l'arrivée et le concours de l'Américain Ezra Butler Eddy et du Français Étienne Delille Reboul pour que naisse la Ville de Hull en 1875. Mais Bytown, qui est devenue Ottawa, a pris une avance insurmontable sur la municipalité québécoise. En effet, la ville ontarienne est désignée capitale du Canada-Uni en 1857, puis capitale de la fédération canadienne en 1867. Dès 1871, les sœurs Grises la dotent d'un hospice pour vieillards qui dessert aussi la rive nord de l'Outaouais[1].
Avant même la transformation de Wright's Town en Ville de Hull, sa population dépendait d'Ottawa pour quantité de services.. En 1900, Hull ne compte ni hôpital, ni orphelinat, ni hospice. Le Pontiac dépend tout autant de l'Ontario. Par exemple, la ville de Pembroke, Ontario, est dotée d'un hôpital dès 1878 et devient le siège d'un évêché en 1898 auquel le Pontiac reste assujetti même si Hull devient évêché en... 1963[2]. Et la petite ville de Renfrew, située non loin d'Ottawa, a son Victoria Hospital dès 1897. Et dire que ce n'est pas avant 1911 que la ville de Hull se dotera d'un hôpital alors que son orphelinat ne verra le jour qu'en 1928[3]. Le premier hôpital de l'Outaouais a été fondé à Maniwaki en 1902 et il sera suivi par celui de Buckingham en 1906. Quant à la Petite-Nation, elle dépend plus de la région montréalaise et d'Hawkesbury (Ontario) pour quantité de services que de Gatineau.
Le siège de l'Église catholique à Ottawa
Il n'est pas étonnant que l'Outaouais soit dépendante de l'Ontario. Alors que l'Est ontarien s'est d'abord construit sur l'industrie agricole et la fonction publique,  l'Outaouais s'est avant tout construit sur l'industrie forestière qui périclitera tout au long du XXe siècle. Comme les services existaient par delà la rivière des Outaouais et que le siège des communautés religieuses les plus importantes – les oblats et les sœurs Grises – était aussi situé dans la capitale fédérale, l'Outaouais n'a pu se développer comme les autres chefs lieu du Québec. Par exemple, il n'y a jamais eu de séminaire à Hull ni même de scolasticat alors qu'il y en avait dans des villes québécoises beaucoup moins importantes que la ville outaouaise. La population de la rive québécoise de l'Outaouais fréquentait le séminaire d'Ottawa, le scolasticat des oblats, le collège séraphique des capucins à Ottawa, le collège universitaire des dominicains à Ottawa, etc. Ce n'est qu'en 1981 que les études supérieures seront offertes en Outaouais avec la création de l'Université du Québec à Hull. Quand on pense que le réseau des universités du Québec a vu le jour en 1968 et que l'Université du Québec à Rimouski a vu le jour en... 1969 ! J'ajoute que l'université d'Ottawa a reçu sa charte en 1889.
l'Outaouais s'est avant tout construit sur l'industrie forestière qui périclitera tout au long du XXe siècle. Comme les services existaient par delà la rivière des Outaouais et que le siège des communautés religieuses les plus importantes – les oblats et les sœurs Grises – était aussi situé dans la capitale fédérale, l'Outaouais n'a pu se développer comme les autres chefs lieu du Québec. Par exemple, il n'y a jamais eu de séminaire à Hull ni même de scolasticat alors qu'il y en avait dans des villes québécoises beaucoup moins importantes que la ville outaouaise. La population de la rive québécoise de l'Outaouais fréquentait le séminaire d'Ottawa, le scolasticat des oblats, le collège séraphique des capucins à Ottawa, le collège universitaire des dominicains à Ottawa, etc. Ce n'est qu'en 1981 que les études supérieures seront offertes en Outaouais avec la création de l'Université du Québec à Hull. Quand on pense que le réseau des universités du Québec a vu le jour en 1968 et que l'Université du Québec à Rimouski a vu le jour en... 1969 ! J'ajoute que l'université d'Ottawa a reçu sa charte en 1889.
À une exception près, les journaux quotidiens francophones ont tous pignon sur rue à Ottawa, sauf La Tribune de Hull de 1960 à 1964 . Et bien qu'environ 80% des lecteurs du journal Le Droit vivent en Outaouais, ce quotidien est toujours situé à Ottawa. Toutefois, dans le domaine des médias électroniques, l'Outaouais a damé le pion à Ottawa avec sa station radiophonique CKCH fondée à Hull en 1933. Toutes les chaînes télévisées francophones de la région, à part Radio-Canada et TFO, sont situées à Gatineau.
Une région longtemps ignorée
Depuis toujours, la dépendance de l'Outaouais vis-à-vis l'Ontario semble avoir fait l'affaire du gouvernement québécois qui n'a jamais investi autant dans cette région frontalière qu'en Mauricie où au Saguenay. Quant aux représentants de l'Outaouais à Québec, n'ont jamais été bien exigeants d'autant plus que plusieurs d'entre eux ont souhaité la venue d'un district fédéral. Devant l'inaction du gouvernement québécois en Outaouais, les élites hulloises ont fait appel au gouvernement fédéral dont ils se sont toujours sentis plus proches. Ainsi, en 1910, la Ville de Hull faisait appel à l'aide financière du gouvernement fédéral pour aménager son parc... de l'hôtel de ville. En 1942, le maire Raymond Brunet a même essayé de supprimer sa police municipale pour la remplacer par la Gendarmerie royale du Canada.
Aujourd'hui, une partie de l'Outaouais peut compter sur ses propres forces pour se développer sauf le Pontiac qui est resté fortement dépendant de l'Ontario. Mais comme la dépendance de l'Outaouais à l'égard de l'Ontario est plus que séculaire, elle est devenue une habitude.
SOURCES :
Archives des Oblats de Marie-Immaculée, Montréal, fonds 2D 20/13.
BARBEZIEUX, Alexis de, Histoire de la province ecclésiastique d’Ottawa et de la colonisation dans la vallée de l’Ottawa, Ottawa, 1897.
BERTRAND, André, Héritiers, témoins... Un peuple bâtisseur, Gatineau, 1990.
BOUCHER, Louis-Nathalie, La confession de Philemoin Wright, dans Hiedr encore, no 5, 2013, pages 39 et 40.
BOUTET, Edgar, Le bon vieux temps à Hull, tome 1, Hull, éd. Gauvin, 1971.
BRAULT, Lucien, Hull 1800-1950, Ottawa, éditions de l’Université d’Ottawa, 1950.
BROUSSEAU, Françine, Historique du nouvel emplacement du Musée national de l’Homme à Hull, collection Mercure, Histoire no 38, Ottawa, 1984.
CARRIÈRE, Gaston, Louis Reboul, o.m.i. 1827-1877, organisateur de la vie religieuse à Hull, Ottawa, Les éditions de l’Université d’Ottawa, 1959.
LAMOUREUX, Georgette, Bytown et ses pioniers canadiens-français 1826-1855, Ottawa, 1978.
Notre-Dame de Grâce, Hull, Québec, 1892, Hull, Société de généalogie de l’Outaouais, 1992.
Le Droit (Ottawa), 1924.
Du premier hôtel de ville à la Maison du citoyen, sous la direction de Lucien Brault, Hull, éditions Asticou, 1981.
NEWTON, Michael, La maison Charron : symbole d'une vision contrariée, dans la rfevue Outaouais, 1988, Le Hull disparu, IHRO, page 11 à 17.
[1] Et l'hôpital Saint-Vincent, pour malades chroniques, a vu le jour en 1924.
[2] Gatineau ne deviendra archevêché qu'en 1990 alors que le rôle de l'Église catholique dans la société québécoise n'a plus d'importance.
[3] Pendant de nombreuses années, l'Église ottavienne et la bourgeoisie franco-ontarienne se sont opposées à l’établissement d’un hôpital, d’un orphelinat et d'un évêché à Hull pour ne pas affaiblir le pouvoir des francophones d'Ottawa.
L'historique dépendance de l'Outaouais à l'égard de l'Ontario
L'Outaouais dépend de l'Ontario depuis très longtemps, sinon depuis toujours. À cause de la faiblesse de sa population et des liens entre les populations des deux provinces, une habitude s'est créée en Outaouais de consommer les services offerts par et sur la rive ontarienne de l'Outaouais.
Soulignons d'abord que de 1840 à 1867, les provinces actuelles de l'Ontario et du Québec étaient confondues dans l'Union des Canadas dont les anciennes colonies des Bas et Haut Canada étaient désormais appelées Canada-Est et Canada-Ouest. Ainsi les deux rives de l'Outaouais étaient unies sous un même gouvernement. Comme la rive nord de l'Outaouais est dotée d'une forêt dense, elle va se développer moins rapidement que la rive sud dont la qualité des terres lui était de beaucoup supérieure. Ainsi, l'industrie du bois va rapidement s'imposer en Outaouais
C’est au printemps de 1800 que l’Américain, Philemon Wright, fonde le premier établissement permanent sur un territoire qui deviendra plus tard la ville de Hull[1]. Il tente de créer un village dans les environs de l’actuel Musée des civilisations dans les années 1820, mais ses exigences envers les habitants – il préfère le plus souvent louer les terrains èa un prix particulièrement élevé, selon l'historien Michael Newton,ce qui a pour effet d'inciter les nouveaux venus à s’établir à Bytown (Ottawa)[2] – et l’état de ses finances personnelles ont vite fait de transformer ses efforts d’urbanisation en un échec dont les seuls vestiges sont la maison Charron[3]. La géographe Louis-Nathalie Boucher qui site l'archiviste Pierre-Louis Lapointe écrit dans la revue Hier encore (2013) : « Fondamentalement, Wright voit à demeurer propriétaire du sol. » Elle a aussi cité Joseph Bouchette qui a écrit dans son rapport de 1825 : « Tout le village est la propriété de Philemon Wright and Sons ; circonstance qui explique que sa population et ses établissements tardent à se développer. »
Cinquante ans après l’arrivée du « fondateur », la future ville de Hull n’est encore qu’une petite bourgade, d’au plus une centaine de personnes employées par les Wright, appelée Wright's Town, par Wright, Chaudières par les francophones et parfois Hull du nom du canton[4]. Un certain John J. Bigsby, qui avait visité le hameau en 1850, a écrit qu’il était composé de : ...half a dozen good houses and stores, a handsome Episcopal Church, and many inferior buildings[5]. À cette époque, le conseil du canton de Hull siège au village de Chelsea.
Un hameau qui stagne
Il y a peu de catholiques aux Chaudières et ceux-ci obtiennent des secours religieux de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa, municipalité qui bénéficie d'un personnel religieux catholique depuis 1827. En avril 1840, l’abbé Brady écrit à Mgr Bourget : « Il n’y a à Chelsea ni à Buckingham, ni à Templeton une maison où je puisse me retirer [...] Je me suis donc installé aux Chaudières et là je me trouve au centre de mes missions [...] C’est ici, aux Chaudières, que devrait être construite l’église des deux cantons de Hull et de Templeton si l’on pouvait y faire consentir tout le monde ; mais ça [sic] été impossible dans le temps. »
Le 8 octobre 1840, Mgr Bourget ordonne :  « ...que le canton de Templeton avec le village des Chaudières jusqu’au chemin de Brigham [actuel boulevard Saint-Joseph] y compris la terre d’Andrew Leamy qui est au-delà du chemin, forment la nouvelle mission de Saint-François-de-Sales de Gatineau. » À cette époque, les habitants du hameau des Chaudières sont peu nombreux et la très grande majorité est de religion protestante. Les catholiques du canton de Hull n’habitent pas sur les bords de la rivière des Outaouais, mais plutôt à l’intérieur des terres, à Chelsea, où on érige la mission Saint-Étienne en 1840.
« ...que le canton de Templeton avec le village des Chaudières jusqu’au chemin de Brigham [actuel boulevard Saint-Joseph] y compris la terre d’Andrew Leamy qui est au-delà du chemin, forment la nouvelle mission de Saint-François-de-Sales de Gatineau. » À cette époque, les habitants du hameau des Chaudières sont peu nombreux et la très grande majorité est de religion protestante. Les catholiques du canton de Hull n’habitent pas sur les bords de la rivière des Outaouais, mais plutôt à l’intérieur des terres, à Chelsea, où on érige la mission Saint-Étienne en 1840.
Les Chaudières sont bien situées au point de vue géographique. C’est là où le bois coupé dans les chantiers est assemblé en cage et acheminé à Québec par la rivière des Outaouais. Mais les nombreux cageux, soudain oisifs, doivent attendre cinq ou six jours pour sauter les chutes des Chaudières. Pour les prémunir contre les dangers de Bytown – bordels et tavernes –, le père Durocher fait construire à Hull, en 1846, une chapelle[6] qu’il dédie à Notre-Dame-du-Bonsecours, mais qui sera surtout connue sous le nom de « chapelle des chantiers ». Ce premier lieu de culte catholique à Hull sert d’abord et avant tout aux milliers de raftmen qui, en route pour Québec, doivent passer quelques jours aux Chaudières. Et c’est autour de cette chapelle que prendra forme le « village d’en bas », hameau à l’origine de la ville de Hull.
À partir de 1855, les prêtres du Collège d’Ottawa[7], c’est-à-dire les oblats, commencent à dire la messe à la « chapelle des chantiers » tous les dimanches. Hull a commencé à se développer depuis l’arrivée, en 1851, d’Ezra Butler Eddy (1827-1906) qui y fonde divers établissements, dont une allumière et une scierie. En 1861, on érige en mission la desserte de Hull. Sept ans plus tard, c’est-à-dire en 1868, le père Louis-Étienne Reboul (1827-1877) commence la construction d’une vaste église en pierre dont le sous-sol est ouvert au culte en 1870. En 1871, la paroisse Notre-Dame de Hull est érigée canoniquement et confiée aux Oblats de Marie-Immaculée.
À SUIVRE...
[1] Wright est propriétaire de tout le territoire du canton de Hull.
[2] NEWTON, Michael, La Maison Charron : symbole d'une vision contrariée, Outaouais (IHRO), Lù Le Hull disparu, page 13. Notons que Nerwton appelle la partie est du village de Hull le « village d'en-bas». Il est intéressant de savoir que le premier pont qui a relié les deux rives de l'Outaouais, le pont Union, a été construit en 1828 par le colonel John By fondateur de Bytown.
[3] Maison située dans le parc Jacques-Cartier, à la hauteur de la rue Verdun.
[4] Bytown compte alors plus de 7 000 habitants.
[5] Cité par Brousseau, Françine, dans Historique du nouvel emplacement du Musée national de l’Homme à Hull, Collection Mercure, Histoire no 38, Ottawa, 1984, page 15. Traduction : ...une demi-douzaine de bonnes maisons et magasins, une jolie église épiscopale et plusieurs bâtiments secondaires.
[6] Grâce à une souscription de 1 000 dollars des hommes de chantier, et à un don deux terrains, situés à l’intersection des actuelles rues Laurier et Papineau, par Ruggles Wright. Notons que les Oblats se sont établis à Bytown en 1844 et qu’ils y assuraient le service à la cathédrale.
[7] La future université d’Ottawa.
Il y a une petite soixantaine d'années, l’Église catholique dominait presque tous les secteurs de la société québécoise, sauf les secteurs industriels. Il faut dire que plus 95% de la population était alors de foi catholique. Par exemple, dans une petite municipalité comme l’ancienne ville de Hull (aujourd'hui incluse dans la ville de Gatineau), outre plusieurs paroisses, l’Église dirigeait le journal local, c’est-à-dire Le Droit d’Ottawa, la station radiophonique CKCH, les centres de loisirs, l’Organisation des terrains de jeux sans compter de nombreuses organisations dans lesquelles la population était enrégimentée : enfants de Marie, Ligue du Sacré-Cœur, Dames de Sainte-Anne, l’Association du Saint-Rosaire perpétuel, la Société de Tempérance, les croisés, les scouts, les guides, les actions catholiques, etc. Il y en avait pour tous les goûts, tous les sexes, tous les âges. Et chacune de ces organisations avait son aumônier. Rien ne se passait dans une paroisse catholique sans que le curé ne le sache. Des curés allaient même jusqu’à débusquer les amoureux qui se caressaient dans les fourrés des parcs…
Les autorités religieuses régissaient le quotidien de ses fidèles. Par exemple, elles avaient dressé une liste d’ouvrages, appelée l’Index, que les catholiques n’étaient pas autorisés à lire, accompagnée des règles de l’Église au sujet des livres. Le but de cette liste était d’empêcher la lecture d'ouvrages qui contredisaient ou critiquaient l’Église et d’éviter ainsi que les fidèles ne se détournent de leur foi. À l’Index, on trouvait les livres des auteurs tels Alexandre Dumas, père et fils, Balzac, Victor Hugo, etc. L’Église valorisait alors l'ignorance et la soumission, multipliait les tabous, gérait à coups d'interdits et infligeait une culpabilité morbide même à des enfants innocents.
Le catéchisme
La pratique religieuse s'apprenait très tôt. Généralement, la maman enseignait aux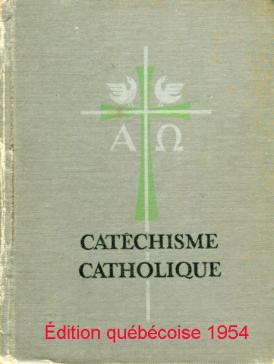 enfants à dire leurs prières. Souvent, la première prière apprise s’adressait au « p’tit Jésus » et à l’ange gardien. Puis, selon les convictions de la mère, elle enseignait à l’enfant le Notre Père ou le Je vous salue Marie. À l’école, l’enfant devait apprendre le Catéchisme catholique qui contenait « Ce que nous devons croire, ce que nous devons faire, ce que nous devons avoir pour aller au ciel. » Celui des années 1940 contenait 519 questions et réponses, celui des années 1950, en contenait… 992 ! La prière centrale du catéchisme, celle qu’il fallait absolument savoir par cœur pour faire sa première communion était le Je crois en Dieu qui contient apparemment « les principales vérités révélées que nous devons croire pour aller au ciel. »
enfants à dire leurs prières. Souvent, la première prière apprise s’adressait au « p’tit Jésus » et à l’ange gardien. Puis, selon les convictions de la mère, elle enseignait à l’enfant le Notre Père ou le Je vous salue Marie. À l’école, l’enfant devait apprendre le Catéchisme catholique qui contenait « Ce que nous devons croire, ce que nous devons faire, ce que nous devons avoir pour aller au ciel. » Celui des années 1940 contenait 519 questions et réponses, celui des années 1950, en contenait… 992 ! La prière centrale du catéchisme, celle qu’il fallait absolument savoir par cœur pour faire sa première communion était le Je crois en Dieu qui contient apparemment « les principales vérités révélées que nous devons croire pour aller au ciel. »
À 7 ans, l’âge de la raison, les enfants faisaient leur première communion, après avoir été confirmés par l’évêque du diocèse, et se confessaient (sacrement de la pénitence) pour la première fois à un prêtre qui les absolvait de leurs péchés. Les catéchismes scolaires de cette époque disaient alors qu’il y avait quatre types de péchés : le péché actuel, le péché mortel, le péché véniel et les péchés capitaux. La confession commençait alors par la formule suivante : « Mon père, bénissez-moi parce que j’ai péché. Je me confesse à Dieu et à vous, mon père… » Ensuite, le pécheur disait « Mon père, je m’accuse de… » Il fallait alors nommer tous les péchés commis en soulignant le nombre de fois qu’ils avaient été commis. Enfin, la confession se terminait par la formule : « Je m’accuse encore de tous les péchés de ma vie ; j’en demande pardon à Dieu, et à vous, mon père, la pénitence et l’absolution. »
Il y avait plusieurs moments forts dans la pratique du catholicisme. D’abord le baptême qui est le sacrement « qui efface le péché originel et fait d’un enfant un chrétien ; la confirmation qui est le sacrement par lequel « un baptisé devient un parfait chrétien, un apôtre et un soldat du Christ. » Outre ces derniers, il y a cinq autres sacrements : eucharistie (communion), pénitence, extrême-onction, le mariage, et le plus important, au dire des prêtres d’alors, l’ordre, sacrement par lequel un homme (et seul un homme) devient un ministre sacré de l’Église catholique.
Hors de l'Église point de salut !
Les catholiques étaient appelés à célébrer obligatoirement (donc, aller à la messe) sept fêtes religieuses : Noël, la Circoncision (jour de l’An), l’Épiphanie, Pâques, l’Ascension, la Toussaint et l’Immaculée Conception. Les catholiques devaient s’abstenir de manger de la viande tous les vendredis de l’année, pendant le carême, etc. On leur conseillait fortement de se confesser tous les premiers vendredis du mois. Les catholiques avaient aussi l’obligation de recevoir la communion au moins une fois par année, pendant le temps pascal qui va du mercredi des Cendres au dimanche de la Quasimodo (premier dimanche après Pâques). Ne pas faire ses Pâques c’était être en état de péché mortel. Et mourir en état de péché mortel c’était passer l’éternité en enfer.
 Les catholiques devaient aller à la messe tous les dimanches et les fêtes d’obligations. Le catéchisme des années 1950 dit : « Hors de l’Église, point de Salut ! » Ce qui veut dire que « celui qui par sa faute n’appartient pas à l’Église catholique et meurt sans se repentir ne peut pas aller au ciel. »
Les catholiques devaient aller à la messe tous les dimanches et les fêtes d’obligations. Le catéchisme des années 1950 dit : « Hors de l’Église, point de Salut ! » Ce qui veut dire que « celui qui par sa faute n’appartient pas à l’Église catholique et meurt sans se repentir ne peut pas aller au ciel. »
Le péché mortel était alors défini comme une « désobéissance grave qui offense Dieu et nous enlève la vie surnaturelle. » Or mourir avec sur la conscience un seul péché mortel, c’était se condamner à l’enfer pour l’éternité. Désobéir aux commandements de Dieu était un péché mortel ; la contraception était un péché mortel, etc. Dans les classes des écoles décorées d'images religieuses, il arrivait que l'on raconte aux enfants qu’une religieuse, morte à l’âge vénérable de 80 ans, avait commis le seul péché mortel de sa vie la veille de son trépas, ce qui lui avait mérité l'enfer pour l’éternité. Alors que l’on priait autour de son cercueil, elle s'était soulevée pour dire : « Ne priez pas pour moi : je suis damnée ! » Ça enlevait l’envie de faire un péché mortel à moins d'en rire. L’Église de cette époque voyait l'homme comme un monstre, égoïste, veule, lubrique et lâche qui, laissé à lui-même, ne ferait que du mal, à lui-même et à son prochain, bref, essentiellement comme un pécheur.
Ceux et celles qui avaient publiquement fauté, comme les Patriotes de 1837-1838, ont été inhumés dans des fausses situées à l’extérieur des limites des cimetières catholiques ou même dans des fosses préalablement désacralisées !
Sources :
Le catéchisme des provinces ecclésiastiques, de Québec, Montréal et Ottawa, Québec, 1944.
Catéchisme catholique, Québec 1954.
Le Devoir (Montréal) 12 mars 2008.
Souvenirs d'enfance de l'auteur
Noël au Québec dans les années 1930
Le krach boursier 1929, qui s’est transformé en une importante dépression économique dès le printemps 1930, a eu des répercussions énormes sur la population québécoise. Songeons qu’en 1933, la pire année de la dépression, plus de 25% des travailleurs (34% à Montréal) étaient sans emploi. Pas d’assurance chômage (pardon, assurance emploi !) ni de Bien être social pour les familles ; elles ne pouvaient compter que sur les solidarités familiales (importantes) et la charité publique.
La population avait faim. En avril 1934, 400 à 500 chômeurs manifestaient aux abords des bureaux de l’Assistance publique à Hull. Ils demandaient une distribution plus généreuse des secours et des vêtements chauds pour les hommes qui travaillaient à des travaux d’utilité publique. Les polices municipale et provinciale sont intervenues et ont dispersé les hommes après avoir arrêté le principal meneur, un certain Jean-Paul Lafontaine. Le même soir, le maire Lambert déclarait que la Ville n’était pas en mesure de faire plus pour ses chômeurs dont les organisations étaient injustement taxées de communistes.
La vie était à ce point difficile que le nombre des naissances au Québec, de 87 527 qu’il était en 1925, chute à 75 267 en 1935. Même les animaux souffraient de la faim. Les chômeurs faisaient preuve d’imagination pour permettre à leur famille de survivre. Certains s’improvisaient affûteurs de couteaux, pelleteurs de neige ou réparateurs d’automobiles. Quant aux femmes, elles géraient du mieux qu’elles le pouvaient le famélique budget familial et s’adonnaient à la couture à domicile (par exemple, elles fabriquent des couvertures avec des poches de farines), à des travaux faiblement rémunérés et, parfois, à la prostitution. Heureusement, il y avait la solidarité. Les gens de la ville pouvaient souvent compter sur des parents restés à la campagne qui partageaient les fruits de leur potager.
Évidemment, les travailleurs protestaient. En 1934, 600 bûcherons de l’Abitibi, payés un maigre 26 $ par mois, se mettaient en grève ; 77 d’entre eux ont été arrêtés pour avoir fait « sédition ». Le 20 décembre 1934, on en condamnait 13 à des peines variant de 4 à 12 mois de prison et les 64 autres à des condamnations avec sursis.
À cette époque, le communisme progressait même au Québec. L’Église catholique était inquiète. Dans un message publié le 23 décembre 1933, l’éditorialiste du journal Le Droit écrivait : C’est Noël dans quelques heures. […] Des quatre coins du monde, monte la plainte, l’immense plainte de la plèbe qui souffre. […] Et au travers de ces voix, déjà aigries et fielleuses, circulant en vitesse et déjà ne cachant plus l’appel des éléments subversifs de l’ordre social : cri de guerre qui redit aux foules, comme celui des Princes du peuple dans la Passion : Détruisez, renversez, clouez au pilori cet ordre qui est né pour la jouissance du petit nombre […]
C’est Noël dans quelques heures. […] Des quatre coins du monde, monte la plainte, l’immense plainte de la plèbe qui souffre. […] Et au travers de ces voix, déjà aigries et fielleuses, circulant en vitesse et déjà ne cachant plus l’appel des éléments subversifs de l’ordre social : cri de guerre qui redit aux foules, comme celui des Princes du peuple dans la Passion : Détruisez, renversez, clouez au pilori cet ordre qui est né pour la jouissance du petit nombre […]
Dans ce cadre de vie désespérant, les chansons de Mary Travers dite la Bolduc ont permis aux nôtres de passer à travers la crise économique des années 1930 qui ne s’est achevée qu’avec la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Elle a chanté sur tous les tons les hauts et les bas de la dépression. Sa chanson Le jour de l’An a été enregistrée le 14 novembre 1930. Un mois et demi plus tôt, elle chantait :
Mes amis je vous assure que le temps est bien dur
Il faut pas s'décourager ça va bien vite commencer
De l'ouvrage i'va en avoir pour tout le monde cet hiver
Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement
Ça va v'nir puis ça va v'nir
Ah! mais décourageons-nous pas
Moi J'ai toujours le cœur gai et j'continue à turluter !
Et Noël dans tout ça ?
Dans les années 1930, les francophones du Canada ne fêtaient pas Noël comme aujourd’hui. De fait, aujourd’hui, Noël est la grande fête de la « sainte consommation » (seulement 11 % des Québécois estiment que Noël est un moment de recueillement). Il y a à peine 60 ans, Noël était une fête religieuse qui commençait par la messe de minuit et suivi du réveillon, ou par un réveillon suivi de la messe du matin. L’extrait suivant du poème Conte de Noël, écrit par Émile Coderre dit Jean Narrache montre bien l’importance de la messe de minuit pendant la crise :
Conte de Noël (1939)
Vous parlez d’un veill’ de Noël !
C’nuit-là, i’ poudrait à plein ciel ;
I’ vous faisait un d’ces frets noirs
Qu’on g’lait tout grandis su’ l’trottoir.
Ça traversait mon capot d’laine
Comm’ si ç’avait été d’l’inyienne.
Le mon’, ça passait en band’s drues ;
Y’en arrivait d’tout’s les p’tits rues,
L’nez dans l’collet et puis l’dos rond
En tâchant d’longer les perrons,
Chacun à deux mains su’ son casque
Pour pas qu’i’ par’ dans la bourrasque.
On s’dépéchait tous pour la messe,
Vu que l’gros bourdon d’la paroisse
Grondait les premiers coups d’minuit
Qu’ça faisait comm’ trembler la nuit.
… Noël ! Noël ! La joie d’la fête
Me montait du cœur à la tête !…
Peu de francophones échangeaient des cadeaux – qu’on appellaient étrennes – à Noël. De fait, les échanges de cadeaux se faisaient au Jour de l’An, et ce, jusqu’au début des années 1950. Généralement parlant, seuls les Canadiens de langue anglaise et une certaine bourgeoisie francophone sacrifiaient au nouveau dieu, le père Noël, qui avait commencé à pénétrer dans nos foyers vers la fin du XIXe siècle ; la célèbre famille Papineau l’avait adopté et l’Église condamné parce qu’il représentait le matérialisme et mercantilisme !
Les cadeaux étaient modestes et rares pendant la Dépression : une bonne moitié de la population n’avait pas les moyens d’acheter des cadeaux. Et quand il y en avait, c'était souvent des oranges (0,25 $ la douzaine, soit le salaire horaire légal en 1931) et des pommes, enfouies dans des bas, pour les enfants qui avaient été gentils, et des morceaux de charbon ou, pire encore, des pelures de patates pour ceux qui ne l’avaient pas été. Je vous laisse imaginer la tête que faisait alors l’enfant qui recevait un tel présent ! N’empêche, on savait s’amuser, de Noël au jour des Rois, avec des chansons à répondre agrémenté de « p’tits remontants » fabriqués à la maison.
SOURCES
BAnQ, enregistrements sonores 1930.
La Presse (Montréal), 6 décembre 2008.
L’Action catholique (Québec), 19 avril 1934.
Le Droit (Ottawa), décembre 1933 et 1934, avril 1934.
Le Petit Journal (Montréal), décembre 1930, 1931 et 1932.
Narrache, Jean, Quand j’parl’ pour parler – Poèmes et proses – Anthologie présentée par Richard Foisy, Montréal, l’Hexagone, 1993, p. 100.
Les rites funéraires de notre passé
Il n’y a pas si longtemps, novembre était le mois des morts. En moins de cinquante ans sont disparus la plupart des cérémonies et des rites d’antan qui accompagnaient le décès d'une personne. Même le décorum a été jeté aux oubliettes de l’histoire. Mais la mort, elle, est toujours présente même si l'on meurt rarement à la maison aujourd'hui, mais plutôt à l’hôpital, et que la plupart des défunts ne voient plus leur corps exposé, mais incinéré.
Pensons à ceux et celles qui mouraient à la maison, ce qui a été le cas jusqu'au début des années 1960. On faisait d’abord taire la radio voire le téléviseur. Chez certains, on allait jusqu’à voiler les sources de lumière et même les miroirs de la maison afin que l’âme du défunt ne soit tentée de se mirer à loisir, retardant ainsi ou compromettant son entrée au paradis. Aujourd’hui, dans des hôpitaux de la région, il arrive encore que le personnel ouvre la fenêtre de la chambre où la personne est décédée, pour permettre à son âme de quitter ce monde[1].
Ensuite, on accrochait un crêpe à la porte si le défunt y était exposé : noir pour un homme, gris ou violet pour une femme, et blanc pour un enfant. Si une dépouille mortelle gisait dans la maison un dimanche, on croyait généralement qu’un autre décès serait à déplorer dans la famille au cours de l’année. Puis, les proches du défunt observaient le deuil pendant un an (voilette des femmes appelée pleureuse et abandonnée au milieu du XXe siècle) – le grand deuil –, et pendant six autres mois le demi-deuil qui permettait d’assortir aux vêtements noirs du grand deuil des vêtements blancs ou violets. Quant aux hommes, ils portaient à leur bras un brassard noir. La personne qui ne suivait pas ces règles s’exposait à la réprobation générale. Je me souviens, enfant, avoir vu une femme arriver à la maison funéraire, les ongles recouverts d’un vernis rouge pompier ! Ça avait fait jaser… Et nul n’aurait osé venir à la maison mortuaire ou aux funérailles vêtu de vêtements de travail ou de sport ; chacun se mettait « sur son trente-six ».
Pendant tout le temps que durait le deuil, on évitait de danser et même d’écouter musique joyeuse ou radio. Pour garder vivace le souvenir du disparu, on faisait imprimer des cartes mortuaires, avec la photo de la personne décédée, que l’on remettait aux parents et amis de la famille. Cette dernière pratique est revenue à la mode ces derniers temps.
Les vêtements de deuil
Il s’agissait, dans des temps très anciens, de marquer les personnes qui vivaient en compagnie du défunt, de façon à les tenir à l’écart, à n’avoir de contact avec elles que de loin et à éviter ainsi toute contagion possible. Les proches du défunt s’interdisaient de sortir ou tout au moins de se mêler à la société des autres pendant un temps déterminé. Ils acceptaient ou on leur imposait des vêtements de forme ou de couleurs spéciales pendant un temps variable selon les sociétés, les civilisations, les époques.
Tant à la résidence de la dépouille (jusque dans les années 1950)  qu’à la maison funéraire, on veillait le corps pendant trois jours (à la maison, on le veillait aussi la nuit). Puis venait le jour des funérailles à l’église. Il y avait trois classes de funérailles plus la simple absoute et la cérémonie des anges réservée aux bébés. Dans la 1re classe, l’église était toute tendue de noir et la grand-messe funèbre, accompagnée par les chants d’un chœur, était dite par trois prêtres (diacre, sous-diacre). Pour mettre en valeur le cercueil du défunt, on dressait provisoirement, au centre de l’église (allée centrale, près de la sainte table), un catafalque – sorte d’estrade funéraire sur laquelle était déposée le cercueil et qui le dégageait du sol – et dont l’élévation, la pompe et les ornements indiquaient l’importance, le rang social, du disparu.
qu’à la maison funéraire, on veillait le corps pendant trois jours (à la maison, on le veillait aussi la nuit). Puis venait le jour des funérailles à l’église. Il y avait trois classes de funérailles plus la simple absoute et la cérémonie des anges réservée aux bébés. Dans la 1re classe, l’église était toute tendue de noir et la grand-messe funèbre, accompagnée par les chants d’un chœur, était dite par trois prêtres (diacre, sous-diacre). Pour mettre en valeur le cercueil du défunt, on dressait provisoirement, au centre de l’église (allée centrale, près de la sainte table), un catafalque – sorte d’estrade funéraire sur laquelle était déposée le cercueil et qui le dégageait du sol – et dont l’élévation, la pompe et les ornements indiquaient l’importance, le rang social, du disparu.
L’inhumation se déroulait, en présence d’un prêtre et d’un ou deux enfants de chœur, généralement au cimetière paroissial (parfois sous le plancher de l’église), lequel était alors divisé en deux parties : celle consacrée – elle comprenait aussi la fausse commune où l'on enterrait les indigents – et l’autre profane où on y inhumait les juifs, les hérétiques, les apostats, les schismatiques, les suicidés et les pécheurs publics. Une autre partie était réservée aux enfants morts sans baptême. L’hiver, la dépouille mortelle était entreposée dans un charnier (parce que la terre est trop dure) et inhumée seulement au printemps au cours d’une cérémonie collective.
Jusqu’en 1963, l’Église a frappé d’interdit la crémation. Encore aujourd’hui, l’islam la proscrit tout comme l’orthodoxie juive. La première crémation au Canada au eu lieu au cimetière Mont Royal, à Montréal, le 18 avril 1902 lorsque le corps du sénateur Alexander Walker Ogilvie a été incinéré.
Et jusqu’à la moitié du XIXe siècle, les monuments funéraires permanents ont été rares au Québec. À preuve la lettre suivante d’un paroissien qui, en 1813, s’adresse à l’évêque :
Je prends la liberté d’écrire à Votre Grandeur à l’égard d’une tombe que je désirais ériger dans le cimetière de Laprairie à la mémoire de ma pauvre défunte femme… Ne m’imaginant point qu’il put y avoir aucune objection […] [le curé lui a dit] ne pourrait me le permettre sans que j’eus la permission de votre grandeur.
Ces rites funéraires jetés aux orties font qu'il n'est pas rare que des concierges trouvent dans les casiers d'un édifice à logements multiples des urnes funéraires qui y ont été oubliées ou simplement abandonnées par les locataires qui ont quitté l'immeuble. Autre temps autres mœurs ou indifférence et disparition du respect envers celle ou celui qui n'est plus ? Bien malin celui qui saura répondre à cette question,
Sources:
GAGNON, Serge, Mourir hier et aujourd’hui, Québec, Les Presses de l’université Laval, 1987 .
Cap-aux-Diamants, « Patrimoine et rites funéraires », no 107.
Souvenirs personnels.
[1] J'en ai été témoin à l'hôpital de Hull à la mort de ma mère en 2010.
LES EXPÉDITIONS MILITAIRES FRANÇAISES
Un grand danger guettait les voyageurs qui naviguaient sur l’Outaouais : l’Iroquois qui détruit la Huronie en 1648-1649 et qui est en guerre avec les Français et leurs alliés. Pour échapper au massacre, 400 Hurons s’exilent à l’île d’Orléans, en 1649, par le chemin de l’Outaouais. La magnifique chute des Chaudières est devenue un lieu de tragédies. En 1642, une Algonquine, dont l’Histoire n’a malheureusement pas retenu le nom, est faite prisonnière par des Iroquois qui dévorent ses enfants. Désespérée, elle se jette dans le tourbillon de la chute d’où les guerriers ennemis la retirent pour la tuer de leurs mains.
Une embuscade
En 1661, les célèbres aventuriers Médard Chouart des Groseillers et Pierre-Esprit Radisson,  ainsi que leurs alliés algonquins, tombent dans une embuscade qui leur est tendue près de l’actuel pont Interprovincial, à Hull. Les deux hommes étaient alors en route pour le lac Supérieur. Le voyage s’était poursuivi sans incident jusqu’aux Chaudières quand, à la tête du premier portage, l’avant-garde de l’expédition est accueillie par des coups de fusil et par des cris. Radisson écrit, plus tard : « Un canot va d’un côté, un autre va de l’autre. Quelques hommes atterrissent et courent de tous côtés. C’est la confusion générale. » La troupe se ressaisit rapidement et réussit à mettre pied sur la terre ferme. Elle construit, en moins de deux heures, un petit fortin avec des arbres abattus en toute hâte.
ainsi que leurs alliés algonquins, tombent dans une embuscade qui leur est tendue près de l’actuel pont Interprovincial, à Hull. Les deux hommes étaient alors en route pour le lac Supérieur. Le voyage s’était poursuivi sans incident jusqu’aux Chaudières quand, à la tête du premier portage, l’avant-garde de l’expédition est accueillie par des coups de fusil et par des cris. Radisson écrit, plus tard : « Un canot va d’un côté, un autre va de l’autre. Quelques hommes atterrissent et courent de tous côtés. C’est la confusion générale. » La troupe se ressaisit rapidement et réussit à mettre pied sur la terre ferme. Elle construit, en moins de deux heures, un petit fortin avec des arbres abattus en toute hâte.
Les Iroquois observent les Français et les Algonquins tapis dans leur réduit. Ils capturent un Algonquin téméraire qu’ils rôtissent pour ensuite le manger. À la faveur de la nuit, des Groseillers, Radisson et leurs alliés algonquins réussissent à s’échapper de leur fortin à la barbe des Iroquois.
À la conquête de la baie d’Hudson
Des convois de fourrures, des expéditions militaires amérindiennes et françaises sillonnent régulièrement la rivière des Outaouais. L’une des plus spectaculaires expéditions du XVIIe siècle à franchir les Chaudières est celle du chevalier de Troyes. En 1685, des marchands anglais, dirigés par le traître Radisson, s’établissent à la baie d’Hudson où ils construisent un certain nombre de forts. Le gouverneur de la Nouvelle-France, le marquis de Denonville, décide d’expulser les Anglais de la baie et confie le commandement de l’expédition au chevalier Pierre de Troyes. La troupe, composée de 30 soldats des troupes de la Marine et de 70 miliciens, quitte Montréal le 30 mars 1686. Ses officiers sont Canadiens : le premier lieutenant est Jacques Lemoyne de Sainte-Hélène et le second, le fameux Pierre Lemoyne d’Iberville. Les deux frères ont amené avec eux leur frère cadet, Paul, sieur de Maricourt. De Troyes raconte que le 19 avril « ...nous décampames de fort bonheur pour aller à un lieu nommé la chaudière [...] Nous passames la rivière du lièvre [...] et nous fumes camper à deux lieues plus haut (rivière la Blanche) où tous les canots à cinq ou à six nous vinrent joindre le lendemain. »
 Le 21 avril, l’expédition s’arrête au pied de la chute des Chaudières où le père Silvy y dit la messe. La troupe ne se remet en branle que le surlendemain. Elle franchit la chute de la Grande-Chaudière, les rapides de la Petite-Chaudière puis les rapides des Chesnes. Le 24 avril, elle atteint le portage des Chats (Quyon). Enfin, le 19 juin, après avoir effectué plus d’une centaine de portages, l’expédition arrive à la baie James qu’elle reconquiert de brillante façon.
Le 21 avril, l’expédition s’arrête au pied de la chute des Chaudières où le père Silvy y dit la messe. La troupe ne se remet en branle que le surlendemain. Elle franchit la chute de la Grande-Chaudière, les rapides de la Petite-Chaudière puis les rapides des Chesnes. Le 24 avril, elle atteint le portage des Chats (Quyon). Enfin, le 19 juin, après avoir effectué plus d’une centaine de portages, l’expédition arrive à la baie James qu’elle reconquiert de brillante façon.
Les dernières expéditions
Quatre ans après l’expédition militaire du chevalier de Troyes, une autre expédition prend le chemin de l’Outaouais pour porter secours au poste de Michillimakinac, menacé par les Iroquois. Le comte de Frontenac, alors gouverneur de la Nouvelle-France, décide d’y faire parvenir du secours. Il y dépêche le sieur de Louvigny, avec une troupe de 113 hommes, qui quitte Montréal le 22 mai 1690. Le 2 juin, la troupe fait halte à 3 lieues au-dessus des Chats (Quyon). On aperçoit deux canots iroquois au bout d’une pointe. Louvigny décide d’envoyer à leur rencontre une trentaine d’hommes montés dans 3 canots et une soixantaine d’hommes par voie de terre pour prendre l’ennemi à revers. Devant le feu nourri des Iroquois, la flottille n’a d’autre choix que celui de se retirer après avoir perdu 4 hommes. Pendant ce temps, l’expédition terrestre donne en plein dans une embuscade. Le choc est brutal, le combat sanglant. Après avoir tué une trentaine d’ennemis, les Français retraitent dans leurs canots en amenant avec eux 4 prisonniers dont un sera mangé par les Hurons et les Outaouais. Enfin, l’expédition atteint Michillimakinac sans autres difficultés.
En juin 1728, une grande expédition militaire française traverse notre région pour la dernière fois. Elle compte pas moins de 400 soldats et miliciens, de même que 700 à 800 Amérindiens. Commandée par le major de Ligneris, elle se rend en Indiana pour y soumettre les Amérindiens de la nation des Renards.
Les explorateurs d'un continent
À la suite des explorations de Samuel de Champlain, nombre d’explorateurs suivent l’Outaouais pour parcourir l’Amérique du Nord dans tous les sens. Les Français rêvent de posséder l’Amérique et de marier leurs enfants à ceux des Amérindiens pour fonder une nouvelle nation. Le territoire qu’ils explorent est immense. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, ils colonisent ou explorent le Canada de Terre-Neuve aux montagnes Rocheuses et pas moins de 31 des 50 États des États-Unis, des Grands Lacs au golfe du Mexique !
La route de l’Outaouais permet d’atteindre deux grands réservoirs de fourrures : la baie d’Hudson et les Grands Lacs ou « Pays d’en haut ». Pour se rendre dans les Pays d’en haut, le voyageur qui part de Montréal remonte l’Outaouais jusqu’à la rivière Mattawa, suit ce cours d’eau jusqu'au lac Nipissing pour ensuite naviguer sur la rivière des Français qui se jette dans le lac Huron. À son arrivée à Michillimakinac, poste situé à l’extrémité ouest du lac Huron, le voyageur a parcouru environ 1 200 kilomètres en un peu moins de 40 jours !
À la découverte de l’Amérique
Le fameux explorateur du Mississippi, Louis Jolliet, est sans doute l’un des hommes les plus connus de l’histoire de la Nouvelle-France à fouler le sol de l'actuelle région de l'Outaouais. Il emprunte cette rivière pas moins de quatre fois entre 1668 et 1672. En 1668, le père Marquette, qui deviendra le compagnon de Jolliet, franchit les chutes des Chaudières alors qu’il s’en va fonder la mission Saint-Ignace à Michillimakinac. En 1669, Cavelier de La Salle,  qui désire découvrir le passage qui lui permettrait d’atteindre la Chine, navigue lui aussi sur l'Outaouais avec 22 compagnons, en route pour les chutes du Niagara où il construit un fort.
qui désire découvrir le passage qui lui permettrait d’atteindre la Chine, navigue lui aussi sur l'Outaouais avec 22 compagnons, en route pour les chutes du Niagara où il construit un fort.
Des dizaines de canots sillonnent avec régularité la rivière des Outaouais soit pour apporter des fourrures à Montréal soit pour conduire des aventuriers et des soldats à la baie d’Hudson ou dans les Pays d’en haut, soit pour échanger des fourrures à Montréal contre des objets fabriqués en France.
Au XVIIe siècle, le plus grand chef algonquin de l’Outaouais est un certain Paul Tessouat. Il passait pour être la « terreur de toutes les nations, même de l’Iroquois ». On ne pouvait d’ailleurs naviguer au-delà de son fief, l’île aux Allumettes, sans lui acquitter un droit de passage. En 1643, Tessouat descend l’Outaouais pour se rendre à Ville-Marie (Montréal) où il se fait baptiser ; son parrain est Paul Chomedey de Maisonneuve, le fondateur de Montréal, et sa marraine, Jeanne Mance.
La Grande Rivière
Katche-sippi est le nom que les Algonquins donnent à l’Outaouais et que les Français traduisent par Grande Rivière. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le peuple des Outaouacs, qui habite dans la région de Green Bay (Wisconsin), échange tant de fourrures aux Français que la principale rivière qui conduit à leur territoire finit par prendre leur nom, c’est-à-dire celui d’Outaouais, en français moderne, et plus tard d’Ottawa en anglais. Mais les coureurs des bois ne suivent pas toujours l’Outaouais pour se rendre aux Chaudières. Les frères Gastineau dit Duplessis, par exemple, des Trifluviens qui font la traite des fourrures, viennent à la rencontre des Algonquins au portage des Chaudières, par la Saint-Maurice puis la Gatineau.
Vers la mer de l’Ouest
En 1684, Daniel de Greysolon du Lhut remonte l’Outaouais pour aller fonder des postes de traite dans l’Ouest et trouver l’océan Pacifique. Il se rend jusqu’à l’extrémité ouest du lac Supérieur et explore une partie du Minnesota . Une ville, Duluth, y p orte aujourd’hui son nom. Et bien avant que les automobiles de marque Cadillac roulent sur les routes de l’Outaouais, Antoine Laumet de Lamothe, sieur de Cadillac, futur fondateur de la ville de Détroit (Michigan) remonte la rivière des Outaouais et franchit les Chaudières, en septembre 1694, en route vers Michillimakinac où il remplace le commandant de la place, Louvigny.
orte aujourd’hui son nom. Et bien avant que les automobiles de marque Cadillac roulent sur les routes de l’Outaouais, Antoine Laumet de Lamothe, sieur de Cadillac, futur fondateur de la ville de Détroit (Michigan) remonte la rivière des Outaouais et franchit les Chaudières, en septembre 1694, en route vers Michillimakinac où il remplace le commandant de la place, Louvigny.
Les plus grands explorateurs du régime français à naviguer sur l'Outaouais sont sans aucun doute les La Vérendrye, père et fils qui, tels des géants, ont chaussé les bottes de sept lieues pour enjamber le continent. Dès l’âge de 14 ans, Pierre Gaultier de La Vérendrye rêvait d’atteindre la grande mer de l’Ouest, l’océan Pacifique ; quatre fois au moins il franchira le « saut des Chaudières ». En juin 1731, il quitte Montréal en route pour Michillimakinac et se rend jusqu’à l’emplacement actuel de Winnipeg ; il refait le même itinéraire en 1738 et 1741, poussant toujours plus loin ses explorations. En 1742-1743, ses fils, Pierre et Louis, parcourent l’est du Montana, les plaines du Wyoming, traversent le Dakota et se trouvent en vue des montagnes Rocheuses le 1er janvier 1743. (À suivre...)
Ah ! l’hiver ! On dirait que depuis une trentaine d’années les Canadiens ne sont plus adaptés à cette saison ; un grand nombre va le passer qui en Floride qui à Cuba ou à la Martinique. Aujourd’hui, 15 cm de neige constitue une… tempête et pendant cinq mois c’est à qui « chialera » le plus fort. Sommes-nous devenus des mésadaptés saisonniers ? Des « moumounes » ?
Une forte portion de la population ottavienne et outaouaise ne cesse de maugréer contre l’hiver à la suite d'une tempête de neige. Les journaux sont remplis de lettre des lecteurs qui se plaignent du retard dans le déneigement des rues, d’autres grognent contre les temps froids pendant que des centaines de milliers de snowbirds fuient le pays. J’ai même vu une lettre dans laquelle le signataire demandait à la ville de Gatineau de faire en sorte que ses équipes de déneigement entrent en action avant le début d’un tempête. Pourquoi faire ? Attraper les flocons de neige au vol avant qu’ils ne touchent terre ?
Le temps des adaptations
Les Amérindiens étaient fort bien adaptés à l’hiver canadien et rapidement, les premiers arrivants européens ont adopté leurs modes de transports et vestimentaires : pensons au toboggan, à la traîne qui servait à transporter du bois ou des marchandises, aux raquettes, aux lunettes de soleil (simples planchettes perforées d’une fente pour diminuer les effets de la réverbération du soleil sur la neige), au parka en peau d’original, d’ours ou de caribou, aux mitasses, aux mocassins et aux chapeaux en poil pour se protéger du froid.
Les Européens comprennent fort vite que la construction de maisons en pierre comme en Europe répond mal aux nécessités locales, parce que les pierres, gardant le froid, il se forme sur elles un frimas qui transmet une fraîcheur malsaine ; la maison est alors difficile à chauffer. Les colons saisissent alors qu’il vaut mieux construire les maisons en bois avec des toitures à haut grenier pour supporter le poids de la neige. Ensuite, le colon remplace le foyer par le poêle, qui devient l’âme de la maison canadienne, parce que la fonte et la tôle répandent mieux la chaleur (surtout si le tuyau de fumée conduisant à la cheminée courait dans la maison).
À leurs souliers, les Québécois mettent des grappins sinon il serait presque impossible de gravir les côtes de la Vieille Capitale. Et puis, pendant les longues veillées d’hiver, les Canadiens profitent de l’arrêt des grands travaux pour s’amuser de Noël jusqu’au Mardi gras.
Maudit hiver !
Il y a toujours eu des personnes pour grogner contre l’hiver. Déjà au XVIIe siècle, le baron de Lahontan écrivait dans son journal : « Je ne puis vous rien dire encore de ce païs, si ce n’est qu’il y fait un froid à mourir. » Mais tous ne voient pas cette saison du même œil. Le père Paul Le Jeune trouve des qualités à l’hiver. Il écrit, en 1632-1633 : « Voicy les qualitez de l’hyver, il a esté beau & bon, & bien long. Il a esté beau, car il a esté blanc comme neige, sans crottes & sans pluye…Il a esté bon, car le froid y a esté rigoureux… Il y avoit par tout quatre ou cinq pieds de neige, en quelques endroicts plus de dix, devant notre maison une montagne.
Dans la mémoire populaire. les hivers d’antan sont toujours plus rudes que les hivers contemporains, et ce, depuis toujours. Ainsi, en avril 1721, le père Pierre François-Xavier de Charlevoix écrit : « On a beau dire que les hyvers ne sont plus aussi rudes, qu’ils l’étoient il y a quatre-vint ans, & que, selon toutes les apparences, ils s’adouciront encore dans la suite… » On avait oublié que l’hiver de 1667-1668 avait été pluvieux et doux à tel point qu’en février 1668 on naviguait en canot sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Lévis !
L'hiver outaouais
L’Outaouais n’est pas tellement différent du reste du Québec. En 1884, il est tombé pas moins de 5 mètres (16½ pieds) de neige sur la région, l’année suivante, 3½ mètres (11½ pieds). Mais en 1881-1882, il est tombé 17 pieds de neige sur la ville de Québec. Pourtant, on ne relève guère de plaintes dans les journaux du temps, même si la machinerie pour déblayer les rues est inexistante. On tape la neige dans la rue au moyen d’un rouleau. Il arrive évidemment un moment où il faut bien la ramasser. On embauche des hommes qui l’enlèvent à la pelle et la mettent dans un tombereau qui déverse son chargement dans la rivière. Il faut aussi nettoyer les rues du crottin des chevaux et les enfants d’Ottawa donnent à ces hommes le nom évocateur de « crottes-knockers », parce qu’ils frappent à l’aide d’un bâton les pommes de routes gelées pour les amasser en un même endroit.
 L’hiver de 1905 est tellement dur, qu’à la suite d’une tempête qui souffle pendant 3 jours et aggravée par de forts vents, certains chemins de la région sont couverts de pas moins de… 3 mètres de neige ! Mais la pire tempête enregistrée au Québec est celle des 17 et 18 janvier 1827 : en 48 heures, il est tombé près de 2 mètres de neige sur Montréal. Mais le 2 février 1903, il n’y avait pas un millimètre d’épaisseur de neige dans la région ; l’hiver était fini.
L’hiver de 1905 est tellement dur, qu’à la suite d’une tempête qui souffle pendant 3 jours et aggravée par de forts vents, certains chemins de la région sont couverts de pas moins de… 3 mètres de neige ! Mais la pire tempête enregistrée au Québec est celle des 17 et 18 janvier 1827 : en 48 heures, il est tombé près de 2 mètres de neige sur Montréal. Mais le 2 février 1903, il n’y avait pas un millimètre d’épaisseur de neige dans la région ; l’hiver était fini.
Enfin, c’est le plus souvent dans la tête que l’hiver est pénible. N’est-ce pas à partir de Noël, la plus belle fête du christianisme, que les journées commencent à s’allonger ? Noël est une promesse : celle de l’enfant qui deviendra un adulte, celle du retour de la lumière, donc d’un printemps qui succédera à l’hiver. Alléluia !
Sources :
Asticou, cahier no 38, juillet 1988.
BAnQ, procès de Jacques Bigeon, 1668.
CARLE, Pierre et MINEL, Jean-Louis, L’Homme et l’Hiver en Nouvelle-France, Montréal, Hurtubise HMH, 1972.
Sacrer comme un charretier (suite)
Les condamnations
Aussi loin que nous remontions dans l’histoire depuis Jésus-Christ, nous constatons des peines très sévères pour punir les blasphémateurs. Par exemple, en 538 ou 539, l’empereur d’Orient, Justinien, ordonnait d’arrêter les blasphémateurs et de les soumettre aux derniers supplices, c’est-à-dire rien de moins que la peine de mort !
En France, le blasphème était puni si sévèrement (jusqu’à la mutilation comme le percement de la langue ou aux galères) que les Français ont trouvé le moyen de transformer leurs jurons pour échapper à la justice du roi. Par exemple, mort à Dieu est devenu morbleu, tort à dieu a été transformé en tornom.
En Nouvelle-France, dès 1621, les officiers coloniaux ont demandé au roi l’application rigoureuse de lois contre « […] le blaspheme & autres crimes déjà trop familiers entre quelques François habitants en la dite terre. » Le 29 décembre 1635, on pose sur un pilier en face de l’Église à Québec des « Affiches & défenses, sur certaines peines ; de blasphemer, de s’enyvrer […] » Puis on a attaché au même pilier un carcan et un chevalet.
Le premier cas recensé de châtiment pour blasphème en Nouvelle-France remonte à 1636 quand un homme a été condamné au cheval de bois pour ivrognerie et blasphème. Dix ans plus tard (15 février 1646), un domestique de M. Couillard, reconnu coupable de blasphémer en public, est mis sur le chevalet (les pieds alourdis de boulets de canon). En 1668, Jean Ronceray est convaincu d’avoir blasphémé en présence d’un membre du clergé. On lui ordonne alors de demander pardon à genoux à Dieu, à l’évêque et à l’abbé en question puis il est attaché au carcan de la basse-ville de Québec pendant sept heures (les habitants pouvaient alors lui lancer des œufs et des ordures). Pour crime de blasphème, Jacques Bigeon passe trois semaines en prison et doit payer dix livres d’amende (à peu près dix pour cent de son revenu annuel).
En Outaouais
L’Outaouais a longtemps été une région riche en chantiers forestiers, ce qui en a fait un haut lieu du sacre. Comme ailleurs au pays, les autorités ont bien tenté d’enrayer cette mauvaise habitude. Par exemple, en 1909, à Hull, une certaine dame Larmouth est accusée d’avoir blasphémé dans sa demeure, rue Champlain, par des passants qu’ils l’ont entendue. Pour se défendre, la dame déclare, et je cite : « les paroles que j’ai prononcées étaient pour mon fils que je suis en train d'élever ! » Madame Larmouth a été condamnée, le 22 décembre 1909 à un mois de prison. Le recorder Desjardins a cependant suspendu la sentence sur la promesse de l'accusée de peser plus sur ses paroles à l'avenir.
Notons que les autorités ont puni les blasphémateurs jusqu’à tout récemment. En 1971, pas moins de 126 d’entre eux se sont vus officiellement poursuivis au Québec pour avoir sacré et blasphémé.
Dans son Guide raisonné des jurons publié en 1980, Jean-Pierre Pichette conclut que le juron est devenu « le pain quotidien de certains chefs syndicalistes et la manie malencontreuse de certains députés provinciaux. Il ne nous manque plus que le point d’exclamation auprès de la fleur de lis et l’adoption d’une sorte de Ronde des jurons [Georges Brassens, Plume Latraverse] comme hymne national. » Enfin, on trouve sur Internet une « Liste non officielle des sacres québécois » et la façon de les employer au cas il où resterait encore quelqu’un qui ne saurait comment faire !
Pour en savoir plus :
Lapointe Ghislain, Les mamelles de ma grand-mère les mamelles de mon grand-père, Montréal, éd. Québécoises, 1974.
Pichette, Jean-Pierre, Le guide raisonné des jurons, Montréal, Les quinze éditeur, 1980 ; Le Temps (Ottawa) décembre 1909.
Il y a longtemps que nous jurons au Québec, mais jamais, semble-t-il, autant qu’en ce début de XXIe siècle. Il est vrai que nous avons eu des ancêtres portés sur les jurons. Le roi de France, Henri IV lui-même, jurait abondamment. Son juron préféré : jarnidieu pour je renie Dieu (transformé en jarnicoton). Et que dire de Rabelais (1494-1553), cet auteur français qui, dans ses écrits, a été, avec plus de talents, le précurseur de certains humoristes québécois ? Son personnage, Gargantua, jurait avec régularité en disant reniguebieu, c’est-à-dire je renie Dieu.
Sous l’impulsion des hommes de chantier, qui organisaient souvent des concours de sacres, les blasphèmes d’origine française se sont transformés le plus souvent en inventaire d’objets liturgiques. Les jarnidieu et les Que le diable torde mon âme au bout d’un piquet sont devenus des câlisses et des tabarnaques.  Les hommes de chantier et les charretiers n’avaient-ils pas la réputation d’être les plus grands « sacrards » de notre société ? D’ailleurs, on disait : « Sacrer comme un charretier ».
Les hommes de chantier et les charretiers n’avaient-ils pas la réputation d’être les plus grands « sacrards » de notre société ? D’ailleurs, on disait : « Sacrer comme un charretier ».
Généralement parlant, on n’osait pas sacrer en présence des enfants (pour éviter le scandale), des femmes (par délicatesse) ni de ses contremaîtres ou de ses parents. Les hommes ne juraient qu’au bureau, au chantier, à la taverne. Pour les adolescents, sacrer c’était « faire son homme ».
Des campagnes contre le blasphème
L’auteur-historien Édouard-Zotique Massicotte (1867-1947) disait qu’avec les Irlandais, les Canadiens-Français détenaient facilement « le record dans ce genre de sport linguistique ». En 1919, le président de la Société historique de Montréal, Victor Morin, allait plus loin : « On punissait les blasphémateurs en leur coupant la langue jusqu’à la racine ; on n’oserait le faire aujourd’hui par crainte de rendre toute une génération muette. »
Dès 1922, on lance des campagnes contre le blasphème. On répand en même temps une foule d’images pieuses et d’affiches avec des slogans que l’on pose partout : « Seuls, l’idiot et l’ignorant sacrent et blasphèment. » Ces campagnes sont un lamentable échec. Et dans les années 1940, c’est au tour des femmes et des filles, qui remplacent alors les hommes dans les usines pendant toute la guerre, de ponctuer leur conversation de sacres.
La littérature s’est emparée, dès les années 1960, des sacres à la mode. Les câlisses, crisses et tabarnacles farcissent les Salut Galarneau ! (Jacques Godbout), Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, etc. Puis le monde du spectacle se met lui aussi à s’en nourrir abondamment : pensons à l’Ostid ’show .
Le monde de la politique n’est pas en reste : le 27 octobre 1970, le député libéral Louis-Philippe Lacroix s’attaque aux journalistes au moment de la Crise d’octobre : « Les câlices de journalistes qui sont allés en France sont tous des crisses de séparatistes ». On sacre aussi en anglais, mais le ministre Jean-Luc Pépin affirme, le 26 septembre 1972 : « le premier ministre Trudeau devrait proférer ses jurons en français pour ne pas offenser les anglophones. » Excusez pardon ! Enfin, les humoristes, la radio et la télévision s’en emparent et en font leurs choux gras tous les jours sur les ondes publiques avec l’approbation du CRTC.
Comme nous sacrons beaucoup, cela démontrerait que nous nous reconnaissons dans nos éléments religieux : le juron a une saveur de défi. Quand ça va mal, quand on ne sait plus à qui s’en prendre, on ne défie plus les hommes, mais l’Église et Dieu lui-même ! Savez-vous qu’en France, les blasphèmes ont presque disparu avec la débâcle du christianisme commencée à la Révolution ? Ils ont été remplacés par « merde » et « putain de merde » !
À SUIVRE
En attendant la suite, je vous invite à écouter Jacques Labrecque, Monsieur Guindon, à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=xrGj4BWC27s
La tragédie de Fort McMurray, en Alberta, a eu son pendant au Québec en 1870. Cette année-là, le printemps et l’été sont exceptionnellement chauds partout dans la province. Dès le mois de mai, des incendies se déclarent dans les forêts du canton de Templeton. Au mois de juin, il fait si chaud que le thermomètre atteint la température record de 40°C en Outaouais. En juillet, la sécheresse est telle que de nombreux incendies éclatent spontanément dans les forêts entourant les villages d'Aylmer et de Hull, ainsi que la ville d'Ottawa. Les incendies prennent une ampleur sans précédent et, dans la dernière quinzaine de juillet, une fumée épaisse recouvre les agglomérations urbaines citées. Des feuilles brûlées et des petits morceaux de bois calciné tombent sur les toits des maisons, risquant à tout instant de mettre le feu. La fumée rougit les yeux des habitants et son odeur imprègne maisons et vêtements. Heureusement, une bonne pluie réduit la virulence de l'incendie.
À la mi-août, un autre incendie de forêt gigantesque menace Hull et Ottawa encore une fois. Il a éclaté sur les bords du lac Constance, à 25 kilomètres à l'ouest d'Ottawa. Sous la poussée du vent, les flammes traversent la rivière des Outaouais pour s'attaquer à la forêt des environs de Breckenbridge, près d'Aylmer.  La population épouvantée abandonne tout derrière elle, se précipite vers la rivière et souvent dans la rivière pour échapper aux flammes. Maisons, récoltes, bestiaux, tout est détruit, brûlé, calciné. Le feu court avec la rapidité du vent vers Hull et Ottawa.
La population épouvantée abandonne tout derrière elle, se précipite vers la rivière et souvent dans la rivière pour échapper aux flammes. Maisons, récoltes, bestiaux, tout est détruit, brûlé, calciné. Le feu court avec la rapidité du vent vers Hull et Ottawa.
Des villages détruits
Le 16 août, le village de Bell's Corner, en banlieue d'Ottawa, est rasé par le feu. Trois jours plus tard, on rapporte qu'à Chelsea, un million et demi de mètres de planches ont brûlé aux scieries Gilmour. Deux jours plus tard, le feu sévit à cinq kilomètres de Hull. Plus de 1 500 employés des scieries Eddy, Bronson, Perly, Pattee et Johnston interrompent leurs travaux pour empêcher le terrible fléau d'atteindre le village de Hull. La course des flammes ne semble pas vouloir s'arrêter. Le village de Chelsea brûle, suivi de celui de Rafting Ground (aujourd'hui Cascades). Puis, le feu s'attaque à la cinquantaine de maisons qui composent le petit village minier d'Ironside (ch, Freeman et boul. St-Joseph à Hull connu maintenant sous le nom Le vieux port), situé à trois kilomètres de Hull seulement. Les deux rives de la Gatineau flambent. Plusieurs personnes, dont on n'a jamais réussi à déterminer ni l'identité ni le nombre, n'ont pas le temps de se mettre à l'abri ; elles succombent à la voracité de la conflagration.
Au même moment, une bonne partie du ciel du Québec est obscurcie par une fumée dense. Au Lac-Saint-Jean et au Saguenay, les incendies de forêt déferlent sur plus d’une dizaine de villages qui seront rayés de la carte. Les forêts de la Gaspésie, de la Côte Nord, de l’Ungava et de la Mauricie brûlent. Le feu ravage l’Outaouais de toute part. Les cantons de Templeton et de Buckingham sont dévastés par les flammes qui projettent des brandons haut dans le ciel et que le vent fait retomber sur le village de Hull et la ville d’Ottawa. En Ontario, les soldats freinent le progrès des flammes en ouvrant la digue Saint-Louis (Hog’s Back) près du canal Rideau : 125 hectares de terres sont inondés. Les familles des campagnes se réfugient par centaines à Ottawa. Sur le chemin Richmond, 2 000 réfugiés, dans le plus total dénuement, se dirigent vers Ottawa. Seul un miracle, croit-on, sauvera Hull, Pointe-Gatineau et Ottawa de la destruction.
Combien de victimes ?
Enfin, le 20 août, à une heure du matin, un groupe d'hommes rompus à la lutte contre l'incendie débarquent à la gare d'Ottawa pour prêter main-forte à la population outaouaise. Ce groupe est composé d'Alfred Perry, inspecteur du feu de la  compagnie d'assurances Royal de Montréal, et de plusieurs pompiers de la ville de Montréal qui ont apporté avec eux la pompe à incendie à vapeur Union. Dès le lever du jour, ces hommes se rendent à Chelsea pour combattre l'incendie devenu incontrôlable.
compagnie d'assurances Royal de Montréal, et de plusieurs pompiers de la ville de Montréal qui ont apporté avec eux la pompe à incendie à vapeur Union. Dès le lever du jour, ces hommes se rendent à Chelsea pour combattre l'incendie devenu incontrôlable.
Les agglomérations de Hull et Ottawa sont une nouvelle fois complètement enveloppées par une épaisse fumée grise qui cache le soleil à la vue de la population. Enfin, avec l'aide des pompiers de Montréal et de plusieurs centaines de personnes venues des environs de Hull, les Hullois creusent un coupe-feu dans la campagne avoisinante. Le vent cesse soudainement de souffler et l’incendie, qui n'a plus rien à consumer, s'éteint enfin.
Combien de personnes sont mortes dans ces gigantesques incendies ? Combien de bâtiments ont été détruits ? Nous le savons pas, parce qu'à cette époque on tenait peu de statistiques et que les journalistes n'étaient pas assez nombreux pour couvrir l'ensemble du Québec.
Sources :
Les divers journaux d'Ottawa et du Québec.
Noël est devenue la grand-messe du capitalisme triomphant, la fête de la consommation et des caisses enregistreuses. Ça n’a pas toujours été le cas : Noël a déjà été une fête essentiellement religieuse, familiale, une fête d’amour empreinte de fraternité. Retour sur Noël et le temps des fêtes de jadis.
Noël, cette fête qui s’est répandue sur toute la planète ou presque, en perdant sa raison d’être, remonte au IVe siècle de notre ère. À cette époque, les Romains célébraient dans la débauche, vers le 25 décembre, au moment du solstice d’hiver, le culte de Mithra, divinité d’origine persane importée par les légionnaires. Mithra était la divinité du « soleil invaincu ».
À partir du IIe siècle, les chrétiens tentent de déterminer le jour date de la naissance de Jésus. En 354, le pape Libère choisit la date du 25 décembre pour commémorer la naissance de Jésus « le soleil de justice ».
Jusqu’au XIIe siècle, la grande fête de l’année chez les chrétiens n’est pas Noël, mais Pâques, car le christianisme du Moyen Âge est avant tout un « christianisme de printemps », c’est-à-dire celui de la résurrection, de la renaissance. En Orient, les chrétiens ont poussé la réflexion sur la nativité et les Occidentaux rapportent des images illustrant la nativité. Petit à petit, il se fait un retournement au profit de Noël qui souligne l’incarnation de Jésus. La tradition de la crèche commence à apparaître ; elle s’inspire de l’évangile de Luc et serait l’œuvre de saint François d’Assise.
mais Pâques, car le christianisme du Moyen Âge est avant tout un « christianisme de printemps », c’est-à-dire celui de la résurrection, de la renaissance. En Orient, les chrétiens ont poussé la réflexion sur la nativité et les Occidentaux rapportent des images illustrant la nativité. Petit à petit, il se fait un retournement au profit de Noël qui souligne l’incarnation de Jésus. La tradition de la crèche commence à apparaître ; elle s’inspire de l’évangile de Luc et serait l’œuvre de saint François d’Assise.
Au XIXe siècle, on se prépare fébrilement à fêter Noël, car par delà la commémoration de la naissance de Jésus, la fête de Noël est le début d’une période de réjouissances qui ne se terminera qu’avec le Mardi gras. Les semaines précédant Noël, les femmes de la maison cuisinent : beignes, galettes à la mélasse, pâtés, tartes, tourtières, viandes, alors que les hommes coulent le vin de cerise, réduisent le whisky et préparent le caribou.
Les trois chandelles
On attend la messe de minuit en famille. Dans certaines maisons, on allume trois chandelles : une pour les morts, une pour les vivants et une autre pour les enfants à naître. Une heure ou deux avant la messe de minuit, on quitte la maison en berlot, cutter ou à pied, pour se rendre à l’église. Imaginez-vous ce trajet effectué au son des grelots, le crissement des lisses ou des pas sur la neige durcie, le scintillement des étoiles ou, la neige qui tombe en flocons... et la caresse des fourrures sur les joues !… Certaines nuits de Noël peuvent effectivement porter à l’émerveillement. À la campagne, au village, en ville même, tous les chemins, toutes les rues semblent mener à l’église qui est éclairée comme jamais. Trois messes sont alors dites : la messe de minuit proprement dite, avec le fameux Minuit chrétien, la messe de l’aurore et celle du matin.
 Pendant que la famille se recueille à l’église, des femmes restées à la maison préparent le réveillon. Au retour à la maison, on prête attention aux bruits de l’étable, car une vieille légende veut que les animaux se parlent la nuit de Noël.
Pendant que la famille se recueille à l’église, des femmes restées à la maison préparent le réveillon. Au retour à la maison, on prête attention aux bruits de l’étable, car une vieille légende veut que les animaux se parlent la nuit de Noël.
Pas de cadeaux à Noël : on mange, on rit au milieu de la nuit. Puis, on va se coucher à l’aube. Le reste de la journée se passe en famille, souvent à chanter.
Pendant la semaine qui suit Noël, la routine journalière reprend place sauf pour les affaires d’Église. Le curé visite chacun de ses paroissiens et procède à la « quête de l’Enfant Jésus », accompagné de trois marguilliers.
Sources :
Lacoursière, Jacques, Histoire populaire du Québec, éd. cédérom.
Provencher, Jean, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, Montréal, éd. du Boréal, 1988.
Souvenirs personnels.
Il y a 350 ans : arrivée du régiment de Carignan
1665. La Nouvelle-France, qui ne compte que 3 200 habitants, est en péril, car elle peine à se défendre contre les attaques des Iroquois. Son développement est compromis. C'est ainsi que Louis XIV daigne venir à l'aide de sa colonie américaine en y faisant parvenir des troupes régulières.
C'est ainsi qu'il envoie à Québec 20 compagnies de 50 hommes du régiment de Carignan  commandé par le colonel Henri de Chastelard de Salières et 4 compagnies, tirées de la Martinique, commandées par le lieutenant-général des colonies l'Amérique septentrionale, Alexandre de Prouville de Tracy. Ces compagnies appartiennent aux régiments de Lignières, de Chambellé, de Poitou et d'Orléans.
commandé par le colonel Henri de Chastelard de Salières et 4 compagnies, tirées de la Martinique, commandées par le lieutenant-général des colonies l'Amérique septentrionale, Alexandre de Prouville de Tracy. Ces compagnies appartiennent aux régiments de Lignières, de Chambellé, de Poitou et d'Orléans.
Les quatre premières compagnies du régiment de Carignan arrivent à Québec à compter du 19 juin sur le navire le Vieux Siméon, les autres au mois d'août et au mois de septembre suivant. Entre temps, le marquis de Tracy est arrivé en Nouvelle-France le 30 juin.
Jamais la petite colonie n'avait vu autant de soldats, autant de navires en si peu de temps. Dès la fin août, des soldats sont envoyés construire des forts le long de la rivière Richelieu. C'est ainsi qu'apparaissent les forts Sorel, Chambly, Saint-Jean, Sainte-Thérèse et Sainte-Anne.
À l'automne, les compagnies sont réparties comme suit :
8 à Québec
5 à Montréal
3 à Trois-Rivières
1 à l'Île d'Orléans
2 à Fort Richelieu
2 à Fort Saint-Louis
3 à Fort Sainte-Thérèse
En quelques semaines, la petite colonie française modifie sa mentalité d'assiégée en esprit offensif. C'est ainsi que les troupes françaises, appuyées de miliciens, se portent à l'attaque des Iroquois en plein hiver de 1666. Les soldats, chaussés de raquettes et tirant des « traines sauvages » tombent sur les Agniers (Mohawks) non loin de Schenectady qui s'enfuient après une escarmouche. Leur chef avait pour nom le Bâtard Flamand parce que son père était Hollandais.
 Épuisés et près d la famine, les soldats prennent le chemine du retour. Au cours du printemps 1666, les rapports entre les Français et les Iroquois alternent entre escarmouches et tentatives de pourparler de paix. En septembre, le marquis de Tracy décide de porter un grand coup et, à la tête de 700 soldats, de 400 volontaires canadiens et d'une centaine d'alliés algonquins et hurons, il pénètre au cœur du pays iroquois. Incapable de résister à une telle force, les Iroquois se cachent dans la forêt et se rendent compte que leurs alliés anglais les ont abandonnés. Les Français brûlent quatre villages iroquois et détruisent leurs récoltes de maïs. Enfin, en juillet 1667, les Iroquois signent un traité de paix. Enfin, les colons peuvent s'établir et travailler sans crainte se long du Saint-Laurent et du Richelieu.
Épuisés et près d la famine, les soldats prennent le chemine du retour. Au cours du printemps 1666, les rapports entre les Français et les Iroquois alternent entre escarmouches et tentatives de pourparler de paix. En septembre, le marquis de Tracy décide de porter un grand coup et, à la tête de 700 soldats, de 400 volontaires canadiens et d'une centaine d'alliés algonquins et hurons, il pénètre au cœur du pays iroquois. Incapable de résister à une telle force, les Iroquois se cachent dans la forêt et se rendent compte que leurs alliés anglais les ont abandonnés. Les Français brûlent quatre villages iroquois et détruisent leurs récoltes de maïs. Enfin, en juillet 1667, les Iroquois signent un traité de paix. Enfin, les colons peuvent s'établir et travailler sans crainte se long du Saint-Laurent et du Richelieu.
Afin de peupler la colonie, le roi incite les soldats à rester en Nouvelle-France. On offre aux officiers des seigneuries et des terres aux soldats. Une trentaine d'officiers et un peu plus de 400 soldats décident de rester et 283 d'entre eux épouseront des filles du roi. Pour défendre la colonie, on garde 4 compagnies de 75 hommes chacune. Les autres compagnies retournent en France en 1667 et 1668. On estime à une soixantaine le nombres de soldats de ces troupes qui sont morts au pays ; plusieurs auraient succombé à des engelures.
Sources
CHARTRAND, René, Le patrimoine militaire canadien d'hier à aujourd'hui, 1000-1754, Montréal,éd, Art global, 1993.
Répertoire du patrimoine culturel du Québec, site Internet http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26633&type=pge#.VjBJcSZdFN0
Pendant au moins un demi-siècle, toute ville qui se respectait avait son service de transport en commun assuré par des véhicules sur rail, les tramways. Puis, fin des années 1940, début des années 1950, ces machines sont presque toutes disparues. Pourquoi donc ? Retour sur une histoire au secret bien gardé.
Exploités par la Ottawa Electric Company, une entreprise privée, les tramways électriques apparaissent à Ottawa en 1891 (premier réseau au pays). En 1895, son réseau s’étend sur 50 kilomètres. Cependant, l’entreprise commence éprouver des difficultés financières quand, après la Seconde Guerre mondiale, elle doit payer des taxes fédérales élevées. Bien que le nombre de passagers se maintienne, l’entreprise fait l’objet d’un nombre croissant de plaintes. La Ville d’Ottawa achète le système en difficulté en 1948, et donne naissance à la Ottawa Transportation Commission qui exploite dès lors 130 tramways. En 1959, tous les tramways sont remplacés par les autobus jugés plus rentables.
À Gatineau, le service des tramways électriques apparaît dans les secteurs Aylmer et Hull en 1896. Fondé par Théophile Viau, puis exploité pendant la plus grande partie de son existence par la Hull Electric Compagny, le service comprend quatre circuits et un peu plus d’une douzaine de tramways peints en vert. Les tramways sont remplacés par les autobus du Transport urbain de Hull en 1947 quand la ville refuse de prolonger le contrat signé en 1938 avec la Hull Electric.
Hull en 1896. Fondé par Théophile Viau, puis exploité pendant la plus grande partie de son existence par la Hull Electric Compagny, le service comprend quatre circuits et un peu plus d’une douzaine de tramways peints en vert. Les tramways sont remplacés par les autobus du Transport urbain de Hull en 1947 quand la ville refuse de prolonger le contrat signé en 1938 avec la Hull Electric.
La disparition des tramways
Plusieurs raisons président à la disparition des tramways au Canada dans les années 1950. L’une des principales raisons, tant à Hull, à Ottawa qu’à Montréal, est l’inaptitude des entreprises privées à offrir un service de qualité, et la cupidité des actionnaires des compagnies de tramways qui trop souvent ne respectent pas les ententes passées avec les villes.
Pendant la crise économique des années 1930, la Hull Electric Company, alors propriété de la célèbre et inassouvissable Canadian International Paper, avait demandé la permission d’augmenter ses tarifs à cause d’un déficit d’exploitation de son service de tramways. Or, une enquête démontrera que la Hull Electric n’avait jamais cessé de faire de profits bien que ceux-ci soient passés de 26,8 % à 15,1 % de 1927 à 1931 ! Devant cette cupidité, les villes de Montréal et d’Ottawa municipaliseront leur service de tramways.
Les années 1940 et 1950 ont vu s’établir la domination du transport par automobile. Dès 1930, le parc automobile du Québec était quatre fois plus élevé qu’en 1917. En 1960, il aura été multiplié par sept pour atteindre 1 161 599 véhicules automoteurs. L’individualisme s’exprimait de plus en plus à travers l’automobile qui est devenue la reine du transport. Aussi les villes développent-elles leur réseau routier, et ce, à des coûts faramineux. En 1945, la Compagnie de tramways de Montréal rendait publique une étude dans laquelle on relève que : « L’élargissement des rues est fréquemment avancé comme solution à la congestion de la métropole. Bien qu’une telle mesure accroisse la capacité des rues, il a été démontré qu’elle n’améliore en rien les conditions de circulation en général. » Or, ce rapport a été confirmé par des études conduites par la Ville de Villeneuve-d’Ascq (France) dans les années 1980 et par celle de l’Université Cornell (États-Unis) dans les années 2000. Ces études ont démontré qu’à chaque fois que l’ont doublait le nombre de voies de circulation automobile on ne faisait que doubler le nombre d’automobiles dans les dix ans, et ce, sans pour autant résoudre les problèmes de congestion ! L’étude de 1945 montrait qu’une voie de circulation automobile permettait d’accommoder 1 400 personnes à l’heure, alors qu’une voie de métro pouvait alors transporter 40 000 personnes à l’heure.
 Malgré ces études et la pollution engendrée par les moteurs à explosion, la liberté de l’autobus, dont le trajet n’est pas astreint à des rails, séduit ; le célèbre urbaniste Jacques Gréber estimait les tramways nuisibles. À Ottawa, le rapport d’un soi-disant spécialiste du transport a alors recommandé l’abandon du tramway à cause de ses coûts d’exploitation, comparés à ceux de l’autobus, et le vieillissement des équipements. Car l’ancienne entreprise privée ottavienne, pas plus que la hulloise d’ailleurs, n’avait pas entretenu son matériel roulant qui avait vieilli. Toutefois, un rapport de la Ville de Montréal, rédigé dans les années 1930, avait démontré que pour chaque tranche de revenu de 100 dollars générés par les réseaux de transport en commun, il en coûtait 97 dollars pour les frais d’exploitation des autobus contre 73 dollars pour ceux des tramways.
Malgré ces études et la pollution engendrée par les moteurs à explosion, la liberté de l’autobus, dont le trajet n’est pas astreint à des rails, séduit ; le célèbre urbaniste Jacques Gréber estimait les tramways nuisibles. À Ottawa, le rapport d’un soi-disant spécialiste du transport a alors recommandé l’abandon du tramway à cause de ses coûts d’exploitation, comparés à ceux de l’autobus, et le vieillissement des équipements. Car l’ancienne entreprise privée ottavienne, pas plus que la hulloise d’ailleurs, n’avait pas entretenu son matériel roulant qui avait vieilli. Toutefois, un rapport de la Ville de Montréal, rédigé dans les années 1930, avait démontré que pour chaque tranche de revenu de 100 dollars générés par les réseaux de transport en commun, il en coûtait 97 dollars pour les frais d’exploitation des autobus contre 73 dollars pour ceux des tramways.
Un progrès ?
On pourrait croire que c'est une certaine vision du progrès qui l'a emporté, mais ce n'est pas le cas. De fait, des pressions occultes d’entreprises privées… De 1969 à 1974, un comité sénatorial dirigé par Bradford C. Snell a mené une enquête approfondie sur l’industrie du transport aux États-Unis. Dans ses conclusions, le rapport Snell incrimine les trois grands de l’auto – GM, Ford, et Chrysler –, ainsi que la Standard Oil of California, la Phillips Petroleum, Mack Manufacturing, Firestone et plusieurs autres compagnies dans un vaste complot qui, au cours des années 1930 et 1940, avait pour dessein de supprimer tous les réseaux électriques de transport, et ce, afin de les convertir au diesel. Ainsi, les réseaux de tramways et de trolleybus ont été démantelés dans une centaine de villes américaines et remplacés par les autobus diesel de GM.
Ces faits, méconnus tant des Canadiens et des Étasuniens ont été si troublants que la GM a demandé et obtenu du Sénat la mise à l’index du rapport Snell. À Montréal, toutes les études et les enquêtes qui démontraient le bien-fondé du remplacement des tramways par les autobus ont été… jetées au panier. Ainsi, en dépit que le coût de l’électricité au Québec soit un des plus bas au monde, les autobus au diesel constituent la plus grande part des véhicules qui assurent le transport en commun. Cherchez l’erreur.
Sources :
BÉLANGER, Mathieu, Dehors le train, vive l’automobile, Le Droit (Gatineau-Ottawa), 27 septembre 2010.
DAGENAIS, Jean-Pierre, Ironie du char, Montréal, 1982, 208 p.
Outaouais – Le Hull industriel 1900/1960, IHRO, Hull, 1986 ; site Internet http://www.octranspo1.com/apropos/pionniers_du_transport_en_commun/
Trois choses annonçaient Noël dans les années cinquante : la neige, la publicité dans les médias et l’avent. À cette époque, le Canada français était majoritairement catholique et pratiquant. Le temps de l’avent s’échelonne sur quatre dimanches et a pour objectif de faire de ces semaines qui précèdent Noël une période d’attente patiente. Les catholiques devaient alors se préparer à Noël en faisant des « sacrifices » comme se priver de friandises, de desserts ou de danses.
La semaine qui précédait Noël était celle des « quatre-temps ». Trois des jours de cette semaine – mercredi, vendredi et samedi – étaient consacrés au jeûne et à la prière. De l’avent, il ne reste plus aujourd’hui que le calendrier qui permet de faire le décompte jusqu’au 25 décembre.
Dans les années cinquante, le Noël religieux est de plus en plus mis à mal par l’américanisation de cette fête qui, à l’origine, en était une d’espoir, puis d’amour. Les magasins invitent la population à venir acheter des cadeaux pour leurs proches. On attire les consommateurs au moyen de vitrines aux décorations multicolores, d’un défilé du père Noël, d’un père Noël qui accueille les enfants dans les magasins et qui écoute les demandes des enfants, ainsi que par des annonces dans divers médias.
Dans la région, le père Noël élisait domicile, pendant un mois, à l’étage des jouets du magasin Freiman à Ottawa. Mais dès le mois d’octobre, Dupuis Frères, Eaton’s et Simpson’s Sears avaient distribué leur catalogue de Noël chez des milliers de famille de la région. Une grande partie de ces catalogues illustrés contenait des centaines de jouets.
Dès la mi-novembre, on échangeait des vœux de Noël au moyen de cartes. Cette coutume, presque disparue, mais qui a atteint son apogée dans les années 1950, nous vient apparemment de France où, au XVIIe siècle, les enfants écrivaient un petit compliment ou un poème de leur plus belle main, sur une feuille de papier ornée d’une image, pour leur maître d’école ou pour leurs parents. Un homme d’affaires anglais, Henry Cole, aurait alors eu l’idée, au XIXe siècle, de fabriquer et de commercialiser des cartes de vœux en série pour Noël.
Les cartes de vœux de Noël reçues étaient suspendues à une ficelle accrochée au mur de la cuisine ou du salon. On les comptait en se félicitant d’en avoir reçu plus que l’année précédente.
Les décorations domestiques
Presque toutes les familles installaient dans leur salon un sapin décoré de boules et d'ampoules lumineuses bleues, rouges et vertes. En terre d’Amérique, c’est à Sorel qu’a été érigé en 1781, par la baronne Riedesel, épouse du général mercenaire allemand du même nom, le premier sapin de Noël décoré. Mais l’événement n’a pas eu de suite et ce n’est que dans les années 1840 que l’idée de décorer un sapin s’est répandue à travers le monde grâce aux journaux. D’abord à Paris, au jardin des Tuileries, en 1840, puis Londres en 1841. Au Québec, le sapin est devenu populaire dans le premier quart du XXe siècle.
Pendant longtemps, la principale décoration a été la crèche, sans doute l’élément le plus touchant de la période des fêtes de fin d’année et qui suscitait le plus d’émerveillement. Venue du Moyen Âge et inspiré de l’évangile de saint Luc, cette tradition a été introduite en Amérique par les Français dès les premiers temps de la Nouvelle-France. D’abord érigée dans les églises, la crèche a commencé à pénétrer dans les maisons au XIXe siècle. Dans les années 1950, on la trouvait dans toutes les maisons du Canada français, le plus souvent placée sous le sapin, ou simplement sur un meuble. On peut aujourd’hui admirer des crèches grandeur nature à Rivière-Éternité, au Saguenay.
 Noël se célébrait aussi en musique. D’abord avec des chants religieux. Le plus connu est sans contredit le Minuit chrétiens, composé en 1847 par Placide Cappeau et mis en musique par Adolphe Adam. Il a été chanté pour la première fois en Amérique à Noël 1858 dans l’église de Sillery. La messe de minuit était alors le moment le plus émouvant du temps des Fêtes. Le 25 décembre, tous les chemins du Canada français menaient à l’église pleine à craquer de fidèles venus célébrer la naissance d’un enfant Dieu, d’un enfant porteur d’espoirs.
Noël se célébrait aussi en musique. D’abord avec des chants religieux. Le plus connu est sans contredit le Minuit chrétiens, composé en 1847 par Placide Cappeau et mis en musique par Adolphe Adam. Il a été chanté pour la première fois en Amérique à Noël 1858 dans l’église de Sillery. La messe de minuit était alors le moment le plus émouvant du temps des Fêtes. Le 25 décembre, tous les chemins du Canada français menaient à l’église pleine à craquer de fidèles venus célébrer la naissance d’un enfant Dieu, d’un enfant porteur d’espoirs.
Dès les années 1930, les chansonnettes de Noël ont commencé à rivaliser avec les chants religieux grâce à la radio. Il y a eu celles de la Bolduc suivies de chansons américaines comme White Christmas, popularisée par Bing Crosby en 1942 (adaptée en français sous le titre de Noël Blanc) , qui ont remporté des succès que seul Tino Rossi, en 1946, avec Petit papa Noël, pourra égaler.
Traditionnellement, les échanges des « étrennes », au Canada français, se faisaient au jour de l’An. Sous la pression du monde anglo-saxon, et plus particulièrement étasunien, les cadeaux seront échangés après la messe de minuit et à la suite du réveillon ou, comme aux États-Unis, le matin de Noël. C’est donc à partir des années 1950 que le Noël canadien-français a peu à peu été remplacé par le Noël des marchands, ce qui fait qu’aujourd’hui l’on voit de moins en moins de crèches sous les sapins et de plus en plus de cadeaux.
Sources :
Blais, Sylvie et Lahoud, Pierre, La fête de Noël au Québec, Les édtions de l’Homme, Montréal, 2007.
Le Droit (Ottawa), novembre et décembre 1959.
La Patrie (Montréal), novembre et décembre 1955.
Souvenirs d'enfance.
Joyeux Noël
Bonne et heureuse année 2015
Petite histoire de la peine de mort au Québec (suite)
On a aussi exécuté des criminels en Outaouais, et ce, pas moins de huit fois. Les personnes pendues par le cou, jusqu'à mort s'ensuive, ont été :
François-Xavier Séguin dit Ladéroute, pendu à Aylmer le 2 octobre 1863.
Stanislas Lacroix, exécuté à Hull le 21 mars 1902.
Marie Beaulne, exécutée à Hull le 23 août 1929.
Philibert Lefebvre, exécuté à Hull le 23 août 1929.
Édouard Thomas, pendu à Mont Laurier le 22 mai 1931.
Austin Cassidy, pendu à Hull le 8 avril 1932.
Michael Bradley, exécuté à Campbell's Bay le 5 avril 1935.
Omer Girard, supplicié à Hull le 26 février 1937 à Hull.
Stanislas Lacroix a assassiné sa femme, Emma Fauteux, et un homme, Hyppolite Thomas dit Tranchemontagne, à Montebello le 24 août 1900, au cours d'une crise de jalousie. Marie Beaulne a supprimé son mari avec l'aide de son amant, Philibert Lefebvre, à Montpellier le 22 janvier 1929. Austin Cassidy, lui, a occis William Bertram Marshall à Hull le 8 avril 1932 parce que ce dernier avait heurté son automobile, rue Eddy, juste devant l'Ottawa House.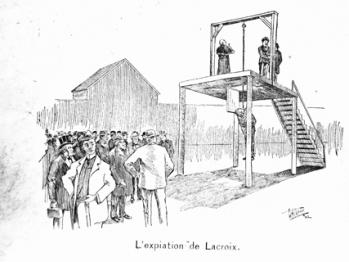 Édouard Thomas a abattu Arthur Nantel, mari de sa maîtresse, le 29 septembre 1930 à l'Annonciation. La population était convaincue que Maria Jolicoeur avait poussé son amant à commettre le crime et l'a expusée du village. (À cette époque, Mont Laurier était en Outaouais.) Michael Bradley a occis cinq membres de sa famille, dont son père et sa mère, le 21 juillet 1933 à l'Île aux Allumettes. Enfin, Omer Girard a trucidé deux vieillards, Léon Leclerc et Alfred Dudevoir le 6 avril 1936 à Namur. J'ai raconté les affaires Beaulne, Lacroix et Thomas dans Crimes, mystères et passions oubliés, et l'affaire Girard dans L'Affaire des Crucifiés.
Édouard Thomas a abattu Arthur Nantel, mari de sa maîtresse, le 29 septembre 1930 à l'Annonciation. La population était convaincue que Maria Jolicoeur avait poussé son amant à commettre le crime et l'a expusée du village. (À cette époque, Mont Laurier était en Outaouais.) Michael Bradley a occis cinq membres de sa famille, dont son père et sa mère, le 21 juillet 1933 à l'Île aux Allumettes. Enfin, Omer Girard a trucidé deux vieillards, Léon Leclerc et Alfred Dudevoir le 6 avril 1936 à Namur. J'ai raconté les affaires Beaulne, Lacroix et Thomas dans Crimes, mystères et passions oubliés, et l'affaire Girard dans L'Affaire des Crucifiés.
L'affaire Ladéroute
Ladéroute était un pauvre hère idiot qui, à l’âge de 40 ans, s’était vu amputer d’une jambe. Depuis lors, il avait changé et sa raison chancelait. Âgé de 46 ans en 1863, il vit du produit de sa pêche et dort le plus souvent à la belle étoile. Le 20 juin 1863, il accuse le Pointe-Gatinois Guillaume Larocque de piller ses filets de pêche dans le ruisseau de la Brasserie à Hull. Le lendemain, Ladéroute se vante auprès de sa belle-sœur d’avoir réglé le cas de Larocque le matin même. L’Outaouais est en émoi : Larocque laisse dans le deuil une veuve et neuf enfants. Prestement arrêté, Ladéroute est jugé devant une foule en colère par un jury partial avant même le début du procès. Un des jurés se paiera même le luxe de dormir pendant le procès ! Le 7 juillet 1863, soit seulement 17 jours après le crime, Ladéroute est condamné à être pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive bien qu’il n’y ait eu contre lui que des preuves circonstancielles. En effet, comment un unijambiste, de surcroît en canot, a-t-il pu tuer un autre homme aussi en canot ?
Le 2 octobre, à 10 h, Ladéroute est traîné par deux hommes à la potence dressée à côté du palais de justice alors situé à Aylmer. Comme le pays n’a pas de bourreau, les autorités ont sorti de la prison de Kingston un prisonnier qui a bien voulu exercer momentanément le rôle d’exécuteur des hautes œuvres, sans doute en échange d'une remise de peine.
 Une pluie fine commence à tomber. Ladéroute tremble de tous ses membres et au moment où le bourreau lui passe la corde au cou, il fond en larmes et s’écrie : « Oh ! Monsieur le Curé, je vous en prie, dites-leur donc de me laisser aller ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! » Puis le bourreau glisse sur la tête de Ladéroute un bonnet noir, puis expédie le condamné dans l'au-delà. Satisfaites, la foule et les autorités judiciaires abandonneront à leur pauvreté l’épouse et les enfants de William Larocque… La société est vengée !
Une pluie fine commence à tomber. Ladéroute tremble de tous ses membres et au moment où le bourreau lui passe la corde au cou, il fond en larmes et s’écrie : « Oh ! Monsieur le Curé, je vous en prie, dites-leur donc de me laisser aller ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! » Puis le bourreau glisse sur la tête de Ladéroute un bonnet noir, puis expédie le condamné dans l'au-delà. Satisfaites, la foule et les autorités judiciaires abandonneront à leur pauvreté l’épouse et les enfants de William Larocque… La société est vengée !
Ladéroute n'a pas été le premier à commettre un homicide. Le premier homicide enregistré en Outaouais semble être celui de John Rowan qui, a tiré sur son beau-frère, Patrick Grogan , en août 1846. On en sait toutefois ce qu'il est advenu de Rowan. Le premier meurtre a été commis par Henry McGill en 1854. Condamné à être pendu, sa peine a été commuée en prison à vie le 15 janvier 1855.
Quant à la dernière personne exécutée au Québec, il s'agit d'Ernest Côté, qui a tué Alexander Heron au cours de vola à main armée d'une banque Témiscaming le 15 mai 1959. Jugé et condamné à la peine capitale à Hull, il a été exécuté à Montréal le 11 mars 1960 après une tentative de suicide.
Sources :
BAnQ-CAO, fonds Foran, P137, 53, SS3, D4.
BAnQ-CAO, TP9-S9, Archives judiciaires, divers, exécutions 1863-1937.
BRAULT, Lucien, Hull 1800 – 1950, pages 66 à 68.
BRAULT, Lucien, Aylmer d’hier/of Yesterday, Aylmer, Institut d’histoire de l’Outaouais, 1981, pages 91 et 92.
La Minerve (Montréal), 1846.
OUIMET, Raymond, Crimes, mystères et passions oubliés, Gatineau, Éditions Vents d’Ouest, février 2010.
OUIMET, Raymond, L'Affaire des Crucifiés, Québec, éditions du Septentrion, février 2013.
Petite histoire de la peine de mort au Québec
Saviez-vous, qu’à la prison de Bordeaux (Montréal), le son d’une cloche retentissait sept fois pour annoncer l'exécution d'un homme et dix fois pour annoncer l'exécution d'une femme, et qu’au Québec l’échafaud était peint en rouge sang alors que dans le reste du pays, il était noir ? Ces faits font partie de la petite histoire de la peine capitale au Canada.
On ne sait pas combien de personnes ont été condamnées à mort depuis que le monde européen a conquis le Canada. Nous savons par contre que la première personne à avoir été exécutée au pays est Michel Gaillon condamné par le sieur de la Rocque de Roberval pour cause de vol. Quant à la première femme connue à subir la peine capitale au pays, le déshonneur en revient à Françoise Duverger qui a été exécutée en 1671, à Québec, après avoir été trouvée coupable d’infanticide. Cependant, on estime qu'il y a eu environ 57 exécutions capitales sous le Régime français, 7 de 1761 à 1791, et au Québec, 111 de 1792 à 1866, et 148 de 1867 à 1960.
Une justice expéditive et répressive
À une certaine époque, on ne riait pas avec le crime, c'est-à-dire ceux commis par le peuple – les grands ayant de nombreux moyens pour s’en sortir. Ainsi, le Code criminel britannique, qui a été en vigueur au Canada jusqu’en 1859, prévoyait la peine de mort pour 220 types de délits (dont le déguisement en forêt, sans doute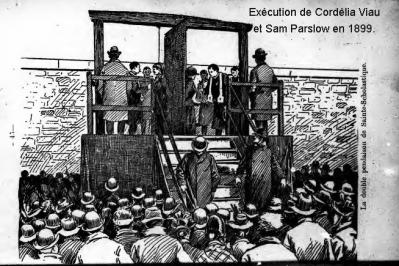 un mauvais souvenir de Robin des Bois !) ; c’est alors un des codes criminels les plus durs, sinon le plus rigide, du monde occidental. Par exemple, en 1795, un homme a été pendu à Halifax pour avoir volé quelques pommes de terre. En 1803, à Montréal, un enfant de 13 ans a été exécuté pour avoir volé une vache. Le dernier jeune à voir été exécuté au pays avait 17 ans et a été exécuté en 1936 à Dorchester au Nouveau-Brunswick. Deux jeunes âgés de 15 ans seulement ont été condamnés à mort : l’un en Nouvelle-Écosse en 1940 et l’autre au Québec en 1944. Heureusement, le gouvernement a eu l’intelligence de commuer les peines. Aux États-Unis, le 16 juin 1944, on a exécuté un enfant noir de 14 ans, George Junius Stinney,sur la chaise électrique, pour un crime qu'il n'aurait pas commis ! Le plus jeune condamné à la peine capitale aux États-Unis a été James Arcene, 10 ans, en 1882 en Arkansas.
un mauvais souvenir de Robin des Bois !) ; c’est alors un des codes criminels les plus durs, sinon le plus rigide, du monde occidental. Par exemple, en 1795, un homme a été pendu à Halifax pour avoir volé quelques pommes de terre. En 1803, à Montréal, un enfant de 13 ans a été exécuté pour avoir volé une vache. Le dernier jeune à voir été exécuté au pays avait 17 ans et a été exécuté en 1936 à Dorchester au Nouveau-Brunswick. Deux jeunes âgés de 15 ans seulement ont été condamnés à mort : l’un en Nouvelle-Écosse en 1940 et l’autre au Québec en 1944. Heureusement, le gouvernement a eu l’intelligence de commuer les peines. Aux États-Unis, le 16 juin 1944, on a exécuté un enfant noir de 14 ans, George Junius Stinney,sur la chaise électrique, pour un crime qu'il n'aurait pas commis ! Le plus jeune condamné à la peine capitale aux États-Unis a été James Arcene, 10 ans, en 1882 en Arkansas.
La dernière exécution hors les murs d’une prison au Canada, c'est-à-dire à la vue de tous, a été celle de huit Amérindiens de la nation Crie qui a eu lieu le 27 novembre 1885 dans l’Ouest canadien à Battleford. Elle a mis un point final à la rébellion de Riel et des siens.
Abolition de la peine de mort
C’est en 1914 qu’a été présenté à la Chambre des communes, par le député Robert Bickerdike, député de Saint-Laurent, le premier projet de loi visant l’abolition de la peine de mort. Mais 76 ans auparavant, le docteur Robert Nelson, qui avait proclamé la république du Canada en 1837, avait aboli en principe la peine capitale sauf dans le cas de meurtre.
 Au Canada, la peine de mort a été abrogée en vertu du Code criminel en 1976. Son rétablissement a été débattu et refusé par le Parlement en 1987 (et aboli dans les cours militaires en 1999 seulement). En 1969, le concile Vatican II a symboliquement aboli la peine de mort dans l'État du Vatican. Cette peine a figuré dans la Constitution vaticane jusqu’en 2001. Aujourd'hui, 69 % des Québécois sont encore pour la peine capitale pour les meurtriers bien qu'il a été démontré que cette peine est inefficace. La peine capitale a été appliquée pour la dernière fois au Canada en 1962 à Toronto. Au Québec, le dernier condamné à mort a été exécuté en 1960. (À suivre)
Au Canada, la peine de mort a été abrogée en vertu du Code criminel en 1976. Son rétablissement a été débattu et refusé par le Parlement en 1987 (et aboli dans les cours militaires en 1999 seulement). En 1969, le concile Vatican II a symboliquement aboli la peine de mort dans l'État du Vatican. Cette peine a figuré dans la Constitution vaticane jusqu’en 2001. Aujourd'hui, 69 % des Québécois sont encore pour la peine capitale pour les meurtriers bien qu'il a été démontré que cette peine est inefficace. La peine capitale a été appliquée pour la dernière fois au Canada en 1962 à Toronto. Au Québec, le dernier condamné à mort a été exécuté en 1960. (À suivre)
Sources :
Boyer, Raymond, Les crimes et châtiments au Canada-Français, Ottawa, Le Cercle du livre de France, 1966.
Gaboury, Hélène, LeChasseur, Antonio, Les condamnés à la peine de mort au Canada 1867-1976, Ottawa, Bibliothèque et Archives nationales du Canada, 1994.
Proulx, Daniel, Juges, policiers et truands, Montréal, éd. du Méridien, 1999.
Documentation personnelle.
Histoire du père Noël au Québec
Le Noël du Québec est passé presque inaperçu pendant longtemps. Tout au plus fréquentait-on la messe de minuit et confectionnait-on un petit réveillon savouré en famille.
Le Québec aura résisté longtemps au père Noël. Dans les années 1940, il y a encore une majorité de francophones qui donne ses cadeaux au jour de l’An, jour des étrennes. Au début du siècle, les parents donnaient des fruits aux enfants sages et des morceaux de charbon ou des pelures de patates à ceux qui n’avaient pas été gentils pendant l’année.
Ce sont les commerçants, les marchands qui finissent par imposer aux Canadiens francophones la fête de Noël, puis le Père Noël pour attirer dans leurs magasins la population. Ils poussent les parents à leur rendre visite avec leurs enfants pour y rencontrer le Père Noël. Alors que la société traditionnelle était axée vers les besoins, la nouvelle société est orientée vers le désir.
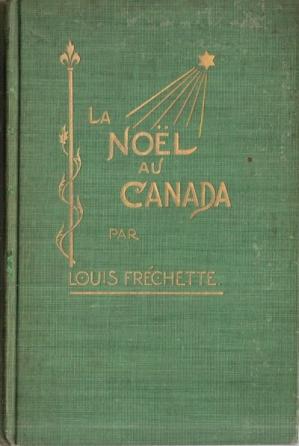 C’est ainsi que Noël supplante peu à peu le jour de l’An, et ce, au grand plaisir de l’Église catholique – dans un premier temps – qui voit enfin le jour de l’An, fête essentiellement païenne, détrôné par Noël, fête chrétienne. Le clergé n’avait toutefois pas prévu que le père Noël éclipserait le « p’tit Jésus » comme distributeur des cadeaux et que la consommation effrénée remplacerait l’aspect religieux de la fête qui l’emportera, et de loin, sur la principale fête religieuse : Pâques. Ainsi, plus on avance dans le XXe siècle du Québec, plus les symboles chrétiens s’effacent au profit d’une vision purement commerciale du temps des fêtes.
C’est ainsi que Noël supplante peu à peu le jour de l’An, et ce, au grand plaisir de l’Église catholique – dans un premier temps – qui voit enfin le jour de l’An, fête essentiellement païenne, détrôné par Noël, fête chrétienne. Le clergé n’avait toutefois pas prévu que le père Noël éclipserait le « p’tit Jésus » comme distributeur des cadeaux et que la consommation effrénée remplacerait l’aspect religieux de la fête qui l’emportera, et de loin, sur la principale fête religieuse : Pâques. Ainsi, plus on avance dans le XXe siècle du Québec, plus les symboles chrétiens s’effacent au profit d’une vision purement commerciale du temps des fêtes.
Dans Noël au Canada, publié en 1900 par Louis Fréchette, Santa Claus est celui qui, sa hotte pleine de jouets, fait la tournée des maisons et exauce les vœux des enfants sages. De fait, Santa Claus s’impose dans la publicité montréalaise vers 1890-1900.
Ceux et celles qui résistent à l’invasion du Québec par Santa Claus font flèche de tout bois, parce que non seulement le bonhomme a conquis les vitrines des magasins et les affiches des marchands, mais aussi parce qu’il a commencé à pénétrer dans les maisons des catholiques pour y détrôner, dans le cœur des enfants, le petit Jésus. Ainsi, certains n’hésitent-ils pas à diaboliser Santa Claus. Par exemple, un certain abbé Dugas accuse Santa Claus de détourner l’esprit des enfants « des belles crèches de l’Enfant Jésus » et, en général, de trahir le recueillement spirituel et familial des fêtes.
Plus encore, au cours de la guerre de 1914-1918, on monte une campagne de dénigrement à l’encontre de ce « prince de la camelote teutonne », de ce fantoche « made in Germany ». Il a donc fallu rebaptiser Santa Claus et c’est « saint Nicolas », puis le « bonhomme Noël » et enfin le « père Noël » qui gagnera le cœur des francophones.
Nombreux sont ceux qui s’attaquent non seulement à Santa Claus, mais aussi à l’esprit commercial de Noël en faisant savoir que cette fête encourage la célébration d’au moins trois des sept péchés capitaux de la tradition catholique : l’avarice, la gourmandise et l’envie.
Il n’y a pas que les francophones qui résistent à Noël, de nombreux anglophones s’insurgent aussi contre la commercialisation de cette fête. Par exemple, des journaux anglophones de Montréal n’hésitent pas, en 1910, à qualifier Noël de hold-up annuel. Pour eux, Santa Claus est un ogre insatiable.
Quoi qu’il en soit, dans les années 1950 Noël supplantera définitivement le jour de l’An comme journée de remise des étrennes ou cadeaux, et le Père Noël remplacera sans appel le « petit Jésus » comme distributeur de ces cadeaux.
Sources :
Warren, Jean-Philippe, Hourra pour Santa Claus, Montréal, Boréal, 2006.
Site Internet Notre famille.com.
Documentation personnelle
Qui dit « Sainte-Catherine » dit « vieille fille » et « tire » ce fameux bonbon fait de mélasse, de sucre, de beurre et de vinaigre. Mais d’où vient cette fête de la « Sainte-Catherine » me direz-vous ? Disons d’abord que sainte Catherine est la patronne des « vieilles filles », c’est-à-dire des jeunes femmes célibataires âgées de 25 ans révolus (la fête a été retirée du calendrier liturgique en 1969). Pour éviter cet affreux statut social, les jeunes femmes sur le point d’avoir 25 ans priaient : Sainte Catherine, sainte Catherine, aide-moi. Et promets de ne pas me laisser mourir célibataire. Un mari, sainte Catherine, un bon, sainte Catherine; mais plutôt un que pas du tout.
D’autres préféraient s’adresser à plus d’une sainte et d’un saint à la fois :
Sainte Marie, faites que je me marie
Sainte Sylvie, j’en ai bien envie
Saint Gervais, avec le juge de paix
Saint Anatole, avec le maître d’école
Saint Lucien, avec le pharmacien
Sainte Claire, avec monsieur le maire,
Saint Macaire, avec le notaire
Sainte Madeleine, sortez-moi de peine
Saint Julien, qu’il se porte bien
Saint Yvon, qu’il soit bon garçon
Saint Grégoire, qu’il n’aime pas boire
Saint Éloi, qu’il n’aime que moi
Saint Loup, qu’il ne soit pas jaloux
Saint Landry, qu’il soit bien gentil
Saint Nicolas, ne m’oubliez pas !
Se trouver un mari est longtemps la hantise des femmes. Car, voyez-vous, on disait que : « La vieillesse est l’enfer des femmes. » Peu réjouissant, n’est-ce pas ? Il fallait que nos grands-mères se marient à tout prix, et pour ce faire ,qu’elles acculent les hommes à l’inévitable le plus tôt possible. Ainsi, en mars 1907, des « demoiselles de Hull » (c’est de ce pseudonyme qu’elles ont signé la lettre) écrivent au journal Le Temps, d’Ottawa :
Monsieur le Maire et Messieurs les Échevins,
Nous avons une faveur à vous demander au sujet des célibataires de la cité de Hull, qui sont si nombreux et surtout d'aucune utilité.
Ils s'habillent à crédit et ne se marient pas pour mieux jouir de leur libertinage... sans même payer. Le dimanche, vous les voyez poser en dandys, mais à l'église, ils ne paient pas un sou pour leur banc. Ils ne paient même pas leur pension à leurs parents ; ils préfèrent garder leur argent pour boire ou vagabonder.
Nous vous demandons en grâce une faveur, c'est de les taxer. Ce sera en même temps un soulagement pour les papas. Chargez moins cher pour l'eau et imposez les célibataires. Cette taxe devrait être de $5 pour les célibataires âgés de 21 ans à 25 ans et proportionnellement avec l'âge.
Évidemment, cela ne vous dit pas pourquoi sainte Catherine était la patronne des « vieilles filles ».
L’origine de la « Sainte-Catherine »
La vie de sainte Catherine d'Alexandrie est tout à fait édifiante, puisque cette sainte a été à la fois vierge, martyre et docteur de l'Église, ce qui lui vaut
d'être représentée avec trois auréoles : la blanche des vierges, la rouge des martyrs et la verte des docteurs. Elle ne se contente pas non plus d'être la sainte patronne des filles à marier, mais aussi celle des prêcheurs et des philosophes. C'est sa vie exemplaire qui lui vaut tous ces honneurs : originaire d'une famille noble d'Alexandrie, Catherine se convertit au christianisme à la suite d'une vision. L'empereur Maxence, qui persécutait les chrétiens, lui proposa de renoncer à sa foi en échange d'un mariage royal. Catherine a refusé et allégué qu'elle avait contracté avec le Christ un mariage mystique. On raconte qu'elle a tenu tête à toute une armée de philosophes envoyés pour lui démontrer la fausseté de sa foi et qu’elle a même réussi à les convertir. L'empereur l’a alors condamné à mourir du supplice de la roue. La légende dit que la roue s’est brisée miraculeusement, et qu'elle a été finalement décapitée vers l'année 310, un 25 novembre.
Son refus de se marier explique tout naturellement pourquoi sainte Catherine est la patronne des filles célibataires. L'expression « coiffer sainte Catherine » qui signifie ne pas être mariée l'année de ses 25 ans, s'explique par une tradition qui remonte au XVIe sièce. En effet, à cette époque, on renouvelait la coiffure de la statue de la sainte dans les églises, et c'était les femmes célibataires de 25 à 35 ans qui se chargeaint de cette tâche. Il faut savoir que les hommes célibataires ont eux aussi leur saint patron en la personne de saint Nicolas : en effet, tout comme on dit « coiffer sainte Catherine » pour les filles, en France ont dit « porter la crosse de saint Nicolas » pour les garçons !
Mais quelle est l'origine de la tire ? Marguerite Bourgeois (1620-1700) est venue de France en 1653 pour enseigner aux enfants de la Nouvelle-France. Il paraît aussi que pour remémorer la fête de l'ouverture de la première école, elle a donné aux enfants des bonbons, pralines, nougats... Or, elle avait fait venir ces friandises de France. Mais une année, le bateau était en retrard et elle a donc dû trouver un moyen pour récompenses ses élèves. C'est alors qu'elle aurait imaginé un bonbon dont la recette consiste à faire bouillir de la mélasse et à la faire refroidir. Il ne restait plus qu'à l'étirer pour lui donner la belle couleur blonde qu'on lui connaît. On a appelé ce bonbon : tire Sainte-Catherine, en l'honneur de la saine qu'ont fêtait ce jour-là. Ajoutons que la chute de neige qui tombe la semaine de la Sainte-Catherine s'appelle la « bordée de sainte Catherine ».
Sources :
OUIMET, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éd. Vents d'Ouest, 1994.
Nos racines
Historia, hors série, no 44, Le roman du mariage.
En ce jour de l’Halloween, veille de la Toussaint et avant-veille de la fête des Morts, n’est-ce pas le moment propice pour parler de la mort au temps de jadis ? Voilà un sujet qui ne porte pas à rire, surtout à notre époque, puisque plus d’une personne estime que sa mort est un assassinat ! Aussi la cachons-nous derrière les murs des hôpitaux et des CHSLD. Cela n’a pas toujours été le cas. Ainsi, à l’entrée du cimetière de Montfort-l’Amaury (France) voit-on cette inscription : Vous qui passez ici, priez Dieu pour les trépassés ; ce que vous êtes ils ont été, ce que sont, un jour serez.
Au XIXe et au tournant du XXe siècle, la mort est une préoccupation de tous les instants. La médecine est alors impuissante. Ainsi, en janvier 1911, un certain Célestin Beaudin, de Hull, qui déambulait dans la rue, a trébuché et dans sa chute s’est tranché le bout de la langue avec les dents. Il saignait tant qu’on a appelé un médecin pour le soigner. Malgré les soins prodigués, Beaudin est mort au bout de son sang le surlendemain.
Omniprésente est la mort. Par exemple, du XVIIe au XIXe siècle, un prêtre récite cette prière devant le lit des nouveaux mariés :
Souvenez-vous que votre lit nuptial sera un jour le lit de votre mort... Joignez vos Prières aux nôtres, & demandez à Dieu qu’il vous détourne d’un sort malheureux, qu’il éloigne de vôtre lit & de vos coeurs l’esprit d’Impureté, & qu’il fasse régner celui de la chasteté [...]
Nombre de prières se terminent alors par les paroles ...et préservez-nous Seigneur de la mort subite. Souvenez-vous des paroles : Nul ne sait ni le jour ni l’heure... Il viendra comme un voleur ! La peur de la damnation éternelle entretient la crainte de la mort subite, sans confession préalable des péchés, sans le temps nécessaire pour faire ses comptes avec le prochain, avec Dieu lui-même (plus justicier que miséricorde).
Au tournant du XXe siècle, plus de la moitié des mortalités survient chez les enfants de 5 ans ou moins. Pas étonnan t alors que l’espérance de vie, en 1901, ne soit que de 49 ans. Diphtérie, typhus, fièvres typhoïdes et tuberculose prélèvent une part importante de la population. Plusieurs maladies ont pour cause des pratiques hygiéniques déficientes.
t alors que l’espérance de vie, en 1901, ne soit que de 49 ans. Diphtérie, typhus, fièvres typhoïdes et tuberculose prélèvent une part importante de la population. Plusieurs maladies ont pour cause des pratiques hygiéniques déficientes.
Une fois que la mort a fait son oeuvre, les parents proches lavent le cadavre, puis le revêtent de ses vêtements du dimanche. Le cercueil sert alors à enfermer le corps plutôt qu’à l’exposer. Plus tard, le mort sera déposé dans un cercueil peint en noir, placé sur deux chevalets dans le salon du domicile du défunt. Les pompes funèbres ne s’occupaient alors que de la fourniture du cercueil et du transport du défunt à l’église et au cimetière. Ça a été là le début de la marchandisation de la mort.
Le deuil
Parents et amis « veillent au corps » jusqu’à trois jours et deux nuits. Accroché à la principale porte de la maison, un crêpe noir, pour les hommes, gris pour les femmes, et blanc pour les enfants, sert à signaler au passant la présence d’un mort. Si une dépouille mortelle gît dans la maison un dimanche, on croit qu’un autre décès sera déploré dans la famille au cours de l’année. On ne cloue jamais le couvercle du cercueil dans la maison ; on attend d’être à un arpent de distance de la maison pour conjurer le sort.
Après l’inhumation de la dépouille, qui se fait en présence de la famille, les proches parents observent, pendant un an, le grand deuil, et pendant six autres mois le demi-deuil qui permet d’assortir aux vêtements noirs du grand deuil des vêtements blancs ou violets. Quant aux hommes, ils portent à leur bras un brassard noir (et cravate noire).
À l’origine, le noir des vêtements de deuil servait à marquer les personnes qui vivaient en compagnie du défunt, de façon à les tenir à l’écart, à n’avoir de contact avec elles que de loin et à éviter ainsi toute contagion possible. Les proches du défunt s’interdisaient de sortir ou tout au moins de se mêler à la société des autres pendant un temps déterminé. Pendant tout le temps que durait le deuil (il y a à peine 60 ans), on évite de danser et même d’écouter la radio. Chez certains, on va jusqu’à voiler les sources de lumière et même les miroirs afin que l’âme ne soit tentée de se mirer à loisir, retardant ainsi ou compromettant son entrée au paradis.
 Au Québec, on a commencé à embaumer les morts à partir des environs de 1910. Mais la pratique ne deviendra commune que dans les années 1930. L’embaument coûte alors 15 $, un cercueil environ 40 $ et l’enterrement de 2 $ à 10 $. C’est aussi à cette époque que l’on commence à exposer les morts dans des « maisons funéraires », bien que, dans la région, des personnes ont été exposées à la maison jusqu’à tard dans les années 1950.
Au Québec, on a commencé à embaumer les morts à partir des environs de 1910. Mais la pratique ne deviendra commune que dans les années 1930. L’embaument coûte alors 15 $, un cercueil environ 40 $ et l’enterrement de 2 $ à 10 $. C’est aussi à cette époque que l’on commence à exposer les morts dans des « maisons funéraires », bien que, dans la région, des personnes ont été exposées à la maison jusqu’à tard dans les années 1950.
Sources :
Documentation personnelle.
Gagnon, Serge, Mourir hier et aujourd’hui, Québec, les Presses de l’Université Laval, 1987.
Les vivants et leurs morts – Art, croyances et rites funéraires dans l’Ardenne d’autrefois, Belgique, Musée Piconrue, Bastogne, Crédit Communal, 1987.
