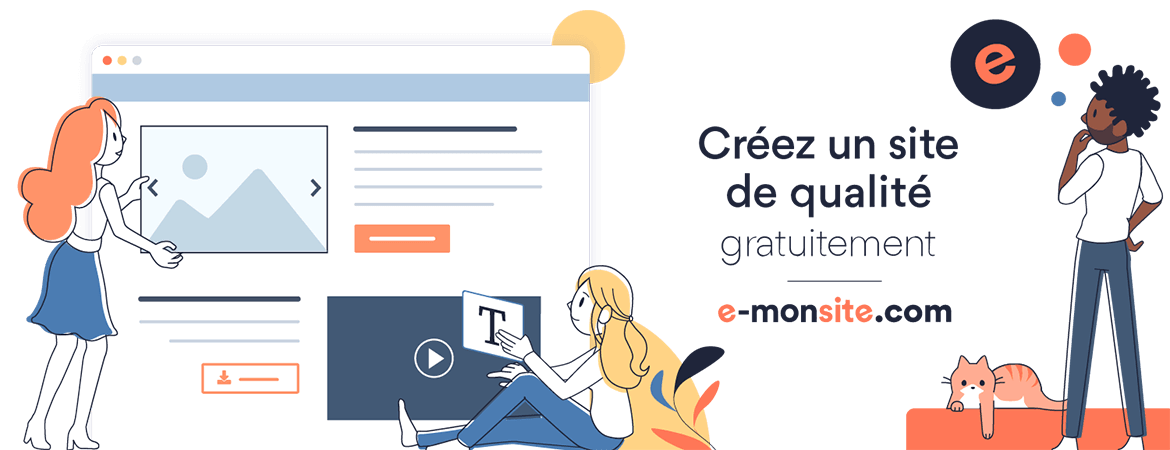Histoire générale
![]() Par
ouimet-raymond
Le 13/12/2022
Par
ouimet-raymond
Le 13/12/2022
Dans les années 1950, les catalogues de Eaton et Simpsons Sears, puis la période de l’avent annonçaient l’arrivée prochaine du temps des Fêtes. L'avent, c'était les quatre semaines qui précédaient la veille de Noël, période de jeûne pas facile à respecter puisque les mères préparaient, à ce moment, la mangeaille des Fêtes. Chez nous, la parenté éloignée venait aider ma mère à préparer cette période de l’année. C’était une grand-tante et des cousines venues de la campagne de l’île aux Allumettes si chère à ma mère qui en était originaire. Pendant une semaine, la maison se remplissait d’effluves de tourtières, de beignets, de galettes à la mélasse et au gingembre, de tartes aux atocas, etc. Le gâteau au lard (aux fruits) était toutefois préparé deux mois avant Noël et pouvait se conserver pendant un an, mais il était rapidement dévoré.
Nous allions acheter notre sapin de Noël environ une semaine avant Noël. Il y avait toujours quelqu’un dans le quartier qui faisait ce commerce annuel dans son fond de cours. Nous décorions l'arbre en famille au cours d'un samedi soir ou d’un dimanche après-midi. Sous l’arbre, on installait toujours une crèche que mon père avait fabriquée ; elle était entourée d’un petit village de maisonnettes blanches illuminées et de personnages de plâtre peint tels des anges, des bergers et des mages. Mais ce n'était qu'à minuit, le jour de Noël, ou dans les heures suivantes que le petit Jésus y était déposé. Nous conservions l’arbre de Noël jusqu’à la semaine suivant la fête des Rois alors que d’autres familles, certes peu nombreuses, le conservaient jusqu’au Mardi gras.
Chaque année, nous postions et recevions entre soixante et quatre-vingts cartes de vœux de Noël que nous suspendions à une ficelle tendue sur un mur de la cuisine. Nous les comptions en espérant en recevoir un plus grand nombre que l’année précédente. Dans le journal Le Droit du début de décembre, on trouvait un cahier de chants de Noël allant de l’Adeste Fideles aux Anges dans nos campagnes que nous chantions en famille. Puis on allumait le « Victrola[1] » dont les vibrations de l’aiguille nous transmettaient la douce voix de Tino Rossi : Petit papa Noël.
La messe de minuit
La messe de minuit était le moment fort du Noël de mon enfance. L’église Notre-Dame-de-Grâce (Hull) était éclairée comme jamais pendant l’année sinon à Pâques. Les yeux étaient tous tournés vers la crèche qui bordait la Sainte Table ; elle faisait au moins trois mètres de haut.
; elle faisait au moins trois mètres de haut.
Les confessions terminées, la grand-messe commençait, sérieuse, solennelle. Minuit moins cinq : les grandes orgues Casavant faisaient entendre les premières notes. Puis le chœur de chant entonnait le Venez divin Messie. Mais toute l’assistance attendait « L’heure solennelle », celle qui, au moment de l’entrée des célébrants et des 80 enfants de chœur vêtus d’une soutane rouge et d’un surplis blanc, donnait le coup d’envoi au cantique tant aimé : Minuit, chrétiens ! Les fidèles étaient pris d’un frisson qui secouait tant le corps que l’âme. Tous, sans exception, écoutaient le chant comme des mélomanes.
Ce chant a été composé en France en 1847 et a été banni de nombreuses églises du Québec dans les années 1930 et 1940 à la suite d’une campagne menée par le cardinal Villeneuve (1883-1947) qui emboîtait le pas à des autorités ecclésiastiques françaises. On avait fait courir la rumeur que ce chant avait été composé pendant une beuverie, et que l’auteur, un supposé franc-maçon alcoolique, avait recyclé la musique de l’un de ses opéras pour l’offrir à sa maîtresse, ce qui était évidemment faux.
Si la grand-messe était longue et solennelle, les messes (la messe de l’Aurore et celle du Matin) qui suivaient étaient dites beaucoup plus rapidement. Et les chants éclataient plus joyeux les uns que les autres sous la voûte de la grande église. Chacun chantait à pleins poumons. Puis on quittait le temple pour se rendre à la maison, le plus souvent à pied et parfois sous une neige qui donnait un air féérique à notre parcours d’une vingtaine de minutes.
Une nuit miraculeuse
On disait que la nuit de Noël, à la campagne, les ruraux prêtaient une attention spéciale aux bruits de l’étable. Un vieil adage français, repris au Québec, voulait que les animaux se parlent à ce moment ; on pouvait donc les surprendre en pleins palabres. Longtemps la population québécoise en a été convaincue. On répétait, par exemple, que les montagnes s’entrouvraient et laissaient voir le minerai qu’elles contenaient. Les morts sortaient des tombes et venaient s’agenouiller au pied de la croix du cimetière, là où le dernier curé de la paroisse, vêtu du surplis et de l’étole, leur chantait la messe. Puis toujours en silence, ils se relevaient, regardaient le village où ils avaient vécu, la maison où ils étaient décédés, et gagnaient à nouveau leur tombe.
Évidemment, le monde des vivants n’avait pas le temps de voir ce qui se passait dehors puisque, à l’intérieur des maisons, le réveillon tant attendu était servi. Chez moi, jusqu’en 1956, il n’y avait pas de cadeaux à Noël : on mangeait, on riait au milieu de la nuit. Puis, on allait au lit la tête pleine de chants joyeux et religieux. Le reste de la journée se passait en famille à chanter et à jouer à divers jeux. Mais la fête la plus célébrée, celle où nous recevions nos étrennes, était évidemment le jour de l’An célébré chez mes grands-parents paternels avec toute la famille qui comptait plus d’une vingtaine d’adultes. C’était un véritable festin avec repas, chansons et alcool :
Prendre un verre de bière mon minou
Prendre un verre de bière right through
Tu prends d’la bière
Tu m’en donnes pas
J’te chante des belles chansons
J’te fais des belles façons
Donne-moé z’en donc…
La fête se terminait vers les trois ou quatre heures du matin, ce qui ne laissait aux travailleurs que deux petites heures de sommeil avant leur retour au travail, fatigués, mais gonflés à bloc par cette journée de réjouissances.
Joyeux Noël
Photographie : Noël 1961 chez mes parents.
[1] Tourne-disque 78 tours.
John Romanuk alias Jos Patates
![]() Par
ouimet-raymond
Le 23/04/2022
Par
ouimet-raymond
Le 23/04/2022
Avant l’arrivée des grandes surfaces et des dépanneurs à tous les coins de rue, la population a longtemps compté sur les vendeurs itinérants qui passaient de porte en porte pour vendre leurs produits. On a tout vendu de cette façon : lait, pain, fruits et légumes, glace, guenille et même des frites.
Ces vendeurs itinérants ont beaucoup attiré l’attention dans les années 1950, car ils ont souvent été les derniers à se transporter au moyen de véhicules hippomobiles. Tous les enfants étaient fascinés pas les chevaux qu’ils caressaient. Mais leurs parents en avaient vu d’autres, au temps où presque tous les véhicules étaient tirés par des chevaux. Car qui dit chevaux, dit aussi écurie, avoine, épouvante, crottin et odeurs. L’avoine mêlée au crottin nourrissait tout de même les moineaux dont la population est nettement en baisse depuis la disparition des chevaux de la ville.
De son vrai nom ROMANIUK, il demeurait au 10½ rue Saint-Florent. Célibataire. On disait qu’il était un « Poloc », mais son nom laisse croire qu’il était plutôt Ukrainien. Ils sont venus nombreux les Ukrainiens au pays, fuyant un pays partagé en deux par l’occupation polonaise et soviétique en 1921. Il parlait un peu l’anglais et baragouinait le français. Quant aux Romanuk, il semble être arrivé au pays peu avant la guerre, peut-être à la suite des menaces que l'Allemagne nazie faisait peser sur l'ensemble de la Pologne à la fin des années 1930. Chose certaine, John Romaniuk, né en 1902, vendait déjà des frites en 1938 comme le montre une photo de la rue Montcalm prise cette année-là (BAnQ).
Jos Patates entretenait peu de relations avec le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.
le voisinage. Il allait parfois téléphoner chez les Charron à qui il remettait 0,10 dollar pour la communication. Célibataire, lui-même était, dit-on, économe sinon avaricieux (on disait « Séraphin »). Il avait un parent qui gérait une salle, la salle Romanuk, boulevard Sacré-Cœur, où l’on vendait aussi des frites.
Cet homme ne faisait apparemment rien d’autre que de travailler. Il se couchait tôt ; rarement les lumières de sa maison étaient allumées. Il possédait plusieurs propriétés ; on le disait même riche.
Les meilleures frites en ville
Comme son nom l’indique, Jos Patates vendait des pommes de terre frites qu’il faisait frire dans sa voiture tirée par un cheval. Il a été le dernier marchand hullois, sinon le dernier Hullois à entretenir un cheval dans la ville, dans une écurie située derrière sa maison, au 10½, rue Saint-Florent.
Il vendait les meilleurs frites en ville. Il avait appris ce métier de Roger Millette, aussi un « friteur » de patates qui s’était attaché aux Romanuk au point de travailler avec Mike Romanuk, propriétaire d’un commerce de location de salles de fêtes (mariage, etc.). Roger Millette était un Hullois pure laine qui avait commencé à vendre des frites en 1931, à la faveur de la crise économique de 1929. Ses fils, Réjean et Robert, suivront plus tard ses traces et feront les meilleures frites de Hull et Gatineau.
Jos Patates pelait ses patates tous les matins, en compagnie de deux enfants de la rue Saint-Florent qu’il payait de 0,05 à 0,10 dollar (pour 1 heure de travail, avant la classe, dans les années 1950) et qu’il entreposait dans de gros barils pleins d’eau.
Avec son cheval, il faisait un circuit de rues bien déterminé dans le Vieux Hull. Dans les années 1950, il vendait ses frites 5¢ dans un petit cornet et 10¢ dans un sac, en papier brun, plus gros. Le midi, les mères lui envoyaient leurs enfants avec un bol qu’il comblait généreusement de frites contre la somme de 1 dollar. Le soir, il s’installait, avec sa voiture et son vieux cheval, aux abords de lieux où se déroulaient des événements sportifs. Trois fois par semaine, durant la belle saison, il se garait au coin des rues Papineau et Kent, aux abords du parc Fontaine, où se déroulaient les matchs de balle rapide de la fameuse Ligue commerciale. Il y avait là parfois jusqu’à trois mille spectateurs. Ces jours-là, Jos Patates vendait toutes ses frites et son maïs soufflé.
Puis un jour, le cheval de Jos Patates est mort. Dès que la nouvelle s’est répandue, les enfants du quartier ont vite fait d’entourer l’écurie pour regarder à travers les interstices des planches ce à quoi pouvait ressembler un cheval mort.
Comment faisait-il pour donner une couleur dorée à ses patates et un goût incomparablement bon ? Il faisait simplement frire les pommes de terre dans de la graisse de bœuf (suif), la moins chère sur le marché, après les avoir lui-même épluchées, lavées et essuyées. Certains ont dit qu’il ajoutait un peu de Coca-Cola au suif, d’autres de la... mélasse ! Mais avez-vous essayé d’ajouter de la mélasse à du saindoux liquéfié ? Quoi qu’il en soit, ces frites étaient bonnes, meilleures que celles de la plupart des autres vendeurs itinérants. Et si c’était à cause de l’odeur du crottin de son cheval ?
Le malheureux destin de Mireille Balin
Ma mère aimait beaucoup le cinéma français ce qui fait que pendant mon adolescence, j’ai visionné de nombreux films de France, à la télévision de Radio-Canada, films aujourd’hui méconnus et même inconnus au Québec. J’ai aimé ces films et ses acteurs, de Jean Gabin à Philippe Noiret, de Danielle Darrieux à Catherine Deneuve. Mais qui se souvient aujourd’hui, parmi les cinéphiles francophones, de l’actrice Mireille Balin ?
Née à Monte-Carlo le 20 juillet 1909 dans une famille pauvre, un père typographe à la Tribune de Genève et une mère blanchisseuse originaire de Turin, Mireille Balin reçut une très bonne éducation à Paris où la famille s’était définitivement établie. La jeune fille manifesta tôt de bonnes dispositions pour les langues étrangères – italien, anglais et allemand – et étudia le piano. « Grande, le teint clair contrastant avec sa chevelure et ses yeux en amande, elle avait véritablement un port de reine », écrira plus tard Michel Azzopardi. Recrutée par le couturier Jean Patou, elle y est devenue une mannequin de renom.
En 1933, Mireille fit ses débuts au cinéma dans la version du Don Quichotte du réalisateur autrichien Georg Wihelm Pabst. Ce qui devait être une expérience sans lendemain se transforma en véritable carrière. En 1936, ce fut la consécration quand elle joua, au côté du réputé Jean Gabin, dans le film Pépé le Moko. Désormais auréolée de prestige, elle fit connaissance avec le célèbre Tino Rossi en 1937 dont elle devint la maîtresse.
En 1938, elle acheta une villa de 20 chambres à Cannes, qu’elle baptise Catari, titre d’une chanson de Tino Rossi. La villa avait eu trois propriétaires : deux s’étaient suicidés, le troisième s’était ruiné au jeu ! Si elle menait une vie mondaine fort active et dans le luxe, elle était professionnellement très occupée : elle jouait dans deux ou trois films par année dans lesquels elle personnifiait le plus souvent des garces d’une grande noirceur. Puis ce fut la guerre.
En 1941, elle fréquentait les soirées à l'ambassade d'Allemagne ; elle avait acheté un nouvel appartement avenue d'Iéna à Paris et rompu avec Tino Rossi. Mireille renoua alors avec un certain Birl Deissböck, jeune officier viennois de la Wehrmacht dont elle avait fait la connaissance en 1938. Ce fut le coup de foudre !
La déchéance
Elle continua à jouer au cinéma, mais à la libération de Paris en 1944, elle s’enfuyait avec son amant en direction de la frontière italienne où le couple se cacha dans la cave d’un immeuble à Beausoleil, près de Nice. Le 28 septembre, elle fut arrêtée, frappée et violée par des « résistants FFI »[i]. Birl Deissböck se fit collaborateurs auprès des forces étasuniennes, puis de la Défense et sécurité du territoire français[ii].
Traînée à travers la ville, Mireille Balin fut jetée en prison. Libérée début 1945, son appartement avait été pillé, ses biens volés, elle fit une dépression. Sa vie, la carrière et sa santé étaient brisées. La plupart de ses anciennes relations l'évitaient. Le public se détourna d'elle également ; elle tourna son dernier film en 1947.
Seule et criblée de dettes, elle fut obligée de vendre son appartement et la villa Catari, plongea dans l'alcool, et tomba malade – typhus, cirrhose, typhus. Dans un dénuement complet, marquée physiquement par la maladie, elle fut secourue par l'association La roue tourne qui aident les anciens artistes dans le besoin.
C’est dans l’anonymat et la misère que Mireille Balin mourra à l’âge de 59 ans le 9 novembre 1968 à Clichy. L’association lui évita l’inhumation dans la fosse commune et à part le réalisateur Jean Dellannoy, aucune personnalité du spectacle n’assista à ses funérailles. Fernandel président d'honneur de l'association La roue tourne, et Tino Rossi, son ancien compagnon, contribuèrent en grande partie à payer l'enterrement et le caveau de l’ancienne vedette de cinéma.
SOURCES :
AZZOPARDI, Michel, Le temps des vamps : 1915-1965 : cinquante ans de sex-appeal, L'Harmattan, 1997, 484 p.
BERTRAND, Frank,Mireille Balin, la star foudroyée, Éd. Vaillant, 2014, 194 p.
GAUTELIER, Loic, Mireille Balin, éd. Les passagers du Rêve, 2019.
Wikipédia.
Petite histoire du premier jour de l'année
Chaque année, à date fixe, douze coups d’horloge sont précédés de bonnes résolutions et suivis d’embrassades. Pourquoi ce jour-là ? En a-t-il toujours été ainsi ? Évidemment, je parle du Nouvel An. Retour sur l’histoire de notre calendrier.
La conception du temps dans les sociétés disparues est à peu près inconnue. La première mesure du temps était certainement liée à la nécessité de prévoir l’apparition de la pluie et du soleil, pour suivre et contrôler le renouvellement des ressources alimentaires. On pense que l’astrologie constitue la source des calendriers primitifs. Par exemple, à Babylone, la mesure du temps était lunaire. En Égypte antique, le premier jour de l’année était le premier jour du premier mois de la saison de l’inondation des cultures par le Nil. En Chine, le début de l’année était déterminé par chaque empereur, début qui oscillait entre les divers mois de la saison froide.
En 46 avant notre ère, Jules César, en tant que Pontifex Maximus, a décrété que le début de l’année commençait le premier quantième du mois dédié à Janus (le mois de janvier) et réalignait le calendrier romain qui avait pris 90 jours d’avance (calendrier julien). Divinité aux deux visages, l’un tourné vers l’avenir tandis que l’autre s’attardait encore sur le passé, Janus leur semblait une divinité de bon augure pour glisser au Nouvel An d’autant plus qu’elle était invoquée avant toute autre divinité. C’est donc l’avènement du calendrier julien encore utilisé aujourd’hui par les Églises orthodoxes serbes et russes.
L'influence de l'Église chrétienne romaine
Janus est un dieu païen. Du coup, les chrétiens cherchèrent d’autres dates, même si le calendrier continuait imperturbablement à aller de janvier à décembre. La seule étape importante leur sembla longtemps Pâques, qui demeure la fête par excellence des orthodoxes. Réuni par l’empereur Constantin en 325, le Concile de Nicée fixa la Résurrection le dimanche suivant la pleine Lune d’après l’équinoxe du printemps. Il s’agissait donc, comme aujourd’hui, d’une date… mobile ! Fallait-il du coup commencer l’année à Pâques? Certains pays l’ont fait, comme l’ancien royaume de France. Mais sous Charlemagne, l’année commençait à Noël.
 La Provence et l’Autriche avaient fixé le début de l’année à l’Annonciation, qui tombe comme il se doit neuf mois avant Noël : le 25 mars. D’autres jours ont été élus. Citons le 1er mars, à Venise le 1er septembre à Constantinople ou le 25 décembre. Il faut dire que le plus grand désordre horloger régnait parallèlement. Ni le commerce ni les transports n’avaient encore exigé le temps GMT. Quoi qu’il en soit, en 1564, le roi de France, Charles IX, fixait le premier jour de l’année au 1er janvier.
La Provence et l’Autriche avaient fixé le début de l’année à l’Annonciation, qui tombe comme il se doit neuf mois avant Noël : le 25 mars. D’autres jours ont été élus. Citons le 1er mars, à Venise le 1er septembre à Constantinople ou le 25 décembre. Il faut dire que le plus grand désordre horloger régnait parallèlement. Ni le commerce ni les transports n’avaient encore exigé le temps GMT. Quoi qu’il en soit, en 1564, le roi de France, Charles IX, fixait le premier jour de l’année au 1er janvier.
La Franche-Comté, qui était alors terre d’Empire, a adopté le 1er janvier comme début de l'année en 1575, la Lorraine, principauté indépendante en 1579, l’Écosse royaume encore libre en 1600, l’Église romaine en 1622 et la Russie en 1725. Mais ce n’est qu’en 1752 que le Royaume-Uni a adopté cette date. Et parmi les premières mesures d’Atatürk (Turquie), en 1927, a figuré l’adoption du calendrier occidental. Le Japon avait agi de même en 1872.
Un problème de calendrier
Certains pays n’ont pas eu qu’à changer la date du premier jour de l’An, mais aussi leur calendrier. En effet, parce que pour que le 1er janvier puisse véritablement s’ancrer dans l’année, au XVIe siècle, il restait une réforme à accomplir. Le calendrier julien, remontait comme son nom le suggère à l’Antiquité, était un peu généreux. Au bout d’un millénaire et demi, il accusait une erreur de onze jours sur la réalité. L’Église catholique, qui entendait rythmer l’année, s’est chargée d’y mettre bon ordre. Le pape Grégoire XIII en 1582, a fait directement passer les fidèles du 4 au 15 octobre. Un coup de force scandaleux pour les protestants et les orthodoxes qui aimaient mieux être en désaccord avec les saisons que d’accord avec un catholique. Les premiers attendirent 1700, voire 1752, pour suivre l’exemple. Ainsi, l’année 1701, à Genève, a commencé ainsi non pas le 1er, mais le… 12 janvier.
L'histoire du premier jour de l'An et de notre calendrier n'est pas finie. En effet, La Révolution française a créé un calendrier basé sur le système décimal. Ainsi, l’année commençait le 1er vendémiaire (22 septembre, premier jour de l’automne. Ce calendrier sera abandonné en 1805. Il n’aurait été employé qu’environ douze ans. Le calendrier républicain sera réutilisé pendant 15 jours et seulement dans le Journal officiel lors de la Commune de Paris en 1871. Une autre réforme, elle, est restée mort-née. La Société des Nations, en 1922, l’ONU, après 1945, ont songé à créer des calendriers universels, avec 13 mois de 28 jours. Les États-Unis y ont opposé leur veto, invoquant les convictions… religieuses de ses habitants.
SOURCES
Attali, Jacques, Histoires du temps, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1982.
La Tribune de Genève (Genève), 31 décembre 2001.
Wikipédia.
Vivre au XVIIe et XVIIIe siècles
Dans notre siècle d'abondance, nous avons peine à comprendre combien la vie était rude voilà 300 à 400 ans. Selon Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), ingénieur de Louis XIV, les mendiants et miséreux formaient alors 10% de la population de France, les pauvres, 50%. Ceux qui avaient un peu de biens, mais embarrassés de dettes, 30%. Sur les 10% restant, il n’y avait pas 6 000 familles « qu’on puisse dire véritablement à leur aise. » Les élites nobles et bourgeoises ainsi que l’Église possédaient la terre que travaillait une paysannerie largement illettrée et misérable.
Les disparités de revenus étaient énormes. Par exemple, la duchesse de Montpensier (1627-1693) dite la Grande Mademoiselle avait une dot de 800 000 livres. Un engagé en Nouvelle-France recevait entre 75 et 100 livres par année. La solde annuelle d'un soldat des compagnies franches de la Marine n'était de 108 livres au XVIIIe siècle.
Les paysans avaient des conditions de vie particulièrement fragiles. Il suffisait qu’une récolte s’annonce médiocre pour que le prix des céréales, qui constituaient la base de l’alimentation populaire s’envole, et que les « manouvriers », c’est-à-dire ceux qui ne possédaient rien et louaient leur travail, soient au bord de la famine. Le régime alimentaire des paysans était monotone et précaire. Ils mangeaient des bouillies de céréales et des soupes de légumes, du pain surtout, très peu de viande et quasi exclusivement du porc. La situation était meilleure en Nouvelle-France parce que la nourriture était plus facilement accessible qu'en France, et ce, grâce à ses forêts giboyeuses et ses rivières poissonneuses.
La vie était pénible, fragile même, et l'hygiène sommaire. On avait très peu de vêtements et souvent pas plus d'une chemise ou d'une robe. En France, un enfant sur quatre mourait au cours de sa première année et il n’y avait guère plus de 2 enfants sur 4 qui arrivaient à l’âge adulte. L’espérance de vie d’une personne de 20 ans dépassait rarement la trentaine d'années. En Nouvelle-France, la vie était plus douce parce que la population était moins dense qu'en France et mieux nourrie. Aussi atteignait-elle les 40 ans au XVIIe siècle. Ainsi, vieillir relevait quasiment du miracle. En 1680, 94,5% de la population avait moins de 46 ans.
 Une simple infection, il y a 400 ans, pouvait conduire directement à la mort quel que soit les moyens financiers du malade parce l'ignorance du médecin était alors abyssale. Aussi soignait-il ses patients avec des saignées qui affaiblissaient le patient ou des médicaments comme des tablettes d'yeux d'écrevisses, de la poudre de corne de cerf, du mercure, des testicules de castor, de la térébenthine, du vitriol de Chypre, etc. Et les sages-femmes procédaient à l'accouchement de leurs parturientes sans même se laver les mains avant d'intervenir.
Une simple infection, il y a 400 ans, pouvait conduire directement à la mort quel que soit les moyens financiers du malade parce l'ignorance du médecin était alors abyssale. Aussi soignait-il ses patients avec des saignées qui affaiblissaient le patient ou des médicaments comme des tablettes d'yeux d'écrevisses, de la poudre de corne de cerf, du mercure, des testicules de castor, de la térébenthine, du vitriol de Chypre, etc. Et les sages-femmes procédaient à l'accouchement de leurs parturientes sans même se laver les mains avant d'intervenir.
Les odeurs en milieu urbain
Dans les villes, l'odeur était pestilentielle. L’auteur allemand Patrick Süskind a fait, dans son roman intitulé Le Parfum, une description assez réaliste des odeurs parisiennes de l’époque qui suivit :
À l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l’urine, les cages d’escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton [...] Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient [...] Car en ce XVIIIe siècle, l’activité délétère des bactéries ne rencontrait aucune limite, aussi n’y avait-il aucune activité humaine, qu’elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin, qui ne fut accompagnée de puanteur.
En effet, à cette époque les citadins vidaient encore leur pot de chambre dans la rue. Il n'était donc pas étonnant d'y trouver des amas d'immondices, des membres de bêtes mortes, des cochons, etc., souvent responsables d'épidémie comme la peste. Les villes du Grand Siècle et de celui des Lumières n'avaient rien avoir avec les images idylliques du cinéma américain.
Il était difficile d'avoir une bonne hygiène d'autant plus qu'il n'y avait pas d'aqueduc qui dirigeait l'eau vers les logements. À la campagne les paysans pouvaient utiliser l’eau des ruisseaux pour se laver quand elle n'était pas gelée. En ville, y compris dans la noblesse et la bourgeoisie, on pratiquait la « toilette sèche», c'est-à-dire que les personnes se frottaient le corps avec un linge blanc et des onguents, et employaient du parfum pour dissimuler l’odeur. À partir du XVIIIe siècle, la pratique de l’ablution connaît un renouveau progressif dans la toilette avec l’apparition d’objets jusqu’alors inusités comme le bidet et la demi-baignoire italienne.
En conclusion, nous pouvons nous estimer chanceux de vivre au XXIe siècle. Mais qu'en sera-t-il pour nos petits-enfants ?
Sources :
BURGUIÈRE, André, http://www.vousnousils.fr/2016/11/18/comment-vivait-on-au-xviiie-siecle-596029
LACHANCE, André, Les marginaux, les exclus et l'autre au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles, Montréal, éditions Fides, 1996.
LACROIX, Claudine, Mortalité adulte et longévité exceptionnelle au Québec ancien, mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de maître es sciences en démographie, Université de Montréal, octobre 2009.
PETITFILS, Jean-Christian, Louis XIV, Paris, éd. Perrin, 1995.
SÜSKIND, Patrick, Le parfum, Paris, Le livre de poche, 1988.
Les bébés-boumeurs, une génération égoïste ?
Que laisseront les bébés-boumeurs aux générations suivantes ? Trop peu sans doute en regard du potentiel dont elle a hérité. Nombreuses sont les personnes qui estiment que les bébés-boumeurs font partie de l'une des générations les plus égoïstes de l'histoire humaine. Génération de consommateurs à outrance, de pollueurs à tout-va et de vandales de nombreux programmes sociaux dans le monde, elle laisserait à sa descendance plus de problèmes qu'elle en a réglés. Fait assuré, si elle a mis à la porte la religion catholique dans de nombreux pays occidentaux, elle est devenue l'adepte inconditionnelle d'une nouvelle religion appelée « Économie ». Au nom du dieu Argent, elle a sapé le système d'éducation québécois qui a déjà été l'un des meilleurs en Amérique du Nord et fait de même avec le système de santé au nom de l'économie.
La génération des bébés-boumeurs s'enorgueillit d'être progressiste parce qu'elle a créé « les Beatles, des véhicules capables de faire marcher l'homme sur la lune, l'internet, les panneaux solaires, les microprocesseurs, les microordinateurs ; elle a découvert l'ADN, développé le génie génétique, le séquençage de l'ADN [...] ». Mais elle a oublié que les deux ou trois générations précédentes avaient créé les antibiotiques, l'avion, le cinéma, la fusée, la radio, la télévision, la radiographie, etc., et, surtout, développé des outils pour assurer le bien commun des êtres humains en créant la Croix rouge, la Société des Nations, puis l'Organisation des Nations Unies. Amnistie internationale, Médecins dans frontière, etc.
En effet, les générations de l'entre-deux-guerres et celle d'avant la Grande Guerre ont été productives en matière de bien commun même si les guerres ont ralenti leurs efforts. Avant la fin du XIXe siècle, la génération d'avant 1914 a créé des syndicats pour mettre fin à l'exploitation des ouvriers, des coopératives pour donner du pouvoir économique aux classes ouvrières, la pension de sécurité de vieillesse en 1927, l'aide sociale en 1940 ainsi que l'assurance-chômage en 1941, la gratuité scolaire pour l'école primaire en 1943 et lancé la lutte pour l'égalité des femmes dès la fin du XIXe siècle.
La génération suivante n'est pas en reste puisqu'elle a conçu, en 1960, le régime d'assurance-hospitalisation du Québec et 10 ans plus tard l'assurance-maladie universelle. Elle a rendu gratuite l'école secondaire en 1961  de sorte qu'en 1964, le gouvernement du Québec créait le ministère de l'Éducation en dépit des vives protestations des autorités religieuses qui, jusque là, contrôlaient « l'instruction publique ». C'était la Révolution tranquille en marche dont on a tant parlé.
de sorte qu'en 1964, le gouvernement du Québec créait le ministère de l'Éducation en dépit des vives protestations des autorités religieuses qui, jusque là, contrôlaient « l'instruction publique ». C'était la Révolution tranquille en marche dont on a tant parlé.
En 1967, le gouvernement québécois créait les Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégep) où l'enseignement préuniversitaire et professionnel est gratuit. Un an plus tard, c'était la mise en place du réseau universitaire – les universités du Québec – avec pour mission de faciliter l'accessibilité à l'enseignement universitaire, et ce, à un faible coût. Un an plus tôt était apparu le Régime des rentes du Québec pour améliorer la situation financière des futurs retraités. Toutes ces réalisations, reliées au bien commun, sont celles des générations précédentes, et plus particulièrement de celle de l'entre-deux-guerres, la génération la plus progressiste de notre histoire, qui s'est inspirée de celle de ses pères.
La valeur la plus importante : le fric !
On ne peut pas nier que les bébés-boumeurs ont amélioré la qualité de vie de leurs contemporains, du moins au Québec, comme bénévoles dans de nombreuses organisations, en créant le système de garderies d'enfants à 5 $ et l'assurance médicament. Mais là où le bât blesse, c'est son rôle dans le développement d'un individualisme forcené qui a entraîné l'abandon des parents dans des foyers pour personnes âgées et le refus d'assurer la pérennité de leur culture par une diminution du taux de natalité, ce qui au Québec est suicidaire. Par ailleurs, dévorés par une quête d'épanouissement personnel, les bébés-boumeurs occidentaux ont fait des droits individuels un dogme qui, selon le philosophe Pierre Manent (un bébé-boumeur), « règne sans contrepoids jusqu'à faire périr l'idée du bien commun. » Ils accordent une telle valeur à l'argent qu'ils congédient des milliers de travailleurs pour faire monter la valeur de leurs actions. Cette génération a transformé le syndicalisme en corporatisme, la médecine en machine à sous... de sorte qu'aujourd'hui tout est calculé à l'aune de l'économie.
La société des loisirs promise ne s'est concrétisée que pour une fraction de la population et jamais il n'y a eu autant d'inégalités. Le professeur Léo-Paul Lauzon, de l'Université du Québec à Montréal, a récemment écrit :
En 1950, la proportion des femmes âgées de 24 à 54 ans au travail était de 22 % contre 82 % en 2015. Aujourd’hui, les femmes au travail contribuent pour 47 % du revenu familial, soit presque la moitié. Même avec deux salaires, le revenu médian des familles après impôt a augmenté de seulement 13 % en dollars constants au cours des quarante dernières années. Cela ne fait que confirmer cette vérité : la classe moyenne s’effrite et leurs gains annuels stagnent alors que les revenus des nantis (gens d’affaires, médecins, professionnels, etc.) explosent, faisant grossir ainsi les inégalités économiques à des sommets historiques.
Pourtant, en 1968, les premières cohortes de bébés-boumeurs voulaient révolutionner le monde : elles ont lutté contre la guerre, pour un salaire minimum hebdomadaire à 100 $, puis pour la souveraineté du Québec avant de rentrer dans le rang et se laisser aller à une consommation démesurée.
Les générations précédentes n'étaient pas parfaites, j'en conviens – elles ont trop aimé la guerre et étaient le plus souvent racistes. Mais que laissent les bébés-boumeurs aux générations suivantes ? Un monde dans lequel il y a moins de guerres et la quasi-disparition des famines naturelles, ce qui n'est pas rien, mais aussi des océans si pollués que dans moins de trente ans il n'y aura plus de poissons ; une pénurie d'eau potable qui sera l'enjeu de guerres à venir ; des milliards de tonnes de déchets toxiques ; des programmes sociaux atrophiés ; des ressources naturelles privatisées, une folle envie de surconsommer... Les bébés-boumeurs laisseront-ils moins qu'ils ont reçu ? C'est du moins ce que prétendent de nombreux historiens et philosophes et c'est pourquoi cette génération se fait souvent traiter, à tort ou à raison, d'égoïste. Par ailleurs, elle-même qualifie sa descendance, les générations X, Y et Z, d'égoïstes et de narcissiques !
Enfin, l'exemple extrême de l'égoïsme d'une génération est celui de Donald Trump et de ses principaux conseillers, qui font partie de la première cohorte des bébés-boumeurs. Représentent-ils leur génération ?
Sources :
CLAPIERS, Roselyne de, Les baby-boomers seront égoïstes et dépensiers dans Les Échos.fr, https://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=18246-166-ECH
LAUZON, Léo-Paul, Appauvrissement des travailleurs : le tripotage des chiffres dans le Journal de Montréal (Montréal), 18 juin2018.
MANENT, Pierre, La Loi naturelle et les droits de l'homme, Paris, PUF, 2018, cité dans Le Figaro (Paris), 11 juin 2018.
RAMBAL, Julie, Les papy-boomers, génération sans partage, dans Le Temps (Genève), 5 juillet 2016.
RAVARY, Lise, Égoïstes, les jeunes ?, dans Le Journal de Montréal (Montréal),7 juin 2018.
Carême est un mot dont la définition échappe à beaucoup de monde de nos jours. Quant au poisson d’avril, c’est une espèce en voie d’extinction.
Le carême semble remonter aux premiers temps de la chrétienté quand les Apôtres, pour associer tous les membres de l’Église à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ, ont imaginé une période annuelle de jeûne d’une quarantaine de jours. Le carême est donc un temps de pénitence en préparation à la fête de Pâques. Le mot dérive du latin quadragesima ou « quarantaine ». Le chiffre quarante est d’ailleurs symbolique : il rappelle les quarante années que le peuple hébreu, libéré par Dieu de l’esclavage d’Égypte, a passées dans le désert avant d’entrer dans la Terre promise et aussi les quarante jours passés par Jésus dans le désert.
Au Québec, sous le régime français, quand venait le mercredi des Cendres, les fidèles étaient tenus de se présenter a`la messe au cours de laquelle le célébrant bénissait les cendres et en déposait une pincée sur la tête de chacun des paroissiens en répétant la phrase de la Genèse : « Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. »
Mercredi des Cendres
Avec le mercredi des Cendres commençait donc une longue période de jeûne. En 1702, Mgr de Saint-Vallier, évêque de Québec, écrivait que jeûner « c’est s’abstenir de l’usage de la chair, se contenter d’un seul repas, sur le midi, d’une légère collation le soir. » Tous les fidèles bien portants, de 21 à 60 ans, y étaient tenus. En tout temps également, on faisait maigre, sauf les dimanches. Remarquez que s’abstenir de l’usage de la chair sous-entendait aussi l’abstinence sexuelle. De là peut-être l’expression assez éloquente : avoir un visage de carême !
L'Église contrôlait l'observance du carême par la confession et la délation. Et on ne lésinait pas sur l’application du carême qui était une loi tant civile que religieuse au temps de la Nouvelle-France. Par exemple, en 1670, un homme de l’île d’Orléans, Louis Gaboury, s’était avisé de consommer de la viande un jour de semaine sans la permission de son curé. Dénoncé par un voisin, il a dû comparaître devant le juge de la cour seigneuriale qui l'a condamné, séance tenant, à être attaché au poteau public durant trois heures. Le capitaine de la milice l'a conduit par la suite à la porte de l’église où, à genoux, mains jointes et tête nue, il demandait pardon à Dieu, au Roi et à la Justice. Il lui aussi fallu verser en outre une amende de 20 livres.
À la fin du XVIIIe siècle, les exigences du carême sont moins dures. On tolère la consommation d’œufs et de produits laitiers et on accorde la permission de manger de la viande quatre jours sur sept et d’utiliser la graisse animale pour la cuisson des aliments. Au XIXe siècle, les ecclésiastiques se montrent tolérants envers les personnes qui se livrent à un travail physique : on leur demande simplement d’éviter de manger à leur faim. A u XXe siècle, les enfants sont privés de bonbons et de desserts pendant le carême, sauf le dimanche. Aujourd’hui, le carême est à toutes fins utiles disparu de nos mœurs remplacé par la consommation à outrance. La religion des commerçants s’est substituée à celle des prêtres !
u XXe siècle, les enfants sont privés de bonbons et de desserts pendant le carême, sauf le dimanche. Aujourd’hui, le carême est à toutes fins utiles disparu de nos mœurs remplacé par la consommation à outrance. La religion des commerçants s’est substituée à celle des prêtres !
Le poisson d'avril
Vers la fin du carême est apparue cette fameuse journée du « poisson d’avril ». Son origine est controversée. Plusieurs ouvrages attribuent à l'expression poisson d'avril une origine liée à la corruption de la passion de Jésus-Christ qui aurait eu lieu le 3 avril : Jésus étant renvoyé d'un tribunal à l'autre et contraint de faire diverses courses par manière d'insulte et de dérision, on aurait pris de là la froide coutume de faire courir et de renvoyer, d'un endroit à l'autre, ceux dont on voulait se moquer.
Il y a, à mon avis, une explication plus vraisemblable. Pendant longtemps, l’anarchie était totale en ce qui touchait la date du début de l’année. Dans certaines villes, l’année commençait le 1er mars, dans d’autres, le 15 décembre ou à Noël, ailleurs l’année commençait à Pâques – fête à date flottante – ou encore le 1er avril. En 1235, par exemple, l’année a commencé à l’Annonciation (25 mars) et les cadeaux du Nouvel An s’échangeaient au début avril. À partir du XIVe siècle, l’année débutait le 1er avril à Paris et dans une bonne partie de la France, mais cette date n’était pas reconnue partout et encore moins dans toute l’Europe
Le décalage des dates ne facilitait pas l’établissement de contrats d’intérêts, ni la tenue des comptes des marchands et des foires, ni celle des budgets des villes ou du royaume. En 1563, Charles IX, roi de France, a décidé de mettre de l’ordre dans le calendrier en fixant le début de l’année au 1er janvier pour toute la France. Ce changement a eu pour effet de décaler les échanges de cadeaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle année. Pour semer le doute au sujet de la date réelle du Nouvel An, certains ont persisté à offrir des présents en avril. Avec le temps, les petits cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en stratagèmes pour piéger les autres.
Au XVIe siècle les cadeaux que l'on s'offrait au Nouvel An, donc en avril, étaient souvent alimentaires. Cette date étant à la fin du carême, période durant laquelle la consommation de viande est interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent. Lorsque les blagues se sont développées, l'un des pièges les plus courants était l'offrande de faux poissons. Puis, on en est venu à accrocher un poisson de papier dans le dos de l’autre pour lui jouer un tour.
La tradition de la blague du 1er avril s'est peu à peu diffusée dans toute l’Europe comme aussi la date du début de l’année. Elle s'exprimait de différentes manières en fonction des pays. En Angleterre, par exemple, le 1er avril est l' « April's fool day ». Les farces ne se font que le matin et si vous êtes piégé, vous êtes « une nouille ». En Écosse, les farceurs peuvent également sévir le 2 avril. Au Mexique, l'unique tour consiste à subtiliser le bien d'un ami. La victime aura en échange des bonbons et un petit mot lui indiquant qu'il s'est fait avoir.
Le 1er avril est un temps de canulars. Il y a quelques années,journal Le Droit avait montré une baleine échouée dans la rivière des Outaouais, devant le Musée des civilisations à Hull, en première page de son journal. Plusieurs avaient cru à cet impossible échouage. En 1999, la BBC avait fait croire aux Anglais que le God Save the Queen serait remplacé par un hymne européen chanté en… allemand. La station de radio a été inondée d’appels de personnes scandalisées.
Sources :
Attali, Jacques, Histoires du temps, Paris, Éd. Fayard, 1982.
Provencher, Jean, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, Montréal, éd. du Boréal, 1988.
Le Petit catéchisme, 1901.
Il y a huit ans, j’ai vu, au cours d’un baptême collectif, un père vêtu d’un « marcel », de jeans effilochés, et de bottines de construction, un autre avait gardé sa casquette sur la tête – on l’a vu aussi à la messe dite pour Cédrika Provencher à la suite de sa disparition (c'était un meurtre). Dans un resto, une serveuse m’a récemment dit : C’est quoi tu veux ? Et que dire des jurons à la Mike Ward ? Dans un certain collège de notre région, les autorités ont été si molles qu’elles ont laissé un de leurs professeurs sacrer à tous les quatre ou cinq mots pendant son enseignement, et ce, pendant des années. Bel exemple ! Pas étonnant que les Latino-Américains nous appellent les Los Tabarnacos...
De l'huile dans les rouages
La politesse, comme l’huile dans les rouages, a pour fonction de polir les gestes, les discours et les comportements dans les interactions humaines. Malheureusement, la bienséance, la politesse et le savoir-vivre sont en voie de disparition avancée.
Qu’on l’appelle le savoir-vivre, la civilité, la bienséance, les bonnes manières ou la courtoisie, tout le monde sait depuis toujours que sans la politesse la vie en société serait insupportable. La politesse a donc une histoire et les règles qu’elle impose n’ont jamais cessé de changer. Mais même si on ne mange plus avec ses doigts depuis l’invention de la fourchette, si le baisemain venu d’Angleterre nous paraît aujourd’hui démodé, si on ne vouvoie plus ses parents, ses enfants ou son conjoint, et si on ne demande plus la main de sa promise en gant, on devrait encore savoir qu’il ne faut pas mettre ses coudes sur la table et que même si on a une furieuse envie de mettre son poing sur la figure de quelqu’un, il faut savoir lui dire bonjour ou merci.
La politesse, c’est des règles toutes simples qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble sans avoir envie de s’entretuer La politesse c’est d’abord et avant tout le souci de l’Autre. Au XVIIe siècle, Bacon disait : La politesse est le vêtement de l’esprit. Elle doit servir, comme les habits de tous les jours, qui n’ont rien de trop recherché et cachent les défauts du corps : elle ne doit pas empêcher l’esprit d’agir librement.
La Bible
La première et la plus importante règle en matière de bonne conduite est la gentillesse et la considération des autres. Cette règle immuable émane de la Bible et c’est le deuxième commandement le plus important après celui d’aimer Dieu : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Dans la Bible on trouve : « Dites toujours "Merci" ;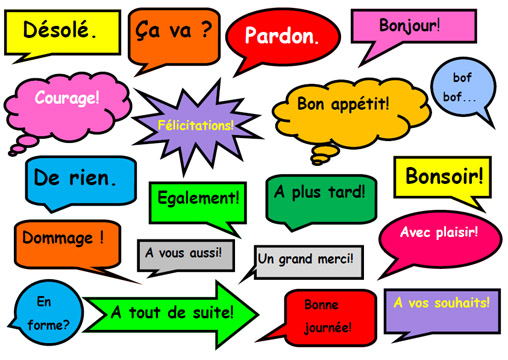 c'est une façon de faire des éloges aux autres et un principe de base des bonnes manières; n'oubliez pas de dire "Excusez-moi", "S'il vous plaît", "Je vous en prie", "Bonjour" et "Au revoir". » (COLOSSIENS 3:15 ; 1 THESSALONICIENS 5:18 ; 3 JEAN 14).
c'est une façon de faire des éloges aux autres et un principe de base des bonnes manières; n'oubliez pas de dire "Excusez-moi", "S'il vous plaît", "Je vous en prie", "Bonjour" et "Au revoir". » (COLOSSIENS 3:15 ; 1 THESSALONICIENS 5:18 ; 3 JEAN 14).
Une autre recommandation pleine de bon sens : « Soyez plein d'égards et ne mettez personne dans l'embarras ; traitez les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite. Pensez à la façon dont vous pourriez mettre les gens à l'aise. Ne rabaissez jamais personne par des plaisanteries de mauvais goût ou des surnoms malvenus. » (1 CORINTHIENS 13:4 ; PHILIPPIENS 2:4 ; LUC 10:27)
Ne vous adressez pas à une personne âgée ou à quelqu'un de plus âgé par leur prénom, à moins qu'ils ne vous y aient invité. Levez-vous à l'arrivée d'une personne âgée ou d'un invité dans la pièce, et ne vous asseyez pas tant que vous ne leur avez pas proposé un siège. (1 PIERRE 5:5)
Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas d’hier que l’on enseigne la bienséance.
Le vous
Les Italiens de la Renaissance ont codifié la politesse. Les Français du Grand Siècle ont inventé la galanterie. Puis, on a publié de plus en plus de livres sur le sujet. Le plus connu est sans doute celui de Berthe Bernage publié dans les années 1930.
L’usage du vous a longtemps prédominé dans la société française, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Le philosophe des Lumières Jean-Jacques Rousseau, auteur de Émile, ou de l’éducation (1762), juste avant la Révolution, recommande ainsi le tutoiement systématique dans la famille. Aujourd’hui, l’usage du tutoiement est de plus en plus répandu, notamment parmi les jeunes générations. On attribue généralement cette évolution à l’influence de la langue anglaise, dans laquelle le pronom « you » est perçu comme l’équivalent du « tu » français, ce qui n’est pas nécessairement vrai. Or, c’est le système scolaire qui l’a fait disparaître au Québec. Ainsi, il y a près de trente ans, ma fille aînée s’est fait menacer, par son professeur de la Secondaire V, de ne pas recevoir de réponse si elle ne le tutoyait pas !...
C'est dans le temps du jour de l'An
On s'donne la main et on s'embrasse,
C'est le bon temps d'en profiter
Ça n'arrive qu'une fois par année !
Le jour de l'An a longtemps été la fête par excellence des Québécois. Tous le célébraient dans la gaieté avec parents et amis. Mais la veille, on passait la « guignolée », mot qui vient de l’expression « Au gui l’an neuf ! » Cette quête était généralement effectuée par des jeunes gens qui allaient de porte en porte dans les rangs des campagnes ou les rues de la paroisse au son de la musique. On espérait recueillir pour les indigents des aumônes en nature afin d’égayer leur temps des Fêtes.
Le groupe qui passait la guignolée ne prenait pas d’assaut les maisons ; il y avait un cérémonial à respecter. On entonna d’abord la chanson « La guignolée », que tous connaissaient par cœur, battant la mesure avec de longs bâtons. Le maître et la maîtresse de la maison ouvraient alors la porte et invitaient les guignoleux à entrer. On servait au groupe beignes et rasades de rhum, puis on leur remettait en don diverses victuailles. On visitait ainsi presque toutes les maisons de la paroisse. La quête terminée, on divisait en lots les produits récoltés, avant de se rendre cette fois-ci chez les plus démunis.
Arrivait le jour de l’An, lequel est célébré le 1er janvier depuis 1564 ; avant cette année-là, l’année commençait généralement le 1er avril. Cette journée est exceptionnelle, car, la veille, les enfants se sont couchés en pensant aux étrennes qu’ils recevront le lendemain matin. On dit aux enfants que c’est l’Enfant Jésus qui est passé pendant la nuit et qui a laissé des étrennes. Les étrennes sont généralement des bonbons ou des fruits qui seront remplacés, à la fin du XIXe siècle par des jouets, souvent faits maison. La tradition de remettre les cadeaux au jour de l'An s'est maintenue dans plusieurs familles jusqu'au début des années 1960.
Si Noël était la fête de la petite famille, le jour de l’An rassemblait la parenté, et avec leur trâlée d’enfants, frères et sœurs se retrouvaient chez leurs parents ou grands-parents, après s’être arrêtés chez des amis et cousins pour leur souhaiter la bonne année. Dès que la plus grande partie de la parenté était réunie, le plus vieux des enfants demandait à son père la bénédiction du jour de l’An. Puis on se souhaitait la bonne année et « le Paradis à la fin de vos jours » en se serrant la main ou en s’embrassant. On se mettait ensuite à table dans un brouhaha indescriptible où chacun faisait bombance. Dans certaines familles, on laissait une place vide à la table, la « place du pauvre » au cas où quelque étranger se serait présenté.
Le repas terminé, on tassait la table. Puis chacun y allait d’une chanson, souvent reprise en chœur, d’autres jouaient une partie carte. Enfin, on commençait à danser au son du violon, puis du phonographe, parfois jusqu’au petit matin, les enfants étant déjà couchés dans tous les lits de la maison, au nombre de quatre ou cinq par lit, sur le sens de la largeur.
La fête des Rois
Le jour de l’An achevé, le temps des Fêtes continuaient. La fête des « Rois », le 6 janvier, clôturait ce temps de l’année. C’est une très vieille fête préchrétienne. Chez les juifs, les Grecs et les Romains, on élisait un « roi du festin » pour tourner le pouvoir en dérision. En 1512, le  pape Jules II décida de donner un nouveau sens à la fête des Rois. Dorénavant, les catholiques étaient tenus d’assister à la messe. On fêtera l’Épiphanie, pou rappeler la visite des rois mages à la crèche, un événement précédemment confondu avec la fête de Noël.
pape Jules II décida de donner un nouveau sens à la fête des Rois. Dorénavant, les catholiques étaient tenus d’assister à la messe. On fêtera l’Épiphanie, pou rappeler la visite des rois mages à la crèche, un événement précédemment confondu avec la fête de Noël.
Ce jour-là, au Québec, les paroissiens se présentaient à la messe, mais se retrouvaient par la suite à la maison pour le repas des Rois. Comme au Moyen Âge, on élisait roi, fût-elle une femme, la personne qui trouvait la fève dans le gâteau des Rois. On l’affublait d’une couronne puis on buvait à sa santé. Le repas terminé, on faisait à nouveau la fête jusque tard dans la nuit.
Sources :
Lacoursière, Jacques, Histoire populaire du Québec, éd. cédérom.
Provencher, Jean, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, Montréal, éd. du Boréal, 1988.
Souvenirs personnels.
1950 a été décrétée « année sainte » par le pape Pie XII et à cette occasion, il invite les catholiques du monde entier à faire pèlerinage à Rome.
L’année sainte correspond à une année déterminée durant laquelle le pape proclame des célébrations pouvant produire des indulgences plénières. Celles-ci « remettent les peines temporelles dues pour les péchés » et s’obtiennent à quatre conditions : confession, communion, visite de quatre basiliques majeures et prières. Depuis 1470, le jubilé se fait tous les 25 ans. L’année jubilaire de 1950 est dite « Année du grand pardon » ou « Grand retour ».
On sait combien le pèlerinage était populaire au Québec. Pensons à ceux de Sainte-Anne-de-Beaupré, du Cap-de-la-Madeleine ou de l’oratoire Saint-Joseph. Pour faire connaître l’appel du pape, quatre évêques forment, dès le début de 1950, un comité national canadien pour transmettre l’invitation.
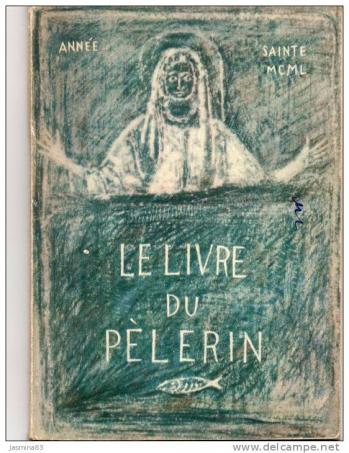 Des milliers de Canadiens, dont dix mille francophones, se rendent à Rome et les journaux publient les noms des partants de même que des photos de groupes de pèlerins qui s'y rendent par avion ou par bateau.
Des milliers de Canadiens, dont dix mille francophones, se rendent à Rome et les journaux publient les noms des partants de même que des photos de groupes de pèlerins qui s'y rendent par avion ou par bateau.
Un des groupes de pèlerins, composé de 120 personnes âgées en moyenne de 48 ans, dont Mgr Maurice Roy et le ministre Camille Pouliot, monte à bord du navire Columbia le vendredi 13 octobre 1950, à Québec. Ces pèlerins ont payé leur voyage 860 $ chacun. À cette époque, cette somme est relativement importante compte tenu du fait que le salaire moyen d’un ouvrier ne dépassait guère les 2 000 $ par année. Pour 40 des 120 de pèlerins, il n’y aura pas de retour.
La traversée de l’océan est difficile : tous les pèlerins souffrent du mal de mer. Ils ont peine à assister aux conférences données sur le navire par les prêtres qui les accompagnent. Enfin, le groupe débarque à Lisbonne (Portugal) le 22 octobre ; il entreprend un véritable marathon de visite de lieux dits « miraculeux ». À peine arrivé, le groupe se rend à Fatima où il prie pendant deux heures pour la conversion de la Russie.
Deux jours plus tard, il a déjà quitté le Portugal et se trouve en France, plus précisément à Lourdes. Le 25 octobre, il est à Tours et il assiste au dévoilement d’une dalle-souvenir à l’Ermitage Saint-Joseph : c’est-là que mère Marie de l’Incarnation avait révélé son projet de mission en Nouvelle-France. Par la suite, il groupe se rend à Paris, et après un pèlerinage au Sacré-Cœur de Montmartre, il parvient, le 29 octobre, à la basilique de Lisieux.
Enfin, le 31 octobre, les pèlerins canadiens arrivent à Rome où, dès leur arrivée, ils suivent une procession de la basilique Sainte-Marie-Majeure jusqu’à Saint-Pierre. Et le lendemain, avec 700 000 autres fidèles et 650 cardinaux et évêques, ils assistent à la proclamation du surprenant dogme de l’Assomption de la Vierge.
Le pèlerinage n’est pas fini. Après avoir été reçu en audience par le pape (12 personnes), le groupe assiste à la béatification de Marguerite Bourgeois. Plusieurs pèlerins n’hésitent pas à dire qu’ils se croient dans « l’antichambre du Ciel ». Plusieurs sont dans l’antichambre de la mort et ne le savent pas.
Un terrible accident
Le 13 novembre 1950, 40 des 120 personnes du groupe de pèlerins prennent l’avion pour revenir au pays. L’appareil, baptisé le Pèlerin canadien, est un DC-4 Skymaster exploité par la compagnie aérienne Curtiss-Reid Air Tours de Cartierville. Pendant la guerre, ce même appareil avait servi au transport de l’amiral américain C.W. Nimitz.
Le vol qui devait partir à 8 h est retardé par suite d’une audience accordée par le pape à tous les Canadiens qui se trouvent alors à Rome. La compagnie aérienne en profite pour faire l’inspection des quatre moteurs du DC-4. En début d’après-midi, 40 des 120 pèlerins montent à bord de l’avion en compagnie de 18 ou 20 autres personnes. (Mgr Vachon, archevêque d’Ottawa, avait annulé son voyage de retour à la dernière minute.)
À 14 h 16, l’avion s’envole ; le plan de vol prévoit une escale à Paris après le contournement des Alpes. Vers 17 h 3, l’aéronef qui a subitement dévié de sa route se fracasse sur le mont Obiou à 2 700 mètres d’altitude et entraîne dans la mort tous les occupants. Pendant trois jours, une centaine de sauveteurs alpins retirent des débris les restes des occupants de l’appareil de même qu’une imposante masse de dollars américains liés par un fil rouge. Des rumeurs circuleront autour du massif de l’Obiou sur des enrichissements inattendus dans la région. Parmi les débris de l’appareil, on trouve un lot de montres dorées, astucieusement disposées en auréoles et qui auraient échappé au douanier parce que la poitrine d’une femme s’offrait alors comme un sanctuaire inaccessible.
Les corps des victimes sont d’abord entreposés dans un dépositoire à Grenoble puis inhumés temporairement, en juin 1951, au Petit Sablon, cimetière magnifiquement situé dans la perspective du mont Saint-Eynard (un dernier corps sera trouvé en septembre 1951). Enfin, en 1955, 53 victimes reçoivent leur sépulture définitive à La Salette-Fallavaux.
puis inhumés temporairement, en juin 1951, au Petit Sablon, cimetière magnifiquement situé dans la perspective du mont Saint-Eynard (un dernier corps sera trouvé en septembre 1951). Enfin, en 1955, 53 victimes reçoivent leur sépulture définitive à La Salette-Fallavaux.
Un des passagers, l’abbé Romano Mocchiutti, prêtre de rite byzantin, verra sa dépouille mortelle transportée en Italie en Alfa-Roméo, limousine qu’un carrossier a transformée pour l’occasion. Or, cet abbé était membre de l’organisation anticommuniste ProRussie et devait être attaché au secrétariat outaouais du délégué apostolique, Mgr Antoniutti.
Un mystère
Que cachait donc l’avion ? Souvenons-nous qu’en 1950, nous sommes en pleine guerre froide. En 1949, le Vatican émettait un décret menaçant d’excommunication les Français qui « apporteraient leur concours aux communistes ». La chasse aux communistes, appelée « maccarthysme » (du nom du sénateur américain du même nom), est en cours depuis le mois de février, et la guerre en Corée fait rage depuis le mois de juin. De nombreux religieux sont arrêtés et enfermés dans des camps de concentration derrière le « rideau de fer ».
L’abbé Mocchiutti aurait-il transporté, dans ses bagages, des documents secrets destinés à desservir les intérêts soviétiques dans la guerre de Corée ? C’est la thèse du géographe Louis-Edmond Hamelin. Pour empêcher ces documents de se rendre à destination, les services secrets soviétiques mettent en place l’opération ZACHVAT, consistant à détourner l’avion, sans doute vers l’Autriche. L’équipe de l’opération est composée de deux personnes : une certaine Valentina, une ravissante tigresse russe de 36 ans, et d’un Méditerranéen, Amilcar, gorille obéissant aveuglément à Valentina.
Mais deux personnes pour détourner un avion à une époque où cela n’est pas encore courant, c’est peut-être trop peu. Quoi qu’il en soit, il y a peut-être eu lutte dans l’appareil qui a brusquement dévié de sa course pour enfin s’écraser sur l’Obiou le 13 novembre 1950. Le Canada ne mènera aucune enquête officielle sur ce fameux écrasement.
Sources:
Hamelin, Louis-Edmond, L’Obiou : Entre Dieu et Diable, éd. du Méridien, 1990 ; journaux d’époque ; documentation personnelle.
Le deuil de Monsieur de Montespan
Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan avait le bonheur, croyait-il, d’avoir épousé la plus belle femme du royaume de France : Françoise-Athénaïs de Rochechouart Mortemort. La très jolie jeune femme, demoiselle d’honneur de la reine, est un jour remarquée par le roi, Louis XIV – qui aurait pu être qualifié d'obsédé sexuel n'eut été de son rang –, lequel s’intéressait beaucoup plus aux reliefs de la géographie féminine qu’aux besoins de ses sujets. Louis XIV voulait attirer dans sa couche la belle Françoise-Athénaïs qui suppliait son mari de l’emmener en Gascogne pour la soustraire aux avances du Roi-Soleil. Fort de la vertu de sa femme, Louis-Henri de Montespan se refusa à quitter Paris et la cour du roi.
Pendant que M. de Montespan guerroyait dans le Roussillon, la vertu de Françoise-Athénaïs tomba au champ d’honneur du lit de Louis XIV. De retour de guerre, M. de Montespan apprit que sa femme était dorénavant la maîtresse du roi. La première surprise passée, la réaction du marquis fut violente : il asséna sur la joue de sa femme une gifle qui laissera sa trace pendant quelques jours. Quelque peu soulagé par cette violente réaction, Louis-Henri signifia à son épouse que, roi ou pas, son amant ne trouvera aucune complaisance chez le marquis de Montespan qui mit en œuvre tous les moyens possibles pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Et pendant quelques semaines, Louis-Henri fit un tapage épouvantable à la cour pour flétrir l'attitude indigne d'un monarque qui, pour son bon plaisir, foulait aux pieds tous les principes de la famille, de l'honneur et de la religion. Le roi tout puissant commença à en avoir assez du marquis de Montespan et ordonna son exil.
tomba au champ d’honneur du lit de Louis XIV. De retour de guerre, M. de Montespan apprit que sa femme était dorénavant la maîtresse du roi. La première surprise passée, la réaction du marquis fut violente : il asséna sur la joue de sa femme une gifle qui laissera sa trace pendant quelques jours. Quelque peu soulagé par cette violente réaction, Louis-Henri signifia à son épouse que, roi ou pas, son amant ne trouvera aucune complaisance chez le marquis de Montespan qui mit en œuvre tous les moyens possibles pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Et pendant quelques semaines, Louis-Henri fit un tapage épouvantable à la cour pour flétrir l'attitude indigne d'un monarque qui, pour son bon plaisir, foulait aux pieds tous les principes de la famille, de l'honneur et de la religion. Le roi tout puissant commença à en avoir assez du marquis de Montespan et ordonna son exil.
Un grand deuil
S'enfonçant chaque jour un peu plus dans sa douleur et sa colère, le marquis en arriva à une action étonnante, à une bravade que seul un Gascon courageux pouvait imaginer. Il savait qu'il avait perdu définitivement sa femme, que la cour lui était désormais interdite, et qu'il lui fallait regagner sa lointaine Gascogne. Mais il ne partira pas sans faire un coup d'éclat qui lui rendra son honneur perdu et mettra, pensait-t-il, les rieurs de son côté.
Nous sommes au début de l’année 1669. Le marquis de Montespan va quitter Paris. Pendant que le roi préside son Conseil, on voit arriver dans la cour du château le plus étrange attelage qui se soit jamais vu : la lourde berline de voyage du marquis est ornée des plus arrogantes armes parlantes de son nouvel état : les plumets fichés aux quatre coins de la voiture ont été remplacés par des bois de cerf les plus gigantesques que ses gens ont pu se procurer, de grands voiles noirs donnent au carrosse la plus funèbre apparence, rehaussée de surcroît par un sombre attelage de chevaux à la robe d'ébène. Le marquis, quant à lui, a revêtu les vêtements du grand deuil et c'est dans cet équipage qu'il vient s'installer sans la moindre vergogne au milieu de la salle des pas perdus par où le roi va quitter son Conseil. Les courtisans, affolés d'une pareille audace, s'éloignent autant qu'ils le peuvent du trop compromettant marquis qui se retrouve bientôt seul, au milieu du vestibule, face à la porte par où va sortir le roi. Lorsque le roi sort enfin de son Conseil, il s'arrête, étonné et après un court instant de silence, il interroge le marquis : « Pourquoi tout ce noir, monsieur ? »
— Sire, réplique sans se troubler le marquis, je porte le deuil de ma femme !
— Le deuil de votre femme ? interroge Louis XIV un peu surpris.
— Oui, Sire, pour moi elle est morte et je ne la reverrai plus... »
Puis il s'incline dans une révérence arrogante et, devant tous les courtisans effarés, il tourne les talons avec la plus grande désinvolture, puis regagne son carrosse funèbre avec lequel il traverse la France pour se rendre dans sa Gascogne natale.
Des funérailles
 À peine parvenu dans ses domaines, il lance à tous les seigneurs du voisinage une invitation à la solennelle messe d'obsèques qui met un terme à sa vie conjugale. Imaginez le spectacle de cette cérémonie funèbre autour d'un cercueil vide, transporté en grand apparat jusqu'à la chapelle du village, dans le carrosse aux cornes de cerfs plus que jamais tendu de noir ! C'est avec éclat que le marquis de Montespan veut que tout le pays de Gascogne sache qu'il n'accepte pas et que si quelqu'un, en cette affaire, a perdu l'honneur, ce n'est pas le mari, mais celui qu'il appelle le voleur d'épouse...
À peine parvenu dans ses domaines, il lance à tous les seigneurs du voisinage une invitation à la solennelle messe d'obsèques qui met un terme à sa vie conjugale. Imaginez le spectacle de cette cérémonie funèbre autour d'un cercueil vide, transporté en grand apparat jusqu'à la chapelle du village, dans le carrosse aux cornes de cerfs plus que jamais tendu de noir ! C'est avec éclat que le marquis de Montespan veut que tout le pays de Gascogne sache qu'il n'accepte pas et que si quelqu'un, en cette affaire, a perdu l'honneur, ce n'est pas le mari, mais celui qu'il appelle le voleur d'épouse...
Françoise-Athénaïs, marquise de Montespan, ne se contente pas de son titre de marquise et réclame celui de duchesse. Mais pour être duchesse, il faut que son mari soit duc. C’est ainsi que le roi décide de faire M. Montespan duc. Il apprend la nouvelle par sa femme et lui oppose le refus le plus dédaigneux, comme toujours formulé de la façon la plus percutante : « Sa Majesté a fait huit ou dix enfants à mon épouse sans m'en dire un mot, il peut bien lui faire présent d'un duché sans pour cela m'appeler à l'aide... Si Madame de Montespan rêve des ambitions, la mienne est depuis quarante ans satisfaite : je mourrai marquis à moins d'une catastrophe imprévue... »
Le marquis de Montespan est mort à Toulouse en 1701 à l’âge de 61 ans. Il a signé son testament comme ceci : « De Pardaillan de Gondrin Montespan, époux séparé quoique inséparable. » Son épouse décèdera six ans plus tard à l’âge de 66 ans.
Sources :
BARATON, Alain, Vice et Versailles, Paris, Le Livre de Poche, 2011.
CASTAGNON, Robert, Gloires de Gascogne, éd. Loubatières.
Nos ancêtres les femmes (suite)
Pendant longtemps, les Églises chrétiennes (et encore aujourd’hui l’islam) ont considéré la femme comme un instrument de la tentation diabolique. Saint Jérôme, persuadé de l’ardeur dévorante de la femme, dira aux hommes : « Quiconque aime trop son épouse est adultère. » De nombreux autres saints rabaissent la femme : dont saint Augustin qui décrète : « Homme, tu es le maître, la femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu. » Plus tard, saint Thomas enfoncera le clou : « La femme a été créée plus imparfaite que l'homme, même quant à son âme. » La maternité inspire même le dégoût : saint Jérôme, qui a dû être un homosexuel qui s’ignorait, trouve aux femmes enceintes « un aspect hideux » et saint Ambroise clame : « Heureuses les stériles ! » Mais le champion de la misogynie et de la bêtise est saint Odon de Cluny (879-942, abbé de Cluny en 927 (il a inventé la notation musicale) qui, au Xe siècle, déclare à propos de la femme : « Nous, qui répugnons à toucher du vomi et du fumier, comment pouvons-nous désirer serrer dans nos bras ce sac de fientes ? » On se demande bien comment ces hommes peuvent encore conserver leur statut de saint alors qu'ils méprisaient la moitié du genre humain.
Les Pères de l'Église ont voulu faire oublier que Jésus était l'ami des femmes. Souvenons-nous qu’un jour Jésus entra chez Marthe et Marie. Pendant que Marthe s’affairait à un service compliqué, Marie s’était assise au pied de Jésus pour écouter sa parole. Marthe, sans doute un peu frustré dit alors : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m’aider » Et Jésus de répondre : « C’est Marie qui a choisi la meilleure part. »
L’Église catholique, qui a pourtant peur de la femme, va finir par la défendre, au XIIe siècle, contre l’irresponsabilité des hommes. En effet, au Moyen âge les hommes utilisaient les femmes comme bon leur semblait. L’homme répudiait facilement son épouse pour en prendre une deuxième ou une troisième, en mettant à la porte la légitime et ses enfants. Les monastères d’Europe étaient encombrés de femmes et d’enfants expulsés des lieux où ils vivaient. Il fallait civiliser les hommes. C’est ainsi que l’Église fit du mariage, qui était alors un acte privé, un acte public en l’élevant au rang de sacrement. Ainsi, les hommes furent alors tenus de s’engager publiquement envers leur femme.
contre l’irresponsabilité des hommes. En effet, au Moyen âge les hommes utilisaient les femmes comme bon leur semblait. L’homme répudiait facilement son épouse pour en prendre une deuxième ou une troisième, en mettant à la porte la légitime et ses enfants. Les monastères d’Europe étaient encombrés de femmes et d’enfants expulsés des lieux où ils vivaient. Il fallait civiliser les hommes. C’est ainsi que l’Église fit du mariage, qui était alors un acte privé, un acte public en l’élevant au rang de sacrement. Ainsi, les hommes furent alors tenus de s’engager publiquement envers leur femme.
Mais être femme reste difficile, très difficile. Lady Flemming, gouvernante de Marie Stuart, a été chassée de la cour pour s’être vantée d’avoir été remarquée « bibliquement » par Henri II. Et Françoise de Rohan a été exilée parce que le duc de Nemours, lui ayant fait un enfant, l’avait ensuite abandonnée au lieu de l’épouser comme il l’avait promis.
Encore en 1900, la femme a la réputation d’être un être faible, incapable de contrôler ses émotions. Ainsi, lors du grand feu de 1900, à Hull, on dit des femmes : « Des femmes de pauvres familles s'agenouillaient dans la rue et demandaient au ciel de les épargner. D'autres furent trouvées évanouies dans leur demeure. » Au regard de la loi, la femme reste mineure même quand elle prend époux. C’est l’homme qui décide. La femme ne conquiert sa majorité que dans le veuvage. S’il a pris longtemps aux hommes d’avoir le droit de vote, il a en pris encore plus pour les femmes dont on discutera, en Cour suprême du Canada, en 1928, si elle est une personne ou non.
Les pionnières
En 1927, cinq femmes, soit Irene Parlby, Emily Murphy, Nellie McClung, Henrietta Muir Edwards et Louise McKinney, signent une pétition réclamant que la Cour suprême du Canada se penche sur l'expression « personnes qualifiées » de l'article 24 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 et détermine si elle comprenait les femmes comme étant des personnes admissibles à la nomination au Sénat. Après que la Cour eut rendu sa décision selon laquelle l'expression n'englobait pas des personnes de sexe féminin, les requérantes ont interjeté appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé en Angleterre. Le 18 octobre 1929, le Comité a infirmé la décision de la Cour suprême et a jugé que « personnes qualifiées » de l'article 24 comprenait les femmes et que les femmes étaient « admissibles au processus de nomination et au poste de membre du Sénat du Canada » (Dominion Law Reports, [1930] 1 DLR).
De toutes les femmes qui ont été les « fondatrices » du Québec on a d’abord retenu le nom de religieuses : Marie Guyart, dite de l’Incarnation, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, Marguerite d’Youville... On a surtout traité des femmes ayant fait carrière dans des communautés ou ayant eu un mari célèbre. De toutes nos ancêtres, les premières qui ont fait parler d’elles, en bien et en mal, sont les « filles du roi ». On écrit sur elles depuis plus de trois siècles, souvent à tort et à travers. Si on connaît relativement bien leur comportement en Nouvelle-France, on ne sait rien ou presque par contre de la vie de ces filles dans la mère patrie et des raisons qui les ont poussées à s'établir en Amérique. Il reste tant à faire pour connaître et faire connaître l'histoire des femmes, et ainsi reconnaître leur part dans la marche de l'humanité...
LE GUIDE DE LA BONNE ÉPOUSE
Tiré de la revue Housekeeping Monthly, 13 mai 1955.
Assurez-vous que le souper est prêt. Pour votre mari, planifiez d’avance, même la veille, un repas délicieux et juste à temps pour son retour [du travail]. Ainsi, vous lui montrez que vous avez pensé à lui et que ses besoins vous préoccupent. La plupart des hommes ont faim quand ils arrivent à la maison et la perspective d’un bon repas (particulièrement leur met préféré) fait partie de l’accueil chaleureux dont ils ont besoin.
-
Préparez-vous. Prenez 15 minutes pour vous reposer ; ainsi, vous serez fraîche quand il arrivera. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez épanouie. Il a passé une journée auprès de gens exigeants.
-
Soyez joyeuse, au moins un peu, et plus intéressante pour lui. À cause de la journée qu’il a eue, il a peut-être besoin d’être requinqué et cette tâche vous revient.
-
Faites disparaître le désordre. Faites une dernière inspection des principales pièces de la maison avant l’arrivée de votre mari.
-
Ramassez les livres d’école, jouets, papier, etc. et époussetez les tables.
-
Pendant les mois les plus froids de l’année, vous devriez lui préparer un feu de foyer pour qu’il puisse se détendre au coin de l’âtre. Votre mari aura alors l’impression d’être dans un havre d’ordre et de paix, ce qui aura pour effet de vous requinquer à votre tour. Après tout, voir à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle.
-
Préparer les enfants. Prenez quelques minutes pour laver les mains des enfants et leur visage (s’ils sont petits), peignez leurs cheveux et, au besoin, changez leurs vêtements. Ce sont de petits trésors chéris et il aimerait les voir comme étant tels. Abaissez le niveau de bruit. Au moment de son arrivée, éliminez les bruits de laveuse, sécheuse ou aspirateur. Exhortez les enfants au calme.
-
Soyez heureuse de le revoir.
-
Accueillez-le avec un sourire chaleureux et montrez-lui que vous voulez sincèrement lui plaire.
-
Écoutez-le. Vous avez peut-être une douzaine de choses à lui dire, mais le moment de son arrivée n’est pas le temps propice. Laissez-le parler d’abord. Rappelez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants que les vôtres.
-
Faites sienne la soirée. Ne vous plaignez pas s’il arrive tard ou s’il soupe à l’extérieur, ou ailleurs pour s’amuser sans vous. Essayez plutôt de comprendre son monde de stress et de tension, et son réel besoin d’être à la maison et de relaxer.
-
Votre but : veiller à ce que votre maison soit un havre de paix, d’ordre et de tranquillité où votre mari peut refaire ses forces physiques et spirituelles.
-
Ne l’accueillez pas avec des plaintes et des problèmes.
-
Ne vous plaignez pas s’il arrive en retard pour le souper et même s’il passe la soirée à l’extérieur. Tenez cela comme étant insignifiant en comparaison avec ce qu’il peut avoir subi pendant la journée.
-
Mettez-le à l’aise. Faites-le asseoir dans une chaise confortable ou s’étendre sur le lit de la chambre. Préparez-lui un breuvage chaud ou froid.
-
Préparez son oreiller et offrez-lui de lui retirer ses chaussures. Parler d’une voix basse, réparatrice et plaisante.
-
Ne lui posez pas de question sur ces actes ou ne mettez pas en doute son jugement ni son intégrité. Rappelez-vous : il est le maître de la maison et à ce titre il appliquera toujours sa volonté équitablement et objectivement. Vous n’avez pas le droit de le contester.
-
Une bonne épouse sait toujours où est sa place.
Qui peut dire le nom de sa première ancêtre matrilinéaire ? La mienne est Marie Garnier (Charles et Jeanne Labraye), engagée avec son mari, Olivier Charbonneau, à La Rochelle le 5 juin1659, arrivée à Montréal le 20 septembre1659. C’est drôle, mais la plupart des généalogistes que je rencontre ne connaissent souvent pas l’identité de leur première ancêtre.
Il suffit de consulter brochures, fascicules, livres et dictionnaires pour se rendre compte que les femmes, au Québec, sont ignorées par la généalogie et par l’histoire. À en croire les écrits de la majorité des généalogistes, la paternité est une certitude et la maternité un terme médical ! Dans nos livres d’histoire, on devise sur des ancêtres du moyen-âge dont le nom de la mère de leurs enfants est inconnu. Ce qui est encore plus étonnant, c’est que les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire de la généalogie et de l’histoire, et pourtant la généalogie féminine et l’histoire des femmes sont à peine plus populaires aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a un quart de siècle.
De nombreux ouvrages ont été publiés sur les pionniers de la Nouvelle-France. Pensons, par exemple, aux ouvrages de Jacques Saintonge (Nos ancêtres) et de Robert Prévost (Portraits de familles pionnières), ainsi que le fameux ouvrage Nos racines dont chaque fascicule, on s’en souviendra, contenait une biographie d’ancêtre. Aucun de ces ouvrages n’a consacré de notices biographiques à des femmes. À les lire, on a l’impression que les femmes – pourtant la moitié des sociétés de toutes époques – n’ont été qu’accessoires. Saluons par contre le fichier Origine, le premier instrument de recherche qui traite les femmes comme des personnes, des ancêtres à part entière, et ce livre de Robert Prévost, Figures de proue du Québec. Évocation de 700 femmes « dépareillées ».
La femme est pourtant la composante essentielle de la famille. La preuve en est que les foyers monoparentaux sont d’abord et avant tout composés de femmes chefs de famille, et que les familles se désunissent généralement après la mort de la mère. De plus, la maternité est un état biologique que l’on peut constater de visu alors que la paternité n’a bien longtemps été qu’un acte de foi. Je dis été, parce qu’aujourd’hui, l’ADN peut démontrer la paternité.
Le péché originel
Comment se fait-il que la femme ait été laissée de côté et le soit encore de nos jours, particulièrement en généalogie et en histoire ? Il faut dire que ce n’est pas d’hier que la femme est traitée comme une personne sans importance ou pire, comme une tentatrice ou un mal nécessaire. Cela remonte à loin dans notre histoire et celle du monde. Pensons à Ève qui aurait fait chuter Adam et à cause de qui nous naîtrions tous avec le… péché originel !
Les évangélistes Luc et Mathieu ont voulu démontrer que Jésus a réalisé la promesse des écritures, faites jadis au roi David par l'intermédiaire du prophète Natan[1], qui disait que le roi sauveur attendu devait être un descendant de David. Ils font ainsi une généalogie de Jésus qui établit l'ascendance de Joseph, son père, jusqu'à Adam pour le premier, et à Abraham pour le second (Mathieu 1.1 à 1.17 et Luc 3.23 à 3.4). La première se décline comme suit : Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra... Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie de laquelle est né Jésus.
Je vous fais grâce de la seconde, car les deux généalogies ne coïncident pas. En effet, Mathieu prétend que le père de Joseph était Jacob alors que Luc dit qu'il s'appelait Héli. Notons que Luc est moins catégorique que Mathieu à l'égard de la paternité de Joseph. Il a écrit que Jésus : « ...était fils, croyait-on, de Joseph [...] » Il omet cependant d’écrire que Jésus était le fils de Marie. Mais là où les deux généalogies sont rigoureusement exactes, c’est pour les mères : apparemment, les ancêtres de Jésus n’en avaient pas. Autre déclaration contradictoire : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint... Mais voilà, si Joseph est le géniteur de Jésus, le dogme de la virginité de Marie devient caduc, car on voit mal l'intérêt qui peut s'attacher au fait, très hypothétique, d'une appartenance de Joseph à la maison de David. Comment se fait-il que les évangélistes, pour démontrer leur point de vue, n'ont pas plutôt eu recours à la généalogie de Marie qui, elle aussi, était apparemment de la maison royale de David ?
Après les personnages de l’Ancien Testament, pas tous recommandables, celui qui prend le plus de place dans la littérature féminine et l’histoire du monde chrétien est la Vierge Marie. Or, ce personnage irréel est un modèle inaccessible. À l’opposé du genre humain, elle est née sans la tache originelle, elle a conçu un enfant par l’entremise du Saint-Esprit, elle est restée vierge avant, et pendant la conception de son enfant et même après l’accouchement. Elle aussi est la mère d’un dieu. De fait, ses attributions la placent carrément au rang de déesse.
Complètement obnubilée par le modèle de la mère de Jésus, l’Église catholique a emboîté le pas au judaïsme et a marginalisé la femme. Les juifs disaient : « Mieux vaut brûler la Torah que de la confier à une femme. » Ainsi, les recommandations de saint Paul (l’homme misogyne par excellence et néanmoins saint) ont déterminé la condition de la femme dans l'Église catholique et, par conséquent, dans la société civile. Dans une lettre aux Corinthiens, il écrit : « Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. » Paul estimait que le mariage était mieux que l'enfer, mais moins bien que la chasteté du célibat. Cette pensée devait en inspirer d'autres qui feront de la femme une personne de rang inférieur, et ce, pendant longtemps. Aux Éphésiens il déclare : « ...femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église... » L'apôtre condamnait la femme à obéir à l'homme, car à son avis elle était une dangereuse séductrice :
Pendant l'instruction la femme doit garder le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Qu'elle se tienne donc dans son silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité...
Voilà pourquoi la femme a si longtemps été représentée comme un obstacle au salut des hommes, comme une machine à faire des enfants, et que l'Église lui refuse, aujourd'hui encore, l'accession à la prêtrise.
À suivre...
La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal !
La guerre des tuques
Si j’aurais su, j’aurais pas venu.
La guerre des boutons
Ah ! Si les morts de cette guerre pouvaient sortir de leur tombe,
comme ils briseraient ces monuments d'hypocrite pitié,
car ceux qui les y élèvent les ont sacrifiés sans pitié !
Louis Barthas
Quand la Grande Guerre commence à l’été de 1914, soldats et militaires de hauts rangs sont convaincus qu’ils seront de retour à la maison pour Noël. Et on croit que les armées remporteront des batailles avec des charges de cavalerie dignes de celles des armées napoléoniennes. Mais la guerre a changé. Or, il appert que les généraux européens n’ont retenu aucun enseignement de la guerre civile des États-Unis (1861-1865) qui a fait pas moins de 620 000 morts. La mitrailleuse de 1865 ne tirait guère plus de 300 coups à la minute et n’était pas du tout fiable, tandis que celle de 1914 en tire pas moins de 700 à la minute. Pendant que le canon de 1865 tirait au plus 8 coups à la minute, celui de 1914 en tire 20. À la mitrailleuse, la Grande Guerre ajoute la mitraillette, les chars d’assaut, les gaz asphyxiants, les lance-flammes, les canons qui tirent à très longue distance des obus énormes, les ballons dirigeables et les avions qui bombardent et mitraillent les villes, etc. La Grande Guerre aura été un déluge d’acier et de fer ainsi qu'un vaste de champ de souffrances.
tandis que celle de 1914 en tire pas moins de 700 à la minute. Pendant que le canon de 1865 tirait au plus 8 coups à la minute, celui de 1914 en tire 20. À la mitrailleuse, la Grande Guerre ajoute la mitraillette, les chars d’assaut, les gaz asphyxiants, les lance-flammes, les canons qui tirent à très longue distance des obus énormes, les ballons dirigeables et les avions qui bombardent et mitraillent les villes, etc. La Grande Guerre aura été un déluge d’acier et de fer ainsi qu'un vaste de champ de souffrances.
Les pertes sont si énormes que dans les premiers mois on cache à la population la vérité sur le nombre de morts dans les batailles. Pas étonnant quand on sait que juste pour les mois d’août et septembre 1914, les armées françaises perdent 313 000 hommes (morts, disparus et prisonniers). À vrai dire, les généraux de cette époque sont peu soucieux de la vie de leurs hommes. Le maréchal Ferdinand Foch est partisan de l’offensive à outrance qui entraîne de lourdes pertes pour l’armée française. Le général Douglas Haig se voit surnommer « Boucher de la Somme » par ses hommes. Les hommes politiques canadiens, comme ceux gouvernements alliés, envoient, sans état d’âme, ses citoyens, ses soldats au sacrifice. Ainsi, le 15 septembre 1916 à Courcelette, le Royal 22e bataillon, seule unité francophone canadienne, perd pas moins de 806 hommes sur un total de 930 après avoir grappillé quelques mètres à l’ennemi.
Bilan statistique
Voici donc le triste bilan statistique de la Grande Guerre tiré des recherches les plus récentes en ce domaine.
Hommes mobilisés : 65 millions
Soldats morts : 9,7 millions (dont 64 944 Canadiens)
Soldats disparus/prisonniers : 8,9 millions
Soldats blessés : +21 millions
Gueules cassées : 300 000
Invalides : 6,5 millions
Civils tués 9 millions (dont 2 000 Canadiens)
Veuves : 4 millions
Orphelins : 8 millions
Nombre de chevaux tués : ±10 millions
Avions fabriqués : 60 000
Obus tirés : +1 milliard
Habitations détruites : 300 000 (France et Belgique)
Usines détruites : 20 000 (France et Belgique)
Coût des destructions : 110 milliards $ ($ de 1918)
Coût de la guerre : 300 milliards $ ($ de 1918)
Empires effondrés : 4
Les conséquences de la Grande Guerre, outre les souffrances humaines, auront été gigantesques et se font encore sentir de nos jours : effondrement et disparition des empires allemand, austro-hongrois, ottoman (dépecé) et russe ; apparition de nouveaux États (Estonie, Finlande, Lituanie, Lettonie, Pologne, Tchécoslovaquie, Turquie, Ukraine et  Yougoslavie) ; révolution en Russie et coup d’État des communistes qui s’y emparent du pouvoir ; perte de la prééminence de l’Europe dans le monde au profit des États-Unis d’Amérique ; prise de pouvoir des fascistes en Italie et des nazis en Allemagne ; déficit de naissance de 20 millions d’enfants ; partage du Moyen-Orient entre Britanniques et Français avec l'accord Picot-Sykes en 1916 ; trahison des Britanniques à l’endroit de leurs alliés Arabes** avec la déclaration Balfour qui annonce que la Grande-Bretagne est favorable à la création d’un foyer national juif en Palestine ; endettement de l’Europe au profit des États-Unis.
Yougoslavie) ; révolution en Russie et coup d’État des communistes qui s’y emparent du pouvoir ; perte de la prééminence de l’Europe dans le monde au profit des États-Unis d’Amérique ; prise de pouvoir des fascistes en Italie et des nazis en Allemagne ; déficit de naissance de 20 millions d’enfants ; partage du Moyen-Orient entre Britanniques et Français avec l'accord Picot-Sykes en 1916 ; trahison des Britanniques à l’endroit de leurs alliés Arabes** avec la déclaration Balfour qui annonce que la Grande-Bretagne est favorable à la création d’un foyer national juif en Palestine ; endettement de l’Europe au profit des États-Unis.
La Grande Guerre aura été une boucherie bien inutile et coûteuse. L’historien américain de l’économie, E. L. Bogart, a estimé, en 1919, que le coût du conflit, pour chacun des belligérants européens, avait été quatre fois supérieur à leurs PIB respectifs de 1913. Et puis, vingt et un ans après sa conclusion, une Seconde Guerre mondiale a éclaté et met en cause les mêmes belligérants que ceux de 14-18 (bien que l’Italie ait changé de camp). Elle fera encore plus de victimes que la Première.
Notes :
* Mutilés du visage
** Les Arabes avaient aidé les Britanniques à conquérir la Palestine en échange de la promesse de la création d’un grand royaume arabe unitaire au Moyen-Orient qui aurait compris la Palestine.
Sources :
Apocalypse : la 1ère Guerre mondiale (TV5).
Le Devoir (Montréal), 16 mai 2014, page B1.
Enseigner la Première Guerre mondiale, site Internet http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/sujets/europe_1918.htm
Hérodote.net
Historia, mars 2014, no 807.
Musée de la Grande Guerre, Meaux, France.
La Presse (Montréal), 28 juin 1914.
Il y a 100 ans : l'attentat qui déclencha la Grande Guerre
Ce jour-là, le 28 juin 1914, François-Ferdinand de Habsbourg, archiduc et héritier présomptif de l'empereur austro-hongrois, François-Joseph, visite la ville de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, territoire que l'empire a annexé en 1908 au grand mécontentement de la Russie et de la Serbie. De fait, les populations slaves des Balkans n'acceptent pas la mainmise des Austro-hongrois sur un territoire slave et souhaitent plutôt la création d'un État serbo-croate (la future Yougoslavie).
Des foyers extrémistes se sont développés pour chasser les intrus des territoires slaves. L'une des organisations des plus actives est la « Main noire » dirigée par le chef des services secrets serbes, le colonel Dragitin Dimitrijevic. Il fait placer sur le parcours de l'archiduc, sept conspirateurs chargés d'assassiner l'illustre visiteur qui est accompagné de son épouse morganatique, l'archiduchesse Sophie, née Chotek. L'attentat est apparemment préparé avec l'approbation de hautes personnalités politiques serbes qui se savent appuyées du tsar Nicolas II, de Russie, en cas de guerre avec l'Autriche-Hongrie.
morganatique, l'archiduchesse Sophie, née Chotek. L'attentat est apparemment préparé avec l'approbation de hautes personnalités politiques serbes qui se savent appuyées du tsar Nicolas II, de Russie, en cas de guerre avec l'Autriche-Hongrie.
Les sept conspirateurs n'ont aucune expérience des armes, et ce n'est que par une étonnante succession de coïncidences qu'ils parviendront à leur fin. À 10 h 15, le défilé de six voitures dépasse le premier membre du groupe, Mehmebasic qui ne parvient pas à obtenir un bon angle de tir ; il décide de ne pas tirer. Le deuxième membre, Vaso Cubrilovic, laisse passer le convoi sans tirer. Nedeljko Čabrinović, lance une bombe sur la voiture de François-Ferdinand, mais, dans sa précipitation, il n'avait pas attendu les huit secondes recommandés pour la lancer : l'archiduc a le temps de prendre la bombe dans sa main et de la rejetée ; l'explosion détruit la voiture suivante, blessant gravement ses passagers et plusieurs personnes dans la foule. Čabrinović avale alors sa pilule de cyanure et saute dans la rivière tout proche. Les voitures se hâtent alors vers l’hôtel de ville, et la foule panique. La police sort Čabrinović de la rivière. Celui-ci est violemment frappé par la foule avant d'être placé en garde à vue. La pilule de cyanure qu'il avait prise était vieille ou de trop faible dosage, de sorte qu'elle n'a pas eu l'effet prévu. Certains des autres conspirateurs s'enfuient en entendant l'explosion, présumant que l'archiduc a été tué.
L'archiduc décide d'aller à l'hôpital rendre visite aux victimes de la bombe avant d'aller déjeuner. Pendant ce temps, Gravilo Princip, dont le mobile de l'attentat est la « vengeance pour toutes les souffrances que l'Autriche-Hongrie endurer au peuple », se rend dans une boutique des environs pour s'acheter à manger. C'est alors qu'il aperçoit, peu avant 11 h, la voiture de François-Ferdinand qui passe près du pont Latin. Princip rattrape la voiture, puis tire deux fois : la première balle traverse la carrosserie de la voiture et atteint la duchesse Sophie à l'abdomen. La seconde balle atteint l'archiduc dans le cou. Tous deux sont conduits à la résidence du gouverneur où ils meurent peu après.
 La mort tragique de l'archiduc François-Ferdinand et celle de son épouse passent d'abord presque inaperçue en Europe. En Outaouais, le journal Le Temps écrit, en première page, le 29 juin :
La mort tragique de l'archiduc François-Ferdinand et celle de son épouse passent d'abord presque inaperçue en Europe. En Outaouais, le journal Le Temps écrit, en première page, le 29 juin :
HORRIBLE RÉGICIDE COMMIS
PAR UN ANARCHISTE EN AUTRICHE
Le journal Le Droit traite de l'affaire en sixième page sous un titre assez laconique : « Un double assassinat ». Quoi qu'il en soit, sitôt les funérailles célébrées, les journaux d'ici ne parlent plus de l'attentat.
Le prince est inhumé à Vienne en catimini... Il est vrai que François-Joseph ne l'appréciait guère. Les policiers autrichiens estiment qu'il y a un lien entre les assassins et la Serbie. Il apparaît dès lors raisonnable à l'ensemble des chancelleries européennes que l'Autriche-Hongrie punisse celle-ci. Personne n'imagine qu'un conflit local entre le prestigieux empire des Habsbourg et la Serbie archaïque puisse déraper. Et pourtant...
Le vieil empereur François-Joseph ne veut à aucun prix de complications. La dynastie des Habsbourg a tout à y perdre de même que les Hongrois de l'empire, qui doivent faire face aux revendications des autres minorités : Tchèques, Polonais, Serbes, Italiens, Roumains... Mais le ministre des Affaires étrangères ainsi que les généraux austro-hongrois sont impatients d'en finir avec l'agitation serbe. Le 4 juillet, sitôt acquises les preuves de l'implication serbe dans l'attentat de Sarajevo, le ministre des Affaires étrangères envoie un émissaire à Berlin pour obtenir l'appui du kaiser (empereur d'Allemagne), Guillaume II.
perdre de même que les Hongrois de l'empire, qui doivent faire face aux revendications des autres minorités : Tchèques, Polonais, Serbes, Italiens, Roumains... Mais le ministre des Affaires étrangères ainsi que les généraux austro-hongrois sont impatients d'en finir avec l'agitation serbe. Le 4 juillet, sitôt acquises les preuves de l'implication serbe dans l'attentat de Sarajevo, le ministre des Affaires étrangères envoie un émissaire à Berlin pour obtenir l'appui du kaiser (empereur d'Allemagne), Guillaume II.
Guillaume II reçoit l'émissaire du gouvernement austro-hongrois qui s'apprête à punir les Serbes pour leur implication dans le meurtre de l'archiduc à Sarajevo. Il souhaite obtenir au préalable l'aval de son allié allemand. Le kaiser fait dire à l'empereur François-Joseph 1er qu'il « se tiendra en toutes circonstances fidèlement aux côtés de l'Autriche-Hongrie. »
Les autorités austro-hongroises remettent, le 23 juillet 1914, une note au gouvernement serbe, note dans laquelle elles exigent, en dix points, que la Serbie s'engage publiquement à ne plus soutenir d'aucune façon les menées terroristes en Bosnie. Elles exigent aussi que soient recherchés et punis les responsables serbes qui ont trempé dans l'attentat de Sarajevo et souhaite que des fonctionnaires austro-hongrois participent à l'enquête en Serbie même. Le gouvernement serbe a 48 heures pour répondre à ces 10 points, quelque peu humiliants. Il est disposé à les accepter, sachant qu'il ne peut guère attendre de soutien en Europe. Mais le tsar de Russie, Nicolas II, s'immisce dans le différend : il attend de son allié serbe qu'il fasse front à Vienne. Les dés sont jetés. Guerre il y aura !
SOURCES
DUROSELLE, Jean-Baptiste, La Grande Guerre des Français 1914-1918, Paris, éd. Perrin, 2002.
Hérodote, http://www.herodote.net/
Le Droit (Ottawa), juin et juillet 1914.
Le Temps (Ottawa), juin et juillet 1914.
Chez les Églises chrétiennes, Pâques est la fête la plus importante du calendrier liturgique. Elle met le point final à la semaine sainte et constitue une sorte de nouveau départ, et surtout l’espoir de vaincre la mort dans l’éternité comme l'a fait Jésus il y a plus de 2000 ans. Il y cinquante ans, elle mettait un terme à 40 jours de jeûne et de sacrifices (pas de bonbons !). Depuis lors, la société marchande a remplacé la semaine sainte par la fête du chocolat.
Il y a cinquante ans, on déclinait les jours de la semaine sainte comme ceci : lundi saint, mardi saint, etc. Ce temps de pénitence commençait le mercredi des Cendres, 46 jours avant Pâques. Ce jour-là, les fidèles allaient à l’église se faire imposer les cendres sur le front pour se rappeler les propos que Dieu avait tenus à Adam : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré ; car tu es poussière et tu retourneras en poussière… » Les églises voyaient alors leurs statues recouvertes de voiles violets ou noirs, selon la paroisse, et ce, jusqu’à Pâques. Les vêtements liturgiques des prêtres étaient aussi violets pendant tout le carême.
La principale fête suivant le mercredi des Cendres est le « dimanche des Rameaux ». Cette fête rappelle l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les rameaux étaient constitués de feuilles de palmier, tressées ou non (les rameaux étaient aussi faits de branches de sapin à la campagne), et souvent vendus de porte en porte par des enfants de chœur. On les apportait à l’église le « dimanche des Rameaux » pour les y faire bénir. Placés en évidence sur un mur, les rameaux étaient censés protéger la maison contre la foudre et les accidents ; on s’en servait aussi comme goupillon.
À partir du jeudi saint, les cloches des églises se taisaient ; une vieille croyance  voulait qu’elles soient parties à Rome. À partir de ce jour jusqu’à Pâques, les fidèles passaient beaucoup de temps à l’église. Les familles faisaient le tour des « sept églises » ou entraient sept fois de suite dans la même église où était exposé le Saint-Sacrement dans un ostensoir (dit aussi soleil) pour gagner une indulgence plénière. L'indulgence plénière rattachée à l'exercice pouvait, soit servir à effacer toutes les peines temporelles (jours de purgatoire) dues pour les péchés commis à ce jour ou être employée à faire sortir instantanément une âme du purgatoire.
voulait qu’elles soient parties à Rome. À partir de ce jour jusqu’à Pâques, les fidèles passaient beaucoup de temps à l’église. Les familles faisaient le tour des « sept églises » ou entraient sept fois de suite dans la même église où était exposé le Saint-Sacrement dans un ostensoir (dit aussi soleil) pour gagner une indulgence plénière. L'indulgence plénière rattachée à l'exercice pouvait, soit servir à effacer toutes les peines temporelles (jours de purgatoire) dues pour les péchés commis à ce jour ou être employée à faire sortir instantanément une âme du purgatoire.
L’après-midi du Vendredi saint, dans plusieurs églises, on faisait la procession du Christ mort et on méditait sur les Sept douleurs de la Vierge Marie. Le soir, il y avait la cérémonie des Sept paroles du Christ en croix (à remarquer le chiffre 7 qui revient (sept sacrements, sept péchés capitaux, sept églises) :
- Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font,
- Tu seras avec moi au Paradis,
- Voici ton fils, voici ta mère,
- Père, père, pourquoi m’as-tu abandonné ?
- J’ai soif,
- Tout est consommé,
- Père, je remets ton esprit entre tes mains.
Le dimanche de Pâques
Le carême prenait fin le samedi à midi ; les cloches revenaient de Rome. Elles rapportaient, sous leur grosse jupe de fonte ou d'airain, les friandises aux enfants sages (ou sel pour saler le lard), toutes carillonnantes d'avoir été bénies à Rome en ce saint jour. Samedi soir, c’était la bénédiction de l’eau.
Le matin de Pâques, les fidèles se levaient dès l’aube pour aller chercher de l’eau de Pâques puisée dans un ruisseau où à la rivière. Cette eau avait, dit-on, des propriétés particulières : ne se corrompait pas, guérissait les maladies de la peau, les troubles de la vue et les indispositions bénignes. En boire sur place assurait une bonne santé pour l’année à venir
Puis c’était la messe de Pâques, préparée plusieurs jours à l’avance. L’église était dépouillée de ses ornements de deuil et les vêtements sacerdotaux sombres faisaient place à ceux colorés blanc et or. C’est aussi ce jour-là que les dames étrennaient un nouveau chapeau… et s’il faisait très beau, une nouvelle robe – c’était la discussion du jour !
 Il fallait alors communier au moins une fois l'an, au temps de Pâques (jusqu’à 15 jours après Pâques [Pâques de renard]. Le Catéchisme catholique de 1954 prescrivait : « Celui qui volontairement et sans raison grave, néglige de communier, au moins une fois, dans le temps de Pâques, commet un péché mortel. » Au XIXe siècle, celui qui négligeait de communier risquait même d’être excommunié, c'est-à-dire exclut de l'Église catholique et voué aux flammes de l'enfer à sa mort.
Il fallait alors communier au moins une fois l'an, au temps de Pâques (jusqu’à 15 jours après Pâques [Pâques de renard]. Le Catéchisme catholique de 1954 prescrivait : « Celui qui volontairement et sans raison grave, néglige de communier, au moins une fois, dans le temps de Pâques, commet un péché mortel. » Au XIXe siècle, celui qui négligeait de communier risquait même d’être excommunié, c'est-à-dire exclut de l'Église catholique et voué aux flammes de l'enfer à sa mort.
L'œuf de Pâques
Un grand courant religieux a soufflé dans les poulaillers à partir du IVe siècle et est venu encourager cette coutume d'offrir des œufs le premier dimanche après la pleine lune suivant l'équinoxe du printemps – une façon moins spirituelle de fêter la résurrection du Christ dans toute la chrétienté. Pourquoi direz-vous ? Tout simplement parce que l'Église interdisait la consommation des œufs durant les 40 jours de jeûne précédant l'avènement, mais les poules ne faisaient pas Carême et continuaient à pondre. On se retrouvait donc, au matin de Pâques, avec une grande quantité d’œufs. Il fallait donc partager la surproduction. Un panier d’œufs frais, c'est gentil, mais colorés, peints de figurines, de devises, etc. les œufs devenaient « cadeaux » dans le vrai sens d'une belle présentation conçue pour faire plaisir
Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, en France, qu'on a décidé de vider un œuf frais et de le remplir de chocolat. Puis sont venus les moules, les décorations et la tradition gourmande. Ici, quand sonnaient les cloches de Pâques, les enfants partaient dans le jardin pour une course à l’œuf... ou à la poule en chocolat qu'on dissimulait dans les haies, sous les buissons.
La tradition du lapin en chocolat a suivi un long processus d'évolution apportée par les anciens Teutons (Germains ou Allemands) qui croyaient fermement qu'à Pâques, c'était au tour des lapins de couver les œufs. L'association lapin – Pâques – chocolat découle de cette croyance populaire.
Petite histoires des élections
Qui dit démocratie, dit élections. Mais élections ne signifient pas nécessairement démocratie. Cela dit, des élections, au Québec, on connaît ça. On en a eu de toutes les couleurs depuis 1657, et pas toujours honnêtes.
Des élections ont été tenues pour la première fois au Canada en 1657 quand le Conseil colonial, à Québec, décrète que quatre de ses membres seront élus par la population en général « à la pluralité des voix exprimées lors d’un vote libre. » Cette façon de faire sera abolie par le secrétaire d'État aux Affaires coloniales, Jean-Baptiste Colbert, en 1674.
C’est en Nouvelle-Écosse qu’on a élu la première Assemblée législative au Canada., gouvernement responsable que devant le roi. A le droit de vote tout protestant âgé de 21 ans et propriétaire. Sont exclus les femmes, les juifs et les catholiques. En 1848, la Nouvelle-Écosse élit le premier gouvernement responsable au Canada.

Les Bas-Canada et Haut-Canada élisent leur première assemblée législative en 1792. Les femmes obtiennent le droit de vote au Bas-Canada (actuel Québec) alors qu’il leur est refusé au Haut-Canada. Il faut être sujet britannique, avoir 21 ans et être propriétaire d’un bien-fonds d’une certaine valeur ou payer un loyer annuel de 10 £ (cens). Ce qui signifie que les journaliers, ouvriers, instituteurs, etc. n’ont pas le droit de vote.
1840 : abolition des gouvernements des Bas-Canada et Haut-Canada remplacés par le Canada-Uni. Mais le système de représentation est floué : les Bas-Canada (Québec) et Haut-Canada ont le même nombre de députés même si le Bas-Canada compte 150 000 habitants de plus que le Haut-Canada ! De plus, les élections sont truquées pour minorer le vote francophone : le gouverneur établit des bureaux de vote dans les villages anglophones, le plus souvent à quelques jours des centres francophones.
Premier gouvernement responsable en 1848. En 1849, les femmes perdent le droit de vote, et ce, parce que le candidat défait dans la circonscription de Halton-Ouest, au Haut-Canada, s’est plaint qu’on ait validé le vote de sept femmes pour son adversaire, en dépit de la Common Law. Les listes électorales sont tellement mal tenues qu’aux élections de 1859, on comptera jusqu’à trois fois plus de votes que d’électeurs en règle dans plusieurs circonscriptions électorales. Mais comment vote-t-on ? Chaque circonscription électorale ne compte généralement qu’un bureau de scrutin. Les électeurs votent de vive voix. On sait donc qui a voté et pour qui. Ce qui permet à des élus de se… venger ! Les élections se tiennent à des dates différentes d’une circonscription à l’autre. Dans chaque bureau de scrutin, l’élection dure jusqu’à ce qu’une heure entière s’écoule sans qu’un électeur vienne voter. En 1867, elles durent six semaines, en 1872, trois mois !
Les femmes obtiendront le droit de vote au fédéral en 1918 (1917 en Ontario et 1940 au Québec), le cens (des moyens financiers dépassant un certain seuil) ne sera aboli partout au pays qu’en 1920, et le scrutin secret n'a été mis en vigueur qu'en 1885. Enfin, les derniers vestiges de discrimination religieuse seront supprimés en 1955.
Bagarres à Montegello et à Hull
 Les élections entraînent des comportements violents, car les esprits s’échauffent rapidement. Des forts à bras empêchent des électeurs de voter. Et pourquoi les esprits s’échauffent-ils autant ? Une des raisons est l’alcool que les partis politiques distribuent gratuitement aux électeurs pour acheter leur vote. Ainsi donc, plus d’un électeur et même d’un organisateur est saoul la journée du vote. Le 9 juillet 1871, au cours de la journée de vote à l’élection du gouvernement provincial, un certain George Henry McCauley se présente à l’hôtel de Joseph Tranchemontagne à Montebello. McCauley, qui est ivre, est un agent du candidat E. B. Eddy (conservateur) alors que l’hôtel montébellois est le Q.G du candidat Charles Leduc (Libéral) dans la Petite-Nation. La présence de McCauley est tenue pour un affront. Norbert Thomas expédie McCauley hors de l’hôtel à coups de poing et de pied. L’intrus sombre dans le coma et rend l’âme au cours de la nuit. Accusé de meurtre, Thomas sera défendu par l’illustre avocat Joseph-Adolphe Chapleau (1840-1898) au cours d’un procès tenu à Aylmer en janvier 1872. Il ne sera trouvé coupable que de voies de fait
Les élections entraînent des comportements violents, car les esprits s’échauffent rapidement. Des forts à bras empêchent des électeurs de voter. Et pourquoi les esprits s’échauffent-ils autant ? Une des raisons est l’alcool que les partis politiques distribuent gratuitement aux électeurs pour acheter leur vote. Ainsi donc, plus d’un électeur et même d’un organisateur est saoul la journée du vote. Le 9 juillet 1871, au cours de la journée de vote à l’élection du gouvernement provincial, un certain George Henry McCauley se présente à l’hôtel de Joseph Tranchemontagne à Montebello. McCauley, qui est ivre, est un agent du candidat E. B. Eddy (conservateur) alors que l’hôtel montébellois est le Q.G du candidat Charles Leduc (Libéral) dans la Petite-Nation. La présence de McCauley est tenue pour un affront. Norbert Thomas expédie McCauley hors de l’hôtel à coups de poing et de pied. L’intrus sombre dans le coma et rend l’âme au cours de la nuit. Accusé de meurtre, Thomas sera défendu par l’illustre avocat Joseph-Adolphe Chapleau (1840-1898) au cours d’un procès tenu à Aylmer en janvier 1872. Il ne sera trouvé coupable que de voies de fait
Il n’y a pas que les partisans qui échangent des coups. Les politiciens ne donnent pas leur place. Ainsi, en avril 1905, au cours d’un souper à l’hôtel Impérial, à Hull, une discussion tourne au vinaigre entre l’ancien député provincial du comté d’Ottawa, Charles Beautron Major et l’avocat René de Salaberry. Le premier accuse le second d’avoir appuyé Ferdinand-Ambroise Gendron aux dernières élections (Major avait été vaincu). De Salaberry réplique en injuriant Major qui, perdant tout sang-froid, lance un verre de lait à la figure de l’avocat. Mais il est lancé avec une telle vigueur que Salaberry perd connaissance ; il ne reprendra ses esprits que beaucoup plus tard dans la soirée.
En 1876, peu après les élections municipales hulloises et sans doute à cause d’elles, on se bat même dans la rue. Le 18 février, à 11 heures, cinq hommes – Charles Leduc, un échevin fraîchement élu, et de surcroît juge de paix, son frère Jean-Baptiste, Théophile Viau, Andrew Leamy et un certain d’Arpentigny (de Repentigny) – qui viennent de quitter les bureaux de la municipalité, se rendent chez l’échevin, marchand et juge de paix François-Xavier Élie Gauthier. Ce dernier, qui doit avoir des raisons de se méfier de la bande, s’arme d’un bâton que Leduc lui arrache des mains. Leamy s’empare alors d’un bout de bois puis en frappe Gauthier à la tête. Bien que ce dernier soit tombé par terre, on continue à l’abreuver de coups. Un vieillard, nommé Lemieux, vient s’interposer. Leduc, qui aime la bagarre, ordonne alors à Viau de battre l’intrus, ce qui est vite fait. Cette première ronde terminée, la bande se rend chez le marchand Bergevin à qui elle donne une raclée malgré les protestations d’un certain Narcisse Trudel.
Les archives faisant défaut, on ne connaît pas la suite de cette affaire. Soulignons toutefois que Charles Leduc sera maire de Hull à trois reprises, Théophile Viau obtiendra, en 1894, le droit exclusif d’assurer le service de tramway à Hull pendant 30 ans et qu’Andrew Leamy s’établira à Grand Forks, en Colombie-Britannique, où il sera nommé... juge !
Les entreprises participent, elles aussi, aux élections en intervenant auprès de leurs employés. Ainsi, le 10 mars 1896, une compagnie affiche sur les murs de sa manufacture à Montréal le texte suivant : Nous considérons qu’il est juste que nos employés soient notifiés que, dans le cas d’un changement de gouvernement [conservateur], nous ne pouvons vous garantir les mêmes gages qui vous sont payés en ce moment, pas plus que nous ne pouvons garantir aucune espèce d’ouvrage à tous les employés que nous employons en ce moment. En Outaouais, le magnat du bois, E. B. Eddy, a employé un procédé semblable pour se faire élire.
Sources
Histoire du vote au Canada, Élections Canada.
La Patrie (Montréal), 10 mars 1896.
Le Cultivateur, 1905.
Le Temps (Ottawa), 1905.
The Ottawa Times (Ottawa), 1872.
Ouimet, Raymond, Hull mémoire vive, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1999.
La Saint-Valentin se veut encore aujourd’hui la pratique d’un mythe qui est la source essentielle de toutes les relations humaines : l’amour. Et saint Valentin n’y est… pour rien !
On se perd en conjectures sur l’identité de saint Valentin tellement les saints de ce nom apparaissent nombreux. Mais ce saint, qui apparaissait au martyrologe aurait été un prêtre saisi et décolleté (rapetissé à la hauteur des épaules ou du col !) à la fin du IIIe siècle (270). Mais personne n’a réussi à faire le lien entre lui et la fête de l’amour qui semble être une invention poétique de la fin du XIVe siècle et qui aurait été élaboré en fêtes et jeux amoureux à la cour de France au début du XVe siècle.
 Les Français ne se sont pas les premiers à fêter l’amour. Des chercheurs disent que la coutume d’envoyer des mots d’amour le 14 février est associée avec les dies februatus ou les purifications du rite des Lupercales (en l’honneur de Lupercus, dieu loup, dieu de la fécondité). Ainsi, au cours de la course des Luperques, des officiants nus ou couverts d’un pagne couraient en tenant un fouet fait de lanières de peau de bouc et ils frappaient les femmes qui se présentaient à eux, celles-ci espérant par ce moyen devenir fertiles. Fécondité exige (c’est avant la fécondation in vitro), il y avait par la suite accouplement à la suite d’un choix de partenaires.
Les Français ne se sont pas les premiers à fêter l’amour. Des chercheurs disent que la coutume d’envoyer des mots d’amour le 14 février est associée avec les dies februatus ou les purifications du rite des Lupercales (en l’honneur de Lupercus, dieu loup, dieu de la fécondité). Ainsi, au cours de la course des Luperques, des officiants nus ou couverts d’un pagne couraient en tenant un fouet fait de lanières de peau de bouc et ils frappaient les femmes qui se présentaient à eux, celles-ci espérant par ce moyen devenir fertiles. Fécondité exige (c’est avant la fécondation in vitro), il y avait par la suite accouplement à la suite d’un choix de partenaires.
Quoi qu’il en soit, le plus ancien document traitant de la Saint-Valentin est La Charte de la Cour d’amour de l’année 1401 rédigée à Mantes. Cette charte a été présentée par le prince du tribunal de l’Amour à tous les nobles et autres personnes connues qui au présent et à l’avenir recevront cette lettre d’amour. C’est ainsi que le roi Charles VI, à la demande d’Isabelle de Bavière, a décidé qu’il y aurait une « feste de puy d’amour » solennelle et joyeuse le premier dimanche de tous les mois commençant en février. « Et le jour prochain de la Saint-Valentin, le 14e de février prochain, quand les petits oiseaux recommencent à chanter, il y aura une messe chantée à l’église Sainte-Catherine du Val des Écoliers à Paris pour le saint martyr et, le même jour, cette charte sera leu devant le public […] » Vous avez sans doute remarqué le lien fait entre l’amour, les petits oiseaux et le printemps… Quoi qu'il en soit, cette charte de l’amour n’a pas aidé la cause de saint Valentin puisque le 14 février 1969, il s’est vu évincer du calendrier liturgique par un décret papal.
L’amour, ça s’exprime de nombreuses façons. En 1906, Athanase Mainville, un charmant jeune homme de l'Île-aux-Allumettes, fréquente une belle et jolie jeune femme, l'une des plus belles filles de l'île, Herméline Vaillancourt. Cuisinier dans les chantiers de l'Outaouais, Athanase est un joyeux luron qui aime à chanter ses amours sur l’air d’un psaume) :
-Avec qui te marieras-tu,
Jean mon fils, royal David ?
Avec qui te marieras-tu,
Jean mon ami?
-Avec la plus bell' des fill's que j'pourrai trouver,
Pèr', pensez-y donc !
Pensez-vous qu'j'vas prendre un vieux laideron
Comme y en a qui font ?
Non, belle dam', non !
 Un jour qu'il marche avec Hermine – c'est ainsi qu'il la nommait – peu après qu'une forte pluie ait détrempé la terre, il la prend dans ses bras et la soulève pour traverser une mare d'eau qui leur barre le chemin. Galant homme, Athanase voulait éviter que son amie de cœur salisse ses souliers ou même sa robe. Mais ce jeune garçon est aussi un pince-sans-rire. Arrivé au milieu de la mare, il l'interroge : « M'aimes-tu Hermine ? » À cette question, la jeune fille répond par un éclat de rire. Sur un ton enjoué, Athanase la menace alors de la laisser choir si elle ne lui répond pas favorablement. Herméline qui rit de plus belle répond négativement juste pour voir la réaction de son prétendant. Celui-ci ne tarde pas à réagir. « Puisque c'est comme ça » lui dit-il…Et en même temps, de la laisser tomber dans la mare boueuse. Et plouf ! Savez-vous quoi ? Ce couple a vécu ensemble 59 ans !
Un jour qu'il marche avec Hermine – c'est ainsi qu'il la nommait – peu après qu'une forte pluie ait détrempé la terre, il la prend dans ses bras et la soulève pour traverser une mare d'eau qui leur barre le chemin. Galant homme, Athanase voulait éviter que son amie de cœur salisse ses souliers ou même sa robe. Mais ce jeune garçon est aussi un pince-sans-rire. Arrivé au milieu de la mare, il l'interroge : « M'aimes-tu Hermine ? » À cette question, la jeune fille répond par un éclat de rire. Sur un ton enjoué, Athanase la menace alors de la laisser choir si elle ne lui répond pas favorablement. Herméline qui rit de plus belle répond négativement juste pour voir la réaction de son prétendant. Celui-ci ne tarde pas à réagir. « Puisque c'est comme ça » lui dit-il…Et en même temps, de la laisser tomber dans la mare boueuse. Et plouf ! Savez-vous quoi ? Ce couple a vécu ensemble 59 ans !
Il y a des couples qui s'aiment tellement qu'ils restent inséparables pendant toute leur vie. Vivre l'un sans l'autre est une chose insupportable pour ces amants inconditionnels, car chez eux le couple ne forme plus qu'une seule personne ; le je s'efface devant le nous. Cette fusion de deux personnes est tellement authentique que lorsque l'un meurt, il n'est pas rare que l'autre le suive de près dans la mort.
L'épicier W.H. Lyons était, au tournant du siècle, un homme bien connu à Hull où il s'y était établi en 1865. La soixantaine bien sonnée, il avait commencé à ralentir ses activités professionnelles, car il était tombé en bas d'une échelle d'une maison en construction lors d'une tournée d'inspection comme évaluateur de la Ville. Le 26 avril 1900, il a perdu presque tout dans la conflagration qui a détruit la majeure partie de la ville. Mais en moins de huit mois, il a courageusement reconstruit ses propriétés et forcé le retour de la prospérité. Comblé par la vie, Lyons qui avait six enfants était depuis longtemps marié à une femme qui l’adore.
Dans la nuit du 5 décembre 1900, l'épicier mourait dans sa maison de la rue Chaudière. Terriblement accablée par cette mort subite, la veuve a subitement été atteinte de paralysie. Trois jours après l'inhumation de son mari, elle a succombé à son tour au cours de la nuit.
Les époux Robidoux aussi ont été de véritables inséparables. Nés à six mois d'intervalle, Louis Robidoux et Marcelline Dagenais se sont établis à la Pointe-Gatineau vers 1860. À une heure du matin, le dimanche 18 avril 1926, Marcelline mourait à l'âge de 85 ans et 6 mois. Le même soir, vers les 22 heures 30, son mari expirait à son tour.
SOURCES
Documentation personnelle.
Guitard, Michelle, La Saint-Valentin, origines, histoire, collection, Gatineau, Musée canadien de la poste, 2003.
Ouimet, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1994.
Vous souvenez-vous du fameux roman et de la sériée télévisée historiques de Maurice Druon intitulés : Les Rois maudits ? Le roman a été construit autour d’une malédiction : « Pape Clément !... chevalier Guillaume !... Roi Philippe... Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment !... Maudits ! Maudits ! vous serez tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races !... »
Ces paroles (rapportées par le chroniqueur Geoffroy de Paris) ont été prononcées le 18 mars 1314, par le dernier Grand maître des Templiers, Jacques de Molay, supplicié sur le bûcher de l'îlot des juifs, à Paris. Quelques jours après son exécution, les toits du Palais Royal sont recouverts d'une véritable nuée de corbeaux comme un présage de malheur, un signe de deuil... Les nuits de Philippe le Bel en auraient apparemment été troublées jusqu'à sa mort !
Le 20 avril 1314, le pape Clément V succombait des suites d'une affection intestinale. Le 29 novembre suivant, c’est Philippe IV le Bel qui meurt à son tour quand il est jeté bas de son cheval au cours d’une chasse au sanglier[1]. Le mauvais sort s’acharne sur la famille régnante et les trois fils de Philippe le Bel – Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel – ne régneront en tout que pendant 14 ans et mourront sans descendance mâle, mettant ainsi fin au règne des Capétiens directs.
Il y a de nombreux exemples de malédiction familiale dont celle des Kennedy est sans doute la plus connue. La plus étonnante est probablement celle des Habsbourg qui commence avec François-Joseph 1er, empereur d'Autriche-Hongrie de 1848 à 1916. Nobles depuis 900 ans, les Habsbourg, occupaient le trône autrichien depuis 4 siècles. Mais François-Joseph conduira sa dynastie et l'empire austro-hongrois à leur perte définitive.
L’histoire du règne de François-Joseph a mal commencé avec des soulèvements dans le pays. Puis il épousera la très belle duchesse Élisabeth de Wittelsbach, surnommée affectueusement Sissi – cette histoire d’amour a été popularisée au cinéma par la très belle actrice austro-française Romy Schneider. Ce couple avait tout pour être heureux : l’amour, la beauté et l’argent. Malheureusement, elle est marquée par la malchance. Le couple impérial a un fils, Rodolphe, qui se marie à son tour. Mais Rodolphe n’a pas de garçon. Le 30 janvier 1889, on découvre son cadavre et celui d’une jeune baronne, Marie Vetsera, dans un pavillon de chasse de Mayerling. On a prétendu que le couple s’était suicidé. Aujourd’hui, plusieurs prétendent qu’il a été assassiné.
Comme François-Joseph n'a plus de descendance mâle, seules ses frères peuvent lui succéder. Malheureusement, Maximillien qui a tenté de se tailler un empire au Mexique y est fusillé en 1869 et son épouse, Charlotte, sombre peu après dans la folie. Son autre frère, Charles-Louis, deux fois veuf, a deux garçons. D'une grande piété, il insiste, au cours d'un voyage en Terre Sainte, pour boire de l'eau du Jourdain. Il attrape alors une infection intestnale et en meurt en peu de jours. La tragédie de la famille impériale n'est toutefois pas finie.
Sissi, contrairement à la légende fabriquée par le cinéma, était une femme à l'équilibre psychique précaire : elle souffrait de mélancolie, d'anorexie et de narcissisme pathologique. Pas étannant que sa bele-mère la surveillait de près. Le 10 septembre 1898, à Genève, Sissi est assassinée par l'arnarchiste italien Luccheni. L'année précédente, sa soeur avait péri dans l'incendie du Bazar de la Charité à Paris. Ajoutons qu'un cousin des deux soeurs, Louis II de Wittelsbach, roi de Bavière, était mort fou en 1886.
 C’est donc l’archiduc François-Ferdinand, neveu de l’empereur, qui devient alors l’héritier présomptif au trône de l’empire austro-hongrois. Mais en 1914, un étudiant serbe l’assassine, avec son épouse, à Sarajevo. Un mois plus tard, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. S’ensuit alors l’horrible carnage de la Grande Guerre. En 1916, l’empereur meurt. Son neveu, Charles, lui succède pendant une brève période de temps, jusqu’au moment où l’empire austro-hongrois s’effondre en 1918.
C’est donc l’archiduc François-Ferdinand, neveu de l’empereur, qui devient alors l’héritier présomptif au trône de l’empire austro-hongrois. Mais en 1914, un étudiant serbe l’assassine, avec son épouse, à Sarajevo. Un mois plus tard, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. S’ensuit alors l’horrible carnage de la Grande Guerre. En 1916, l’empereur meurt. Son neveu, Charles, lui succède pendant une brève période de temps, jusqu’au moment où l’empire austro-hongrois s’effondre en 1918.
La malédiction des Habsbourg est elle contagieuse ? Quoi qu’il en soit elle s’est propagée au-delà de la famille impériale. J'ai écrit plus haut que le rôle de Sissi a été tenu, au cinéma, par l’excellente Romy Schneider. Or, David, le fils de l’actrice, est mort accidentellement en 1981, à l’âge de 14 ans, empalé sur les piquets d’une clôture. Moins d’un an plus tard, le 29 mai 1982, l’actrice meurt à son tour ; elle n’avait que 43 ans.
Sources:
DRUON, Maurice, Les rois maudits, Le livre de poche, Paris, 1970.
Généalogie des Habsbourg et des Wittelsbach.
VENNER, Dominique, Le Siècle de 1914 - Utopies, guerres et révolutions en Europe au XXe siècle, Paris, Pygmalion, 2006.
Wikipédia.
[1] Contrairement à l’affirmation de Maurice Druon, le chevalier Guillaume de Nogaret n'est pas mort après l’exécution du Grand maître en 1314, qu'il avait fait arrêter en 1307, mais avant, en 1313.
Petite histoire du « Minuit, Chrétiens ! »
J’ai grandi dans une paroisse et une ville qui n’existent plus aujourd’hui : Notre-Dame-de-Grâce, à Hull. Dans les années 1950 et 1960, la messe de minuit était l’événement religieux de l’année. Il y avait là deux « messes de minuit » : celle chantée dans la grande église – il fallait acheter sa place quelques semaines avant la fête –, et celle chantée au sous-sol. En haut, un chœur formé uniquement d’hommes et en bas, un chœur d’enfants, tous des garçons du collège Notre-Dame des Frères des écoles chrétiennes.
Minuit moins cinq : les grandes orgues Casavant font entendre les premières notes. Puis le chœur entonne le Venez divin Messie. Mais tous attendent « l’heure solennelle », celle qui, au moment de l’entrée des célébrants (grand-messe diacre-sous-diacre) et des 70 ou 80 enfants de chœur, donne le coup d’envoi au chant religieux tant aimé : Minuit, Chrétiens ! Les fidèles sont pris d’un frisson qui secoue tant le corps que l’âme. Tous, sans exception, écoutent le chant comme des mélomanes. Et de fait, je pense qu’à ce moment, chacun était un mélomane.
Aucun chant religieux, je crois, n’a provoqué autant de débats dans l’histoire de l’Église catholique québécoise et autant de commentaires chez le commun des fidèles. Les paroissiens en parlent avant et après l’office religieux : avant, ils se demandent qui le chantera, s’il le chantera aussi bien ou aussi mal que l’année précédente ; après ils commentent la performance du soliste,  de l’organiste, du chœur de chant. Car, voyez-vous, le Minuit, Chrétiens ! est un moment magique dans toutes les églises de la francophonie. Et au Canada, il a été chanté pour la première fois le 25 décembre 1858, par la fille aînée du juge René-Édouard Caron (plus tard lieutenant-gouverneur) dans l’église de Sillery après que l’organiste Ernest Gagnon l’eut entendu à Paris l’année précédente. Le même jour (à la messe du jour), le chant sera repris par Madeleine Belleau dans l’église Saint-Jean-Baptiste à Québec.
de l’organiste, du chœur de chant. Car, voyez-vous, le Minuit, Chrétiens ! est un moment magique dans toutes les églises de la francophonie. Et au Canada, il a été chanté pour la première fois le 25 décembre 1858, par la fille aînée du juge René-Édouard Caron (plus tard lieutenant-gouverneur) dans l’église de Sillery après que l’organiste Ernest Gagnon l’eut entendu à Paris l’année précédente. Le même jour (à la messe du jour), le chant sera repris par Madeleine Belleau dans l’église Saint-Jean-Baptiste à Québec.
Ce chant religieux, si aimé du peuple, est banni de nombreuses églises du Québec dans les années 1930 et 1940 à la suite d’une campagne menée par le cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, archevêque de Québec, qui emboîtait le pas à des autorités ecclésiastiques françaises. On a dit que le Minuit, Chrétiens ! était un chant absolument infâme. À son mieux une « chanson païenne ». Les plus raffinés parmi les musiciens d’église (étaient-ils libres ?) jugeaient la pièce « théâtrale », de « mauvais goût », vulgaire même. Ainsi donc, on a arrêté de chanter le Minuit, Chrétiens ! à Notre-Dame-de-Grâce pendant des années, alors qu’à la campagne on faisait fi des sermons du cardinal Villeneuve.
Pourquoi ?
Pourquoi le Minuit, Chrétiens ! a-t-il soudainement été ostracisé par les autorités ecclésiastiques ? Pour en deviner les raisons, il faut remonter à l’origine du chant.
Le 3 décembre 1847, dans la diligence de Paris, entre Mâcon et Dijon, Placide Cappeau (1807-1877), négociant en vins et poète à ses heures, écrit les paroles d’un Noël, pour lesquelles il est fort loin de se douter un seul instant de l’immense succès qu’il obtiendra par la suite. C’est le curé de Roquemaure (Provence), l’abbé Eugène Nicolas, qui l’avait prié de composer ce chant dans le cadre des manifestations culturelles et religieuses qu’il voulait organiser afin de recueillir quelques oboles pour le financement des vitraux de la collégiale Saint-Jean-Baptiste. Placide Cappeau, alors âgé de 39 ans, ancien élève des jésuites au collège royal d’Avignon, après des études de droit à Paris était revenu s’installer dans son village natal afin de s’associer avec le maire, Guillaume Clerc, dans un commerce de vins.
La chanteuse Émily Laurey adresse les strophes de Minuit, Chrétiens ! au compositeur Adolphe Adam (1803-1856), qui est considéré comme l’un des créateurs de l’opéra-comique français. Adam en fait la musique en quelques jours et, le 24 décembre 1847, à la messe de minuit célébrée dans la petite église de Roquemaure, Emily Laurey chante pour la première fois le Noël d’Adam – le titre sous lequel le chant a d’abord été connu. (À noter que c’est une femme qui, la première, a chanté cet hymne religieux !)
Immédiatement célèbre, notamment grâce au baryton Jean-Baptiste Faure, ce chant de Noël échappe à l’auteur des paroles, qui ne parvient même pas, comme il le désira 20 ans plus tard, à changer le texte. Placide Cappeau, n’était en effet pas du tout un homme d’Église, un fervent catholique, mais au contraire un libre penseur, un voltairien. Au culte d’un Dieu, il préférait celui de l’Humanité. Il dira : « Nous avons cru devoir modifier ce qui nous avait échappé au premier moment sur le péché originel, auquel nous ne croyons pas... Nous admettons Jésus comme rédempteur, mais rédempteur des inégalités, des injustices et de l’esclavage et des oppressions de toute sorte... »
Un juif !
Adolphe Adam appelait le Minuit, Chrétiens ! la Marseillaise religieuse. Non seulement ce chant conquiert-il rapidement les églises de France, mais il est chanté dans les rues, dans les salons, et même dans les cafés-concerts !… 
Le Minuit, Chrétiens ! a été enregistré par nombre d’artistes dont Enrico Caruso, Tino Rossi, Georges Thill, Luciano Pavarotti, Raoul Jobin, Richard Verreau, Nana Mouskouri et… René Simard.
Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle,
Et de son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance,
A cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple, à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur...
Sources:
Bronze, Jean-Yves, Le Minuit, Chrétiens ! au Québec.
Gingras, Claude, Minuit, Chrétiens ! ou l’histoire d’un long ostracisme.
Souvenirs personnels.
Noël, autrefois une fête religieuse, est devenu une célébration presque exclusivement commerciale pour ne pas dire une véritable bacchanale de la consommation. Le grand promoteur de cette fête est le père Noël, dieu du commerce.
Le Père Noël aurait apparemment vu le jour en Allemagne. Un Allemand qui aurait transité par les Pays-Bas, aurait exporté Sinter Klaas aux États-Unis, dès le XVIIe siècle, où il est devenu Santa Claus.
 Sinter Klaas c’est évidemment saint Nicolas, personnage apparemment né à Patara en Asie Mineure entre 250 et 270 après J-C. Il serait mort le 6 décembre, en 345 ou en 352 dans la ville portuaire de Myre en Asie Mineure. C'est l'un des saints les plus populaires en Grèce et dans l'Eglise latine. Évêque de Myre au IVe siècle, sa vie et ses actes sont entourés de légendes.
Sinter Klaas c’est évidemment saint Nicolas, personnage apparemment né à Patara en Asie Mineure entre 250 et 270 après J-C. Il serait mort le 6 décembre, en 345 ou en 352 dans la ville portuaire de Myre en Asie Mineure. C'est l'un des saints les plus populaires en Grèce et dans l'Eglise latine. Évêque de Myre au IVe siècle, sa vie et ses actes sont entourés de légendes.
La légende de saint Nicolas veut que le saint ait ressuscité trois petits enfants qui étaient venus demander l'hospitalité à un boucher. Celui-ci les accueillit et profita de leur sommeil pour les découper en morceaux et les mettre au saloir. Sept ans plus tard, saint Nicolas passant par là demande au boucher de lui servir ce petit salé vieux de sept ans. Terrorisé, le boucher prit la fuite et saint Nicolas fit revenir les enfants à la vie. Cette légende est à l'origine d'une célèbre chansonnette : Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner aux champs...
Depuis le XIIe siècle, on raconte (en France) que saint Nicolas, déguisé, va de maison en maison dans la nuit du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants s'ils ont été obéissants. Les enfants sages reçoivent des cadeaux, des friandises et les méchants reçoivent une trique donnée par le compagnon de saint Nicolas, le père Fouettard (tout vêtu de noir).
Un jour, la société chrétienne a trouvé plus approprié que cette « fête des enfants » soit davantage rapprochée de celle de l'enfant Jésus. Ainsi, dans les familles chrétiennes, saint Nicolas a-t-il désormais fait sa tournée la nuit du 24 décembre.
Le Père Noël en Amérique
En 1821, un pasteur étasunien, Clément Clarke Moore écrit un conte de Noël pour ses enfants dans lequel un personnage sympathique apparaît, le Père Noël, dans son traîneau tiré par huit rennes. Il l’a fait dodu, jovial et souriant. Il a remplacé la mitre de saint Nicolas par un bonnet, sa crosse par un sucre d'orge et l’a débarrassé du père Fouettard.
Trente-neuf ans plus tard, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste au journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly, revêt Santa Claus d'un costume rouge, garni de fourrure blanche et rehaussé d'un large ceinturon de cuir. Pendant près de 30 ans, Nast illustre au moyen de centaines de dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus.
En 1931, le père Noël prend une toute nouvelle allure dans une image publicitaire diffusée par la compagnie Coca-Cola. Grâce au talent artistique de Haddon Sundblom, le père Noël a désormais une stature humaine, plus accessible, un ventre rebondissant, une figure sympathique, un air jovial et une attitude débonnaire. (À suivre : Le Père Noël au Québec)
Sources :
Warren, Jean-Philippe, Hourra pour Santa Claus, Montréal, Boréal, 2006.
Site Internet Notre famille.com.
L'humour dans la poussière du passé
Pour plusieurs, visiter les églises et les cimetières, fouiller les vieux registres et les armoires à vieilleries n’apparaissent pas réjouissant. Et pourtant... tant dans l’église, au cimetière, dans la nécrologie que dans les vieux registres, l’humour trouve sa place.
Dans certaines églises, chaque station des chemins de croix porte le nom de la personne ou du groupe qui en a fait don. Ainsi, dans l'une d'entre elles, on a rapporté avoir lu : JÉSUS DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS – par les dames de sainte Anne !
La mort n'échappe pas plus à la boutade. Pourquoi dit-on feu untel alors qu'il s'est éteint ?
Et voici, tiré d'une rubrique nécrologique, un point de vue que nous partageons sûrement tous :
Joseph G., mort contre son goût à Ixelles dans sa 52e année.
Dans une rubrique nécrologique du journal Le Droit de 1996 : X « …a quitté ce monde le 13 mars. Qu’il soit décédé avec la promesse que le printemps était à l’horizon, quand il était tout près d’avoir ses 70 ans, est typique de la malchance qu’il a subie pendant tout son vivant. »
Dans un cimetière, on a lu sur une pierre tombale :
Ici repose Joseph A. qui fut un bon époux, un bon père, un bon commerçant. Les voisins sont là pour le dire.
Mais quels voisins ?
Une étonnante épitaphe inscrite sur la pierre tombale d’un certain McCaffery (15/10/1940 – 14/08/1995), située au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section C, lot no 01369) à Montréal :
Free your body and soul
Unfold your powerful wings
Climb up the highest mountains
Kick your feet up in the air
You may now live for ever
Or return to this earth
Unless you feel good where you are
Sous la poussière des vieux registres d’état civil où dans les procès-verbaux de procès oubliés, l'humour est omniprésent. Prenons les noms de famille. Ils révèlent la psychologie de nos ancêtres, railleurs, sans indulgence pour les défauts physiques et moraux, et amateurs de termes crus.
Tartuffe a eu beau dire :
Cacher ce sein que je ne saurais voir
Par de pareils objets les âmes sont blessées
Et cela fait venir de coupables pensées
Les hommes célèbrent depuis longtemps les doux charmes des femmes sous une enveloppe de mots qui cache souvent une délicieuse impudeur. Et n'en doutons pas un instant, les patronymes et les prénoms constituent un vaste répertoire de plaisanteries. La réalité est souvent composée de choses les plus invraisemblables, tellement qu'on a pu justement dire qu'elle dépasse souvent la fiction. En 1759, au cours des mois qui ont précédé l’amère défaite des Franco-Canadiens sur les plaines d'Abraham, le marquis de Montcalm, qui avait bien besoin d'un peu de réconfort et de soutien, fréquentait assidûment une jeune et fraîche personne qui habitait près de sa résidence. Cette gente dame, si attrayante aux yeux du marquis, avait un nom prédestiné : madame de Beaubassin ! Et quel patronyme que celui de mon ancêtre parisienne, Françoise Baiselat : elle a eu trois maris et douze enfants !
 De nombreux humoristes ont exploité le comique de la juxtaposition de certains patronymes. Encore une fois, la réalité est encore plus drôle que la fiction. Il y a eu à Gatineau un horloger nommé Cauchon dont l'épouse était née Lebœuf. Mais la palme de la trouvaille la plus singulière revient sûrement à Gabriel Ringlet qui a trouvé le faire-part suivant :...vous êtes priés d'assister aux funérailles de Monsieur Maurice Jésus, époux de Dame Suzanne Dieu.
De nombreux humoristes ont exploité le comique de la juxtaposition de certains patronymes. Encore une fois, la réalité est encore plus drôle que la fiction. Il y a eu à Gatineau un horloger nommé Cauchon dont l'épouse était née Lebœuf. Mais la palme de la trouvaille la plus singulière revient sûrement à Gabriel Ringlet qui a trouvé le faire-part suivant :...vous êtes priés d'assister aux funérailles de Monsieur Maurice Jésus, époux de Dame Suzanne Dieu.
Le généalogiste qui s’intéresse à l’insolite a de quoi se réjouir quotidiennement s’il prête attention aux noms et patronymes qu’il rencontre dans les médias. Par exemple, pendant la fameuse crise du verglas, une certaine madame Lalumière était relationniste à Hydro-Québec. Et « Ninon Ouimet » était une employée de Radio-Canada en 1995, alors qu’au même moment, la Société canadienne des ports comptait parmi son personnel un certain monsieur... Tytanick ! Et que dire des « piscines Desnoyers » à Laval ou du salon mortuaire « Sansregret » à Montréal ?
Remarquez bien que nous avons de qui tenir. L’analyse des fichiers de l’INSEE pour la période 1891 à 1990, a démontré que l’on trouve en France 377 personnes affublées du patronyme de Saloppe, 3 707 de celui de Bâtard et 117 Lagarce ! Ajoutons que 44 Assassin sont nés au pays de la douce France pendant le XXe siècle, et 449 Innocent…
Et que dire de la juxtaposition d’un patronyme et d’un nom. On a tous entendu parler de Claire Lavoie. Mais qui a entendu parler d’Ildéphonse… Laporte ou, encore, de Dieumegarde… Lemoyne ?
Ils sont nombreux les vieux documents qui renferment des perles d'humour. Dans une liste centenaire des donateurs pour la décoration d'une église de Hull, on a constaté que Pierre Cassé avait donné cinq dollars et Gilbert Généreux, dix cents. Et un capitaine Tison commandait les pompiers à Montréal en 1849 !
Et dire qu’il y en a encore qui pense que la généalogie et l’histoire sont des activités ennuyantes !
SOURCES :
Grenon, Hector, Histoire d’amour de l’histoire du Québec.
Lussier, Doris, Philosofolies, sl, Stanké, 1990.
Ringlet, Gabriel, Ces chers disparus, Paris, Albin Michel, 1992 ; Depuis quand ?
Le dictionnaire des inventions, Paris, éd. Berger-Levrault, 1982.
Le Devoir (Montréal) Montreal Mirror (Montréal).
Documentation personnelle.
Le prénom est un des plus importants éléments de l’identité d’une personne. Mais il ne sert pas qu’à nous identifier. Il contient les rêves, les espoirs de nos parents, et du monde dans lequel ils ont eux-mêmes grandi. Ainsi, un prénom peut-il être un lourd héritage.
Ce n’est pas pour rien que les ouvrages sur la signification des prénoms sont si populaires. Chacun y puise un peu de son histoire. Une famille baigne dans un milieu, une ville, une province. Souvenez-vous de cette phrase de Jésus : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Ce prénom est toujours l’un des plus portés dans la chrétienté. Certains noms incarnent le mal. C’est le cas d’Adolf (Adolph Hitler) et de Séraphin (Séraphin Poudrier d’Un homme et son péché), désormais bannis. D’autres sont source de difficultés. Tous les « juniors », qu’ils s’appellent Pierre, Jean, Jacques, sont confrontés, selon certains psychologues, au narcissisme de leur père. L’enfant deviendrait alors projection du parent.
 À l’exception des citoyens romains, on a longtemps eu chez les Occidentaux des noms uniques. Au fil du premier millénaire, avec la christianisation, l’habitude de prendre des noms de saints s’est imposée. Ainsi est née la notion de « nom de baptême » alors porté à titre unique. Ce « nom de baptême », lié très étroitement au sacrement religieux, s’est vu rapidement contrôlé et réglementé par l’Église. Il devait d’abord avoir été porté par un saint patron qui devait protéger ceux à qui on donnait son nom. Rapidement, il a été attribué au nouveau-né par ses parrain et marraine et non par ses parents et a en fait bientôt été généralement la reprise des leurs, du moins pour un garçon du prénom de son parrain.
À l’exception des citoyens romains, on a longtemps eu chez les Occidentaux des noms uniques. Au fil du premier millénaire, avec la christianisation, l’habitude de prendre des noms de saints s’est imposée. Ainsi est née la notion de « nom de baptême » alors porté à titre unique. Ce « nom de baptême », lié très étroitement au sacrement religieux, s’est vu rapidement contrôlé et réglementé par l’Église. Il devait d’abord avoir été porté par un saint patron qui devait protéger ceux à qui on donnait son nom. Rapidement, il a été attribué au nouveau-né par ses parrain et marraine et non par ses parents et a en fait bientôt été généralement la reprise des leurs, du moins pour un garçon du prénom de son parrain.
Les prénoms androgynes
Il en a résulté alors que tout prénom était dès lors considéré par principe comme androgyne, c’est-à-dire qu’il s’appliquait indifféremment aux filles comme aux garçons. Il y a d’abord eu Marie, prénom couramment donné à des hommes (on voit encore des Jean-Marie et des Gérard-Marie), mais aussi Joseph, parfois féminisé en Josephte et Josette. Chez les protestants, on a délaissé les noms de saints au profit des personnages de la Bible : David, Isaac, Judith, Rachel, Samuel… Et dès le début du XVIIIe siècle sont apparus les prénoms doubles, puis triples et multiples peut-être dans un souci de multiplier les saints protecteurs.
Les citoyens romains avaient trois noms : le prénom, le nom et le nom de branche, ainsi Caïus (prénom personnel) Julius (nom de famille) et Cæsar (surnom d’une branche). Mais au cours des trois premiers siècles du second millénaire, donc longtemps après la chute de l’Empire romain d’Occident, et à la suite d’une grande explosion démographique, les homonymies, devenues trop fréquentes, ont entraîné, dans toute l’Europe occidentale, l’apparition de noms complémentaires. D’abord individuels, ceux-ci deviennent peu à peu héréditaires, donnant ainsi nos patronymes ou « noms de famille ».
En Nouvelle-France, dès 1703, l’évêque du diocèse de Québec, Mgr de Saint-Vallier a donné le ton dans l’attribution des prénoms, en publiant le Rituel du diocèse de Québec qui comprenait une liste alphabétique des noms de saints et de saintes que l’on pouvait donner aux enfants, au baptême. On compte alors 1 251 prénoms masculins pour 373 féminins. Autant dire qu’il y avait plus de saints que de saintes – l’Église catholique n’est-elle pas un fief masculin ? N’empêche, nos ancêtres n’étaient pas toujours fidèles à cette liste : le prénom d’une fille sur cinq ne répondait pas aux souhaits de l’évêque de Québec.
Les prénoms insolites
En 1910, la Société de généalogie de Québec a fait appel à ses lecteurs pour établir la liste des douze prénoms les plus insolites relevés avant 1910. On a trouvé un Cénigraphe en 1873, une Énésumène en 1904, une Étichienne en 1878, un Auxibi en 1732 et une Permilon en 1915 (Nouveau-Brunswick). Mais la palme d’or revient à Ucal-Hysopompe Dandurand, 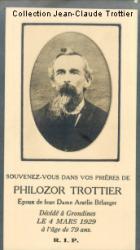 riche financier de Montréal (courtier en immeubles) à la fin du XIXe siècle ! On le surnommait U.-H. pour des raisons évidentes.
riche financier de Montréal (courtier en immeubles) à la fin du XIXe siècle ! On le surnommait U.-H. pour des raisons évidentes.
Aujourd’hui, quand le directeur de l’État civil du Québec juge que les prénoms proposés par les parents sont ridicules, il peut leur suggérer de modifier leur choix. En cas de refus, il peut s’adresser au procureur général qui peut demander à un tribunal de modifier le choix des parents, car : L’intérêt de l’enfant doit prévaloir sur le souci d’originalité des parents. On se souviendra de la fameuse affaire dans laquelle des parents avaient voulu nommer leur enfant Spatule. N’empêche, on trouve maintenant des Agassi, Caresse, Chenille, Fauve, Fiston, Narine, etc.
Ailleurs au Canada, il semble que les autorités soient encore plus libérales, pour ne pas dire laxistes, quant aux choix des prénoms des enfants par les parents. Ainsi, en Colombie-Britannique, des parents ont enregistré leurs quatre premiers enfants sous les prénoms Repent of Your Sins (Repens-toi de tes péchés), Repent or Burn Forever (Repens-toi ou brûle pour toujours), Messiah Is Coming (Le Messie s’en vient) et Mashiah Hosannah. Le prénom de leur cinquième bébé, God’s Loving Kindness (La bonté de Dieu), a été… refusé !
Sources :
L’Ancêtre, 2011.
BEAUCARNOT, Jean-Louis, « Le prénom : piège et atout » dans La revue française de généalogie, no 195, pages 47-49.
Documentation personnelle.
RICHER, Louis, « Les prénoms insolites » dans L’Ancêtre, no 294, pages 207et 208.
Documentation personnelle.
TROTTIER, Jean-Claude, carte mortuaire de Philozor Trottier.