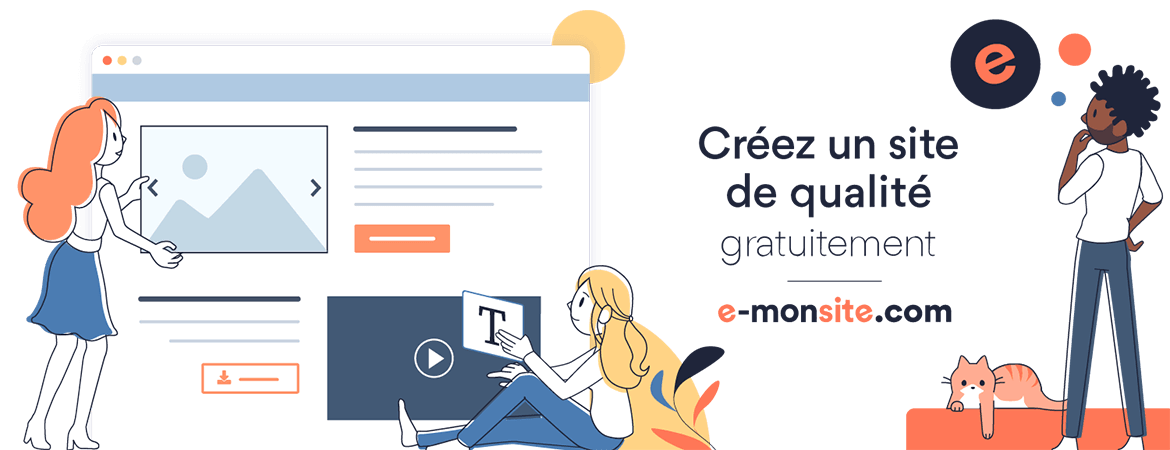- Accueil
- Blog
Blog
La Saint-Valentin se veut encore aujourd’hui la pratique d’un mythe qui est la source essentielle de toutes les relations humaines : l’amour. Et saint Valentin n’y est… pour rien !
On se perd en conjectures sur l’identité de saint Valentin tellement les saints de ce nom apparaissent nombreux. Mais ce saint, qui apparaissait au martyrologe aurait été un prêtre saisi et décolleté (rapetissé à la hauteur des épaules ou du col !) à la fin du IIIe siècle (270). Mais personne n’a réussi à faire le lien entre lui et la fête de l’amour qui semble être une invention poétique de la fin du XIVe siècle et qui aurait été élaboré en fêtes et jeux amoureux à la cour de France au début du XVe siècle.
 Les Français ne se sont pas les premiers à fêter l’amour. Des chercheurs disent que la coutume d’envoyer des mots d’amour le 14 février est associée avec les dies februatus ou les purifications du rite des Lupercales (en l’honneur de Lupercus, dieu loup, dieu de la fécondité). Ainsi, au cours de la course des Luperques, des officiants nus ou couverts d’un pagne couraient en tenant un fouet fait de lanières de peau de bouc et ils frappaient les femmes qui se présentaient à eux, celles-ci espérant par ce moyen devenir fertiles. Fécondité exige (c’est avant la fécondation in vitro), il y avait par la suite accouplement à la suite d’un choix de partenaires.
Les Français ne se sont pas les premiers à fêter l’amour. Des chercheurs disent que la coutume d’envoyer des mots d’amour le 14 février est associée avec les dies februatus ou les purifications du rite des Lupercales (en l’honneur de Lupercus, dieu loup, dieu de la fécondité). Ainsi, au cours de la course des Luperques, des officiants nus ou couverts d’un pagne couraient en tenant un fouet fait de lanières de peau de bouc et ils frappaient les femmes qui se présentaient à eux, celles-ci espérant par ce moyen devenir fertiles. Fécondité exige (c’est avant la fécondation in vitro), il y avait par la suite accouplement à la suite d’un choix de partenaires.
Quoi qu’il en soit, le plus ancien document traitant de la Saint-Valentin est La Charte de la Cour d’amour de l’année 1401 rédigée à Mantes. Cette charte a été présentée par le prince du tribunal de l’Amour à tous les nobles et autres personnes connues qui au présent et à l’avenir recevront cette lettre d’amour. C’est ainsi que le roi Charles VI, à la demande d’Isabelle de Bavière, a décidé qu’il y aurait une « feste de puy d’amour » solennelle et joyeuse le premier dimanche de tous les mois commençant en février. « Et le jour prochain de la Saint-Valentin, le 14e de février prochain, quand les petits oiseaux recommencent à chanter, il y aura une messe chantée à l’église Sainte-Catherine du Val des Écoliers à Paris pour le saint martyr et, le même jour, cette charte sera leu devant le public […] » Vous avez sans doute remarqué le lien fait entre l’amour, les petits oiseaux et le printemps… Quoi qu'il en soit, cette charte de l’amour n’a pas aidé la cause de saint Valentin puisque le 14 février 1969, il s’est vu évincer du calendrier liturgique par un décret papal.
L’amour, ça s’exprime de nombreuses façons. En 1906, Athanase Mainville, un charmant jeune homme de l'Île-aux-Allumettes, fréquente une belle et jolie jeune femme, l'une des plus belles filles de l'île, Herméline Vaillancourt. Cuisinier dans les chantiers de l'Outaouais, Athanase est un joyeux luron qui aime à chanter ses amours sur l’air d’un psaume) :
-Avec qui te marieras-tu,
Jean mon fils, royal David ?
Avec qui te marieras-tu,
Jean mon ami?
-Avec la plus bell' des fill's que j'pourrai trouver,
Pèr', pensez-y donc !
Pensez-vous qu'j'vas prendre un vieux laideron
Comme y en a qui font ?
Non, belle dam', non !
 Un jour qu'il marche avec Hermine – c'est ainsi qu'il la nommait – peu après qu'une forte pluie ait détrempé la terre, il la prend dans ses bras et la soulève pour traverser une mare d'eau qui leur barre le chemin. Galant homme, Athanase voulait éviter que son amie de cœur salisse ses souliers ou même sa robe. Mais ce jeune garçon est aussi un pince-sans-rire. Arrivé au milieu de la mare, il l'interroge : « M'aimes-tu Hermine ? » À cette question, la jeune fille répond par un éclat de rire. Sur un ton enjoué, Athanase la menace alors de la laisser choir si elle ne lui répond pas favorablement. Herméline qui rit de plus belle répond négativement juste pour voir la réaction de son prétendant. Celui-ci ne tarde pas à réagir. « Puisque c'est comme ça » lui dit-il…Et en même temps, de la laisser tomber dans la mare boueuse. Et plouf ! Savez-vous quoi ? Ce couple a vécu ensemble 59 ans !
Un jour qu'il marche avec Hermine – c'est ainsi qu'il la nommait – peu après qu'une forte pluie ait détrempé la terre, il la prend dans ses bras et la soulève pour traverser une mare d'eau qui leur barre le chemin. Galant homme, Athanase voulait éviter que son amie de cœur salisse ses souliers ou même sa robe. Mais ce jeune garçon est aussi un pince-sans-rire. Arrivé au milieu de la mare, il l'interroge : « M'aimes-tu Hermine ? » À cette question, la jeune fille répond par un éclat de rire. Sur un ton enjoué, Athanase la menace alors de la laisser choir si elle ne lui répond pas favorablement. Herméline qui rit de plus belle répond négativement juste pour voir la réaction de son prétendant. Celui-ci ne tarde pas à réagir. « Puisque c'est comme ça » lui dit-il…Et en même temps, de la laisser tomber dans la mare boueuse. Et plouf ! Savez-vous quoi ? Ce couple a vécu ensemble 59 ans !
Il y a des couples qui s'aiment tellement qu'ils restent inséparables pendant toute leur vie. Vivre l'un sans l'autre est une chose insupportable pour ces amants inconditionnels, car chez eux le couple ne forme plus qu'une seule personne ; le je s'efface devant le nous. Cette fusion de deux personnes est tellement authentique que lorsque l'un meurt, il n'est pas rare que l'autre le suive de près dans la mort.
L'épicier W.H. Lyons était, au tournant du siècle, un homme bien connu à Hull où il s'y était établi en 1865. La soixantaine bien sonnée, il avait commencé à ralentir ses activités professionnelles, car il était tombé en bas d'une échelle d'une maison en construction lors d'une tournée d'inspection comme évaluateur de la Ville. Le 26 avril 1900, il a perdu presque tout dans la conflagration qui a détruit la majeure partie de la ville. Mais en moins de huit mois, il a courageusement reconstruit ses propriétés et forcé le retour de la prospérité. Comblé par la vie, Lyons qui avait six enfants était depuis longtemps marié à une femme qui l’adore.
Dans la nuit du 5 décembre 1900, l'épicier mourait dans sa maison de la rue Chaudière. Terriblement accablée par cette mort subite, la veuve a subitement été atteinte de paralysie. Trois jours après l'inhumation de son mari, elle a succombé à son tour au cours de la nuit.
Les époux Robidoux aussi ont été de véritables inséparables. Nés à six mois d'intervalle, Louis Robidoux et Marcelline Dagenais se sont établis à la Pointe-Gatineau vers 1860. À une heure du matin, le dimanche 18 avril 1926, Marcelline mourait à l'âge de 85 ans et 6 mois. Le même soir, vers les 22 heures 30, son mari expirait à son tour.
SOURCES
Documentation personnelle.
Guitard, Michelle, La Saint-Valentin, origines, histoire, collection, Gatineau, Musée canadien de la poste, 2003.
Ouimet, Raymond, Histoires de cœur insolites, Hull, éd. Vents d’Ouest, 1994.
Records de mariages et d'enfantements
Au Québec, nous faisons peu d'enfants. Ça n’a pas toujours été le cas. Il y a moins de 50 ans, une famille standard comptait 4 enfants, et il y a 75 ans, elle en comptait 7. Au XIXe siècle, le gouvernement donnait une terre à la famille qui comptait 12 enfants vivants. Aujourd’hui, les familles comptent en moyenne moins de 2 enfants (1,4), et pourtant, jamais elles n’ont été aussi riches. Ce n’est donc pas une question d’argent.
Quelle est la femme qui a donné naissance au plus grand nombre d’enfants ? J’avoue que je ne le sais pas. Mais, dans ma famille, j’ai un cas assez intéressant. Il s’agit de Marie Délia Rancourt, la seconde épouse de mon arrière-grand-père, David Turgon, qui a eu 24 enfants dont 23 viables ! Elle avait 15 ans à la naissance de son premier enfant et 42 à celle de son dernier. Elle est morte en 1966 à l’âge de 81 ans à Astorville, dans le Moyen-nord ontarien.
Vingt-quatre enfants, c’est loin d’un record. Parce que, voyez-vous, une certaine madame Bernard Scheinberg (Autriche) aurait eu… 69 enfants ! Elle est morte à l’âge de 58 ans. Son mari s’est alors remarié et a eu 18 enfants de sa seconde épouse. Apparemment, une Russe aurait encore fait mieux. En effet, madame Fiodor Vassiliev aurait eu 69 enfants en 27 grossesses : 4 fois des quadruplés, 7 fois des triplés et 16 fois des jumeaux.
Évidemment, les hommes peuvent engendrer plus fréquemment que les femmes. Mais qui en a légitimement fait le plus au Québec ? Il semble que ce soit Pierre Lepage (1872-1948) de Montréal qui en aurait conçu officiellement pas moins de 42, dont 39 viables, avec 3 épouses différentes. En Outaouais, on dit que la palme revient à Jean-Baptiste Groulx, de la paroisse du Très-Saint-Rédempteur de Hull, qui aurait conçu 35 enfants au cours d’une vie ponctuée par 3 mariages. Il est mort en décembre 1910, à Hull, à l’âge de 68 ans.
N’ayez crainte, Jean-Baptiste Groulx n’est pas mort épuisé à la tâche. La preuve en est que d’autres en ont fait plus que lui. Parmi ceux-ci, le célèbre écrivain Alexandre Dumas, père, a prétendu avoir procréé pas moins de... 250 enfants ! Des historiens soutiennent cependant que le romancier avait tendance à exagérer ses exploits et qu’il n’en aurait fait qu’une petite... centaine à ses 34 maîtresses ! Ce qui peut nous sembler un record a été battu, et de loin, par le sultan Abou al-Hasan (XIVe siècle) qui, lui, aurait conçu 1 862 enfants. Difficile de faire plus, non ? Heureusement, le romancier Georges Simenon a créé plus qu’il n’a procréé, lui qui s’est vanté d’avoir couché avec... 10 000 femmes au cours de sa vie !
Records de mariages
C’est bien beau de faire des enfants, encore faut-il être deux. Qui a eu le plus grand nombre de conjoints « légaux », et dûment consignés au Canada-Français et sans avoir divorcé ? Il s’agirait de Pierre Vandal (1859-1948), né à Saint-Simon, comté de Bagot, du mariage de Narcisse Vandal avec Marie Arpin. Ce Québécois a convolé 8 fois en justes noces ! Ce qui est encore plus étonnant, dans ce cas là, c’est que Vandal a vécu 19 ans avec sa première épouse, Emma Boudreau, et qu’il est resté veuf... 21 ans après la mort de la deuxième ! Il est mort à l’âge de 89 ans, enterré par sa dernière épouse, Mina Pilotte.
 Chez les femmes, il semble bien que ce soit Anne Jousselot qui a eu le plus grand nombre d’époux : 5. Née vers 1759 du mariage de Pierre Jousselot avec Ozanne Drapeau, elle a pris époux une première fois en 1677 et une dernière fois en 1725. Elle est morte à l’âge de 83 ans, ce qui est plutôt bien pour l’époque ! Évidemment, nous sommes loin du roi Salomon qui aurait eu, dit-on, mille épouses ou concubines !
Chez les femmes, il semble bien que ce soit Anne Jousselot qui a eu le plus grand nombre d’époux : 5. Née vers 1759 du mariage de Pierre Jousselot avec Ozanne Drapeau, elle a pris époux une première fois en 1677 et une dernière fois en 1725. Elle est morte à l’âge de 83 ans, ce qui est plutôt bien pour l’époque ! Évidemment, nous sommes loin du roi Salomon qui aurait eu, dit-on, mille épouses ou concubines !
N’est-ce pas le Tout-Puissant qui dit un jour : « Il n’est pas bon que l’homme vive seul » ? Mariage et remariage entraînent parfois des situations complexes. Prenons, pour exemple, la famille de Toussaint Minville, dont les 3 épouses lui ont donné pas moins de 19 enfants. Ce personnage, qui a d’abord vécu dans les Deux-Montagnes, s’est installé dans les années 1860 dans l’Est ontarien, plus précisément à Saint-Eugène-de-Prescott. Il s’était marié une première fois en 1849, une deuxième fois en 1864 et une troisième fois en 1877. Alors qu’il a 50 ans, sa 3e épouse, Octavie Beaulne, en a elle 28. Mais le plus intéressant est qu’Octavie est la sœur des épouses de deux des fils de Toussaint ! Une de ses sœurs étant devenue veuve, elle épousera un troisième fils de Toussaint : Le père et trois fils mariés aux trois sœurs Beaulne.
Sources :
BMS 2000
Documentation personnelle.
Le Temps (Ottawa), 16 décembre 1910.
Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, vol 27, no 3, p. 173.
TANGUAY, Cyprien, À travers les registres, p. 122.
Une femme de tête et de coeur : Laurette Larocque dite Jean Despréz
Si les femmes d’aujourd’hui obtiennent leur lot de reconnaissances, elles peuvent remercier leurs devancières qui ont lutté sans relâche pour occuper dans la société une place équivalente aux hommes. Parmi ces devancières : Laurette Larocque dite Jean Despréz.
C’est dans l’ancienne ville de Hull que Laurette Larocque naît le 1er septembre 1906 du mariage d’Adrien Larocque et de Rose-Alma Berthiaume. Adrien Larocque est propriétaire d’une librairie-papeterie à une époque où le livre est rare au Canada français. Cet environnement a très tôt influencé Laurette Larcoque. Non seulement son père fait-il partie du Cercle dramatique de Hull, mais son grand-oncle, Alfred Berthiaume y a joué Michel Strogoff en… 1895 !
Dès l’âge de neuf ans, la petite Laurette organise des séances de théâtre pour ses camarades qui doivent remettre trois pinces à linge pour y assister. Pour s’assurer d’un nombre suffisant de spectateurs, elle confectionne des affiches que ses frères diffusent auprès des marchands.
Laurette fait ses études secondaires au couvent Notre-Dame-de-la-Merci à Aylmer où elle organise nombre de séances de théâtre, dont Les Femmes savantes de Molière. Devenue jeune femme, elle sait provoquer au moyen de ses vêtements. Pis, elle se maquille. René Provost, père de Guy, dit de Laurette : « l’un des plus beaux brins de fille de Hull avec en plus un petit extra qui lui est bien personnel. »
En 1922, Laurette travaille à la librairie de son père où elle dévore à longueur de journée livres et revues de toutes sortes. Puis un jour, elle tombe amoureuse d’un certain Oscar Auger qui a vu le jour à proximité de l’actuel théâtre de l’Île en 1901. Oscar, qui change son nom pour Jacques, est un jeune acteur à la voix grave dont Laurette boit littéralement les paroles, ce qui fait que la jeune femme opte résolument pour faire carrière, elle aussi, au théâtre.
Avec Jacques Auger, Laurette fait des tournées en Outaouais et même à Montréal jusqu’au jour où son amoureux obtient une bourse pour étudier à Paris en 1929. Un an plus tard, et sans crier gare, Laurette va rejoindre son amoureux à Paris. Auger se sent pris au piège. Elle fait tant et si bien, que deux mois après son arrivée en France, elle réussit à se faire épouser par le beau Jacques Auger (25 novembre 1930) qui souvent lui reprochera : « Tu m’as envahi à Paris. » Dans la Ville lumière, Laurette étudie à la Sorbonne et chez des professeurs d’art dramatique. Cependant, le couple connaît rapidement le désenchantement surtout que Jacques boit plus que de raison.
Une femme aux multiples talents
Le couple peine à survivre. Heureusement, Adrien Larocque leur envoie des mandats-poste  régulièrement. Le couple revient au pays en 1933 et Laurette obtient un poste à l’Université d’Ottawa où elle enseigne la diction, la phonétique et la mise en scène. En même temps, elle fonde l’école de spectacle de Montréal. De plus, elle écrit pièces de théâtre et des contes. En 1938, elle obtient son premier rôle de comédienne professionnelle dans le radioroman Vie de famille auprès de Nicole Germain, Mimi d’Estée et Guy Maufette. L’année suivante, elle devient critique de théâtre dans le magazine Radiomonde. Les années 1930 annoncent déjà une femme exceptionnelle.
régulièrement. Le couple revient au pays en 1933 et Laurette obtient un poste à l’Université d’Ottawa où elle enseigne la diction, la phonétique et la mise en scène. En même temps, elle fonde l’école de spectacle de Montréal. De plus, elle écrit pièces de théâtre et des contes. En 1938, elle obtient son premier rôle de comédienne professionnelle dans le radioroman Vie de famille auprès de Nicole Germain, Mimi d’Estée et Guy Maufette. L’année suivante, elle devient critique de théâtre dans le magazine Radiomonde. Les années 1930 annoncent déjà une femme exceptionnelle.
Laurette Larocque est une femme sensuelle. Nombreux sont ceux, et surtout celles, qui lui reprochent ses blouses sans manches, ses décolletés, ses jupes au-dessus des genoux et ses robes moulantes sans compter la cigarette. Elle s’en fout royalement : c’est une femme émancipée et n’entend pas courber l’échine devant l’Église. Deux jolis contes offrant quelques situations osées pour l’époque, entraîne une rupture avec l’Université d’Ottawa dirigée par les Oblats de Marie Immaculée. N’empêche, Laurette écrira une pièce, Le miracle du frère André, qui obtiendra un joli succès au pays.
En 1938, Laurette Larocque s’établit définitivement à Montréal. De mai 1939 à décembre 1943, elle ne publie pas moins de 24 nouvelles dans La Revue moderne tout en jouant au théâtre. De 1940 à 1943, elle écrit le radioroman à succès C’est la vie. Et à partir de 1938, Laurette Larocque commence à écrire sous divers pseudonymes, dont ceux de Carole Richard et Suzanne Clairval. Mais c’est un nom d’homme qu’elle finira par adopter une fois pour toutes – Jean Despréz – parce qu’elle s’est aperçue que trop souvent on lui retournait ses textes sous prétexte qu’une femme n’a pas à se sortir la tête de ses chaudrons !
L’ère de Jean Desprez commence. Elle loue, à trois dollars par mois, une machine à écrire qui crépite sept jours sur sept et produit toute une flopée de radioromans : M’amie d’amour, Jeunesse dorée, Chez Rose, La Marmaille, Docteur Claudine, Yvan l’intrépide. Tous les matins de la semaine, elle collabore à une série d’entrevues à Radio-Canada, avec Jean-Maurice Bailly, qui s’intitule Sur nos ondes.
Deux ans après la naissance de leur fille, le couple Auger-Larocque se sépare. À cette époque, Jean Despréz jouit déjà d’une immense popularité : à la fin des années 1940, elle bénéficie de revenus annuels de l’ordre de 50 000 dollars. En 1944, elle avait collaboré à la réalisation du film Le Père Chopin en écrivant les dialogues. Femme généreuse, Hubert Loiselle dira d’elle : « Quand un comédien était sans le sou, elle lui créait un personnage dans ses feuilletons. »
Une femme malheureuse
 Cette femme-orchestre ne prend guère soin de sa santé ; elle se surmène. Elle souffre de névralgie et de troubles gastriques, s’endort avec des somnifères. (Elle devient quasiment sourde au début des années 1960 et doit porter un appareil auditif dans chaque oreille.) Sa silhouette s’est alourdie et sa vue baisse. Pour mieux cacher son embonpoint, elle donne dans l’élégance tapageuse. Pourtant, cette femme n’a que 45 ans !
Cette femme-orchestre ne prend guère soin de sa santé ; elle se surmène. Elle souffre de névralgie et de troubles gastriques, s’endort avec des somnifères. (Elle devient quasiment sourde au début des années 1960 et doit porter un appareil auditif dans chaque oreille.) Sa silhouette s’est alourdie et sa vue baisse. Pour mieux cacher son embonpoint, elle donne dans l’élégance tapageuse. Pourtant, cette femme n’a que 45 ans !
Elle fait son entrée à la télévision en 1955 quand elle écrit une série de dramatisations historiques Je me souviens et vend, plus tard, l’idée d’un jeu culturel à la télévision d’État : Faites vos jeu. Mais son plus grand succès télévisuel a été le téléroman Joie de vivre qui a tenu l’affiche de 1959 à 1963, soit pendant 4 saisons.
Jean Despréz femme-orchestre ? En voici la preuve. Elle dirige des courriers du cœur tant à la radio (CKLM) que dans les journaux (Photo-Journal et Télé-Radiomonde) et à la télévision (Radio-Canada). Pour accomplir cette tâche, elle s’entoure de spécialistes au besoin. Ainsi, pour nombre de femmes en plein désarroi, Jean Despréz devient synonyme d’espoir
Et pourtant, Jean Despréz n’est pas heureuse. Elle a dit : « J’ai toujours été très mal aimée et très peu longtemps. J’ai raté mes amours complètement. Raté complètement. » Elle accepte mal de vieillir : elle subit 4 lissages en 10 jours. Elle meurt à Montréal dans la nuit du 26 au 27 janvier 1965. Elle a été inhumée au cimetière Notre-Dame, à Gatineau, dans la concession 329B. Le matin de sa mort, Mario Verdon dit, à la radio de CKLM : Elle est morte comme elle a vécu : dans un grand élan de générosité. »
Sources :
Archives du cimetière Notre-Dame de Hull.
BMS 2000.
La Rose, André et Simard, François-Xavier, Jean Despréz (1906-1965), Ottawa, éd. du Vermillon, 2001.
À part les nombreux articles consacrés à la famille de Philemon Wright, on sait peu de choses des premiers habitants de Gatineau. Et pourtant, les Wright n’ont pu faire leurs affaires sans un certain nombre d’employés dont plusieurs étaient des francophones ; parmi eux la famille Charron-Miville.
Au nombre des premiers francophones à élire domicile sur le territoire de Gatineau, il y en a eu quelques-uns qui ont voulu participer à la fondation d’un village sur l’emplacement actuel de l’île de Hull, et ce, aussi tôt que 1827. Sans succès. Parmi ces pionniers, une famille a particulièrement retenu mon attention : celle des Charron-Miville. En 1819, un certain Joseph Miville s’établit dans la Petite-Nation avec sa petite famille. Joseph a vu le jour à Louiseville en 1781. Son père, Benjamin, changeait souvent de lieu de résidence : en 1779, il est à Kamouraska, en 1781, à Louiseville ; en 1784, à Saint-Charles-sur-Richelieu ; en 1787, à l’Assomption et, en 1792, à Québec. Il n’est donc pas étonnant que deux de ses fils aient eu, eux aussi, la bougeotte.
Le 25 janvier 1803, Joseph Miville épouse Catherine Rouleau à Québec. Quinze ans plus tard, le voici qu’il dirige un hôtel de pension au 3, des Jardins, dans la haute ville de Québec. Le recensement de 1818 le qualifie alors de « cantinier ». Pour une raison inconnue, Joseph quitte Québec et s’établit dans la seigneurie de la Petite-Nation l’année suivante. Là, il dresse la liste des habitants de Montebello dans le cadre du recensement national de 1825. Trois ans plus tôt, c’est-à-dire le 22 mars 1822 à Oka, sa fille, Sophie Barbe, avait pris époux en la personne de François Charron, né en 1800 à Saint-Benoît des Deux-Montagnes (Mirabel). Le couple Charron-Miville élit lui aussi domicile à Montebello où il s’adonne à l’agriculture. C’est là que Sophie Barbe donne naissance à cinq enfants entre 1822 et 1837.
La plus vieille maison de Hull
La vie est difficile dans la seigneurie de la Petite-Nation où la pauvreté règne en maître à cause de la piètre qualité agricole des terres, ce qui pousse les Charron et les Miville à quitter cet endroit pour aller vivre sous des cieux qui, vus de Montebello, apparaissent plus cléments : les Chaudières. En effet, depuis l’automne 1826, on a entrepris le percement du canal Rideau sur la rive sud de la rivière des Outaouais, ce qui a pour effet d’attirer de nombreux travailleurs sur le territoire des actuelles villes de Gatineau et d’Ottawa. En avril 1827, le couple Charron-Miville  s’établit dans le canton de Hull où il obtient de Philemon Wright, le 23 du même mois, un terrain « à constitut » dans ce qu’on appellera plus tard le « village d’en bas ». Sur son emplacement, François Charron construit une belle maison de pierre qui est sans aucun doute la plus vieille maison du secteur Hull encore debout aujourd’hui[1]. Au même moment, Louis Rémi Miville, frère de Joseph, loue lui aussi un terrain de Wright.
s’établit dans le canton de Hull où il obtient de Philemon Wright, le 23 du même mois, un terrain « à constitut » dans ce qu’on appellera plus tard le « village d’en bas ». Sur son emplacement, François Charron construit une belle maison de pierre qui est sans aucun doute la plus vieille maison du secteur Hull encore debout aujourd’hui[1]. Au même moment, Louis Rémi Miville, frère de Joseph, loue lui aussi un terrain de Wright.
En octobre 1827, Joseph Miville demande à Wright d’utiliser une petit bâtiment en bois à l’embarcadère situé juste en face du canal Rideau, sur le territoire actuel du secteur Hull de la ville de Gatineau. L’année suivante, on le voit avec son frère, Louis Rémi, tenir taverne à Bytown (Ottawa), sans doute à un emplacement situé près de l’angle des rues George et Sussex. Mais, ni Joseph ni Louis Rémi ne semblent avoir laissé une descendance patronymique parmi nous. Notons que Georgette Lamoureux a écrit qu’il y avait à Ottawa, à l’intersection des actuelles rue Dalhousie et Rideau, un lieu que l’on désignait le « village de Mainville en 1826 ».
Échec de la fondation de Hull
On sait que Wright exigeait un loyer passablement élevé de François Charron pour le terrain du « village d’en bas ». l’historien Michael Newton a écrit : « Outre les 50 livres du prix d’achat, chaque propriétaire était tenu de verser un loyer annuel de six livres payable en versements trimestriels. La Philemon Wright and Sons se réservait le droit de saisir la propriété et de la vendre si l’acheteur ne respectait pas les stipulations ci-dessus. » Les exigences financières et l'état des finances de Wright expliquent sans aucun doute son manque d’intérêt momentané pour l’établissement d’un village et poussent alors les premiers résidents de Hull, dont Jean-Baptiste Couturier et Louis Rémi Miville, à s’établir à Bytown avant la fin de l’année 1827.
Furieux contre son oncle, Philemon Wright, à la suite d’une différend commercial, Charles Symmes quitte la colonie de Wright en avril 1827 pour fonder Symme’s Landing (Aylmer) qui deviendra le chef lieu de l’Outaouais. Quant à François Charron, il se voit dans l’obligation de renoncer à son terrain, sur lequel il avait déjà construit sa maison, en faveur de P. Wright and Sons, parce qu’incapable de payer son loyer. Pour toute compensation, il recevra de Wright la somme de 62 livres et 6 shillings. Le 12 mai 1829, Joseph Miville écrit à Ruggles Wright pour l’informer qu’il n’a plus besoin du bâtiment à l’embarcadère, car il « n’en retire aucun bénéfice ».
Le départ des pionniers du village de Hull entraînent, pour longtemps encore, la stagnation de la colonie de Philemon Wright. Cinquante ans après l’arrivée du « fondateur », Hull n’est encore qu’une petite bourgade d’au plus une centaine de personnes employées par les Wright, appelée Chaudières, Wrightstown et parfois Hull (Bytown – Ottawa - compte alors plus de 7 000 habitants). Un certain John J. Bigsby, qui visite le hameau en 1850, écrit qu’il est composé : d’une demi-douzaine de bonnes maisons et magasins, une jolie église épiscopale et plusieurs bâtiments secondaires....
Les Charron quittent le territoire actuel de Gatineau pour s’établir à Fort-Coulonge où Sophie Barbe donne naissance à son quatrième enfant, Louis Damase. Mais dès l’automne 1831, la famille Charron élit domicile à Montebello où elle fait baptiser ce dernier rejeton et y reste au moins jusqu’à la fin des années 1830. Au milieu des années 1840, les Charron s’installent sur les rives rocailleuses du lac McGregor où Sophie Barbe meurt en juillet 1852. Cinq ans plus tard, François Charron se remarie. Âgé de 57 ans, il épouse une jeunesse de 19 ans : Angélique Lepage. François Charron, qui semble avoir de la difficulté à s’établir définitivement, reste un temps dans les environs de Bouchette, en haute Gatineau, puis au début des années 1870, dans la basse ville d’Ottawa. En 1873, on le trouve à Angers et, en 1881, dans le canton de Gatineau.
Quand Angélique Lepage donne naissance à son dernier enfant qu’elle prénomme Malvina, elle a 47 ans et son mari, François Charron, 80 ans ! Bien que leur établissement à Hull ait été un échec, François Charron et Sophie Barbe Miville ont laissé une descendance parmi nous, car le couple a donné naissance à cinq enfants.
Sources :
BMS 2000.
Brousseau, Françine, Historique du nouvel emplacement du Musée national de l’Homme à Hull, Collection Mercure, Histoire no 38, Ottawa, 1984.
Gourlay, John L., History of the Ottawa Valley, s.l., 1896.
Lamoureux, Georgette, Bytown et ses pionniers canadiens-français 1826-1855, Ottawa, 1978.
Newton, Michael, « La maison Charron : symbole d’une vision contrariée » in Outaouais - Le Hull disparu, IHRO, 1987.
Recensement du Canada, 1881, canton de Gatineau, comté d’Ottawa, province de Québec.
Les marchands de glace de jadis
Jadis, la glace n’était pas un produit facile à produire et à conserver, particulièrement en milieu urbain. Dans l'Antiquité grecque et romaine, la neige prélevée sur les montagnes était entreposée dans des fosses et isolée par des matériaux végétaux. Elle restait ainsi durant des mois à l'abri de la chaleur et à la disposition des utilisateurs. On raconte qu'Alexandre le Grand faisait rafraîchir des tonneaux de vin dans des tranchées bourrées de neige afin de donner du cœur au ventre à ses soldats à la veille des batailles.
Le goût des boissons froides et des friandises glacées s'est répandu en Europe au moins dès le XVIe siècle. Aussi la vente de la neige et de la glace est-elle devenue une activité lucrative. Par ailleurs, on a fini par s'apercevoir que le froid favorisait la conservation des denrées alimentaires en enrayant la prolifération des organismes microscopiques. Le temps passant, on a eu de plus en plus recours à la réfrigération, même dans le grand commerce maritime.
Bien que le réfrigérateur électrique ait été inventé en 1913, les marchands de glace sont nombreux en Outaouais urbain jusqu’à la fin des années 1940. Les principaux marchands de glace étaient : Henri Lafrance et Ernest Dubuc à Val- Tétreau, Godin Frères de même que Hector Lafleur dans le Vieux Hull, Joseph Filiou, Lorenzo Tellier et Vipond à Wrightville, Miron à Pointe-Gatineau, etc. On récoltait la glace sur la rivière des Outaouais, sur les rives du parc Moussette et de baie des Paresseux (Squaw Bay), au lac Leamy et sur la rivière Gatineau.
Tétreau, Godin Frères de même que Hector Lafleur dans le Vieux Hull, Joseph Filiou, Lorenzo Tellier et Vipond à Wrightville, Miron à Pointe-Gatineau, etc. On récoltait la glace sur la rivière des Outaouais, sur les rives du parc Moussette et de baie des Paresseux (Squaw Bay), au lac Leamy et sur la rivière Gatineau.
Dès que la glace se formait sur le plan d’eau, les plus professionnels des marchands de glace préparaient leur produit naturel. Par exemple, les frères Godin, Aimé et Raoul, étaient fiers de dire qu’ils « font la glace » et pourtant ils la récoltaient au lac Leamy. Mais voilà, ils entretenaient leur « rond » soigneusement pendant de nombreuses semaines et n’y laissaient jamais la neige s’y accumuler. Si la pluie y laissait une couche de verglas, ils n’hésitaient pas à gratter la croûte friable jusqu’à la glace dure. Et pour la faire épaissir le plus rapidement possible et lui conserver sa limpidité, ils y perçaient des trous et faisaient monter l’eau par dessus.
Habituellement, la glace était prête à récolter peu après les Rois, c’est-à-dire avant la mi-janvier, quand elle avait atteint environ 35,5 centimètres d’épaisseur. Une dizaine de travailleurs, épaulés par trois ou quatre charretiers, prenaient une quinzaine de jours à la découper, la transporter et l’entreposer. Ce n’était pas un travail facile. On commençait l’opération à la barre du jour pour n’arrêter qu’à la brunante. Il faisait très froid sur les plans d’eau gelée et on devait parfois exécuter les travaux pendant des journées de grands vents et de tempêtes de neige.
La récolte de la glace
La glace était découpée au moyen de longues scies en blocs de 0,91 mètre de long, sur 35 centimètres d’épaisseur et 45 de largeur, qui pesaient plus de 200 kilogrammes. Un bon scieur de glace découpait environ 300 blocs par jour qui étaient ensuite poussés au moyen de longues perches jusqu’à une grue, actionnée par le va-et-vient d’un cheval, qui les soulevait et les déposait sur un traîneau tiré par deux chevaux. À partir des années 1930, la  glace sera sortie de l’eau au moyen d’un chargeur-élévateur mécanique, puis chargée sur un camion.
glace sera sortie de l’eau au moyen d’un chargeur-élévateur mécanique, puis chargée sur un camion.
Les vêtements de travail des hommes étaient alors bien différents des nôtres. Généralement faits de laine, ces vêtements imbibaient l’eau et devenaient lourds à porter. Il y avait danger de se couper ou de se faire écraser un pied. Les chevaux travaillaient tout aussi fort que les hommes et au péril de leur vie. Par exemple, dans les années 1940, le marchand Hector Lafleur en a perdu deux qui se sont noyés dans le lac Leamy pour avoir marché sur une glace trop mince.
La glace prélevée, des traîneaux en transportaient chacun une vingtaine de blocs jusqu’à la glacière. Outre leurs propres chevaux et traîneaux, les marchands de glace employaient des charretiers, avec chevaux et traîneaux, venant de la campagne environnante. Les plus assidus étaient les Benedict, de Hull, les Cardinal, de Clarence Creek et les Shouldice de Bourget. Ce transport de la glace, du plan d’eau aux glacières, était suivi de près par les enfants fascinés par le défilé des traîneaux pleins de glace. Montés sur le dernier rang des blocs de glace, jambes écartées, guides en mains, les charretiers dirigeaient les chevaux habilement décorés de clochettes et de fleurs en papier. Mais dès le début des années 1930, ces défilés se feront de plus en plus rares parce que les marchands de glace ont commencé à s’équiper de camions.
Les frères Godin avaient leur glacière rue Charlevoix, juste en face du parc Flora (aujourd’hui Fontaine), depuis 1925. Ils y entreposaient plus de 15 000 gros blocs qui y étaient hissés au moyen d’un palan et ensuite déposés sur un glissoir qui dirigeait les blocs à l’endroit voulu dans le vaste entrepôt. Quand la glacière était pleine, on étendait du bran de scie sur le dernier rang de glace ; certains marchands en étendaient entre chaque rang de blocs de glace.
 Le printemps arrivé, les marchands livraient la glace de porte en porte. Mais, avant la livraison, les gros blocs de glace étaient découpés à la hache, en petits blocs de 8 kilogrammes, par un « débiteur » adroit. Ces petits blocs seront vendus 0,05 dollar pendant les années 1930, et de 0,10 à 0,15 dollar au cours des années 1940.
Le printemps arrivé, les marchands livraient la glace de porte en porte. Mais, avant la livraison, les gros blocs de glace étaient découpés à la hache, en petits blocs de 8 kilogrammes, par un « débiteur » adroit. Ces petits blocs seront vendus 0,05 dollar pendant les années 1930, et de 0,10 à 0,15 dollar au cours des années 1940.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les réfrigérateurs, dont le prix d’achat a diminué, ont gagné rapidement en popularité de sorte que les marchands ont cessé leurs opérations les uns après les autres : les Godin en 1947 et les Lafleur en 1955. L’un des employés de Godin et frères, Emmanuel Émond, qui ne pouvait se résoudre à quitter le monde de la glace dans lequel il avait commencé à travailler en 1932, à l’âge de 14 ans, est devenu commerçant producteur de glace naturelle, puis artificielle. Dernier des marchands de glace de Hull, il a livré son ultime sac de glace en 1990.
Source :
Documentation personnelle.
Vous souvenez-vous du fameux roman et de la sériée télévisée historiques de Maurice Druon intitulés : Les Rois maudits ? Le roman a été construit autour d’une malédiction : « Pape Clément !... chevalier Guillaume !... Roi Philippe... Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment !... Maudits ! Maudits ! vous serez tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races !... »
Ces paroles (rapportées par le chroniqueur Geoffroy de Paris) ont été prononcées le 18 mars 1314, par le dernier Grand maître des Templiers, Jacques de Molay, supplicié sur le bûcher de l'îlot des juifs, à Paris. Quelques jours après son exécution, les toits du Palais Royal sont recouverts d'une véritable nuée de corbeaux comme un présage de malheur, un signe de deuil... Les nuits de Philippe le Bel en auraient apparemment été troublées jusqu'à sa mort !
Le 20 avril 1314, le pape Clément V succombait des suites d'une affection intestinale. Le 29 novembre suivant, c’est Philippe IV le Bel qui meurt à son tour quand il est jeté bas de son cheval au cours d’une chasse au sanglier[1]. Le mauvais sort s’acharne sur la famille régnante et les trois fils de Philippe le Bel – Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel – ne régneront en tout que pendant 14 ans et mourront sans descendance mâle, mettant ainsi fin au règne des Capétiens directs.
Il y a de nombreux exemples de malédiction familiale dont celle des Kennedy est sans doute la plus connue. La plus étonnante est probablement celle des Habsbourg qui commence avec François-Joseph 1er, empereur d'Autriche-Hongrie de 1848 à 1916. Nobles depuis 900 ans, les Habsbourg, occupaient le trône autrichien depuis 4 siècles. Mais François-Joseph conduira sa dynastie et l'empire austro-hongrois à leur perte définitive.
L’histoire du règne de François-Joseph a mal commencé avec des soulèvements dans le pays. Puis il épousera la très belle duchesse Élisabeth de Wittelsbach, surnommée affectueusement Sissi – cette histoire d’amour a été popularisée au cinéma par la très belle actrice austro-française Romy Schneider. Ce couple avait tout pour être heureux : l’amour, la beauté et l’argent. Malheureusement, elle est marquée par la malchance. Le couple impérial a un fils, Rodolphe, qui se marie à son tour. Mais Rodolphe n’a pas de garçon. Le 30 janvier 1889, on découvre son cadavre et celui d’une jeune baronne, Marie Vetsera, dans un pavillon de chasse de Mayerling. On a prétendu que le couple s’était suicidé. Aujourd’hui, plusieurs prétendent qu’il a été assassiné.
Comme François-Joseph n'a plus de descendance mâle, seules ses frères peuvent lui succéder. Malheureusement, Maximillien qui a tenté de se tailler un empire au Mexique y est fusillé en 1869 et son épouse, Charlotte, sombre peu après dans la folie. Son autre frère, Charles-Louis, deux fois veuf, a deux garçons. D'une grande piété, il insiste, au cours d'un voyage en Terre Sainte, pour boire de l'eau du Jourdain. Il attrape alors une infection intestnale et en meurt en peu de jours. La tragédie de la famille impériale n'est toutefois pas finie.
Sissi, contrairement à la légende fabriquée par le cinéma, était une femme à l'équilibre psychique précaire : elle souffrait de mélancolie, d'anorexie et de narcissisme pathologique. Pas étannant que sa bele-mère la surveillait de près. Le 10 septembre 1898, à Genève, Sissi est assassinée par l'arnarchiste italien Luccheni. L'année précédente, sa soeur avait péri dans l'incendie du Bazar de la Charité à Paris. Ajoutons qu'un cousin des deux soeurs, Louis II de Wittelsbach, roi de Bavière, était mort fou en 1886.
 C’est donc l’archiduc François-Ferdinand, neveu de l’empereur, qui devient alors l’héritier présomptif au trône de l’empire austro-hongrois. Mais en 1914, un étudiant serbe l’assassine, avec son épouse, à Sarajevo. Un mois plus tard, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. S’ensuit alors l’horrible carnage de la Grande Guerre. En 1916, l’empereur meurt. Son neveu, Charles, lui succède pendant une brève période de temps, jusqu’au moment où l’empire austro-hongrois s’effondre en 1918.
C’est donc l’archiduc François-Ferdinand, neveu de l’empereur, qui devient alors l’héritier présomptif au trône de l’empire austro-hongrois. Mais en 1914, un étudiant serbe l’assassine, avec son épouse, à Sarajevo. Un mois plus tard, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. S’ensuit alors l’horrible carnage de la Grande Guerre. En 1916, l’empereur meurt. Son neveu, Charles, lui succède pendant une brève période de temps, jusqu’au moment où l’empire austro-hongrois s’effondre en 1918.
La malédiction des Habsbourg est elle contagieuse ? Quoi qu’il en soit elle s’est propagée au-delà de la famille impériale. J'ai écrit plus haut que le rôle de Sissi a été tenu, au cinéma, par l’excellente Romy Schneider. Or, David, le fils de l’actrice, est mort accidentellement en 1981, à l’âge de 14 ans, empalé sur les piquets d’une clôture. Moins d’un an plus tard, le 29 mai 1982, l’actrice meurt à son tour ; elle n’avait que 43 ans.
Sources:
DRUON, Maurice, Les rois maudits, Le livre de poche, Paris, 1970.
Généalogie des Habsbourg et des Wittelsbach.
VENNER, Dominique, Le Siècle de 1914 - Utopies, guerres et révolutions en Europe au XXe siècle, Paris, Pygmalion, 2006.
Wikipédia.
[1] Contrairement à l’affirmation de Maurice Druon, le chevalier Guillaume de Nogaret n'est pas mort après l’exécution du Grand maître en 1314, qu'il avait fait arrêter en 1307, mais avant, en 1313.
Petite histoire du « Minuit, Chrétiens ! »
J’ai grandi dans une paroisse et une ville qui n’existent plus aujourd’hui : Notre-Dame-de-Grâce, à Hull. Dans les années 1950 et 1960, la messe de minuit était l’événement religieux de l’année. Il y avait là deux « messes de minuit » : celle chantée dans la grande église – il fallait acheter sa place quelques semaines avant la fête –, et celle chantée au sous-sol. En haut, un chœur formé uniquement d’hommes et en bas, un chœur d’enfants, tous des garçons du collège Notre-Dame des Frères des écoles chrétiennes.
Minuit moins cinq : les grandes orgues Casavant font entendre les premières notes. Puis le chœur entonne le Venez divin Messie. Mais tous attendent « l’heure solennelle », celle qui, au moment de l’entrée des célébrants (grand-messe diacre-sous-diacre) et des 70 ou 80 enfants de chœur, donne le coup d’envoi au chant religieux tant aimé : Minuit, Chrétiens ! Les fidèles sont pris d’un frisson qui secoue tant le corps que l’âme. Tous, sans exception, écoutent le chant comme des mélomanes. Et de fait, je pense qu’à ce moment, chacun était un mélomane.
Aucun chant religieux, je crois, n’a provoqué autant de débats dans l’histoire de l’Église catholique québécoise et autant de commentaires chez le commun des fidèles. Les paroissiens en parlent avant et après l’office religieux : avant, ils se demandent qui le chantera, s’il le chantera aussi bien ou aussi mal que l’année précédente ; après ils commentent la performance du soliste,  de l’organiste, du chœur de chant. Car, voyez-vous, le Minuit, Chrétiens ! est un moment magique dans toutes les églises de la francophonie. Et au Canada, il a été chanté pour la première fois le 25 décembre 1858, par la fille aînée du juge René-Édouard Caron (plus tard lieutenant-gouverneur) dans l’église de Sillery après que l’organiste Ernest Gagnon l’eut entendu à Paris l’année précédente. Le même jour (à la messe du jour), le chant sera repris par Madeleine Belleau dans l’église Saint-Jean-Baptiste à Québec.
de l’organiste, du chœur de chant. Car, voyez-vous, le Minuit, Chrétiens ! est un moment magique dans toutes les églises de la francophonie. Et au Canada, il a été chanté pour la première fois le 25 décembre 1858, par la fille aînée du juge René-Édouard Caron (plus tard lieutenant-gouverneur) dans l’église de Sillery après que l’organiste Ernest Gagnon l’eut entendu à Paris l’année précédente. Le même jour (à la messe du jour), le chant sera repris par Madeleine Belleau dans l’église Saint-Jean-Baptiste à Québec.
Ce chant religieux, si aimé du peuple, est banni de nombreuses églises du Québec dans les années 1930 et 1940 à la suite d’une campagne menée par le cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, archevêque de Québec, qui emboîtait le pas à des autorités ecclésiastiques françaises. On a dit que le Minuit, Chrétiens ! était un chant absolument infâme. À son mieux une « chanson païenne ». Les plus raffinés parmi les musiciens d’église (étaient-ils libres ?) jugeaient la pièce « théâtrale », de « mauvais goût », vulgaire même. Ainsi donc, on a arrêté de chanter le Minuit, Chrétiens ! à Notre-Dame-de-Grâce pendant des années, alors qu’à la campagne on faisait fi des sermons du cardinal Villeneuve.
Pourquoi ?
Pourquoi le Minuit, Chrétiens ! a-t-il soudainement été ostracisé par les autorités ecclésiastiques ? Pour en deviner les raisons, il faut remonter à l’origine du chant.
Le 3 décembre 1847, dans la diligence de Paris, entre Mâcon et Dijon, Placide Cappeau (1807-1877), négociant en vins et poète à ses heures, écrit les paroles d’un Noël, pour lesquelles il est fort loin de se douter un seul instant de l’immense succès qu’il obtiendra par la suite. C’est le curé de Roquemaure (Provence), l’abbé Eugène Nicolas, qui l’avait prié de composer ce chant dans le cadre des manifestations culturelles et religieuses qu’il voulait organiser afin de recueillir quelques oboles pour le financement des vitraux de la collégiale Saint-Jean-Baptiste. Placide Cappeau, alors âgé de 39 ans, ancien élève des jésuites au collège royal d’Avignon, après des études de droit à Paris était revenu s’installer dans son village natal afin de s’associer avec le maire, Guillaume Clerc, dans un commerce de vins.
La chanteuse Émily Laurey adresse les strophes de Minuit, Chrétiens ! au compositeur Adolphe Adam (1803-1856), qui est considéré comme l’un des créateurs de l’opéra-comique français. Adam en fait la musique en quelques jours et, le 24 décembre 1847, à la messe de minuit célébrée dans la petite église de Roquemaure, Emily Laurey chante pour la première fois le Noël d’Adam – le titre sous lequel le chant a d’abord été connu. (À noter que c’est une femme qui, la première, a chanté cet hymne religieux !)
Immédiatement célèbre, notamment grâce au baryton Jean-Baptiste Faure, ce chant de Noël échappe à l’auteur des paroles, qui ne parvient même pas, comme il le désira 20 ans plus tard, à changer le texte. Placide Cappeau, n’était en effet pas du tout un homme d’Église, un fervent catholique, mais au contraire un libre penseur, un voltairien. Au culte d’un Dieu, il préférait celui de l’Humanité. Il dira : « Nous avons cru devoir modifier ce qui nous avait échappé au premier moment sur le péché originel, auquel nous ne croyons pas... Nous admettons Jésus comme rédempteur, mais rédempteur des inégalités, des injustices et de l’esclavage et des oppressions de toute sorte... »
Un juif !
Adolphe Adam appelait le Minuit, Chrétiens ! la Marseillaise religieuse. Non seulement ce chant conquiert-il rapidement les églises de France, mais il est chanté dans les rues, dans les salons, et même dans les cafés-concerts !… 
Le Minuit, Chrétiens ! a été enregistré par nombre d’artistes dont Enrico Caruso, Tino Rossi, Georges Thill, Luciano Pavarotti, Raoul Jobin, Richard Verreau, Nana Mouskouri et… René Simard.
Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle,
Et de son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d'espérance,
A cette nuit qui lui donne un Sauveur.
Peuple, à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur...
Sources:
Bronze, Jean-Yves, Le Minuit, Chrétiens ! au Québec.
Gingras, Claude, Minuit, Chrétiens ! ou l’histoire d’un long ostracisme.
Souvenirs personnels.
Histoire du père Noël au Québec
Le Noël du Québec est passé presque inaperçu pendant longtemps. Tout au plus fréquentait-on la messe de minuit et confectionnait-on un petit réveillon savouré en famille.
Le Québec aura résisté longtemps au père Noël. Dans les années 1940, il y a encore une majorité de francophones qui donne ses cadeaux au jour de l’An, jour des étrennes. Au début du siècle, les parents donnaient des fruits aux enfants sages et des morceaux de charbon ou des pelures de patates à ceux qui n’avaient pas été gentils pendant l’année.
Ce sont les commerçants, les marchands qui finissent par imposer aux Canadiens francophones la fête de Noël, puis le Père Noël pour attirer dans leurs magasins la population. Ils poussent les parents à leur rendre visite avec leurs enfants pour y rencontrer le Père Noël. Alors que la société traditionnelle était axée vers les besoins, la nouvelle société est orientée vers le désir.
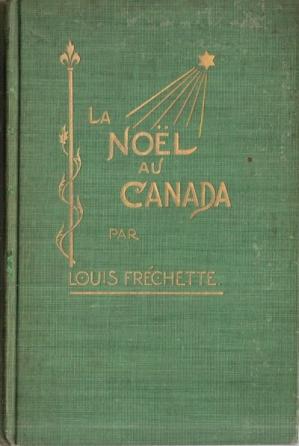 C’est ainsi que Noël supplante peu à peu le jour de l’An, et ce, au grand plaisir de l’Église catholique – dans un premier temps – qui voit enfin le jour de l’An, fête essentiellement païenne, détrôné par Noël, fête chrétienne. Le clergé n’avait toutefois pas prévu que le père Noël éclipserait le « p’tit Jésus » comme distributeur des cadeaux et que la consommation effrénée remplacerait l’aspect religieux de la fête qui l’emportera, et de loin, sur la principale fête religieuse : Pâques. Ainsi, plus on avance dans le XXe siècle du Québec, plus les symboles chrétiens s’effacent au profit d’une vision purement commerciale du temps des fêtes.
C’est ainsi que Noël supplante peu à peu le jour de l’An, et ce, au grand plaisir de l’Église catholique – dans un premier temps – qui voit enfin le jour de l’An, fête essentiellement païenne, détrôné par Noël, fête chrétienne. Le clergé n’avait toutefois pas prévu que le père Noël éclipserait le « p’tit Jésus » comme distributeur des cadeaux et que la consommation effrénée remplacerait l’aspect religieux de la fête qui l’emportera, et de loin, sur la principale fête religieuse : Pâques. Ainsi, plus on avance dans le XXe siècle du Québec, plus les symboles chrétiens s’effacent au profit d’une vision purement commerciale du temps des fêtes.
Dans Noël au Canada, publié en 1900 par Louis Fréchette, Santa Claus est celui qui, sa hotte pleine de jouets, fait la tournée des maisons et exauce les vœux des enfants sages. De fait, Santa Claus s’impose dans la publicité montréalaise vers 1890-1900.
Ceux et celles qui résistent à l’invasion du Québec par Santa Claus font flèche de tout bois, parce que non seulement le bonhomme a conquis les vitrines des magasins et les affiches des marchands, mais aussi parce qu’il a commencé à pénétrer dans les maisons des catholiques pour y détrôner, dans le cœur des enfants, le petit Jésus. Ainsi, certains n’hésitent-ils pas à diaboliser Santa Claus. Par exemple, un certain abbé Dugas accuse Santa Claus de détourner l’esprit des enfants « des belles crèches de l’Enfant Jésus » et, en général, de trahir le recueillement spirituel et familial des fêtes.
Plus encore, au cours de la guerre de 1914-1918, on monte une campagne de dénigrement à l’encontre de ce « prince de la camelote teutonne », de ce fantoche « made in Germany ». Il a donc fallu rebaptiser Santa Claus et c’est « saint Nicolas », puis le « bonhomme Noël » et enfin le « père Noël » qui gagnera le cœur des francophones.
Nombreux sont ceux qui s’attaquent non seulement à Santa Claus, mais aussi à l’esprit commercial de Noël en faisant savoir que cette fête encourage la célébration d’au moins trois des sept péchés capitaux de la tradition catholique : l’avarice, la gourmandise et l’envie.
Il n’y a pas que les francophones qui résistent à Noël, de nombreux anglophones s’insurgent aussi contre la commercialisation de cette fête. Par exemple, des journaux anglophones de Montréal n’hésitent pas, en 1910, à qualifier Noël de hold-up annuel. Pour eux, Santa Claus est un ogre insatiable.
Quoi qu’il en soit, dans les années 1950 Noël supplantera définitivement le jour de l’An comme journée de remise des étrennes ou cadeaux, et le Père Noël remplacera sans appel le « petit Jésus » comme distributeur de ces cadeaux.
Sources :
Warren, Jean-Philippe, Hourra pour Santa Claus, Montréal, Boréal, 2006.
Site Internet Notre famille.com.
Documentation personnelle